|

"Il y a quelque chose de merveilleusement doux dans cette
étude de la Nature qui attache un nom à tous les êtres, une pensée à tous les
noms, une affection et des souvenirs à toutes les pensées et l'homme qui n'a pas
pénétré dans la grâce de ces mystères a peut-être manqué d'un sens pour goûter
la Vie."
Charles Nodier.
Ch. Nodier, 1780 - 1844 : Poète,
romancier, bibliophile, grammairien, académicien et entomologiste...
www.academie-francaise.fr/les-immortels/charles-nodier
Les petits pots :
Il y a quelques années, je rendais visite à mon ami
entomologiste et grand chasseur d'insectes, Michel Ferrand, alors instituteur
dans un village de Guyane près de Maripasoula.
Nous partions chaque jour poser différents pièges dans une des toutes dernières
forêts primaires de la planète, aux environs de Wakapou. Il s'agissait de
capturer des insectes essentiellement coprophages.
L'année précédente, lors d'une expédition aux îles Célèbes, je voyageais sous la
canopée avec un troupeau de babiroussas, ce qui me permettait d'avoir en
permanence des excréments frais pour alimenter mes pièges.
Cependant, en Guyane, mon ami Michel avait dû organiser une collecte journalière
de matière fécale auprès des villages indiens environnants. Les métropolitains
de la station météo s'étaient également portés volontaires pour déféquer dans
des petits pots.
Nous disposions ainsi d'une grande quantité d'appâts pour nos chasses.
Comme chaque matin, à deux sur la moto de Michel, nous étions lancés à vive
allure sur la grande piste de latérite. A l'arrière de la moto, chargé d'un
lourd sac à dos rempli de petits pots, je me suis tout à coup assoupi à cause de
la fatigue accumulée et d'un accès de dengue. Comme je basculai en arrière, mes
deux bottes sont venues frapper Michel en plein sous les aisselles et la moto
s'est cabrée.
Après une "roue arrière" tout à fait prodigieuse, digne d'un Grand Prix, nous
nous sommes vautrés pêle-mêle dans le fossé. N'étant pas nous-mêmes
particulièrement coprophages nous avons gardé de cet incident un souvenir
mémorable.
Marc Soula
Megasoma :
"Ce coléoptère a un vol très puissant et j'en ai su quelque
chose un jour où je chassais à la lumière; j'ai été presque étourdi comme par un
coup de poing en plein front; c'était un gros
Megasoma acteon mâle qui, attiré
par la lumière, était venu se jeter sur mon visage. J'en ai eu une grosse bosse
pendant quelques jours. C'est le seul exemplaire que j'ai capturé
personnellement. J'en ai bien eu une série de mâles et de femelles, mais qui
m'ont été apportés par des forçats-bûcherons."
(Tiré de l'excellent "Mes chasses aux papillons" du grand Le Moult).
Une rencontre sympa :
 "Samedi 21 Octobre 1989 -11h00- Je pars en forêt en compagnie
d'un chien errant (appartenant sans doute à quelque ouvrier du chantier - du
barrage de Petit Saut, sur la Sinnamary; Guyane française -); l'animal me colle
aux basques, attentif et déjà fidèle; je suis posé sur une souche, près de la
rivière, Médor à mes pieds, lorsqu'une intense vibration envahit l'air humide -
trop fort pour un bourdon, pas assez pour un hélicoptère - ; à un mètre juste au
dessus de mon sac, un colibri intrigué m'offre son vol stationnaire (j'ai
entendu dire que les colibris sont attirés par le rose; c'est exact !); ses
ailes à une vitesse telle qu'on ne les voit pas; il hésite encore un instant
puis disparaît entre les arbres; plus tard, mon copain canin se levant d'un
bond, hume l'air avec frénésie, tournant en tous sens autour de moi, l'oreille
dressée et l'œil inquiet; "mais que…?" (me dis-je) lorsque, brusquement, je suis
suffoqué par une terrible odeur de ménagerie : l'odeur puissante des fauves du
Zoo de Vincennes (odeur / fauve / Amazonie = jaguar !); Médor est déjà à vingt
mètres, sur le chemin du retour; je remballe en vrac mes outils et file sur sa
trace en 5 secondes chrono, sans demander mon reste; je cours ainsi, l'air
ridicule, mon aquarelle entamée dégoulinant au bout de mes doigts, jusqu'au camp
où le chien disparaît comme il était venu." "Samedi 21 Octobre 1989 -11h00- Je pars en forêt en compagnie
d'un chien errant (appartenant sans doute à quelque ouvrier du chantier - du
barrage de Petit Saut, sur la Sinnamary; Guyane française -); l'animal me colle
aux basques, attentif et déjà fidèle; je suis posé sur une souche, près de la
rivière, Médor à mes pieds, lorsqu'une intense vibration envahit l'air humide -
trop fort pour un bourdon, pas assez pour un hélicoptère - ; à un mètre juste au
dessus de mon sac, un colibri intrigué m'offre son vol stationnaire (j'ai
entendu dire que les colibris sont attirés par le rose; c'est exact !); ses
ailes à une vitesse telle qu'on ne les voit pas; il hésite encore un instant
puis disparaît entre les arbres; plus tard, mon copain canin se levant d'un
bond, hume l'air avec frénésie, tournant en tous sens autour de moi, l'oreille
dressée et l'œil inquiet; "mais que…?" (me dis-je) lorsque, brusquement, je suis
suffoqué par une terrible odeur de ménagerie : l'odeur puissante des fauves du
Zoo de Vincennes (odeur / fauve / Amazonie = jaguar !); Médor est déjà à vingt
mètres, sur le chemin du retour; je remballe en vrac mes outils et file sur sa
trace en 5 secondes chrono, sans demander mon reste; je cours ainsi, l'air
ridicule, mon aquarelle entamée dégoulinant au bout de mes doigts, jusqu'au camp
où le chien disparaît comme il était venu."
(Du remarquable "La Croisière Verte - Mission Radeau des Cimes" de TRIPP)
Safari dans la bouse :
"Lorsque les petits bergers berbères m'ont vu, dans la
campagne proche de Rabat, couché à plat ventre, en train d'observer les
scarabées sacrés qui roulaient leur boule de crottin, leur opinion sur mon
compte a été plutôt péjorative:
- Tu vois, le chrétien, il mange de la merde…
(…). La même chose m'est arrivée dans nos prairies normandes. Toujours à plat
ventre mais cette fois devant une bouse de vache énorme, juteuse, à l'endroit
exact où elle attire les scarabées coprophages qui m'intéressaient à ce moment
là. Mes scarabées se trouvaient bien au rendez-vous et je tentais de les déloger
en touillant la matière avec une paire de pinces. Survint un vieil indigène qui
se montra poliment surpris de voir un monsieur d'un certain âge dans cette
posture pour le moins surprenante. Il me demanda ce que je fabriquais et quand
je lui appris que j'étais professeur et donc payé par l'Etat pour remuer la
bouse, il eut du mal à contenir son indignation et déplora que les impôts
servent à ce genre d'exercice."
(De "Une étrange Passion - Une vie pour les Insectes" de l'illustre Rémy
Chauvin).
 Digression entomologique : Digression entomologique :
"Un matin où je
grimpais dans la canopée (méthode "spéléo"…), au Pérou, ma corde se
détacha et je tombais brusquement de quelques centimètres en
tournoyant sur place. De la terre et des brindilles me tombèrent
dans les yeux, m'aveuglant. J'avais les mains encombrées de matériel
et, pour me stabiliser, je saisis avec les jambes une haute branche
sur le côté - j'écrasais alors, bien malgré moi, un jardin
d'épiphytes qui recouvrait une fourmilière protégée. Les ouvrières
se glissèrent le long de mes jambes et se jetèrent sur moi telles
des kamikazes -
Camponotus femoratus - réussis-je à penser tandis
qu'elles m'entaillaient la peau de leurs mandibules et déversaient
de l'acide formique dans mes écorchures; dure entrée en matière pour
mon premier contact avec un jardin de fourmis !"
"(…). Je suis surpris de voir combien de personnes (y compris celles
qui manifestent une passion pour les scarabées) ne voient pas en eux
des êtres vivants mais des objets d'art à épingler dans une boîte
sans y penser. L'opinion de ces aficionados pourrait changer s'ils
rencontraient un Goliath géant d'Afrique ou un Hercule d'Amérique;
certains de ces géants sont aussi gros que des oiseaux-chanteurs.
Leur vol vous casse les oreilles comme celui d'un avion à réaction.
Ils s'adaptent superbement à la canopée et déguerpissent dans les
arbres sur de longues pattes. Lorsqu'on les attrape, ils s'agrippent
obstinément. Il faut parfois se mettre à deux pour détacher du bras
d'un troisième les six pattes à double pince d'un Hercule.
J'ai capturé un mâle de cette famille de Coléoptères lors de mon
premier voyage sous les tropiques, à l'âge de dix-sept ans. Il
avalait chaque jour un gros morceau de banane et m'empêchait de
dormir, la nuit, par sa bruyante respiration. Il ne ratait pas une
occasion de me montrer qu'il était vivant ! "
(De l'excellent "Le Monde des Cimes - Exploration de la canopée
tropicale" de Mark Moffett)
Pique et pique et choléra !
:
Folles sont mes pensées envers toi, et brûlant mon désir de
te serrer dans ma main, avec une soif de plaisir incontrôlable pour ce que tu
m'as fait. La nuit était chaude et calme, et j'étais dans mon lit quand,
subrepticement, tu t'es approché. Tu as frôlé mon corps nu avec ton corps, sans
la moindre pudeur. Remarquant mon apparente indifférence, tu t'es pressé contre
moi et tu m'as mordu sans scrupule jusqu'à mes plus intimes recoins. Je me suis
endormi. Quand je me suis réveillé, je t'ai cherché avec une ardente avidité,
mais en vain. Tu avais laissé sur mon corps et dans les draps des preuves
irréfutables de ce qui s'était passé entre nous cette nuit-là.
Cette nuit, je me coucherai plut tôt pour t'attendre dans ce même lit. Quand tu
arriveras, je veux t'étreindre avec fougue et impatience. Je veux te serrer avec
toute la force de mes mains. Il n'y aura pas un millimètre de ton corps que mes
doigts ne toucheront pas. Je n'aurai de répit que lorsque je verrai le sang
chaud couler de ton corps. Ce n'est que comme cela que je t'éclaterai la gueule
!!! Saloperie de moustique !!!
(C'est un peu "lourd", j'en conviens… ).
Vive la Systématique !
"Même des recherches ne portant que sur des groupes bien déterminés de
végétaux ou d'animaux ont apporté de précieuses informations. Ce ne sont parfois
que les pièces d'un puzzle au niveau de l'ensemble des êtres vivants. Mais peu à
peu, chacun se met à sa vraie place dans un schéma général. La Systématique a
certes un rôle immédiat en qualifiant un être comme un mot le fait d'un objet.
Elle a surtout pour but de reconstituer la phylogenèse et l'ordre des parentés
tel qui résulte de l'évolution.
La Systématique a même des applications
pratiques. Des espèces très voisines, que ne peuvent distinguer que des
spécialistes avertis, ont parfois des rôles bien différents dans les
écosystèmes, mais aussi comme réservoirs ou vecteurs spécifiques de germes
pathogènes ou de parasites, comme ravageurs des cultures.
(…).La
Systématique conserve ainsi une place éminente. Ceux qui la pratiquent ne sont
pas de simples collectionneurs réfugiés derrière des boîtes encombrées de
cadavres piqués sur des épingles.
Une collection d'histoire naturelle
n'est pas une collection de
timbres-poste (mon propos n'est en rien péjoratif,
car je suis moi-même philatéliste). En dépit de ses détracteurs, la Systématique
restera jusqu'à la fin des temps une des disciplines fondamentales de la
Biologie."
(De "Et si on parlait un peu de la Vie" de l'éminent Jean
Dorst, ancien
Directeur du MNHN).
Un industriel allemand
consacre sa vie à épingler 2 millions de coléoptères :
UNE FABULEUSE COLLECTION QUE SE DISPUTENT BÂLE ET
MUNICH :
"Un coléoptère est mille fois plus sympathique qu'une mouche" plaide Michel
Brancucci, chef du Département d'Entomologie au Muséum de Bâle, ardent supporter
de la Collection Frey ("l'Empereur" du Loden). Intarissable sur les Coléoptères,
il souligne leur intérêt scientifique : ils sont remarquables par la diversité
des espèces qu'ils regroupent (400 000 pour l'instant…) et par l'habileté avec
laquelle, ils ont su s'adapter à toutes sortes de milieux naturels.
Frey a fait mieux que les autres amateurs. Avec plus de deux millions d'insectes
épinglés, il a constitué la plus grosse collection privée. Sa passion l'a pris
dès le collège et sa veuve raconte que ses premières boîtes emplissaient les
armoires conjugales. A 26 ans, il s'est voué presque entièrement aux insectes,
rachetant pas moins de 42 collections, partant autour du monde armé d'un
"parapluie japonais" qui sert à recueillir les insectes perchés sur des
branches; Barbara, sa femme, l'accompagnait souvent dans ses voyages et se
souvient qu'il faisait sécher ses proies dans les tiroirs des chambres de
palace, aux grand dam des femmes de ménage. Frey avait d'ailleurs établi un
classement bien particulier des palaces de par le monde. Méritaient cinq étoiles
ceux dont l'éclairage extérieur attirait les coléoptères. Un critère qui, après
tout, en vaut bien un autre.
Lorsque la maison familiale de Tuzzing, en Bavière, a été trop envahie, Frey a
fait construire au beau milieu de la propriété un musée pour abriter les 6500
cadres contenant les chères bestioles. Il a dû engager des savants pour l'aider
à déterminer et à classer les spécimens. Totalement autodidacte en la matière,
il a reçu de l'Université de Munich le titre de docteur honoris causa. Il était
en correspondance avec les entomologistes du monde entier et les spécialistes se
pressaient dans son musée qui renfermait 20 000 "types", les individus qui
permettent de définir une espèce.
(Tiré d'un article de "l'Hebdo" du 12 Novembre 1987)
Conflit germano-suisse :
"Bâle hérite de 2 millions de scarabées".
Les Bâlois bourdonnent : après dix années de querelles juridiques, le
Musée d'Histoire Naturelle de Bâle s'enrichit de la plus grande collection
privée de coléoptères (du moment...).
Une précieuse cargaison a franchi, vendredi matin (24 octobre 1997...), la
frontière germano-suisse à Bâle à bord de trois camions. Il s'agit de la
collection privée de Georg Frey, un millionnaire bavarois, qui au terme d'un
feuilleton juridique de 10 ans est devenue la propriété de ce musée.
fabricant de lodens à Munich, G. Frey a voué un véritable culte aux coléoptères.
durant 50 ans, il collectionne toutes les petites bêtes à six pattes portant une
carapace qui lui tombent sous la main, se livrant, ainsi, à un travail de fourmi
(ndlr : il n'a pas seulement "bêtement" collectionné, mais aussi beaucoup
travaillé sur ses bêtes et décrit de nombreuses espèces nouvelles...). Pour
assouvir sa passion, il finance 40 expéditions, des Andes aux steppes de l'Asie
en passant par l'Himalaya. Et pour compléter son impressionnante galerie, il
rachète 65 collections privées pour faire de la sienne la plus grande du monde.
A sa mort, en 1976, la collection soigneusement répertoriée par G. Frey est
rangée dans le grenier de sa villa à Tutzing. Dix ans plus tard, Michel
Brancussi, le responsable du service d'Entomologie du Muséum de Bâle, la tire de
l'oubli en demandant à Barbara Frey, la veuve du collectionneur, de lui faire
une offre de vente. La collection est estimée à 2,3 millions de DM (7,7 millions
de francs).
Pour rassembler les fonds nécessaires, M. Brancussi crée l'association "Käfer für
Basel" (scarabées pour Bâle) qui fait appel aux mécènes et à la générosité des
Bälois [ ... ].
La vente de la Collection Frey échoue car le Muséum de Munich la fait inscrire
sur la liste des "biens culturels allemands", empêchant ainsi un départ en
Suisse. L'association bâloise porte plainte. En vain.
Touchée par l'enthousiasme de ces Bâlois pour ses "Käfer", Barbara Frey décide
de braver les autorité allemandes : elle conclut, en 1987, un contrat de
location sur 30 ans avec l'Association bâloise dont elle fait l'héritière de la
collection. A sa mort, en 1992, le "bien culturel allemand" est transféré de
Tutzing au Muséum de Munich.
Les "héritiers bâlois" réclament leur bien. Un tribunal de Munich confirme, en
1994, la validité du testament. Mais la bataille juridique se poursuit.
Finalement, le jugement est définitivement confirmé en mai 1995 par la Cour
Constitutionnelle de Karlsruhe, l'instance suprême de la justice allemande. La
collection, déclarée propriété légale de l'Association "Käfer für Basel",
demeure cependant "bien culturel allemand" et reste de ce fait bloquée en
Allemagne. [ ...].
En attendant l'autorisation spéciale de sortie du ministère fédéral de
l'intérieur, les 3 millions de scarabées sont entreposés, en juillet 95, au
grenier du Museum am Lindenplatz de Weil-am-Rhein, la banlieue allemande de
Bâle. Bonn a finalement délivré l'autorisation de sortie, le 1er octobre
dernier, en se référant à "la bonne réputation de Bâle".
("Le pays" du dimanche 26 octobre 1997)
Les bizarreries de la Nomenclature :
"Et, feuilletant les Faunes, l'on
tombe de temps en temps sur un
scutellohumeroconjunctobasimaculata ou sur un
nigrohumeraliscutellohumeroconjuncta qui témoignent d'une volonté d'accorder à
tout prix aux désignations une forte valeur sémantique. Ces noms ne sont
dépassés en longueur que de trois ou quatre lettres par la caricature qu'en
donne Isidore de Gosse dans un pamphlet : tel naturaliste est censé rebaptisé la
carotte Micromacroglucoxanthoerythroleucorhyzos pour la raison que ce légume est
petit ou gros, jaune ou rouge, et sucré : avec un tel nom, "pas moyen de ne pas
le reconnaître !".
(Emprunté à "Des animaux et des Hommes" de notre ami Yves Delaporte)
Le plus long taxon connu est Brachyta interrogationis interrogationis var.
nigrohumeralisscutellohumeroconjuncta Plavilstshikov, 1936.
On rencontre aussi :
cancelloidokytodermogammarus (Loveninsuskytodermogammarus)
loveni
Dybowski,
Leonardo davincii, La cucaracha, et La paloma Bleszynski
Aha ha
Menke, 1977, pour se moquer d'un autre groupe de recherche après un conflit
sur la détermination de l'espèce ...
Brachinus aabaaba, 1970, Agra vation, 1983, Agra cadabra, 1986
et Agra schwarzeneggeri Erwin, 2002,
Ytu brutus
Spangler, 1980
Colon rectum
Hatch
Cartwrightia cartwrighti Cartwright, on est jamais aussi bien servi
que par soi-même !
Panama canalia Marsh
Chaos chaos
Linné, 1758
Zyyyzzyx Pate
Zyzzyxdonta Solem
Zyzzuva et
Ababa Casey
Mamma Moersch
Papa Reichenbach
Paratype
Felder
Cannabis Blyth
Les blancbonneti et
bonnetblanci
Rigout
de notre cher éditeur,
et aussi :
Discodon petaini
Cryptocephalus petaini
Cryptocephalus lavali
Lema darlani...
et les célèbres :
Anophtalmus hitleri Schreibel et
Rôchlingia hitleri Gûthorl !
Art (de la promotion) et insectes :
Pour l’éternité Roy Orbison (1936-1988) survit dans Orectochilus orbisonorum
(Col. Gyrinidé). C’est Quentin Wheeler – directeur de l’International Institute
for Species Exploration (université de l’Arizona, États-Unis) - qui a nommé ce
gyrin indien en l’honneur du “plus grand chanteur du monde” (dixit Elvis
Presley). Pour sa production lexicale, Q. Wheeler est bien connu, y compris de
nos services : je l’ai épinglé en 2005 pour avoir créé, pour 3 silphes nouveaux
pour la science, les noms d’espèce bushi, cheneyi, rumsfeldi. L’annonce a
été faite lors d’un concert commémoratif, le 25 janvier 2008 ; Q. Wheeler y a
en outre présenté
Whirligig, infographie signée Charles J. Kazilek, « œuvre d’art entre
Warhol et Darwin ».
Grand-Croix de
l’ordre des Coléoptères :
De nombreux insectes portent une croix, les Coléoptères en général
sur leurs élytres et pas mal d’entre eux ont été nommés d’après cet ornement.
Passons sur les crucifera, crucigera, crucicollis, cruciatus, crucialis…
où se reconnaît le radical crux, croix en latin, pour pointer les purs, ceux qui
s’appellent crux.
Parmi les exemples de Coléoptères crucifères, vient évidemment en premier
Cryptocephalus crux crux (Chrysomelidé), d’un très vaste genre de
traîne-logette. Sans vouloir (ni pouvoir) dresser une liste complète, voici,
choisis dans les meilleures familles quelques croisés : le Curculionidé
Curculio crux, le Brentidé Higonius crux, le Cérambycidé
Pedestredorcadion crux, le Coccinellidé Verania crux. Croix noire,
croix jaune : Deuterocampta crux nigra, Ctenochira crux-flava
(Chrysomélidés). Petite croix : le Carabidé Lebia cruxminor, connu pour
ses particularités – imaginal, il est floricole et pollinivore ; larvaire, il
subit une hypermétamorphose à l’instar des Méloïdés.
Mais c’est un Panagée (Carabidé Harpaliné) qui porte une grande croix :
Panagaeus cruxmajor (alias crux-major, alias crux major) ;
pourtant, sa croix est plus ou moins évidente selon les spécimens. C’est une
espèce peu commune, protégée en Ile-de-France, qu’on peut rencontrer au
printemps et à l’automne sous les pierres dans les prés humides, près des
rivières. En Grande-Bretagne, où il se nomme crucifix groundbeetle, il
était autrefois très commun. On a bien failli mettre une croix dessus, jusqu’à
un petit miracle : sa redécouverte toute récente à Wicken Fen, une réserve de
nature au Cambridgeshire – où il n’avait pas été vu depuis 1951.
 La Cantharide : La Cantharide :
"Le coléoptère le plus utilisé en médecine, jusqu'à une date récente, est la
cantharide ou "Mouche de Milan" qui était naguère le type des coléoptères
vésicants :
"Ces insectes jouissent d'une faculté particulière, celle de produire sur la
peau la formation de vésicules remplies de liquide séreux. La science médicale
utilise souvent avec bonheur cette vertu inflammatoire et attractive pour
rétablir notre santé altérée." (Mulsant)
Mais elle passait aussi pour un puissant aphrodisiaque. Les "dragées d'Hercule"
et autres préparations, contenant de petites quantités de poudre de cantharides
mêlée à du chocolat ou du sucre, étaient absorbées par les hommes qui voulaient
renforcer leur virilité :
"L'ingestion de cette poudre détermine des émissions d'urines sanglantes et une
grande irritation des organes génitaux, avec priapisme opiniâtre et souvent
délire vénérien insatiable ! Aussi cette poudre est fréquemment entrée dans des
préparations, comme pastilles, opiats..., destinées à assouvir la lubricité."
Quoi qu'il en soit, sa réputation d'aphrodisiaque est surfaite et dangereuse.
Son action principale est d'irriter l'urètre, ce qui peut en effet provoquer une
forte érection et un gonflement du gland, par une excitation réflexe dont le
point de départ se trouve dans les muqueuses urinaires enflammées.(....).
Parfois, si la dose absorbée est trop forte, des accidents mortels peuvent se
produire. Ces phénomènes sont provoqués par un alcaloïde très puissant, la
cantharidine, dont 50 à 100mg suffisent à provoquer la mort par un choc
hémorragique."
(D'après l'excellent et très documenté "Le Scarabée et les Dieux" de notre
collègue et ami
Yves Cambefort).
La passion peut sauver :
 "Incarcéré sous le Directoire et compris dans un groupe de
condamnés à la déportation en Guyane, celui qui allait devenir "le Prince des
Entomologistes", Latreille, trompait son ennui en étudiant un petit coléoptère
bleuté qui lui était inconnu et qui vivait en abondance dans les locaux
pénitentiaires où il consommait les asticots multipliés par une hygiène
lamentable. "Incarcéré sous le Directoire et compris dans un groupe de
condamnés à la déportation en Guyane, celui qui allait devenir "le Prince des
Entomologistes", Latreille, trompait son ennui en étudiant un petit coléoptère
bleuté qui lui était inconnu et qui vivait en abondance dans les locaux
pénitentiaires où il consommait les asticots multipliés par une hygiène
lamentable.
Cette attention apportée à un chétif insecte, dans ces conditions,
frappa l'un des geôliers qui s'en ouvrit à des personnalités bordelaises
importantes. Celles-ci s'émurent et obtinrent la libération de Latreille, au
moment où ses compagnons de captivité s'embarquaient pour un voyage vers les
Amériques qui se termina quelque part dans l'Atlantique. Revenu à ses études,
Latreille reconnut le rôle de l'Insecte en le baptisant Necrobia - la Vie dans
la Mort."
(Du très intéressant "Les Coléoptères à la conquête de la Terre" de l'éminent
Renaud Paulian - chez BOUBEE).
Miam-miam :
"Les civilisations au stade de la cueillette ont certainement
toutes fait une large place à la consommation de larves et d'adultes de
Coléoptères : Scarabéides, Lucanides, Cérambycides, Buprestides et Curculionides
ont ainsi contribué à nourrir les hommes un peu partout; au Mexique et à
Madagascar, des coléoptères aquatiques sont aussi consommés.
Une grosse larve de Scarabéide représente une aubaine intéressante, et dans
beaucoup de populations tropicales et rurales, les enfants complètent leur
alimentation par la capture de telles proies. Outre leur valeur énergétique, non
négligeable, les larves de coléoptères ont une teneur élevée en vitamines, dont
l'importance est grande pour les peuples tropicaux.
Cet usage diffus est très généralement attesté, mais il y a peu de coléoptères
qui soient l'objet d'une exploitation systématique accompagnée d'une
commercialisation, comme cela se produit pour…"
(Voir le très bon livre cité précédemment).
Une anecdote pour les
amoureux de l'Amazone (dont je fais
partie…!) :
"- Nao fassa isso !… la pression est tombée, accoste !…
Les machines s'immobilisèrent. Entraînés par le courant violent, nous reculions
sous les acclamations délirantes de ce public bariolé (ndlr : Arrayal da
Conceicao), heureux d'assister à une réjouissance aussi rare.
 Quelques caïmans dormaient, les mandibules en angle droit, sur un banc de sable
chaud de la rive opposée. Pris de panique par l'arrivée inopportune de l'arrière
du navire, ils cherchèrent un refuge au fond de la rivière. Quelques caïmans dormaient, les mandibules en angle droit, sur un banc de sable
chaud de la rive opposée. Pris de panique par l'arrivée inopportune de l'arrière
du navire, ils cherchèrent un refuge au fond de la rivière.
Le gouvernail creusa un profond sillon dans ce sable d'or, et sa tôle, formant
charnière, se tordit comme une mince feuille de papier, pendant que l'avant
tournait dans le sens du courant.
En travers du fleuve (ndlr : l'Iça), le bateau dérivait lentement et les échos
atténués de la population en liesse nous apportaient encore des : Bravo !
Antonio !
Une demi-heure après, par une marche en crabe grâce au gouvernail faussé, nous
abordions enfin.
Noble et digne, l'homme de barre hurla dans le porte-voix de la machine,
l'ultime manœuvre :
- Stop !…
A l'avant, le cuisinier, devenu maître de manœuvre, lança à une main
bienveillante un filin trop court qui retomba à l'eau.
Le capitaine Antonio en avait vu d'autres depuis qu'il commandait le
Marquez-de-Chavez. Sans se démonter, il lança ce nouveau commandement :
- Un peu plus vite que stop !…"
(De "5 000 km EN AMAZONIE", par Roger Courteville, chez Flammarion).
Beuuuuh ... :
"La peau du serpent, d'un bon mètre de largeur, fascine mon attention. Je
cherche à me représenter l'importance du monstre de son vivant. N'ai-je pas déjà
lu, dans une revue de Rio, qu'un fazendeiro de l'Etat de Céara, parti à cheval
de sa ferme, fut attaqué dans un bois par l'un de ces reptiles enroulé à un
arbre ?
Le cheval, pris de peur, désarçonna le malheureux cavalier déjà entouré par les
anneaux. Son personnel tua la bête quelques jours plus tard. Au milieu de la
bouillie sanglante contenue dans l'estomac, on retrouva bottes et éperons avec
30 contos de reis que le défunt avait enfermés dans une blague en caoutchouc.
Intuition ou divination; le latex est le seul produit résistant à l'action
destructrice de la paroi stomacale…"
(Du même "5 000 km EN AMAZONIE", par Roger Courteville, chez Flammarion).
"Scarabiasis" ou "canthariasis" :
"On a signalé plusieurs cas où des coléoptères, ayant pénétré dans les orifices
du corps humain, avaient produit divers dommages. Un exemple célèbre et
dramatique est celui du capitaine Speke, le célèbre explorateur de l'Afrique
Orientale qui découvrit le lac Victoria : un "scarabée" ayant pénétré dans son
oreille avait failli le rendre fou de douleur; les blessures qu'il s'était
faites avec un canif pour tenter de l'extraire mirent plusieurs mois à guérir.
On connaît aussi plusieurs cas de pénétrations dans le nez...
Mais le plus souvent, c'est par l'anus ou le vagin qu'a lieu la pénétration. La
médecine légale connaît ces phénomènes sous le nom de "scarabiasis" lorsque le
coléoptère en cause est un scarabéide (Onthophagus ou Caccobius) ou de "canthariasis"
lorsqu'il appartient à un autre groupe (Tenebrio, Blaps, etc).
De nos jours, scarabiasis ou canthariasis n'ont été signalés que rarement sur
des personnes vivantes, en particulier en Inde et à Ceylan. Ils étaient sans
doute beaucoup plus fréquents autrefois, quand une hygiène défectueuse les
favorisait : Au XVII siècle, Aldrovandi signale "l'accouchement" d'un "scarabée"
par une femme; c'était sans doute la simple expulsion d'un insecte ayant pénétré
de lui-même dans l'anus ou le vagin. Vers la même époque, le médecin anglais
Mouffet rapporte l'évacuation "postérieure" (downward...), par une vieille
femme, d'un grand coléoptère noir tout vivant; il s'agissait probablement d'un
Blaps et donc d'un cas de canthariasis..."
(D'après l'excellent et très documenté "Le Scarabée et les Dieux" de notre
collègue et ami Yves Cambefort - MNHN).
Il pisse des coléos :
Un indien de 13 ans a uriné...des coléoptères ! Le jeune garçon avait en effet
abrité dans son corps des œufs qui ont produit dans ses urines des insectes
ailés et longs de plus d'un demi-centimètre, a déclaré un responsable de la
Santé Publique de L'Etat du Bengale-Occidental; le Dr. Maity a expliqué que
l'enfant se plaignait de douleurs dans la région de l'aine en urinant...
(France Soir du 18/VI/2003)
L'invasion :
Juin 1985 : la presse locale répand la nouvelle : un sinistre
rampant vient perturber le monde agricole, dans les cantons sud-ouest des
Deux-Sèvres; ce fléau paraît ignoré de l'antique Egypte, quand Dieu frappait la
terre des Pharaons des dix plaies vengeresses et, comme il ne connaît pas de
frontières administratives, il chevauche généreusement la Charente-Maritime et
dévaste la forêt de Benon : ce sont les chenilles défoliatrices. Peu exigeantes
sur la nourriture, elles ont dénudé les bois et les
 haies, et maintenant, poussées par la faim, elles envahissent jardins et vergers et pénètrent même dans
les maisons ! On avance des noms : Bombyx disparate (Lymantria dispar) et
Processionnaire du chêne (Thaumetopoea
processionea)[...]. Futaies,
taillis et buissons semblent brûlés par un feu dévastateur; mais plus encore,
c'est un bruissement insolite qui étonne l'oreille ! Le ciel est d'un bleu
candide; pas un nuage, pas un souffle d'air, et pourtant, on perçoit un
froissement confus der feuillage en même temps qu'un pianotement léger, discrète
symphonie dans ce paysage morne et figé, comme si une ondée molle de printemps,
chuintant d'une invisible nuée, heurtait d'imaginaires frondaisons; serait-ce
l'esprit de l'air qui abuserait mes sens, comme dans une comédie de Shakespeare
? Mais l'analyse dissipe la féerie ! La cause, Ô combien matérielle, rampe dans
la broussaille : il y a là des milliers de chenilles errantes; ensemble, elles
découpent en festons, de leurs mandibules tranchantes, des restes de
parenchymes, ensemble, elles fientent et de de petites crottes fermes
rebondissent de brindille en brindille et tombent sur la couche de feuilles
mortes ! Adieu, l'extravagant, l'imaginaire ! haies, et maintenant, poussées par la faim, elles envahissent jardins et vergers et pénètrent même dans
les maisons ! On avance des noms : Bombyx disparate (Lymantria dispar) et
Processionnaire du chêne (Thaumetopoea
processionea)[...]. Futaies,
taillis et buissons semblent brûlés par un feu dévastateur; mais plus encore,
c'est un bruissement insolite qui étonne l'oreille ! Le ciel est d'un bleu
candide; pas un nuage, pas un souffle d'air, et pourtant, on perçoit un
froissement confus der feuillage en même temps qu'un pianotement léger, discrète
symphonie dans ce paysage morne et figé, comme si une ondée molle de printemps,
chuintant d'une invisible nuée, heurtait d'imaginaires frondaisons; serait-ce
l'esprit de l'air qui abuserait mes sens, comme dans une comédie de Shakespeare
? Mais l'analyse dissipe la féerie ! La cause, Ô combien matérielle, rampe dans
la broussaille : il y a là des milliers de chenilles errantes; ensemble, elles
découpent en festons, de leurs mandibules tranchantes, des restes de
parenchymes, ensemble, elles fientent et de de petites crottes fermes
rebondissent de brindille en brindille et tombent sur la couche de feuilles
mortes ! Adieu, l'extravagant, l'imaginaire !
[...]. Les promeneurs sont invités à ne plus se rendre sur les lieux infestés et
cela durant plusieurs mois; on rappelle les risques d'allergie, le danger réel
d'inhalation des poils urticants, les complications possibles pulmonaires et
oculaires. sages conseils ! de fait, des exuvies diaphanes pendent en grappes
serrées, accrochées à des bourses de soie; il en est par milliers, prêtes à
voltiger au moindre souffle d'air [...].
Juin 1986 : [...]. Le fléau se sera déplacé vers d'autres
lieux; la télévision ne vient-elle pas de diffuser des images aberrantes ? A 800
km de là, "l'Alpazur" est paralysé sur ses rails englués de cadavres; on a
filmé, en gros plans, les vedettes de ce fait divers : ce sont des
Processionnaires ! Pour dégager la voie montante, les cheminots ont usé du balai
: ils n'y ont gagné qu'éruptions allergiques; et le feu et les insecticides
eux-mêmes seraient inefficaces tant l'armée ennemie est nombreuse et sans cesse
renouvelée. Tant pis ! Au siècle du TGV, on roulera au pas !
(Ces charmantes lignes sont de notre collègue Louis Cloux,
dans le Bulletin "Sciences Nat n°54)
Les différents types d'entomologistes :
Voici un beau texte de 1842
qui ne manque pas d'humour et dans lequel nombre d'entre nous se reconnaîtront
encore aujourd'hui (emprunté au dernier excellent bulletin de l'ACOREP) :
"Et d'abord, qu'est ce qu'un entomologiste ? la définition n'est pas aussi
simple qu'on pourrait le croire, car chez ces êtres, comme dans leurs
collections, il y a une foule de variétés :
Il a l'entomologiste collectionneur , dont la vocation n'est point spéciale, et
qui ne fait qu'obéir au développement particulier de son crâne, qui l'a voué dès
sa naissance à la manie des collections. Il ramasse et amasse des insectes comme
il ramasserait des plantes, des coquilles , des médailles, des bouquins et
souvent en effet il cumule tous ces goûts. Réunir le plus possible d'objets
soigneusement rangés et étiquetés, pouvoir se vanter de posséder seul tel
Carabus ou tel Elvézir, tel est son suprême bonheur. Du reste, il use peu ou
point de ses propriétés une fois acquises; chaque objet a sa place dans son
casier et dans sa mémoire, mais il ne sort pas plus de l'un que de l'autre.
Il y a l'entomologiste commerçant, qui reporte sur la Science une vocation pour
le négoce qui n'a pu s'exercer autrement. Celui-là ne rêve qu'échanges,
correspondances, comptes ouverts, ventes et achats. Ce qui n'est pour le premier
qu'un moyen de se procurer les objets qui lui manquent devient pour lui le but
principal. Tombe -t-il sur une espèce recherchée, il en remplit ses boîtes, son
chapeau, ses poches. Il cote la valeur de chaque bestiole et consent à rabattre
quelques centimes s'il manque une patte ou une antenne; du reste, il déploie
dans l'exercice de ses goûts une activité, une adresse, un arsenal de ruses et
d'éloquence commerciales, qui l'auraient mené loin dans une autre partie !
Pour l'entomologiste voyageur, les insectes ne semblent qu'une occasion de
courir le monde; son imagination ardente lui représente sans cesse des forêts
obscurcies par le vol des lépidoptères ou de prairies dont chaque brin d'herbe
est chargé d'un coléoptère. L'expérience ne le guérit point et, s'il a parcouru
4 parties du monde, c'est dans la cinquième qu'il placera cet impossible
Eldorado. C'est du reste un héros pour le courage et la persévérance; les
dangers ne sont rien pour lui et partout où surgit un Cook, un Laplace ou un d'Urville,
il ne manque jamais à l'appel.
Son opposé est l'entomologiste observateur, qui sort peu de son jardin, où il
passe sa vie à suivre les manœuvres du nécrophore ou les pérégrinations de la
fourmi. Celui-là lit peu ou point de livres et, les faits les plus connus étant
nouveaux pour lui, le nombre de ses jouissances défie les plus étroites limites.
Aussi ce goût d'observation se rencontre-t-il souvent dans les hommes les plus
illettrés, chez lesquels il témoigne d'une franche admiration pour les beautés
naturelles.
L'entomologiste classificateur est tout différent. Il vit au milieu des livres
et accepte généralement comme prouvé tous les faits qui y sont consignés ou
plutôt il s'en inquiète peu. Un coléoptère a-t-il 4 ou 5 articles aux tarses,
voilà pour lui la question capitale. Il écrira des volumes pour prouver que tel
qui paraît avoir 4 segments en a en réalité 5; seulement ce cinquième n'est pas
visible, voilà tout ! Il ne se soucie que médiocrement des affinités des espèces
entre elles et de la conformité de mœurs ou d'habitudes par laquelle la Nature
semble avoir voulu les rapprocher; pour lui, la Vie même est une faculté
accessoire : il n'étudie que des cadavres !
Enfin, il y a l'entomologiste amateur, à qui le ciel n'a départi qu'une seule
étincelle du feu sacré. Il ne recueille que les insectes les plus brillants, ne
se tourmente nullement pour trouver leurs noms et leurs genres et emploie tout
son temps et tous ses soins à les disposer, avec la symétrie d'un maître
d'hôtel, dans des cadres élégamment dorés qu'il append dans sa chambre à
coucher, au-dessus du piano ou de la couseuse."
("Les Entomologistes peints par eux-mêmes", d'Achille Guenée, 1842)
Une partie de pêche dans l'Acre :
"Dans un méandre, nous rencontrons une pirogue arrêtée avec trois hommes pêchant
à l'épervier. D'un geste élégant, ils lancent leur filet qui s'arrondit dans
l'eau comme un parachute. Ils ressemblent assez au joueur de banjo du film
"Délivrance" ! Au deuxième coup de filet, le plus hideux des trois remonte une
longue anguille, et dans le même temps, un autre dépose une grosse carpe blanche
au fond du bateau.
Les hommes s'amusent à nous prêter un filet. Arthur essaye le premier mais il ne
prend qu'une multitude de poissons-chats aux piquants venimeux et des petits
piranhas aux dents pointues. Les hommes s'empressent de leur couper la tête, les
nageoires et les piquants. Caddy est encore moins chanceux et, maladroitement
accroche le filet au fond de l'eau. Les hommes qui nous ont dissuadés de nous
baigner parce qu'ils savent bien que leur rivière est infestée de piranhas et de
crocodiles, n'hésitent pas à plonger pour aller décrocher le filet.
Quant à mes propres expériences de pêcheuse, elles sont plutôt grotesques :
j'attache l'extrémité de la ficelle à mon poignée gauche comme on me l'a montré,
je prends dans ma main gauche le haut du filet, dans ma droite le bas et, dans
mes dents le milieu. Le filet doit s'arrondir à la surface de l'eau. Je lance de
toutes mes forces et… vlan. Mais j'oublie de desserrer les dents et, entraînée
par mon élan, je pique du nez dans la gueule des piranhas, en faisant chavirer
la pirogue. Nous en sommes tous quitte pour un bon bain et les poissons ont
rejoint leur élément naturel.
- "Forte, molto forte, natoure", s'exclament ces hommes qui ne m'en veulent pas du
tout et rient en exhibant leurs gencives édentées.
- C'est une chance que vous ayez eu des dents naturelles, reprend Arthur, sinon
votre râtelier serait parti dans la rivière !
Les hommes reprennent donc leur filet et, au bout de quelques minutes, la
pirogue déborde de gros poissons. Ils nous conduisent dans leur cahute où leurs
femmes nous préparent un déjeuner succulent. Que cela fait du bien de savourer
du poisson frais aromatisé aux tiges d'oignons; enfin un plat délectable ! Je
suis affamé et je dévore presque autant que Caddy et Arthur dont les appétits
m'ont toujours étonnée. Bien qu'habitant dans la plus primitive des cahutes, et
malgré leurs mines de spectres, ces gens ne sont pas du tout sauvages ou
hostiles aux visiteurs. Les femmes nous parlent avec beaucoup de gentillesse et
de curiosité. Le fait que nous soyons de tout jeunes mariés en pleine lune de
miel les amusent beaucoup et elles nous souhaitent beaucoup, beaucoup
d'enfants."
(Du très sympathique et rafraîchissant "L'équipée amazonienne" d'Evelyne Coquet,
chez Robert Laffont).
Les insectes lumineux :
 "Les
lampyres mâles et femelles se reconnaissent entre eux et signalent
qu'ils sont prêts pour l'accouplement, moins par la luminosité (les
mâles peuvent même être attirés par des éclairs lumineux artificiels)
que par la durée des intervalles entre chaque éclair. Pour l'un des deux
sexes, ces signaux sont normalement courts et se succèdent très
rapidement, jusqu'à 8 éclairs par seconde; chez le partenaire au
contraire, ils sont isolés et prolongés. Chez quelques espèces,
l'émission de lumière est au contraire très lente : un mâle brillera
seulement toutes les 5 ou 6 secondes et la femelle répondra 2 secondes
plus tard. De plus, l'intensité lumineuse est variable selon les taxons. "Les
lampyres mâles et femelles se reconnaissent entre eux et signalent
qu'ils sont prêts pour l'accouplement, moins par la luminosité (les
mâles peuvent même être attirés par des éclairs lumineux artificiels)
que par la durée des intervalles entre chaque éclair. Pour l'un des deux
sexes, ces signaux sont normalement courts et se succèdent très
rapidement, jusqu'à 8 éclairs par seconde; chez le partenaire au
contraire, ils sont isolés et prolongés. Chez quelques espèces,
l'émission de lumière est au contraire très lente : un mâle brillera
seulement toutes les 5 ou 6 secondes et la femelle répondra 2 secondes
plus tard. De plus, l'intensité lumineuse est variable selon les taxons.
Sous les Tropiques, certaines espèces s'assemblent chaque nuit sur des
arbres particuliers; alors des milliers de mâles et de femelles vont et
viennent d'une branche à l'autre, faisant clignoter leurs lumières tout
en se déplaçant, tandis que de nouveaux arrivants viennent en volant se
mêler au ballet. L'arbre est transformé en une scintillante pyramide
d'étincelles et est entouré d'un nébuleux halo; même les grosses pluies
n'ont pas d'action sur l'activité de ces insectes.
Un des plus stupéfiants phénomènes offerts par certains de ces Lampyres
tropicaux est également présenté quand les mâles s'envolent par milliers
des herbes et des broussailles pour se rassembler sur les arbres,
émettant de la lumière à perte de vue; cet étrange comportement n'est
pas sans rappeler celui des mâles de certains "oiseaux du Paradis" qui
s'assemblent en nombre sur un arbre isolé où ils se livrent à leur
somptueuse parade nuptiale. Les lampyres s'illuminent en même temps,
éclair après éclair, en complet synchronisme, comme si, contrôlés par un
alternateur, les formes des arbres se découpaient momentanément dans
l'obscure nuit tropicale.
En plus des Lampyrides, les larves et les adultes de quelques autres espèces
produisent de la lumière. La plus connue est le Taupin d'Amérique tropicale du
genre Pyrophorus, souvent appelée "Mouche de Feu". Ces utiles ennemis des
parasites de la canne à sucre sont des insectes brunâtres de 2 à 4 cm; leur
lumière, le plus souvent verte, est émise de 3 endroits : sur le dos du pronotum,
un peu en avant de ses angles postérieurs aigus et, en dessous, à la base de
l'abdomen; d'autres espèces ont une lumière abdominale rougeâtre et peuvent
émettre en deux couleurs, comme un "feu rouge" de circulation ! La lumière émise
par ces Pyrophores est la plus puissante de celle émise par les coléos; avec
un de ces insectes dans la main, on peut lire un journal dans la nuit ! Aussi
longtemps qu'il est maintenu, il continuera à émettre mais s'arrêtera dès qu'il
est relâché; ce fait suggère ici que la fonction de la lumière est sans doute
d'effrayer les ennemis. Les jeunes indiennes les fixent souvent à leurs cheveux
ou à leurs vêtement, dans un petit sac en filet, comme une superbe décoration;
de même, quand le coléo est maintenu dans une cage, il constitue une véritable
lampe vivante pour éclairer la case."
D'après le fameux "Insectes du Monde" de Walter Linsenmaïer).
Les insectes
ont-ils mal ? :
Ils ne crient ni ne pleurent
et se plaignent encore moins. Plus sérieusement, ils n’apprennent pas à éviter
ce qui blesse, ce qu’on considère comme le rôle positif et adaptatif de la
douleur chez les vertébrés. Et il est banal d’observer un criquet ou un puceron
qui continue à mâcher son brin d’herbe ou à ponctionner la sève tandis qu’il est
déjà à moitié dévoré par une mante ou une coccinelle (respectivement) ou
grignoté de l’intérieur par un parasitoïde. Autres indications : un insecte
amputé d’un tarse appuie son moignon sur le substrat avec la même force que si
son membre était intact et l’on n’a jamais vu un insecte tenter de protéger une
plaie. Certains comportements ressemblent superficiellement à ceux de vertébrés
(tortillements suite à l’application d’un stimulus agressif, réactions de
défense par la projection d’un liquide corrosif ou d’un son) ou favorisent la
survie des congénères (phéromones d’alarme). Mais les anatomophysiologistes nous
enseignent qu’ils ont un système nerveux « trop simple » (sans cortex cérébral,
notamment) et dépourvu de neurones nocicepteurs.
On admet donc que les insectes ne ressentent pas la douleur.
Et l’asticot de se faire embrocher vif sur l’hameçon sans émouvoir le pêcheur.
Mais, on l’a découvert récemment, l’asticot possède des neurones multipolaires
analogues à ceux qui chez les vertébrés assurent la nociception. Ils innervant
l’épiderme et possèdent un canal ionique « painless » indispensable (chez les
vertébrés) à la perception des stimulus nocifs. Par ailleurs, l’asticot se
tortille si on le pique.
Une équipe de l’université de Stanford (États-Unis), mettant en œuvre des
techniques de ciblage génétique et de photoactivation de la rhodopsine – qui
permettent de bloquer ou de réactiver des neurones – vient de montrer que ces
neurones multipolaires sont nécessaires à la réaction de l’asticot. Et que
celle-ci aurait un certain caractère adaptatif : si l’on approche de sa cuticule
une épingle chauffée, l’asticot s’arque à sa rencontre – et non pour s’en
éloigner, comme on aurait pu le penser. Plus efficace pour faire dévier
l’oviscapte d’un parasitoïde, Leptopilina boulardi (Hym. Eucoïlidé), en
l’occurrence ?
Ce n’est sans doute pas un simple réflexe, car ses mouvements impliquent de
nombreux muscles et sont visiblement coordonnés depuis un « étage supérieur » du
système nerveux.
On connaît un peu mieux la physiologie nerveuse de l’asticot (pris comme modèle
d’insecte) mais la réponse, à ce stade, reste non, les insectes ne souffrent
pas.
Des temps heureux :
 "Il faut d'abord évoquer les déprédations désastreuses qu'ils commettaient
alors. Ainsi, en 1688, les hannetons détruisirent toute la végétation du comté
de Galway, en Irlande, de sorte que le paysage prit un aspect hivernal. Le bruit
de leurs mandibules dévorant les feuilles était comparable au sciage d'une
grosse pièce de bois, et, le soir, le bourdonnement de leurs ailes résonnait
comme des roulements éloignés de tambours. Les habitants du pays avaient peine à
retrouver leur chemin, aveuglés par cette grêle vivante. En contrepartie, des
hannetons furent servis à tous les repas, cette année là, dans le comté. En
1804, des nuées immenses de ces insectes, précipitées par un vent violent dans
le lac de Zurich, formèrent un banc épais de cadavres amoncelés sur le rivage,
dont les exhalations putrides empestèrent l'atmosphère. Le 18 mai 1832, à 21 h,
la route de Gournay à Gisors fut envahie par de telles myriades de hannetons
qu'à la sortie du village de Talmoutiers les chevaux de la diligence, aveuglés
et épouvantés, ne purent avancer. En 1841, les vignobles du Mâconnais furent
ravagés et des nuées s'abattirent sur la ville même de Mâcon au point qu'on
avait grand-peine à s'en garantir et qu'on les ramassa à la pelle dans les rues.
Sous la Troisième République, les entomologistes firent des dénombrements plus
précis; c'est ainsi que dans le canton de Gorron (Mayenne), entre le 8 mai et le
12 juin 1887, on ramassa à la main près de 100 millions de hannetons adultes,
pesant environ 75 tonnes ! "Il faut d'abord évoquer les déprédations désastreuses qu'ils commettaient
alors. Ainsi, en 1688, les hannetons détruisirent toute la végétation du comté
de Galway, en Irlande, de sorte que le paysage prit un aspect hivernal. Le bruit
de leurs mandibules dévorant les feuilles était comparable au sciage d'une
grosse pièce de bois, et, le soir, le bourdonnement de leurs ailes résonnait
comme des roulements éloignés de tambours. Les habitants du pays avaient peine à
retrouver leur chemin, aveuglés par cette grêle vivante. En contrepartie, des
hannetons furent servis à tous les repas, cette année là, dans le comté. En
1804, des nuées immenses de ces insectes, précipitées par un vent violent dans
le lac de Zurich, formèrent un banc épais de cadavres amoncelés sur le rivage,
dont les exhalations putrides empestèrent l'atmosphère. Le 18 mai 1832, à 21 h,
la route de Gournay à Gisors fut envahie par de telles myriades de hannetons
qu'à la sortie du village de Talmoutiers les chevaux de la diligence, aveuglés
et épouvantés, ne purent avancer. En 1841, les vignobles du Mâconnais furent
ravagés et des nuées s'abattirent sur la ville même de Mâcon au point qu'on
avait grand-peine à s'en garantir et qu'on les ramassa à la pelle dans les rues.
Sous la Troisième République, les entomologistes firent des dénombrements plus
précis; c'est ainsi que dans le canton de Gorron (Mayenne), entre le 8 mai et le
12 juin 1887, on ramassa à la main près de 100 millions de hannetons adultes,
pesant environ 75 tonnes !
(.....). Cette année là (1497), l'évêque de Lausanne chargea un clerc d'aller
proclamer aux hannetons, en latin, une sommation à comparaître avant 6 jours
devant le tribunal épiscopal. Les hannetons ne bougèrent pas des champs et ne
vinrent pas au tribunal... Après leur avoir accordé un sursis, un second
mandement fut proclamé, où ils étaient qualifiés de "vermine détestable, qu'on
ne peut appeler animale, ni d'ailleurs nommer en aucune façon". Mais ces
créatures innommables n'en furent pas autrement émues. Comme elles ne voulaient
rien entendre, il fallut se résoudre à sévir : le clergé se rendit en procession
dans les champs et la sentence suivante fut rendue :
"Nous, Bénédict de Montferrat, évêque de Lausanne, ayant entendu la plainte des
fidèles de notre diocèse à l'encontre des hannetons, armé de la très Sainte
Croix et tourné vers Dieu, de qui proviennent les justes sentences, déclarons
coupable l'infâme engeance des hannetons, les frappons d'excommunication et les
maudissons au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ". Ce jugement est
resté célèbre comme un des seuls cas d'excommunication prononcée à l'encontre
d'insectes !"
(D'après l'excellent et très documenté "Le Scarabée et les Dieux" de notre
collègue et ami Yves Cambefort).
Une recette culinaire pour
coléoptériste :
"Prenez une trentaine de hannetons bien vigoureux et
dépouillez-les tous vivants de leurs élytres, puis réduisez-les en pâte dans un
mortier. Le scarabée étant réduit en pâte, faîtes frire dans le beurre frais,
puis ajoutez du bouillon fort ou faible, ou même de l'eau, et faîtes chauffer.
Enfin, versez à travers un tamis de crin sur des tranches de pain blanc grillé
et ... dégustez !
Le consommé de hannetons l'emporte incomparablement en délicatesse, en saveur et
en parfum sur la meilleure soupe d'écrevisses. Un préjugé seul peut priver
l'homme de cette fine nourriture essentiellement propre aux convalescents; mais
lorsqu'on aura triomphé de cette répugnance irréfléchie, les hôpitaux auront
fait une belle acquisition".
(Recette allemande provenant d'un recueil culinaire très
estimé ...)
D'intéressants animaux
de compagnie :
 "Son corps mesurait environ 5 cm et ses pattes 18 cm; le corps et les pattes
étaient entièrement recouverts de gros poils gris et rougeâtres. Je fus attiré
par un mouvement du monstre qui se tenait sur un tronc d'arbre, juste au dessus
d'une profonde cavité au travers de laquelle s'étendait une épaisse toile
blanche; la partie inférieure de celle-ci était déchirée et deux petits oiseaux,
des pinsons, y étaient empêtrés; ils avaient à peu près la taille de notre
chardonneret et il devait s'agir du mâle et de sa femelle. L'un était déjà mort,
l'autre agonisait sous le corps de la mygale, tout enduit de l'immonde salive du
monstre. Je chassai l'araignée et pris les oiseaux, mais le second ne tarda pas
à mourir... Certaines mygales sont énormes. J'ai surpris un jour les enfants
d'une famille indienne qui collectait pour moi des échantillons, promenant l'une
de ces hideuses bestioles dans leur case, une corde attachée à la taille,
exactement comme un chien en laisse ! "Son corps mesurait environ 5 cm et ses pattes 18 cm; le corps et les pattes
étaient entièrement recouverts de gros poils gris et rougeâtres. Je fus attiré
par un mouvement du monstre qui se tenait sur un tronc d'arbre, juste au dessus
d'une profonde cavité au travers de laquelle s'étendait une épaisse toile
blanche; la partie inférieure de celle-ci était déchirée et deux petits oiseaux,
des pinsons, y étaient empêtrés; ils avaient à peu près la taille de notre
chardonneret et il devait s'agir du mâle et de sa femelle. L'un était déjà mort,
l'autre agonisait sous le corps de la mygale, tout enduit de l'immonde salive du
monstre. Je chassai l'araignée et pris les oiseaux, mais le second ne tarda pas
à mourir... Certaines mygales sont énormes. J'ai surpris un jour les enfants
d'une famille indienne qui collectait pour moi des échantillons, promenant l'une
de ces hideuses bestioles dans leur case, une corde attachée à la taille,
exactement comme un chien en laisse !
(...) On trouve dans cette région d'Obidos une étrange sorte de grillon des
forêts; les mâles font un bruit très fort et assez mélodieux, en frottant les
uns contre les autres les bords de leurs élytres. Ces notes sont les plus
perçantes et les plus insolites que j'aie jamais entendues produire par un
orthoptère. Les indigènes appellent ce grillon le Tananá; nom qui évoque les
stridulations de l'animal : ta-na-ná, ta-na-ná, ..., telles sont les syllabes qui
se succèdent sans discontinuer. Quand les indiens en capturent un, ils le
gardent dans une cage en vannerie pour le plaisir de l'entendre chanter. Un de
mes amis en a gardé un 6 jours; son entrain n'a duré qu'une soixantaine
d'heures, durant lesquelles son chant a résonné d'un bout à l'autre du village."
(D'après "The Naturalist on the River Amazons" de l'illustre Henry Walter
Bates).
Le "mâlanguille" :
 En 1987, notre collègue Marc Soula (si !) posait quelques pièges à Capestang
(Hérault), localité connue pour ses Carabus clathratus arelatensis, carabe
semi-aquatique qui vit en bordure d'un vaste étang. Il fut alors interpellé
assez violemment par des paysans qui s'inquiétèrent fort de ce qu'il capturât
des "mâlanguilles", c'est à dire, lui expliqua-t-on avec quelque acrimonie, des
anguilles mâles, l'anguille qui vit dans cet étang constituant l'une des
ressources locales. En 1987, notre collègue Marc Soula (si !) posait quelques pièges à Capestang
(Hérault), localité connue pour ses Carabus clathratus arelatensis, carabe
semi-aquatique qui vit en bordure d'un vaste étang. Il fut alors interpellé
assez violemment par des paysans qui s'inquiétèrent fort de ce qu'il capturât
des "mâlanguilles", c'est à dire, lui expliqua-t-on avec quelque acrimonie, des
anguilles mâles, l'anguille qui vit dans cet étang constituant l'une des
ressources locales.
(........). De tout ceci, il ressort que dans une très vaste zone géographique,
les noms populaires attribués aux gros coléoptères aquatiques (Dytiscus,
Cybister, Hydrous...) ou semi-aquatiques (Carabus) en faisaient, et en font
encore, soit des anguilles (Normandie), soit la génitrice des anguilles
(Sardaigne, Gard, Camargue), soit le mâle des anguilles (Hérault).
L'explication de ces surprenantes associations se trouve dans la biologie si
particulière de l'anguille, qui se reproduit en Mer des Sargasses, entre les
Antilles et la Floride. Depuis l'Antiquité, les pêcheurs ont été intrigués par
l'absence d'œufs et l'impossibilité de distinguer les mâles des femelles.
(Y. Delaporte, dans le n. 19 du "Le Coléoptériste")
"Faut pas être dégoûté !"
:
Il doit se baisser pour éviter le maxillaire humain suspendu au dessus de
l'entrée; en se penchant, il découvre un tambour surmonté d'une main desséchée
enduite d'une cire d'abeille sauvage. Dans l'ombre épaisse animée seulement par
le rougeoiement de quelques braises éparpillées sous une poterie, il distingue
enfin une vieille femme, d'autant moins visible qu'elle est recouverte de latex;
le caoutchouc noircit à l'air; cette seconde peau est tatouée d'incrustations
blanches et jaunes; le blanc est une variété de kaolin, le jaune est une sorte
d'amadou pulvérisé produite par certaines espèces de fourmis. Crevaux s'habitue
à l'obscurité; dehors, il entend son fidèle Apatou faire les cent pas devant la
case, fusil en main; il s'approche de la vieille qui lui tourne le dos; de temps
en temps, elle remue son frichti avec une vieille flèche. Crevaux s'apprête à
lui proposer d'échanger une assiette pleine de son ragoût contre un couteau ou
tout autre objet; va savoir ce qu'une indienne peut réclamer ! Dans la vapeur du
pot, il distingue des orbites marquées... : encore du singe, songe-t-il,
toujours du singe, dans cette forêt sans beaucoup d'autre gibier. Puis, il
fronce les sourcils; d'un geste sec, la vieille a retourné la "chose", et
Crevaux sursaute : vu la taille et les lambeaux de chair, c'est une tête humaine
! Le ventre creux, il file rejoindre le reste de ses piroguiers...
(D'après "Le mendiant de l'Eldorado" du très célèbre
Jules Crevaux).
Les Dix Commandements ou l'Abécédaire de l'Entomologiste :
  Les Anciens tu honoreras Les Anciens tu honoreras
Les Biotopes tu respecteras
Les Conseils tu écouteras
Les Directives tu appliqueras
Les Espèces tu recenseras
Les Faunes tu rédigeras
Les Graphiques tu établiras
Les Habitus tu dessineras
Les Insectes - types tu déposeras
Les Jeunes tu initieras
R. M. Quentin
Décembre :
Soulevez une pierre : vous trouverez peut-être une coccinelle
recroquevillée, dure comme la pierre; elle n'est pas morte, juste
en diapause, l'hibernation des insectes. Durant
l'hiver, elle reste immobile et cesse de se nourrir. elle lutte contre le froid
en produisant du glycérol, un antigel animal. La diapause est programmée pour
chaque espèce : la coccinelle ne sortira de son abri qu'après avoir passé un
certain temps au froid. Inutile d'essayer de la réchauffer ...
"Une épouse amoureuse (sur le tard...)"
:
S'ennuyant à Lima et séparée
de son mari depuis dix-huit ans, Isabela décide de le rejoindre à Cayenne (faut
jamais désespérer...!); les mers étant très peu sûres en ces périodes de guerre
(1767), elle décide de traverser le continent; accompagnée de ses deux
militaires de frères qui commandent à une douzaine de soldats, elle commence le
voyage sur une jolie mule blanche, encadrée par ses deux servantes... Le
lendemain matin, les guides indiens se sont enfuis en emportant tout ce qu'ils
ont pu; tant pis !, elle va user ses jolies bottines jusqu'à la première rivière
et chercher un canot. Le troisième jour, leur "skipper" indien (tremblant de
fièvre...) se noie en voulant récupérer le chapeau d'un des deux frères, tombé à
l'eau. Personne ne sachant diriger l'esquif, un soldat est désigné pour partir
chercher du secours dans un village voisin, situé à 6 jours de marche; après 25
jours d'une attente désespérée, les deux frères décident de construire un radeau
en balsa. Ce dernier n'a pas passé deux méandres qu'une branche basse assomme
tous les passagers; pris dans les tourbillons, le radeau se retourne; les
dernières provisions coulent avec Mme Godin; ses deux frères la sauvent par deux
fois de la noyade ! Les survivants préfèrent alors "couper" par la forêt;
dépourvus de guides, ils se perdent; déchirés par les épines, dévorés par les
insectes et la soif, ils meurent les uns après les autres, les servantes, les 2
frères le même jour, puis les derniers soldats; Isabela s'effondre à son tour;
les fourmis arrivent déjà... Après un collapsus de 2 jours, elle sort de sa
léthargie et décide de se battre pour survivre (et revoir son mari !); à coup de
baïonnettes, elle taillade les bottes de ses frères pour se bricoler des
spartiates, et elle part droit devant elle. Mr Godin peut-il se considérer comme
veuf ? NON ! Soixante jours après, un squelette de sexe féminin titube sur les
bords du Rio Bobonafa; nue sous une mantille lacérée, déchirée par la
végétation, taraudée par les piqûres d'insectes, émaciée par les privations,
Isabela s'effondre dans la mission franciscaine. Le moine de service refuse de
lui parler tant qu'elle n'aura pas une tenue décente !
Après quelques mois de "starisation" dans les salons parisiens, elle finira ses
jours en épouse parfaite dans la province française la plus paisible...
Marc SOULA (D'après diverses sources...).
Une épouse modèle :
Un entomologiste, le
Dr. Marcel Leclercq, est spécialisé dans l’étude des taons. Savez-vous comment
il les capturait pour les inventorier ? Il couvrait son épouse d’une peau de
vache et elle attendait patiemment dans les prés que les taons viennent la
visiter!
J’entends souvent dire
que les épouses d’entomologiste doivent composer avec l’entomologie, une
terrible rivale; mais là, quelle abnégation !!
Entomologie conjugale :
Charles et Lois O'Brien, se sont rencontrés en
1958 dans une chaire d’entomologie (université de l’Arizona). Ils possèdent
chez eux, à Green Valley (un lotissement pour vieux en Arizona, États-Unis) 1 200 grands tiroirs vitrés sur le dessus. Dedans, 1 250 000 spécimens de
Coléoptères (c’est la collection de Charles) et de Fulgoroidea (celle de Lois),
pesant (ensemble) 11 000 livres (5 tonnes).
Charles a chassé le coléo sur toute la Planète, souvent lors d’expéditions loin
de tout. Un jour, raconte-t-il, il a été à deux doigts d’être épinglé sur une
lance. Les gens l’avaient pris pour un officiel à la recherche des voleurs de 3
cochons. Le chef de ses porteurs l’a sauvé en déployant un drapeau états-unien
et en criant « American ! American ! ».
(Ça s’est passé au fin fond des îles
Salomon, en 1960).
Une histoire à dormir debout... :
M. Clive et Mme Vicky Hames vont se
coucher, et s’endorment en dépit d’un bruit - comme le vrombissement d’une
guêpe. Au réveil, madame entend toujours le bruit, qui vient du lit, et soulève
l’oreiller, déclenchant la fureur des guêpes (pas une, beaucoup !) qui avaient
bâti leur nid entre l’oreiller et la tête du lit. Elle s’en tire avec une piqûre
; son mari est parfaitement indemne.
Une espèce menacée :



à gauche dessin "Homo entomologicus"
Linné et à droite photos d'Henry Walter Bates
Un "hold-up" historique,
qui a encore de grandes répercussions, de nos jours, pour les naturalistes
voulant étudier le Brésil" (j'en sais quelque chose...) :
Sous prétexte de cueillir les plus belles
orchidées du monde pour la gloire de la reine Victoria. Wickham, jouant le
savant fou, le flambeur, le bambocheur des rios et, en dépit de la parano des
possédants, réussit à dérober des graines d'hévéa, comme d'autres le feu. Des
hautes eaux qui surélèvent le fleuve de 15 mètres, il sut se faire un allié. La
crue paralysant les seringueiros, Wichkam en profite pour se faire enfermé sur
une île par la marée brune, cette inondation qui dure six mois. Cette flaque de
terre ballottée entre les courants porte quelques "seringa", juste assez pour
récolter les 2400 graines historiques ! Ces 2400 graines vont ridiculiser le
plus durable des mythes de la "forêt de la pluie". "Wichkam le rouge" a prévu un
bateau, un rafiot rouillé qui n'inspire que la pitié.
Les graines sont enfouies
dans des pots de terre à fond de cale. A toute vapeur vers les bouches de
l'Amazone, devenues une mer de boues alluviales charriant des millions de tonnes
de déchets. La police arrête l'anglais à Belem, puisque les autorités vivent
dans la hantise des voleurs de graines; mais le consul anglais sait arranger les
plus douloureux états d'âmes ! De l'or change de mains et le bateau aux
orchidées cingle officiellement vers Buckinkam; la reine ne doit pas attendre
les plus belles fleurs du monde ! Wichkam fonce dans l'Atlantique sud, frôle les
falaises de Sainte Hélène, double le Cap de Bonne-Espérance, relâche à l'île
Maurice pour faire du charbon et rafistoler le bastingage, s'élance à travers
l'Océan Indien, s'engouffre dans le détroit de Singapour et jette ses ancres
rouillées dans les eaux mortes du port de Malacca. Les graines sont aussitôt
plantées et donneront 2 400 hévéas qui vivront mieux que dans leur terre mère !
"On essaye de communiquer..." :
- Qu'est ce que tu as d'autre ? demanda le chef qui semblait
s'appeler Maipuri.
Il ne précisa pas sa pensée mais il suffisait de suivre son regard. Je sortis
quelques cartes postales de la poche de ma chemise; je lui en mis une dans la
main : on y voyait la reine d'Angleterre en grande tenue, avec le château de
Windsor à l'arrière-plan.
- Qu'est ce qui est écrit ?
- "Salutations de Londres."
- Ton chef envoie des salutations de Londres ? Mais c'est une femme !
- Oui, c'est une femme.
Je lui montrai une autre carte :
- Ça, c'est sa maison et ça, c'est une image d'un grand village appelé Londres
où elle vit.
- Mmmmmmm..., ton chef a une grande hutte !
- On l'appelle Buckingham Palace. Mon chef est la personne la plus riche du
monde; elle attend mon retour.
Deux guerriers regardaient par dessus son épaule pour voir les photos, mais il
les plaqua contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un jeu de cartes.
- Mais c'est vraiment une femme ?!
- Eh oui...
Le chef, mal à l'aise, toussota, se tourna vers ses hommes et bredouilla quelque
chose en wai-wai. Les villageois s'esclaffèrent.
- Quand cette femme va -t-elle venir ici ?
- Quand je serai rentré sain et sauf.
Maipuri fronça les sourcils :
- Comment s'appelle-t-elle ?
- Elisabeth.
- Lizbeth, expliqua Maipuri à ses hommes.
- Mmmmmmmm...
Puis il se tourne vers moi :
- Lizbeth, elle aime l'or ?
- Énormément.
- Alors, tu donnes l'or de Maipuri à Lizbeth ? Tu es d'accord ?
Les indiens qui m'entouraient se hissèrent sur la pointe des pieds pour mieux
m'observer; ils retenaient leur souffle. Je mijotai un moment au soleil.
- D'accord, j'accepte.
- Sssssssssssssss...Les hommes eurent un long sifflement de soulagement. Le chef
était radieux et ses hommes le regardaient avec admiration.
- À une condition.
Il y eu un long silence inquiet.
- Que veux-tu dire ? demanda lentement Maipuri.
- J'ai besoin d'aide pour continuer ma route. Et avec mes bagages, bien sûr.
Maipuri bredouilla quelque chose tout en ouvrant et fermant ses poings. Puis
marchant droit sur moi, il croisa ses bras et releva triomphalement sa tête :
- Je garde tes bagages; tu es mon prisonnier. Alors tais-toi !
- Mmmmmmmm..., approuvèrent les hommes. Tais-toi !
Ils entreprirent de se consulter, regardant mes bagages avec envie.
- J'ai pris une décision, lança Maipuri en levant sa main droite, les doigts
vers le ciel pour imposer le silence. Tu es mon prisonnier, alors tu es en
grande difficulté. Tu es en grande difficulté, alors tu as besoin de Lizbet.
Nous aussi, nous sommes en grande difficulté et nous avons besoin de Lizbet.
Alors, tu lui parleras de Maipuri qui est un ami.
- Je lui répondis que cet accord me semblait satisfaisant. Maipuri me demanda
alors :
- Tu es fort ?
- Je peux faire cent pompes, tu veux voir ?!
Maipouri répondit qu'il avait une meilleure idée :
- Nous allons te regarder tuer le cochon à mains nues !
Le vol sacrilège du coléoptère :
Du rififi dans le petit monde des insectes. Depuis quinze
jours, les spécialistes du Muséum n'ont qu'un sujet aux lèvres : le vol, commis
le 10 décembre dernier, du Titanus giganteus femelle, un spécimen rarissime
subtilisé au beau milieu de l'après-midi dans les rayonnages du pavillon
d'entomologie. Le chapardeur a été identifié et la "bête", restituée avant-hier,
a retrouvé ses quartiers. "Nous avons été stupéfaits par une telle audace",
confie le responsable de la section coléoptères du
 Muséum. "Notre Titanus
femelle, le seul spécimen que nous possédions, a été victime d'un malheureux
concours de circonstances. Cet animal fait partie du patrimoine national, comme
une peinture du Louvres". Muséum. "Notre Titanus
femelle, le seul spécimen que nous possédions, a été victime d'un malheureux
concours de circonstances. Cet animal fait partie du patrimoine national, comme
une peinture du Louvres".
Amour insolite : Moins coloré qu'un Van Gogh, sa carapace brune est pourtant
presque aussi unique : seuls dix spécimens femelles de Titanus giganteus - le
mâle, lui, est tristement banal - sont recensés à travers le monde. Comme son
nom l'indique, l'insecte affiche un gabarit impressionnant. "Le Titanus adulte
peut mesurer jusqu'à 20 cm et son poids est le triple de celui d'un moineau"
rappelle savamment l'entomologiste. "On le trouve dans la partie tropicale de
l'Amazonie". Inoffensif pour l'homme, l'animal vole à un rythme de croisière de
20 km/h à la recherche de sa nourriture, une larme de sève et quelques fruits
pourris. Et il est très craintif. Dernièrement des scientifiques américains ont
organisé deux ans d'expédition en Guyane française pour piéger ... deux de ces
"dames" !
Prisé, l'insecte coûte très cher. "Pas moins de 100 000 F" disent les
spécialistes. Thomas, 20 ans, connaît la valeur de l'animal. Mais il n'a pas les
moyens de l'acheter. Etudiant en DEUG de "Sciences de la Nature et de la Vie" à
l'Université de Savoie, il voue, depuis 10 ans, une passion sans borne pour
l'Entomologie. Cet amour insolite (!?), révélé après une enfance passée en
Afrique, se concentre sur les coléoptères, leurs mandibules broyeuses et leur
jolie paire d'ailes membraneuses (!?). Le 10 décembre dernier, Thomas quitte
Annecy, où il vit chez sa mère, pour venir à Paris. Il file au Muséum; le
laboratoire d'Entomologie recèle le plus beau des trésors que puisse imaginer le
jeune homme. Au beau milieu d'une kyrielle de cafards, de mouches et d'araignées
- il y a 50 millions de coléoptères -, Thomas ne sait plus où donner de la tête
quand il tombe en arrêt devant un couple de Titanus. Profitant d'un moment
d'inattention de la gardienne, il craque : d'un coup sec, il déverrouille la
sécurité, s'empare de la femelle et disparaît.
Le vol est constaté dans la soirée par deux visiteurs. Les policiers du
commissariat du cinquième arrondissement sont immédiatement chargés de l'enquête
et le parquet du tribunal de Paris ouvre une information judiciaire. Confondu
par un pense-bête oublié sur les lieux du crime, le voleur de coléo. a été
interpellé le 18 décembre à son domicile savoyard. sans opposer la moindre
résistance, Thomas a rendu l'insecte au commissaire Ambiaux en expliquant qu'il
avait agit en état "d'hallucination". Il a été laissé en liberté. Lors de sa
garde à vue, Thomas s'est montré intarissable à propos de sa passion. Un
enquêteur a avoué avoir beaucoup appris sur les mœurs des bêtes à six pattes...
 L'insecte le plus long
(37,5cm) : L'insecte le plus long
(37,5cm) :
C'est un phasme de 35,7 cm et 56,6 cm avec les pattes antérieures étendues.
L’insecte a été mesuré à Londres, où il est conservé et exposé au Muséum
d'histoire naturelle. On ne connaît que 3 spécimens de Phobaeticus chani (Pha.
Phasmatidé).
Il a presque la taille d'un bras
humain, c'est un phasme de l'île indonésienne de Bornéo,
et probablement le plus long insecte du monde vivant à
ce jour, à en croire des scientifiques britanniques.
Le spécimen a été découvert par un
villageois et confié à un entomologue amateur local
malaisien, Datuk Chan Chew Lun, en 1989, nous indique
Philip Bragg, qui a formellement identifié l'insecte et
publié sa découverte dans la revue «Zootaxa». L'insecte
s'appelle «phobaeticus chani», «super-canne de Chan», en
l'honneur de son découvreur. nous indique
Philip Bragg, qui a formellement identifié l'insecte et
publié sa découverte dans la revue «Zootaxa». L'insecte
s'appelle «phobaeticus chani», «super-canne de Chan», en
l'honneur de son découvreur.
Ressemblant davantage à une pousse de
bambou que ses cousins plus petits, l'insecte d'un vert
terne mesure 56,7 cm, avec des pattes en forme de
brindilles. La longueur du corps seul, 35,7 cm, bat le
record précédent, détenu par un autre phasme de Bornéo,
le «phobaeticus kirbyi» de près de 3 cm.
Ces insectes possèdent un des
systèmes de camouflage les plus ingénieux du genre
animal, ils se font passer pour des branches ou des
feuilles et évitent ainsi d'attirer l'attention.
Les
œufs possèdent une caractéristique très particulière:
ils sont munis d'extensions telles des ailettes, leur
permettant probablement d'être facilement transportés
par le vent dès la ponte et d'accroître ainsi la
distribution de l'animal.
 Un échantillon qui revient de loin... : Un échantillon qui revient de loin... :
Auguste Dejean a aussi sa légende entomologique : Général de
division, il fut mêlé à toute la vie militaire de la Révolution et de l'Empire;
à la bataille d'Alcanizas, sur le point de charger à la tête de ses dragons, il
captura et piqua dans son casque doublé de liège un Cebrio ustulatus ; à la fin
de la bataille, il le retrouva intact quoique ce casque ait été "horriblement
maltraité par la mitraille" !
Insectes de Sainte Hélène :
Il semble que le destin ait choisi cette illustre geôle pour
abriter des êtres d'exception. On sait que, parmi bien des endémiques, s'y
trouve un coléoptère remarquable, carabe appartenant à un genre qui n'a de
représentant nulle part ailleurs, Haplothorax burchelli. Les trois spécimens de
cette espèce détenus depuis longtemps par le Muséum, tirent un intérêt
historique, non seulement de leur provenance, mais encore du fait qu'ils ont été
capturés et ramenés en France par le dernier gardien du tombeau de l'Empereur et
furent donnés au Muséum par un de ses descendants.
O Tempora ! O mores ! :
"La Nature" du 17 Avril 1997 : ainsi on vend maintenant les
noms d'insectes entre 5000 et 10000 DM en les dédiant à un entomologiste
fortuné. Cette pratique économique n'a pas encore été interdite par le "Code",
la Bible des afficionados. On peut d'ailleurs tourner cet ignoble mercantilisme
: Cartwright et Abdullah se sont dédiés des genres gratuitement et le premier y
a ajouté une espèce. D'ailleurs, pour ces sommes considérables, on ne vous dédie
même pas un genre mais une espèce; cela coûterait infiniment plus cher.
Les services astronomiques des USA vendent dès maintenant des noms d'étoiles et
on peut offrir à sa fiancée, pour Noël, à un prix raisonnable, une étoile (il y
en a tellement...) mais pas encore une galaxie (bien qu'il y en ait également
beaucoup !); cela coûterait aussi beaucoup plus cher et ne serait accessible
qu'au sultan de Brunei ou à l'ex-futur beau-père de l'infortunée Diana... Vendre
une étoile, quelle poésie. Dans ma jeunesse, on proposait la Lune aux enfants,
mais c'était au figuré.
Récemment, des escrocs ont fondé aux USA une société fictive qui a vendu de faux
noms d'étoiles ou plutôt a dédicacé à ses victimes des étoiles fictives sans
aucun droit de le faire. Cela me rappelle la vente de faux billets de foot aux
brésiliens, écossais et mexicains pour la dernière Coupe du Monde...
Dans Nature du 13 février 1997, on cite l'oiseau Vireo masteri dédié à B. Master
en échange de 70 000 $; il est vrai que la somme était utilisée pour la création
d'une Réserve Naturelle.
Tout se vend, même les noms d'insectes, les titres nobiliaires, les étoiles et
pourquoi pas les plantes et les fossiles ...Il y aura bien des amateurs pour
payer. Il est vrai que c'est le National Museum of Natural History (à Londres !)
qui, par le biais du CAB, a inventé les déterminations payantes. Récemment, un
de mes collègues, dont je respecterai l'anonymat, réclamait à une infortunée
mexicaine 45 $ US par détermination d'insecte. Jusqu'où s'arrêtera le progrès ?!
(D'après notre collègue et ami P. Jolivet, dans le numéro 33 du "Le
Coléoptériste").
L'entomologiste et le
cycliste :
C'était une assez belle journée, un peu fraîche, que ce 24
mars 1999. Ma femme Claire et moi avions décidé de faire une ballade
mi-randonnée, mi-chasse aux insectes comme nous en faisons parfois. Cette fois
nous avions choisi d'aller dans la vallée de La Renarde, une jolie petite région
de l'Essonne. La récolte n'avait guère été fameuse, et en revenant à la voiture
que nous avions laissée dans le coquet village de Breux-Jouy, je donnais
quelques derniers coups de fauchoir au bord de la route, avec pour seul butin
quelques Lema melanopus que je décidais de capturer quand même, pour le
principe ...
J'étais en train de procéder à l'opération avec mon aspirateur lorsque deux
cyclistes passèrent auprès de moi; le premier ralentit un peu, et le second
s'arrêta pratiquement, me regardant faire un moment avant de reprendre sa route;
je l'entendis distinctement héler son compagnon : "T'as vu ?! Y a là un fou qui
attrape les petites bêtes avec un grand filet, et après il les aspire avec un
tuyau pour les manger !". La réponse du compagnon se perdit dans le lointain ...
Ce genre d'anecdote arrive de temps à autre dans la vie d'un entomologiste
et je l'aurais sans doute rapidement oubliée si, quelques jours plus tard, je
n'avais pas entendu l'émission radio de P. Bouvard "les Grosses Têtes" sur RTL,
émission que j'aime bien écouter, entre autres lorsque je fais de petits
travaux, comme préparer les insectes ...
A propos de je ne sais plus quoi, un des participants, Jacques Balutin je crois,
féru de randonnée cycliste, intervint soudain : "Ah, mais en France aussi il y a
des gens qui mangent les insectes. Un de mes amis qui se promenait à vélo il y a
quelques jours, du côté de Breuillet ou par là, m'a dit.... " - suivait le récit
qui précède, vu par le cycliste.
La date et l'endroit correspondaient et, d'après le cycliste, je devais être
passablement cinglé. Sur ce dernier point, j'étais déjà au courant, mais il n'y
a pas à dire, faire parler de soi aux "Grosses Têtes", c'est la consécration !!
(De notre cher et estimé collègue Jean-François Voisin dans
"Le Coléoptériste")
Parmi les captures
insolites effectuées en région parisienne,
celle d'un Batocera lineolata qui a
inspiré à notre collègue et ami Jean-Jean Menier les vers qui suivent :
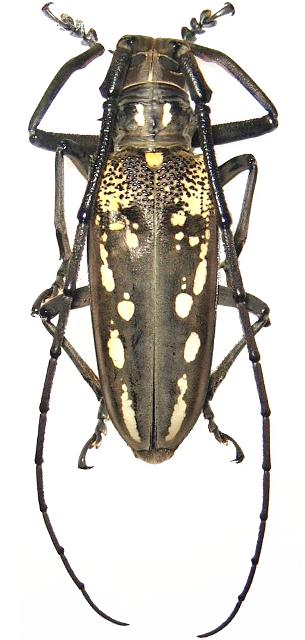 Le Canard et le Capricorne : Le Canard et le Capricorne :
Vert et doré de toutes les laques de l'Orient,
Maître Canard - dont l'origine est incertaine -
Était parvenu à nos rives par mille voies détournées.
Comme il sied à palmipède de son espèce,
De bois massif il était fait.
Par Dame Puill fut acheté,
Dans son logis sur un meuble posé.
Agréable ornement il devait cependant
Causer quelque frayeur à notre Dame,
Et rien ne semblait alors promettre notre Anas
À renommée qui méritât d'être contée.
Il apparu qu'un jour - longtemps plus tard-
Sous le ventre du palmipède,
Deux longues cornes dépassaient,
Se tortillant dans l'air et cherchant à sortir.
Las, le Canard fort lourd ne céda pas d'un pouce.
La Dame le souleva et fut fort effrayée
De voir un Capricorne de très honnête taille
- plus de deux pouces il mesurait -
Sortir tout de go et se mouvoir libre.
Vite, elle courut au Jardin pour consulter
Sur ce prodige.
Notre Rédac' Chef - expert es-capricorne s'il en fût -
Déclara que l'animal était connu
Depuis que Chevrolat en 1852
Le baptisa Batocera lineolata.
Il provient de Chine, du Tonkin ou de Nippon,
Où il est, dit-on, fort commun.
Sans doute une larve habitait le canard qu'avant d'être doré
Et avait trouvé moyen de venir à son terme,
En besognant galerie dans le corps de l'objet.
Moralité :
Voilà comment au cœur de la cité
L'ornithologie peut vous mener
À colliger
La Batocère linéolée.
(De notre collègue et ami Jean-Jean Menier, dans l'Entomologiste d'octobre
1992).
D'intéressantes rencontres à Paris ... :
Citons d'abord notre collègue et ami Henri Inglebert qui a
tant travaillé (et brillamment ...) sur le sujet :
"Je n'utilise qu'un piège U.V. simplifié sur mon balcon, dans le 20ème
arrondissement ; il est orienté en direction du cimetière, proche, du Père
Lachaise, sans grands immeubles faisant barrage. Ce cimetière, sous l'angle
entomologique, représente un espace vert de 42 ha avec de vieux arbres et une
grande variété de plantes et arbustes; on n'y utilise peu ou pas les pesticides,
fongicides ou autres, et peu d'arbres sont abattus; c'est donc un biotope
relativement stable (!!) , qui peut réserver des surprises [ ... ]. On voit
d'ailleurs souvent, sur les murs et trottoirs entourant le cimetière,
coléoptères, hémiptères, lépidos., ... J'ai donc décidé, cette année de piéger
de façon systématique sur mon balcon, de piéger (quand je le pourrai) dans les
espaces verts et de chasser à vue, au crépuscule et en début de nuit sous les
éclairages publics.
Ayant appris que la Ville de Paris avait fait faire un inventaire du square
Georges Brassens, j'ai demandé au responsable de l'étude la liste des
coléoptères. je le remercie de son amabilité. Il s'agit d'un square relativement
récent (anciens abattoirs de Vaugirard). Le piégeage au sol ou avec des assiettes
jaunes a fourni 53 espèces de coléos., dont je ne connaissais qu'une partie
comme "parisiennes". Dans ce même square Y. Cambefort m'a signalé cette année la
présence de Lucanus cervus L .
Sur mon balcon viennent aux U.V. toutes sortes d'insectes :
- 25 espèces de lépidos. [...].
- 17 espèces d'hémiptères en 3 familles [...].
- 242 espèces de coléos. en 46 familles [...].
[...] . Je ne peux prospecter seul tous les espaces vers de Paris. Si vous le
pouvez, prospectez en quelques uns."
Quelque temps après notre excellent collègue publiait son très intéressant
"Catalogue des Coléoptères de Paris Intra-muros" (Supplément du Bulletin de
Liaison de l'ACOREP de mars 1996)
D'autres insectes exotiques à
Paris :
Il est assez amusant de constater l'importation des insectes
exotiques dans les grandes villes. Le cas est classique dans les grands ports
maritimes. Certaines espèces se sont même par la suite acclimatées en France.
Tel est l'exemple de Laemosthenes janthinus Duft. qui se trouve dans le
O6 et le 04 et de Perigona nigriceps, ce rare carabique qui a été trouvé
une fois au Bois de Boulogne (en ce dernier lieu, on trouve aussi maintenant
beaucoup de mammifères bipèdes exotiques importés aux mœurs étranges ...).
Un de nos collègues, habitant Le Havre, obtenait l'autorisation, à chaque
arrivée de cargo, d'aller visiter les cales; il balayait tous les détritus se
trouvant au fond , mettait le tout dans des grands sacs de toile et, chez lui,
il triait tous ces débris; il a pu prendre ainsi toute une faunule de
carabiques, cérambycides, curculionides et chrysomèlides de diverses
provenances.
On rappellera les captures faites dans les entrepôts de bois du Fb. St. Antoine
d'un grand Elatéride phosphorescent (Phyrophorus ...) et d'un
Acrocinus longimanus. Plus récemment encore, notre collègue Hardy capturait
sur son balcon, Bd. Pereire, un très beau Cérambycide de Madagascar.
La toute dernière capture en date, tout aussi étonnante, est celle faite par
Mme. de Saint-Albin d'un scolyte du Japon pris au fauchoir à La Ferté-Alais.
[...].
Tout dernièrement, j'ai eu l'occasion, me trouvant à la gare d'Orléans-Messageries,
de capturer un fort bel insecte de la Famille des Cassidinae sur des bananes
provenant d'Afrique; cet insecte, originaire du Cameroun appartient au genre
Aspidomorpha.
(De notre collègue P. Grandchamp, dans le Bulletin de l'ACOREP
n° 30)
Le grillon du métro :
 À
peine plus gros que son cousin des campagnes, le grillon domestique (Acheta
domesticus), mesurant entre 16 et 20mm, n’a d’autre particularité apparente
que d’être aveugle. Les grillons domestiques (du métro) sont omnivores et se
nourrissent principalement de miettes, de détritus, de papiers gras, de brins de
laine, et même des mégots qui traînent sur les ballasts. Entre deux rames les
mâles stridulent pour attirer les femelles. Lorsque celles-ci approchent, les
mâles se réunissent entre les rails pour se défier au chant. Ceux qui stridulent
le plus fort font fuir les autres. Les grillons en viendront aux pattes si les
mauvais chanteurs refusent de décamper. Puis les mâles et les femelles grillons
restent là à attendre le métro. Quand la rame arrivera, ils se placeront sous le
rhéostat des voitures, là où l'air est le plus brûlant, pour se livrer à leurs
ébats romantiques. Quand on s’aperçut pour la première fois de leur présence
dans les souterrains du métro parisien, on ne leur accorda aucune importance.
Leur prolifération fut néanmoins si rapide que la municipalité lança un
programme pour les détruire jusqu’à ce que quelques scientifiques, qui s’étaient
penchés leur son cas pour étudier les mœurs de cette nouvelle espèce,
déclarèrent que le grillon du métro parisien était d’une importance majeure dans
l’écosystème des galeries. Ils démontrèrent en effet que le grillon, en se
nourrissant de tous les déchets qui jonchent les voies et les tunnels, était
devenu une sorte “d’éboueur écologique” dont il serait dommage de se passer.
C'est à la station Saint-Augustin qu'ils sont actuellement les plus nombreux et
les plus faciles à observer. Ils ne craignent que deux choses : les araignées
cracheuses de glu (Scytodes)
et les grèves qui font
refroidir les rails... !!! À
peine plus gros que son cousin des campagnes, le grillon domestique (Acheta
domesticus), mesurant entre 16 et 20mm, n’a d’autre particularité apparente
que d’être aveugle. Les grillons domestiques (du métro) sont omnivores et se
nourrissent principalement de miettes, de détritus, de papiers gras, de brins de
laine, et même des mégots qui traînent sur les ballasts. Entre deux rames les
mâles stridulent pour attirer les femelles. Lorsque celles-ci approchent, les
mâles se réunissent entre les rails pour se défier au chant. Ceux qui stridulent
le plus fort font fuir les autres. Les grillons en viendront aux pattes si les
mauvais chanteurs refusent de décamper. Puis les mâles et les femelles grillons
restent là à attendre le métro. Quand la rame arrivera, ils se placeront sous le
rhéostat des voitures, là où l'air est le plus brûlant, pour se livrer à leurs
ébats romantiques. Quand on s’aperçut pour la première fois de leur présence
dans les souterrains du métro parisien, on ne leur accorda aucune importance.
Leur prolifération fut néanmoins si rapide que la municipalité lança un
programme pour les détruire jusqu’à ce que quelques scientifiques, qui s’étaient
penchés leur son cas pour étudier les mœurs de cette nouvelle espèce,
déclarèrent que le grillon du métro parisien était d’une importance majeure dans
l’écosystème des galeries. Ils démontrèrent en effet que le grillon, en se
nourrissant de tous les déchets qui jonchent les voies et les tunnels, était
devenu une sorte “d’éboueur écologique” dont il serait dommage de se passer.
C'est à la station Saint-Augustin qu'ils sont actuellement les plus nombreux et
les plus faciles à observer. Ils ne craignent que deux choses : les araignées
cracheuses de glu (Scytodes)
et les grèves qui font
refroidir les rails... !!!
Plus tard, forts des résultats des études scientifiques, d’autres formèrent
des associations pour protéger le grillon. Dans les années 80, la direction du
métro parisien chercha à tirer parti de cette terrible voracité en favorisant la
reproduction des grillons pour en faire le principal nettoyeur des voies. Plus
tard, à l’aube des années 90, commencèrent de courir des bruits qui faisaient
allusion à une commande de la Ratp aux chercheurs du CNRS qui étudient les
moeurs du grillon. Il s’agissait, disait-on, d’un projet qui favoriserait
l’émergence d’une espèce de grillon créée en laboratoire, avec les mêmes
caractéristiques que celle qui fut découverte à l’origine dans les tunnels du
métro, mais plus grosse et plus vorace. Une espèce qui ne serait lâchée qu’à la
période des fêtes de fin d’année. En un mot, d’une espèce capable de dévorer les
suicidés du métro.
La
Ligue de Protection des Grillons du Métro Parisien (LPGMP), association
constituée en 1992, comprenant une centaine de membres, se propose de promouvoir
l'existence des grillons dans le métro et veille au maintien de leurs conditions
de vie. Elle revendique notamment la limitation en
durée et en fréquence des grèves qui ont pour effet de faire chuter la
température dans les galeries ainsi que l'assouplissement de la loi Evin qui,
par l'interdiction de fumer, prive les grillons de mégots, source importante de
nourriture.
Le cafard moscovite dans le rouge :
Autrefois, à
Moscou et dans les environs, tout le monde avait plein de cafards chez soi.
Pouchkine rapporte comment chez une dame, la vaisselle était confiée, une fois
les chandelles éteintes, à ces aimables insectes domiciliaires, qui se
précipitaient par centaines pour accomplir cette tâche avec délectation.
Aujourd’hui, le cancrelat se fait rare au point que l’inscription de certains
sur la liste des espèces en danger est sérieusement envisagée.
Les appartements communautaires soviétiques avec recoins et fuites d’eau étaient
leur paradis. Les immeubles et les meubles modernes ne plaisent pas aux cafards
russes traditionnels.
L’avenir de la Blatte orientale, Blatta orientalis, inquiète Alexander
Lagunov, entomologiste, qui réclame son classement. Jusqu’au milieu du XXe
siècle, c’était le cafard le plus banal chez les gens ; il était arrivé en
Russie avec l’invasion mongole (vers 1230) et les paysans le voyaient d’un bon
œil car il portait chance.
Introduite au XVIIIe siècle par des soldats depuis la Prusse, la Blatte
germanique, Blattella germanica, l’a supplantée petit à petit. Puis s’est
raréfiée ; sans doute s’est-elle déplacée dans les caves et les soupentes où il
fait désormais assez chaud. Pour A. Lagunov, l’espèce est à inscrire au livre
rouge et une population pourrait être installée au zoo de Tchéliabinsk. Au cas
où on en aurait besoin et pour ne pas répéter la pénible (il a fallu trois mois
de traque) récolte des 64 individus nécessaires à une mission spatiale, en 2007
(1).;
D’autres espèces prennent patte à Moscou, en envahisseuses, comme la Blatte des
meubles, Supella longipalpa (qui aime les équipements modernes) et la
Blatte américaine, Periplaneta americana (2), bien acclimatées .
Allez les tanks ! :
Après l'unification de l'Allemagne, fin 1990, les
entomologistes ont constaté que les anciennes zones militaires abritaient de
nombreux insectes que l'on croyait disparus. Explication : pendant les
manœuvres, les tanks arrachaient et broyaient la végétation comme le faisaient
jadis les bisons, aurochs et chevaux sauvages ! Les tanks ont ainsi recréé un
environnement favorable à des espèces qui avaient disparu avec les grands
herbivores.
(Science et Vie, en 1997)
Concours de bourdons voyageurs :
Surtout pratiqués en Flandre, les
concours de bourdons étaient aussi animés que ceux de pigeons voyageurs: on
prélevait des bourdons dans leur nid, on les munissait d’une marque
personnalisée, on misait sur leurs possibles performances, puis on les éloignait
de leur nid et on attendait leur retour avec impatience, le plus rapide
emportait la mise!
 Recette camérounaise : Recette camérounaise :
 Les chenilles au koko :
trempage : 12 h /
préparation : 20 mn /
cuisson : 35 mn Les chenilles au koko :
trempage : 12 h /
préparation : 20 mn /
cuisson : 35 mn
300g de chenilles séchées, 300g de graines de courges, 2 tomates, 2 oignons, 1
grande louche d'huile de palme, 3 paquets de feuilles de koko, sel, piment.
- Bien nettoyer les chenilles en enlevant les piquants (!); les faire bouillir
pendant 1 mn, les rafraîchir, les égoutter, les laisser tremper 1/2 journée dans
de l'eau tiède.
- Préparer une pâte lisse avec les graines de courges écrasées.
- Eplucher les oignons, les émincer et les faire dorer dans l'huile. Ajouter les
chenilles, les tomates hachées, le sel, le piment.
- Couvrir d'eau froide, porter à ébullition et laisser cuire 15 mn.
- Incorporer la pâte de courges, remuer, laisser cuire à nouveau pendant 15 mn.
-
Ajouter le koko lavé, cuit et égoutté, laisser cuire encore quelques minutes
puis servir chaud.
La ferme de coléoptères :
Pas n'importe quels coléoptères, mais une espèce particulièrement redoutable
d'aspect, les "lucanes cerfs-volants", un insecte noir de 2,5 à 6 cm de long, à
la tête hérissée de cornes et de pinces qui le font ressembler à un samouraï de
l'ancien temps.
 Toshio Imamura en possède actuellement plus de 100 000 qu'il livre
périodiquement dans les divers magasins de Nagoya, d'Osaka ou de Tokyo. Des
comptoirs spéciaux ont été ouverts et les enfants japonais viennent en masse les
acheter à raison de trois pour 100 yens. Ils les installent dans de petites
cages de bambou, les nourrissent et organisent des combats avec ceux de leurs
camarades. Toshio Imamura en possède actuellement plus de 100 000 qu'il livre
périodiquement dans les divers magasins de Nagoya, d'Osaka ou de Tokyo. Des
comptoirs spéciaux ont été ouverts et les enfants japonais viennent en masse les
acheter à raison de trois pour 100 yens. Ils les installent dans de petites
cages de bambou, les nourrissent et organisent des combats avec ceux de leurs
camarades.
- Je me suis toujours passionné pour les coléoptères, avoue Toshio, et étant
enfant je passais mes journées à en ramasser à travers les chemins et les
forêts. Si j'ai choisi de me spécialiser, c'est parce que le lucane est le plus
vigoureux, le plus combatif de tous et qu'il vit au moins deux mois. Je ne
m'attendais absolument pas à faire fortune avec ça ! J'étais seulement content
d'avoir trouvé un métier qui me permettait de poursuivre un rêve d'enfant.
Un rêve d'enfant qui a apporté en deux ans à son réalisateur la possession de
deux maisons, d'immenses terrains au sud de la capitale, d'un bateau et d'une
voiture américaine avec lesquels il va livrer son cheptel.
Les grands magasins ne sont pas moins satisfaits :
- Les coléoptères sont une excellente marchandise, sans surprises et qui ne se
démode pas, assure le sous-directeur du gigantesque Mitsukaschi de Tokyo. Et les
petits acheteurs amènent leurs parents qui deviennent nos clients. Nous nous
proposons même d'installer sur le toit du magasin un parc spécial, avec en
permanence 5 000 à 10 000 insectes pour que les enfants puissent les voir
s'ébattre en liberté et les choisir eux-mêmes. Cette passion qui fait fureur n'a
jusqu'ici rencontré que deux sortes d'opposants : les mères qui détestent
trouver de "repoussants" insectes jusque dans leur potage. Et les professeurs :
ils se sont aperçus que chaque fois qu'ils voyaient leurs élèves tranquilles et
visiblement occupés à réviser leurs leçons, ceux-ci étaient en fait occupés à
observer leur "poulain".
(Le journal "L'Aurore", en 1968, déjà...).
André GIDE coléoptériste :
"Vers l'âge de 8/9 ans je me suis intéressé à le Nature, à la botanique et plus
particulièrement aux coléoptères dont j'avais commencé de faire collection; et
mes poches étaient gonflées de boîtes et de tubes où j'asphyxiais mes victimes
de benzène ou de cyanure de potassium.
J'observais alors tous les insectes et leurs larves, particulièrement les
chenilles. A Paris, je tentai d'élever des vers à soies, ceux-ci ne coûtaient
pas si cher que les feuilles de mûriers pour leur nourriture, que je devais
aller prendre, deux fois par semaine, chez un herboriste de la rue St. Sulpice.
Dans le Midi, je chassais également les mantes religieuses, qu'on appelle là-bas
des "prega-diou" et dont les paquets d'œufs conglutinés et pendus à quelques
brindilles m'intriguaient si forts.
Je doute si jamais livres, musiques ou tableaux me ménagèrent plus tard autant
de joies, ni d'aussi vives, que ne faisaient, ces premiers temps, les jeux de la
matière vivante. J'étais parvenu à faire partager à Suzanne ma passion pour
l'entomologie; du moins me suivait-elle dans mes chasses et ne répugnait-elle
pas trop à retourner avec moi bouses et charognes à la recherche des
nécrophores, des géotrupes et des staphylins. Il faut croire que ma famille
finit par prendre en considération mon zèle car, si enfant que je fusse alors,
c'est à moi que l'on fit revenir toute la collection d'insecte de feu Félix
Archimède Pouchet, cousin germain de ma Grand'mère. Ce don de 24 boîtes à fond
de liège pleines de coléoptères, classés, rangés, étiquetés... je n'ai pas
souvenir qu'il m'ait fait un bien énorme plaisir. Car, dans ma pauvre
collection, combien m'était plus précieux chacun de ces insectes que j'y avait
épinglés moi-même, après les avoir moi-même capturés. Ce que j'aimais, ce
n'était pas la collection, c'était la chasse."
(André GIDE, "Si le grain ne meurt", 1927).
Ernst Jünger, écrivain
entomologiste :
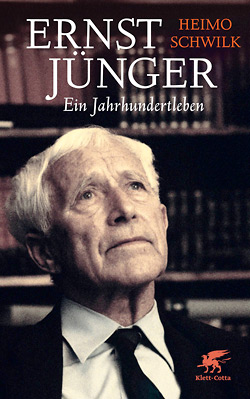 L'infiniment petit
nous apprend que le monde est immense. Et c'est dans l'univers pullulant et
gris des insectes, qu'il peut se manifester. Ernst Jünger, élève rêveur, l'a
compris très tôt. Sans doute après avoir découvert enfant, dans une sablière
de Rehburg une cicindèle chatoyante. Il croyait ramener chez lui une rareté,
500 de son espèce étaient déjà répertoriées. S'ouvraient ainsi les
Chasses subtiles, où Jünger découvrait, selon Claude Gaudin, "un acte
magique car jamais notre désir ne pourra se hausser jusqu'au trésor dont il
ne perçoit que la menue monnaie". L'infiniment petit
nous apprend que le monde est immense. Et c'est dans l'univers pullulant et
gris des insectes, qu'il peut se manifester. Ernst Jünger, élève rêveur, l'a
compris très tôt. Sans doute après avoir découvert enfant, dans une sablière
de Rehburg une cicindèle chatoyante. Il croyait ramener chez lui une rareté,
500 de son espèce étaient déjà répertoriées. S'ouvraient ainsi les
Chasses subtiles, où Jünger découvrait, selon Claude Gaudin, "un acte
magique car jamais notre désir ne pourra se hausser jusqu'au trésor dont il
ne perçoit que la menue monnaie".
L'apprenti entomologiste va se passionner immédiatement pour cet univers
invisible et infini, pour collectionner sans relâche les rencontres au cours
des différentes époques de sa vie. A tel point qu' il chasse au plus fort
des deux guerres mondiales. Ainsi s'émerveille-t-il en 1940 devant un couple
de typhées cornus, qui vaque à ses pieds. "Faut-il s'étonner si, en me
penchant vers ce couple menu, j'oubliai ma mission guerrière -le lieu, le
temps et la consigne? Des deux réalités, celle-ci était la plus forte."
Pour Jünger, la réhabilitation de ces animaux méprisés vient de ce que
le langage en a fait des êtres connus
et reconnaissables. Depuis sa première
cicindèle, l'entomologiste averti était devenu un familier des
nomenclatures. Nomenclatures auxquelles il adhère, selon Claude Gaudin,
comme à l'hypothèse de Platon dans le Cratyle : il existe entre le nom et ce
qu'il désigne un rapport de convenance profonde, la justesse. Et les noms
attribués aux insectes ont de la justesse, car ils ont été donnés par de
savants classificateurs. Grâce à eux, les insectes ne sont plus des signes
dispersés mais forment un alphabet.
"Doubler la pratique littéraire par la chasse aux insectes, ce n'est donc
pas ajouter une corde à un arc de l'écrivain, c'est faire l'apprentissage
d'un moyen de déchiffrement", conclut l'essai de Claude Gaudin. Le
rapport entre l'écrivain et l'entomologiste joue sur cette note là. Ainsi,
comme il se penche avec minutie sur le coléoptère infime mais étiqueté,
Jünger considère les lettres isolément comme des "signes plus puissants
que les textes qu'elles figurent". Avec elles, il rêve d'une écriture
dans laquelle serait visible le profil des choses. La leçon entomologique
enseigne ainsi qu'il faut libérer notre esprit des fausses associations, des
harmonies factices et partir à la conquête de l'unité des choses.
Les Chasses subtiles se ferment sur la "poussière irisée" où
finit toute collection. Dans leurs vitrines, il y a aujourd'hui des
scarabées, des papillons, baptisés d'après Jünger, et même une sous-espèce
de cicindèle, qui s'appelle jungerella.
Les insectes romains :
Plus de 5 000 espèces différentes d'insectes ont été recensées à Rome et sa
banlieue selon une monographie de plusieurs milliers de pages à laquelle ont
contribué plus de 90 spécialistes. Plus de 50% des insectes romains sont
constitués de coléoptères comprenant entre autres les scarabées, les
coccinelles, les staphylins et les lucioles.
Il y a aussi 500 espèces de papillons, 230 de fourmis, une vingtaine de puces
mais seulement 4 de cafards et 2 de poux... Cette recherche, présentée au Musée
de Zoologie de Rome est un instrument précieux pour la connaissance de l'habitat
et pour la planification urbaine de la capitale.
"Rome est la première métropole au monde à s'être dotée d'un tel instrument
riche en données et en suggestions pour des interventions sur l'environnement" a
estimé le professeur A. Vigna de l'Université de La Sapienza.
(AFP Sciences, en 1997)
Un paradis des
papillons :
En Equateur, sur 1 km² de forêt tropicale, volent
1 700 espèces de papillons ! C'est ce que viennent de découvrir deux
entomologistes américains; ils ont étudié ,entre autres, l'Anteros kupris, au vol très rapide, qui vit sur la
canopée à la recherche de partenaires; ou Anteros renaldus, dont les pattes semblent ornées de petits pompons. Certains imitent
l'apparence d'espèces dangereuses pour se protéger des prédateurs; ces
imitations ne sont pas toujours parfaites; c'est le cas pour le Stalachtis
phaedusa. Un Oleria quadrata, aux ailes transparentes, butine un
Aster; cette fleur contient des alcaloïdes qui donnent au papillon un goût
désagréable; le mâle transmettra cette protection à la femelle lors de
l'accouplement.
Arguments en faveur du gradualisme :
Ces dernières années, de magnifiques transformations anagénétiques lentes et
graduelles de séries d'espèces ont été observées par les paléontologistes. On
apprend que, contrairement à ce que l'on a cru longtemps, les espèces voisines
se croisent facilement dans un si grand pourcentage de cas, en donnant des
descendants fertiles (ce qui remet sérieusement en question la notion même
d'espèce...), qu'il est impossible de penser que leur constitution ait été
souvent un phénomène brusque. De très nombreuses observations sont là confirmant
ce gradualisme de la spéciation. La spéciation est en général un phénomène
continu de vitesse très variable, ce qui à peut-être parfois trompé les
partisans du "ponctualisme".
(D'après M. Delsol, 1995).
Entomologiste débutant :
Un étudiant qui devait présenter une boîte d’insectes identifiés
débarque auprès d’un assistant de la Faculté d’agronomie: il s’exclame
«Monsieur, j’ai trouvé une drôle de bestiole et je ne peux la classer… 12 pattes
et 4 ailes», ouvrant précautionneusement une petite boîte… un couple de
Mouche de St-Marc, tout à ses amours, nous apparut!
Les équilibres ponctués, ça existe aussi :
L'évolution n'est pas un long fleuve tranquille d'où
émergent, millénaires après millénaires, les espèces nouvelles. Elle peut aussi
s'emballer : un lézard de l'Adriatique en apporte une preuve des plus
éclatantes. 36 années ont suffi pour changer notablement la morphologie et les
mœurs du petit reptile,...
 Les lézards Podarcis sicula de l'île de Pod
Mracaru ne ressemblent plus à leurs ancêtres restés sur un autre îlot croate. En
36 ans, l'évolution a été fulgurante. Des mensurations précises le confirment :
ils sont plus grands d'environ 6 mm, leurs pattes plus courtes, ralentissent
leur course, leur tête est plus large et plus longue. pourquoi ces
transformations ? A cause de leur nouveau régime alimentaire, révélé par des
lavages d'estomac : jusque là principalement insectivores, ils mangent désormais
des plantes fibreuses; une nourriture plus abondante qui les a fait grandir et
rendus plus paresseux et plus paisibles. Les lézards Podarcis sicula de l'île de Pod
Mracaru ne ressemblent plus à leurs ancêtres restés sur un autre îlot croate. En
36 ans, l'évolution a été fulgurante. Des mensurations précises le confirment :
ils sont plus grands d'environ 6 mm, leurs pattes plus courtes, ralentissent
leur course, leur tête est plus large et plus longue. pourquoi ces
transformations ? A cause de leur nouveau régime alimentaire, révélé par des
lavages d'estomac : jusque là principalement insectivores, ils mangent désormais
des plantes fibreuses; une nourriture plus abondante qui les a fait grandir et
rendus plus paresseux et plus paisibles.
... mais aussi, découverte extraordinaire, le doter d'un organe digestif
totalement nouveau ! Certes, il ne s'agit pas encore d'une nouvelle espèce; mais
cette découverte n'en confirme pas moins que, contrairement à ce que les
biologistes pensaient encore il y a un demi-siècle, "l'évolution peut être
très rapide, sur des échelles de temps écologiques visibles par l'homme" ...
Gould avait donc vu juste :
Si
cette fulgurance biologique passionne les biologistes de terrain, c'est aussi
que sa portée théorique n'est pas négligeable; car elle confirme de façon
éclatante la clairvoyance des célèbres paléontologues américains Stephen Jay
Gould et Niles Eldredge; en 1972, les 2 compères avaient jeté un pavé dans la
mare en affirmant que l'évolution fonctionnait par à-coups et non par une
accumulation lente et imperceptible de changements. Dans cette théorie dite des
"équilibres ponctués", les petites populations
isolées en périphérie de l'habitat "normal" de l'espèce jouent un rôle moteur;
constamment sur le fil du rasoir écologique dans un milieu à la limite des
tolérances de l'espèce, ces populations subissent une pression intense et
doivent s'adapter très vite, formant de nouvelles espèces. ....
(Ce très bon article complet dans le "Science et Vie" d'août
2008)
 Le péril "jaune" : Le péril "jaune" :
Des quartiers résidentiels de Chicago et New York sont envahis actuellement par
le longicorne asiatique Anoplophora glabripennis, coléoptère qui a été trouvé
également, en moins grand nombre, dans des entrepôts de 12 états.
Cette espèce
proviendrait de Chine et aurait été introduite avec le bois de cageots et de
palettes utilisés pour l'emballage et la manutention de divers produits
d'importation. Les dégâts sont tels que les Etats-Unis exigent que les chinois
traitent toutes leurs caisses d'emballage avant exportation, le département
d'état américain de l'agriculture redoutant une acclimatation sur certains
arbres des forêts américaines. Les agences de presse chinoises indiquent que ces
mesures entravent fortement le commerce entre les deux pays, déjà atteint par la
crise asiatique.
(The Economist, 1998)
Classé "X" :
 En 1896, Henri
Gadeau de Kerville publie un article sur
l'observation de mœurs pédérastes chez les hannetons; l'auteur signale qu'il y
a deux sortes de pédérastie : la pédérastie par nécessité qui résulte du simple
manque de femelles et la pédérastie par goût quand l'accouplement entre mâles se
produit en présence de femelles ...! En 1896, Henri
Gadeau de Kerville publie un article sur
l'observation de mœurs pédérastes chez les hannetons; l'auteur signale qu'il y
a deux sortes de pédérastie : la pédérastie par nécessité qui résulte du simple
manque de femelles et la pédérastie par goût quand l'accouplement entre mâles se
produit en présence de femelles ...!
L'auteur donne ensuite des détails croustillants observés chez ces hannetons :
ces aimables insectes se livrent tout d'abord à quelques préliminaires; le mâle
jouant le rôle actif monte sur le dos du mâle passif et l'étreint de ses pattes,
puis se renverse sur le dos, les pattes plus ou moins repliées; ils ne tardent
pas à passer à l'acte et l'auteur nous révèle, dessin à l'appui que "celui qui
jouait le rôle actif dans la copulation avait son pénis solidement engagé dans
le cloaque de l'autre mâle..."!
L'auteur signale en outre qu'une des premières observations de pédérastie chez
les hannetons est due à l'Abbé Maze, en 1884, qui, après avoir longuement médité
sur le sujet, présenta une communication à la Sorbonne, publiée dans le Journal
Officiel (sans doute dans le but d'un appel à la protection des bonnes
mœurs...!).
Gilbert Lachaume, expert en
entomologie et voyageur philanthrope :
Expert en Histoire Naturelle à Drouot depuis près
de 25 ans, ce passionné de voyages parcourt l’Amérique latine pour
ses recherches sur la biodiversité des lépidoptères, forme des
étudiants en Bolivie et au Pérou pour les aider à classifier leur
extraordinaire patrimoine entomologique et se passionne pour les
rapports humains dans son métier . Interview.
Comment
devient-on entomologiste ?
 Par passion ! Depuis toujours, la
plupart des entomologistes sont autodidactes, sauf par exemple les
spécialistes d’entomologie médicale qui sont souvent médecins de
formation. Pour ma part, je viens d’une famille d’amoureux de la
Nature : mes grands parents cultivaient des plantes rares et mon
cousin m’envoyait régulièrement des papillons. Enfant, j’allais
souvent au bois de Vincennes, à l’époque où les pesticides n’avaient
pas encore tout ravagé et où l’on rencontrait encore de nombreux
insectes. Et puis il y avait Deyrolle. Au début des années 1960,
c’était un lieu fascinant où on pouvait passer des heures à observer
les papillons, tirer les tiroirs… C’était la liberté ! En me
privant, j’arrivais parfois à repartir avec un papillon dans une
boîte. Le bonheur ! Après une maîtrise de physique, j’ai ensuite eu
la chance de rencontrer des collectionneurs passionnés qui m’ont
permis de partir en Amérique latine chasser des papillons pour leur
compte. Lors de ces chasses nocturnes en Bolivie, au début des
années 1980, j’ai pu découvrir une trentaine de nouvelles espèces.
En 1982, j’ai posé ma candidature comme expert en histoire naturelle
suite au décès de Monsieur Groult, l’ancien propriétaire de Deyrolle
qui officiait à Drouot, et je suis devenu expert à 30 ans. Par passion ! Depuis toujours, la
plupart des entomologistes sont autodidactes, sauf par exemple les
spécialistes d’entomologie médicale qui sont souvent médecins de
formation. Pour ma part, je viens d’une famille d’amoureux de la
Nature : mes grands parents cultivaient des plantes rares et mon
cousin m’envoyait régulièrement des papillons. Enfant, j’allais
souvent au bois de Vincennes, à l’époque où les pesticides n’avaient
pas encore tout ravagé et où l’on rencontrait encore de nombreux
insectes. Et puis il y avait Deyrolle. Au début des années 1960,
c’était un lieu fascinant où on pouvait passer des heures à observer
les papillons, tirer les tiroirs… C’était la liberté ! En me
privant, j’arrivais parfois à repartir avec un papillon dans une
boîte. Le bonheur ! Après une maîtrise de physique, j’ai ensuite eu
la chance de rencontrer des collectionneurs passionnés qui m’ont
permis de partir en Amérique latine chasser des papillons pour leur
compte. Lors de ces chasses nocturnes en Bolivie, au début des
années 1980, j’ai pu découvrir une trentaine de nouvelles espèces.
En 1982, j’ai posé ma candidature comme expert en histoire naturelle
suite au décès de Monsieur Groult, l’ancien propriétaire de Deyrolle
qui officiait à Drouot, et je suis devenu expert à 30 ans.
Aujourd’hui, en quoi consiste
votre activité ?
J’étudie les problématiques de la biodiversité en
Amérique latine, pour le compte de musées français, péruviens et
boliviens. On redécouvre énormément d’orchidées, d’oiseaux et
d’insectes dans ces pays, dont le potentiel est encore méconnu.
Enormément de jeunes scientifiques en Amérique latine sont
sensibilisés à ces questions et je les aide à mettre en place leurs
travaux de recherche, par exemple dans le cadre du programme « Mariposas
andinas » lancé par des musées occidentaux.
Où peut-on voir de
beaux papillons ?

Chez Deyrolle ! Les collections
d’insectes des muséums sont réservées aux chercheurs, et protégés de
la lumière dans des tiroirs. Les couleurs des papillons s’estompent
à la lumière vive et les bêtes exposées sont perdues pour la
science, sauf pour les manifestations temporaires. Les pigments
rouges de certaines variétés peuvent ainsi blanchir en quelques
jours, contrairement aux ailes bleues des morpho, dont la couleur
résulte de l’incidence du rayon lumineux. Mais le manque
d’expositions d’insectes s’explique surtout par le manque de
budgets : l’Histoire Naturelle est devenue le parent pauvre de la
culture, alors qu’elle représentait un fondement de la connaissance
au 19eme siècle.
Comment se porte
le marché de l’entomologie ?
On compte quelques milliers de
collectionneurs, qui se retrouvent dans les bourses et dans le
réseau associatif, mais les ventes se font de plus en plus rares. Il
s’agit essentiellement de ventes de succession. Les collectionneurs
ont une démarche individualiste, qui exclut souvent les membres de
la famille, ce qui explique que celle-ci préfère s’en débarrasser au
moment de l’héritage ! Les pays anglo-saxons sont encore très férus
d’entomologie, comme ils l’étaient de botanique et de sciences
naturelles, mais l’essentiel des ventes à lieu en France.
Quelles sont les
sommes en jeu ?
Les prix des insectes ont
considérablement chuté depuis que les moyens d’accès vers les pays
tropicaux ont été facilités. A la fin du 19eme siècle, les
papillons, comme les orchidées, coûtaient de véritables fortunes.
Des familles comme les Rothschild investissaient des sommes
exorbitantes dans leurs collections, de l’ordre de plusieurs
immeubles victoriens ! Aujourd’hui, un Ornithoptera
rotschildi d’Indonésie vaut 40€, alors qu’il coûtait encore
4000F dans les années 1980. Les élevages, les techniques de collecte
et les transports ont fait baisser les prix, et le marché s’est
ouvert aux collectionneurs amateurs. Le record de vente des dix
dernières années est un agrias, qui a atteint
70.000F, mais lors des ventes aux enchères, la grande majorité des
lots part pour 100€ ou 200€.
Qui sont les collectionneurs de
papillons ?
Il y a beaucoup de personnages
passionnants et atypiques dans ce milieu, du simple amateur au
scientifique plus exigeant. Certains ont une démarche très pointue,
voire obsessionnelle, tandis que d’autres abordent l’entomologie en
esthète. L’étrange beauté des insectes a toujours attirée les
artistes, comme Breton et les surréalistes. Le rapport humain est
très important dans mon métier, la façon de collectionner dit
beaucoup sur la personnalité des collectionneurs.
Que
répondre à ceux qui trouvent les collections de papillon désuètes ?
Qu’il existe toujours des milliers
d’insectes inconnus et que la science a toujours besoin de
collections entomologiques, avec des données biogéographiques
précises, effectuées par GPS, pour comprendre et protéger la Nature.
Quels conseils
donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire votre métier ?
Il n’y a pas de formation spécifique
et les débouchés restent très limités, mais un diplôme en biologie
me semble indispensable. Aujourd’hui, je conseillerai de se tourner
vers l’entomologie agricole et les recherches de l’INRA,
l’entomologie médicale mais aussi la systématique, grâce à la
biologie moléculaire qui ouvre de nouveaux horizons de
classification. Les problématiques sur les nuisibles et l’utilisation
des insecticides sont de plus en plus passionnantes. Il existe aussi
de nombreuses associations et d’excellents guides qui accompagnent
l’amateur dans sa passion. Mais je conseillerais surtout de prendre
du plaisir à observer la diversité de la nature !
(un article de Noëlle Joly dans "Investir Magazine" de septembre 1999)
Chasser le papillon rare à Drouot :
"La chasse aux papillons ? Un art plus difficile qu'il n'y paraît !" s'exclame
l'expert Gilbert Lachaume. En effet, les plus fascinants lépidoptères vivent de
préférence dans de lointaines contrées, souvent dangereuses d'accès. Et leur
traque demande de solides connaissances ainsi qu'une patience à toute épreuve.
Les plus discrets ne sortent guère qu'une heure par jour. D'autres,
ultra-casaniers, élisent domicile à la cime des arbres pour ne plus en bouger.
Enfin, certains se déplacent à une telle vitesse qu'il est pratiquement
impossible de les attraper en vol. Pour toutes ces raisons, le prix des
papillons et autres insectes exotiques est longtemps resté prohibitif. Au début
du siècle, seuls quelques amateurs fortunés pouvaient se les offrir. Depuis une
trentaine d'années, la démocratisation des voyages et l'apparition de techniques
de chasse plus performantes ont entraîné une baisse très sensible des prix.
Conséquence : lors des ventes d'entomologie menées régulièrement à Drouot, des
lots composés d'une dizaine de papillons (ou d'autres insectes...) s'enlèvent
couramment à partir de 1 000 F. Une aubaine pour les collectionneurs.
Bon à savoir : les prix dépendent avant tout de la rareté. Du coup, toutes
sortes d'espèces hautes en couleurs, mais fréquentes sur le marché, demeurent
très abordables. Comme les scarabées d'or (Rutelinae !), originaires d'Amérique
Centrale, véritables petits bijoux aux reflets métallisés d'or blanc, vert,
jaune pâle ou feu. Si vous êtes amateur, comptez environ 3 000 F pour une
vitrine enfermant six spécimens.
Autres insectes de toute beauté, les curieuses sauterelles-feuilles. Reines du
mimétisme, aux ailes fines comme du papier à cigarette, elles prennent des
formes de feuilles, aux coloris subtils. En raison de leur grande fragilité, il
est bien rare de les trouver intactes. Ce qui explique leur prix relativement
élevé : de 3 000 à 5 000 F la boîte de six.
Si vous préférez les papillons, vous serez sans doute frappé par le bleu intense
des ailes du morpho. Particularité de ce prince des forêts tropicales d'Amérique
du sud : sa couleur dite "physique" est uniquement liée à la réflexion de la
lumière sur ses écailles. De fait, elle varie selon son orientation du mauve au
bleu-vert, au bleu électrique, en passant par des tonalités plus assourdies.
Très répandu, ce magnifique insecte se vend environ 50 F pièce; à condition
toutefois qu'il s'agisse du mâle d'une espèce commune; car la femelle vaut dix
fois plus. L'explication ? : le mâle multiplie les activités et se déplace
énormément; ce qui l'expose à être rapidement capturé; en revanche, la femelle
se cantonne aux parages de la plante nourricière et on la rencontre peu. Ce
schéma parfaitement conventionnel, concerne d'ailleurs peu ou prou toutes les
familles de lépidoptères. Sachez enfin qu'un morpho hermaphrodite, peu fréquent,
se négocie autour de 3 000 à 4 000 F.
Exercice de haut vol :
Cependant, certains papillons rarissimes peuvent parfois... s'envoler au delà de
10 000 F. Le 6 mai dernier, un Papilio werneri partait à Drouot pour la coquette
somme de 15 000 F. Pourtant ce spécimen, relativement terne avec ses ailes
sombres légèrement marquées de bleu et d'orangé, ne paie pas de mine; seule son
extrême rareté explique sa valeur. sa capture reste un exercice hautement
périlleux : p. werneri vit en Colombie, dans une région bien peu hospitalière où
la guérilla des FARC sévit, la pluie tombe en abondance et, pour couronner le
tout, l'insecte se plaît exclusivement au sommet des arbres...
Autre prix record, certes nettement plus ancien, mais néanmoins significatif :
en 1966, un Papilio allotei était disputé jusqu'à 10 500 F, toujours à Drouot;
ce qui représente 66 000 F actuels. "Aujourd'hui encore, cet hybride naturel
entre deux espèces partirait à prix d'or !" commente Gilbert Lachaume. A
condition de le retrouver !
Si les collectionneurs à l'esprit scientifique s'attachent uniquement aux
espèces rares, d'autres se montrent avant tout sensibles à la richesse
décorative des ensembles présentés; d'où la convoitise suscitée par certaines
boîtes offrant des compositions particulièrement éblouissantes; un point qui
contribue bien sûr à la montée des enchères. Tout comme la taille des sujets mis
en vente; il existe, à l'intérieur d'une même famille, des variations
d'envergure parfois très importantes; en raison de leur côté spectaculaire, les
spécimens géants sont nettement plus prisés.
Autre élément à prendre en considération, l'état de conservation des insectes,
très variable d'un lot à l'autre, qui peut entraîner des écarts de prix
importants. Mieux vaut éviter d'acheter des sujets en mauvais état ou réparés
avec les moyens du bord. Une fois la boîte ouverte, une observation attentive
permet de repérer une patte recollée ou une aile restaurée à l'aide d'un
fragment prélevé sur un autre spécimen.
Pour les conserver en beauté :
En dépit de leur apparente fragilité, papillons et autres insectes peuvent fort
bien se conserver durant de longues années. Pour preuve, des milliers de boîtes
détenues par des musées datant des 3 derniers siècles.
Cependant, pour leur garder tout leur éclat, quelques précautions s'imposent.
Prenez soin, tout d'abord, de les installer au sec; l'humidité provoque
l'apparition de moisissures entraînant des dommages irrémédiables. Ensuite,
n'oubliez pas de placer à l'intérieur des vitrines un produit antiparasite
(feuillet antimite, naphtaline...), à renouveler chaque année. Méfiez-vous
également de l'exposition prolongée à la lumière; celle-ci risque fort de ternir
les couleurs dites "chimiques", c'est à dire les rouges, les bruns et les
jaunes. Les couleurs "physiques", comme le bleu caractéristique des morphos, se
révèlent plus résistantes. Vous pourrez donc parfaitement exposer une boîte
emplie de morphos dans un endroit bien éclairé; mais c'est l'exception qui
confirme la règle...
Quelle que soit la beauté de votre collection, n'espérez pas trop la disperser
un jour en effectuant une plus-value substantielle : ce domaine en marge des
modes n'a rien de spéculatif; seuls les ensembles constitués au début du
vingtième siècle se revendent aujourd'hui à bon prix. Rassembler "insectes" et
papillons exotiques reste donc avant tout un plaisir.
L'entomologie
criminelle
: (ou entomologie médico légale ou
entomologie forensique)
"Cependant, si la biologie moléculaire est
devenue un outil essentiel, des disciplines plus classiques
continuent d’apporter leur contribution. C’est, de façon
surprenante, le cas de l’entomologie, science qui étudie les
insectes. La première affaire criminelle résolue avec l’aide des
insectes date du treizième siècle en Chine lorsqu’un assassin
fut trahi par les mouches attirées par l’arme du crime, sa
faucille. Toutefois, les bases de l’entomologie criminelle ont
été posées en France à la fin du dix-neuvième siècle par le
vétérinaire Jean Pierre Mégnin (1828-1905) qui publia en 1894
La Faune des cadavres. Dans cet ouvrage, il décrivait les
huit vagues d’insectes qui se succèdent sur les cadavres en
décomposition et dont l’étude permet de dater, souvent
précisément, la date de la mort. Un autre chercheur, Yovanovitch,
avait publié dès 1888 des planches en couleurs décrivant ces
animaux nécrophages trouvés sur les cadavres. Depuis cette
époque, les connaissances se sont affinées, notamment par
l’utilisation de modèles animaux. Aux États-Unis, il existe même
une Body farm (ferme des cadavres) où ces phénomènes sont
étudiés directement sur des cadavres humains placés dans
différentes conditions alors qu’en France on préfère utiliser
des cadavres de porc considéré comme un modèle fiable."
A visiter :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entomologie_médico-légale
Combien d'espèces d'insectes, combien d'espèces de Coléos ? :
"Les insectes, ainsi que d'autres arthropodes terrestres, sont si importants que
s'ils disparaissaient, l'humanité ne pourrait probablement pas durer plus de
quelques mois. La plupart des amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères
connaîtraient l'extinction à peu près dans le même délai. Ensuite disparaîtrait
la plus grande partie des plantes à fleurs, et avec elle la base physique de la
plupart des forêts et des autres habitats terrestres du monde. La surface des
continents se mettrait littéralement à pourrir. Tandis que la végétation morte
s'entasserait et se dessécherait, ce qui stopperait les cycles des substances
alimentaires, d'autres formes complexes de végétation mourraient, et avec elles,
presque tous les vertébrés terrestres. Les champignons, après avoir connu une
explosion formidable, déclineraient rapidement, et la plus grande partie de
leurs espèces disparaîtraient. La surface des continents reprendrait
approximativement l'aspect qu'elle avait au début du paléozoïque : le sol serait
recouvert d'un tapis de végétation pollinisée par les vents, parsemé de petits
bouquets d'arbrisseaux et de buissons, et largement dépourvu de toute vie
animale.
Générateurs de vie, les arthropodes nous entourent donc de toutes parts, sans
que nous sachions leur nombre exact. Il y a beaucoup plus d'espèces que les 875
000 ayant reçu un nom scientifique à ce jour. En 1952, Curtis Sabrosky, qui
travaillait pour le ministère américain de l'Agriculture, avança l'hypothèse,
sur la base du flot de nouvelles espèces qui se déverse sans arrêt dans les
muséums, qu'il devait y avoir environ 10 000 000 d'espèces d'insectes, la
biodiversité des autres arthropodes restant inconnue. En 1982, Terry Erwin
tripla la mise, estimant qu'il devait y avoir 30 000 000 d'espèces
d'arthropodes, dont une grande majorité d'insectes, rien que dans la forêt
tropicale. La plus grande partie de cette biodiversité se trouve dans la
canopée. Cet étage de feuilles et de branches, au niveau duquel se réalise la
plus grande partie de la photosynthèse, était déjà connu pour sa richesse en
variétés d'animaux. Cependant, il était resté inaccessible, à cause de la
hauteur des arbres, de la surface libre des troncs, et des essaims de fourmis et
de guêpes qui attendent les grimpeurs à tous les niveaux.
Pour surmonter ces difficultés, les entomologistes ont mis au point la technique
de la "bombe insecticide", consistant à envoyer, dans la cime des arbres depuis
le sol un nuage d'insecticide à action rapide, chassant les arthropodes de leurs
cachettes et les tuant. Ce protocole a été utilisé par Erwin en Amérique
centrale et méridionale, au cours d'interventions surtout nocturnes. Marchant le
soir dans la forêt tropicale humide, ils choisissaient un arbre, disposaient en
dessous de lui une série de bâches en entonnoir d'un mètre de large, reliées à
des flacons partiellement remplis d'alcool à 70%, liquide généralement employé
pour la conservation des spécimens. Le matin suivant, avant l'aube, au moment
où le vent tombait, l'équipe envoyait l'insecticide en l'air grâce à une sorte de
canon, et ceci, pendant plusieurs minutes. Puis les chercheurs attendaient
pendant cinq heures, tandis que les arthropodes morts ou en train de mourir
tombaient en pluie par milliers, nombre d'entre eux étant recueillis dans les
entonnoirs. pour finir, les spécimens ainsi collectés, étaient triés,
grossièrement classés en fonction des grands groupes taxonomiques et envoyés à
des spécialistes pour être étudiés de plus près.
Erwin lui-même a fait l'étude des coléoptères du couvert; il a effectué quelques
dénombrements sur un petit échantillon de forêt vierge du Panama, puis par
extrapolations successives, il a avancé une estimation du nombre total des
espèces d'arthropodes qui sont peut-être présentes dans les forêts tropicales
du monde entier. Il a donc recensé 163 espèces de coléoptères vivant
exclusivement dans la couronne des arbres d'une seule espèce d'arbre,
Luehea seemannii, une légumineuse. Il existe à peu près 50 000 espèces d'arbres
tropicaux en tout, de sorte que si Luehea seemannii
est un exemple moyen, le
nombre total des espèces de coléos. tropicaux habitant le couvert forestier
serait de 8 150 000. Les coléoptères représentant environ 40% du total des
arthropodes. Si cette proportion est la même dans tout le couvert tropical, le
nombre d'espèces dans cet habitat doit être environ de 20 000 000 ; comme il y a
environ deux fois plus d'espèces d'arthropodes dans le couvert de la forêt
vierge que sur le sol, le nombre total d'espèces pourrait bien être de l'ordre de
30 000 000 pour la seule zone tropicale humide...".
("La Diversité de la Vie" de l'éminent Edward O. Wilson)
Plus récemment : Une étude semblable
mais plus récente, menée cette fois dans une forêt équatoriale humide de
Nouvelle-Guinée, porte cette estimation à 4 millions d'espèces d'insectes
seulement. Cette équipe de chercheurs a observé que la monophagie stricte, c'est
à dire la consommation par un insecte d'une seule espèce végétale, reste rare.
L'extrapolation est ainsi bien plus modérée. Il resterait quand même plus de 3
millions d'insectes à décrire et à nommer. Les entomologistes ont encore du pain
sur la planche.
A peu près la même information : Une
étude lancée par la NSF (National Science
Foundation) et publiée dans Nature
relance donc le débat en avançant un chiffre de seulement 4 à 6 millions;
les recherches ont été basées sur des données relatives aux rapports entre 900
espèces d'insectes et 51 espèces de plantes des forêts de Nouvelle-Guinée. A
l'aide de savantes équations intégrant données écologiques et génétiques, les
chercheurs sont arrivés à ce nombre réduit par rapport aux estimations
précédentes.
Ces chiffres, très théoriques, risquent
malheureusement de ne jamais être atteints. En effet, les riches forêts
tropicales où se concentrent les plus gros bataillons des insectes sont partout
surexploitées pour le bois et pour laisser la place à de
médiocres terres agricoles devant la pression démographique engendrée par
l'augmentation (intolérable) de la population mondiale. Chaque jour qui passe,
des dizaines d'espèces d'insectes, mais aussi d'autres animaux, de plantes, de
champignons, de bactéries disparaissent à jamais. On dit que lorsque meurt un
Ancien en Afrique, terre de culture orale, c'est une bibliothèque qui brûle.
C'est un peu la même chose quand disparaît une espèce vivante. L'agencement
original de son matériel génétique, résultat de centaines de millions d'années
d'évolution, disparaît à jamais. Cette érosion régulière de la biodiversité,
sans comparaison par son ampleur avec les grandes extinctions de la fin de l'ère
primaire et de l'ère secondaire, est l'un des signes majeurs de l'influence
négative de la pression humaine sur la biosphère dont nous dépendons pour vivre.
Qu'on arrête de se
multiplier !!
Qu'on arrête de persécuter
les entomologistes qui essayent de capturer et de décrire le plus grand nombre
d'espèces avant qu'elles ne disparaissent !!
Avec près
de 350 000 espèces recensées,
les coléoptères
représentent plus de 25% des formes de vie sur la planète. Les
raisons qui expliquent cette étonnante diversité font l’objet de
multiples recherches.
Mieux vaut éviter d’étudier trop longtemps la classification des
coléoptères sinon la migraine risque de poindre vu le fouillis
organisé qu’y règne : pas moins de 4 sous-ordres, 17 superfamilles
et 168 familles !!! Et les distinctions entre un grand nombre de ces
groupes ne sont pas tout à fait claires. Afin de remettre un peu
d’ordre dans ce fatras, une équipe de l’Imperial Collège de Londres
et du Muséum d'histoire naturelle a comparé le patrimoine génétique
de près de 2000 espèces recouvrant 80% des familles de coléoptères.
Les scientifiques ont ainsi pu reconstruire un nouvel arbre évolutif
regroupant espèces actuelles et fossiles.
Si ce nouveau classement n’a pas profondément modifié le précédent
issu de données morphologiques et anatomiques, il bat néanmoins en
brèche l’idée selon laquelle l’extraordinaire diversité des
coléoptères serait due à l’apparition des plantes à fleurs (il y a
140 millions d’années) qui auraient offert abris et nourriture en
abondance à ces insectes. En effet, il apparaît que de nombreuses
lignées de coléoptères modernes sont apparues bien avant autour de
300 millions d’années avant notre ère, à peu près à la même époque
que les dinosaures.
Le grand nombre d’espèces de coléoptères s’expliquerait plutôt par
une importante survie des premières lignées ainsi par une grande
adaptabilité leur permettant d’occuper une importante variété de
niches écologiques. Lors de l’apparition des premières plantes à
fleurs, il existait déjà une centaine de variétés modernes de
coléoptères. Le rôle des plantes n’est pas encore élucidé mais elles
ont très certainement contribué à la spéciation des espèces et à
leur évolution, tant d’insectes dépendent des plantes qu’il existe
forcément un lien entre elles et les coléoptères.
Ce nouvel « arbre généalogique » fait l’objet d’un article publié
aujourd’hui dans la revue Science. L’analyse de l’évolution des
coléoptères est un élément important de compréhension du vivant.
Elle procure des pistes aux spécialistes qui étudient la
biodiversité et la structure évolutive des espèces. Avec 300
millions d’années d’histoire, ils ont de quoi faire…
Combien d'espèces d'insectes
en Europe ? Et en France ? :
On compterait environ 50 000 espèces en Europe et 36 000 en
France.
En France, environ 9 500 espèces de coléos (100 de Coccinelles, 1 000 de Charençons), 8 000 espèces d'hyménos (plus de 1 000 espèces d'abeilles ...), 6 500 espèces de diptères, 5 000 espèces de lépidos (seulement
250 de jour...), 3 500 d'hémiptères, 90 espèces de libellules. 112
espèces sont protégées.
(Et 1 500 espèces d'araignées en France).
Une journée mémorable :
Ce fut le 14 août 1944. Donc, quelques jours seulement avant
l'entrée dans Paris des troupes alliées.
A l'époque, quelques bons amis lépidoptéristes et moi, nous efforcions
d'utiliser systématiquement nos fins de semaine, ou autres jours de liberté, à
des excursions entomologiques aux environs de Paris. Les seuls moyens de
transport étaient alors le train et la bicyclette.
"A quelque chose malheur est bon !" ... dit le proverbe, et de fait, on ne
rencontrait pratiquement personne dans ces déplacements. La nature était belle,
intacte, et les saisons de ces années 1942-1950 ont laissé en moyenne des
souvenirs entomologiques très satisfaisants
toujours est-il que ce fameux 14 août régnait une activité militaire assez
exceptionnelle, notamment dans le domaine aérien. D'importants mouvements des
troupes d'occupation avaient lieu vers l'est, et la veille - si mes souvenirs
sont exacts- nous fûmes avisés que seule la gare de Lyon serait ouverte au
public le lendemain, les 5 autres grandes gares devant restées fermées.
Or, il s'agissait par ailleurs d'une date parfaite pour nous rendre compte si le
fond du champ de tir de Fontainebleau hébergeait toujours - entre autres choses
- la lycène idas armoricana Oberthür. Ce fut également l'avis de mes bons
amis : le Dr. Henri Oberthür, son beau-frère, Georges Carlioz, et Gérard Nobel
tous trois disparus aujourd'hui hélas !! ...
Aussi gagnâmes-nous tous les quatre, au jour dit, la gare de Lyon sur nos vélos
que nous déposâmes à la consigne avant de prendre l'unique train quittant Paris
ce jour-là, avec Fontainebleau pour terminus (et qui, fort heureusement, devait
nous ramener le soir !! ...). Il n'y avait presque personne ... et nous ne
pouvions nous empêcher de regarder ce qui se passait dans le ciel !! ...
Arrivés à Melun, le train roulait au ralenti, et à moins de 100 m de la voie, la
queue d'un avion de chasse Messerschmidt tout fumant, sortait d'un petit
pavillon, sur lequel il venait visiblement de s'écraser ! Dieu veuille que les
habitants du pavillon aient été absents ! ...
A Fontainebleau, nous gagnâmes rapidement le carrefour de l'Obélisque pour
prendre à droite la route de Malesherbes, laquelle coupe le champ de tir. La
circulation militaire était assez intense. entre le carrefour et le champ de tir
- espace alors boisé - deux escouades de fusils mitrailleurs étaient "enterrées"
en position de tir de chaque côté de la route, et défendaient, en direction de
Malesherbes, l'accès du carrefour. un sous-officier s'exerçait au revolver sur
de vieilles boîtes de conserve placées sur une souche à quelques mètres de là.
Je dois avouer que lorsque nous les dépassâmes avec nos filets à papillons
déployés, nous nous jetâmes un coup d'œil en coulisse, nous sentant un peu
gênés, et nous attendant vaguement à être interpellés ... Mais il n'en fut rien.
Nous tournâmes à droite 100 m plus loin, dans le champ de tir vers les buttes,
là où nous comptions trouver nos bestioles. Il faisait une de ces belles
journées d'été, sans grands nuages, et la densité des papillons était vraiment
très élevée ... mais l'activité aérienne de l'aviation de chasse était
continuelle et l'on entendait régulièrement les rafales de mitrailleuses - oh !
combien rapides ! - de combats aériens. La forêt devait flamber certainement un
peu, car de là où nous étions, on voyait dans deux directions s'élever au loin
des colonnes de fumée ...
Quoi qu'il en soit, ceux que nous étions venus chercher étaient au rendez-vous,
qui plus est en parfaite condition. D'autres spécialités du lieu comme les
satyres hermione et statilinus, ainsi que l'arethusa,
étaient également présents, le premier aux femelles encore acceptables. De très
belles femelles syngrapha de la lycène corindon étaient nombreuses
ainsi que d'autres espèces de la saison. Mais la capture la meilleure - et
inattendue ! - fut certainement l'hespérie cirsii Rambur, que nous
n'avions jamais rencontrée encore aux environs de Paris, et dont je contemplais,
surpris, un beau spécimen dans mon filet !! ... A ce moment précis, un
crépitement suraigu de mitrailleuses d'avion éclata à quelques cinquante mètres
au dessus de nous, à la lisière de la forêt où nous nous trouvions, et nous
eûmes à peine la vision fugitive d'une silhouette d'avion de chasse en
poursuivant probablement un autre au ras des arbres dans un fracas assourdissant
!!!
"Il faudrait tout de même qu'il y en ait un de nous qui surveille les
"taxis" !!! ..." , phrase textuelle - et indignée - prononcée alors sans rire
par Nobel, lequel venait de capturer lui aussi, à sa grande surprise, un autre
cirsii ! ... Personne, bien entendu ne se soucia pour autant des "taxis"
! ... Il faut dire que 8 jours plus tôt - le 7 août exactement - Nobel et
Oberthür, prospectant le plateau de St. Mamès, près de Moret, s'étaient
brusquement trouvés dans la trajectoire d'un chasseur américain "Lightning"
descendu en rase-mottes mitrailler leur train resté sur une voie de garage, à
quelques centaines de mètres de là. Mes amis avaient donc exécuté un superbe
plat ventre avec un ensemble parfait et sont rentrés le soir dans un train
jonché d'éclats de verre !
Pour en revenir aux cirsii, Nobel et moi eûmes la chance, dans la
journée, d'en reprendre chacun trois exemplaires mâles. Ils sont tous
aujourd'hui dans ma collection avec, du reste, toutes les Hespérides de la
Collection de Gérard Nobel, ami charmant, compagnon parfait et lépidoptériste
très habile
Vers midi, nous étions revenus au début de l'agglomération dans un petit
restaurant qui nous avait assuré le matin pouvoir nous servir quelque chose pour
compléter nos bien maigres provisions. L'endroit était bourré de militaires,
plus occupés à regarder leurs cartes et à se rafraîchir qu'à nous prêter
attention. Pour notre part, nous nous sentions très détendus, voire même
passablement gais ! ...
Après déjeuner nous sommes retournés au champ de tir. Les fusils mitrailleurs et
leurs servants étaient toujours en place, attendant l'assaillant. Le gradé avait
disparu.
Notre après midi fut euphorique. C'est alors que nous complétâmes les deux
cirsii du matin et fîmes quelques bonnes captures, y compris, bien sûr, la
lycène idas armoricana au pied des buttes de tir, où elle était
abondante.
Nous étions assez éloignés de la gare de Fontainebleau, et nous n'étions pas
très sûrs de pouvoir revenir à Paris. Aussi, nous arrachâmes-nous à ce
merveilleux endroit pour arriver à la gare une heure après.
Nous n'avions plus éprouvé d'alertes nécessitant "la surveillance des taxis ",
sauf peut-être une ?? ... Je ne m'en souviens plus.
Ce dont je me souviens très bien par contre, c'est d'avoir, ainsi que mes amis,
récupéré nos vélos après 21h à la gare de Lyon et d'être revenus rive droite par
les quais, mis soudain à sens unique par les occupants dont les véhicules
roulaient sur quatre rangs en sens inverse du nôtre, tous feux éteints (comme
nous, du reste !...). Je n'ai jamais entendu autant de jurons et d'imprécations
germaniques pour nous éviter dans une demi-obscurité ! Comment sommes-nous
arrivés intacts place de La Concorde ?? Je l'ignore ! ... Toujours est-il que
nous avons tous les quatre dormi dans notre lit.
Ce fut vraiment une journée mémorable !... A tous points de vue !!
(De notre cher H. de Toulgoët ...)
L'origine des coléoptères :
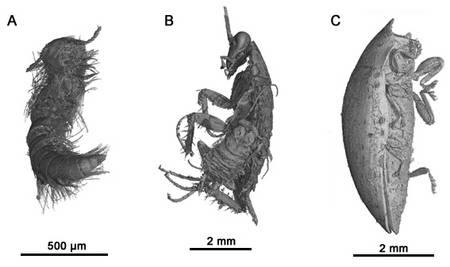 Au commencement, et ce commencement se situe au Permien inférieur, il y a
quelque 200 000 000 d'années, après des tâtonnements qui n'ont semble-t-il pas
laissé de descendants, de vrais coléoptères apparaissent pour la première fois
en Asie centrale. Tel est la leçon que nous apporte pour l'instant la
paléontologie. Au commencement, et ce commencement se situe au Permien inférieur, il y a
quelque 200 000 000 d'années, après des tâtonnements qui n'ont semble-t-il pas
laissé de descendants, de vrais coléoptères apparaissent pour la première fois
en Asie centrale. Tel est la leçon que nous apporte pour l'instant la
paléontologie.
Ces premiers coléos. appartiennent au sous-ordre des Archostemata qui ne compte
plus qu'un faible nombre de représentants vivants.
Au Trias, les gisements de la même région fournissent encore une proportion
importante d'Archostémates (plus de 50%...) et, parmi ceux-ci, la famille des
Cupédidae domine nettement. Ainsi à Djajlyaucho, on a pu reconnaître la présence
de 29 espèces de Cupédides, 16 espèces de Schizophorides (réparties en dix
genres, ce qui marque déjà une considérable diversification), quelques
Tricoléides, Adémosynides et Canitides. Mais à cet étage, à côté des
Archostémates, les deux autres sous -ordres principaux constituant aujourd'hui,
pour l'essentiel, l'ordre des Coléos., apparaissent : les Adéphages sont alors
connus par des Carabides et des Trachypachyides; les Polyphages par des
Elatériformes (Protoagrypnides et Préélatérides).
A partir du Jurassique moyen d'Asie centrale, et surtout du Jurassique
supérieur, un changement brutal semble se manifester. Certes les Archostémates
sont encore nombreux (10% des restes retrouvés au Kazakhstan), avec toujours une
nette domination des Cupédides, mais ils sont manifestement en régression. Les
Adéphages se diversifient, avec l'apparition, dès le Jurassique moyen, des
Parahygrobiides, des Coptoclavides et des Gyrinides, tous trois aquatiques; ils
en viennent à former 10% de l'ensemble de la faune au Jurassique supérieur.
A ce moment, les Polyphages sont en pleine expansion et on peut y reconnaître
des Staphyliniformes, des Elatériformes, des Cucujiformes, des Scarabéiformes et
des représentants des Cléroides, des Chrysomélides et des Curculionides, avec
des Eubélides.
Après ce premier saut qualitatif, un nouveau seuil de rupture est constaté en
Sibérie, au Crétacé inférieur : on retrouve bien encore des Coptoclavides parmi
les Adéphages, mais les Polyphages sont beaucoup plus diversifiés, avec la
brutale multiplication des Scarabéoides et l'apparition, sous des formes bien
reconnaissables, de la plupart des familles actuelles. On peut admettre qu'à la
fin du Crétacé, la faune des Coléos. est résolument moderne.
Alors que les faunes permienne et jurassique n'étaient connues que de stations
peu nombreuses et assez localisées, la faune crétacée, elle, est présente sur
toute la surface de la Terre.
On peut donc considérer que, prise dans son sens actuel, l'expansion de l'ordre
des Coléoptères s'est produite à partir du Crétacé moyen.
Les découvertes récentes de la Biologie Moléculaire tendent à
prouver que les insectes ont une parenté étroite, non plus avec les Myriapodes,
mais avec les crustacés; les premiers insectes seraient donc des crustacés
adaptés à la vie terrestre ...
Un dinosaure insectivore :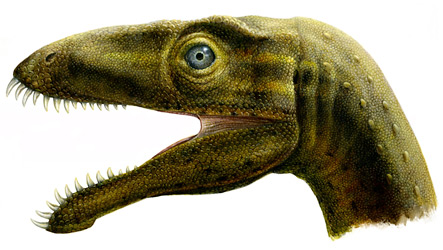
On apprend la découverte d'un dinosaure insectivore;
Masakiasaurus knopfleri, ou "le dinosaure vicieux du fondateur de Dire
Straits", sur les airs duquel (!!) ce fossile aurait été découvert à
Madagascar. Ce "monstre" (bien qu'il ne mesure que 1,80 m de long ...) de la fin
du Crétacé présente 4 dents très proéminentes à l'extrémité de sa mâchoire, dont
2 sont presque horizontales; ce qui fait dire à ses découvreurs qu'on aurait
affaire à un dinosaure insectivore. Ce qu'admet bien volontiers notre confrère
Philippe Taquet et qui nous rassure sur "l'effet média" que cette découverte
pourrait présenter. Cette découverte , la première dans le monde prolifique des
dinosaures, tendrait à prouver qu'au Crétacé l'entomofaune était suffisamment
diversifiée et riche pour subvenir aux besoins énergétiques de tels animaux.
("Libération" du 25 janvier 2001)
Un indien philosophe :
Nous n'avions plus maintenant qu'un seul marin, le Mamaluco, qui, en dépit de
ses dispositions acariâtres, travaillait bien lorsqu'il n'était pas sous
l'influence du cachaça - Chose qui lui arriva deux ou trois fois quand il
profitait de mon absence pour puiser à ma dame-jeanne - . Son aspect déjeté
était une preuve de l'amour immodéré qu'il portait habituellement aux boissons
fortes. Philosophe à sa manière, il me divertit souvent de ses vues cyniques sur
la vie. Il paraissait alors aussi "désillusionné" qu'un roué de la ville ou que
l'Ecclésiaste lui-même. Un soir, couché sur le pont, il regardait un cafard qui
se débattait pour se libérer de sa vieille enveloppe. Lorsqu'il y parvint
finalement, il paraissait faible et titubant mais propre et blanc comme un sou
neuf. Notre Maître Jacques éprouva alors le besoin de moraliser :
-"Comment se fait-il que presque tous les animaux, à l'exception de l'homme,
renouvellent, à des saisons données, leur jeunesse et leur beauté ? Les oiseaux
muent, les serpents changent de peau, même ce misérable petit "bicho", ce cafard,
rejette son ancienne peau. Tous deviennent ainsi aussi beaux et magnifiques
qu'aux jours de leur jeunesse; mais nous, - et il jeta un regard désolé à sa
vieille main toute ridée - nous devenons chaque année plus laids et plus fanés,
et cette peau dans laquelle nous sommes nés doit nous servir jusqu'à l'heure de
notre mort ".
("Voyage au Rio Negro" de l'illustre Richard Spruce)
Les voitures aussi, tuent
les insectes, ou, les voitures tuent aussi
les insectes... :
 Compte tenu du réseau routier et du parc automobile, l'utilisation des plaques
engluées a permis de montrer que plus de 66 billions d'insectes (66 000 000 000 000...) peuvent être tués chaque année par collision avec les voitures sur les
seules routes de France. A ce premier chiffre, il faut ajouter environ 40 tonnes
d'insectes tués et projetés sur les bas côtés. Ce chiffre, compte tenu de la
disparition et du renouvellement des cadavres, peut être multiplié par quatre ou
cinq pour l'année, ce qui représente 120 à 200 tonnes de matière animale déposée
annuellement. La période de la journée au cours de laquelle les insectes sont
les plus vulnérables se situe dans la tranche horaire 13-18 h. La mortalité est
plus élevée en zone boisée qu'en zone cultivée ou urbaine. Compte tenu du réseau routier et du parc automobile, l'utilisation des plaques
engluées a permis de montrer que plus de 66 billions d'insectes (66 000 000 000 000...) peuvent être tués chaque année par collision avec les voitures sur les
seules routes de France. A ce premier chiffre, il faut ajouter environ 40 tonnes
d'insectes tués et projetés sur les bas côtés. Ce chiffre, compte tenu de la
disparition et du renouvellement des cadavres, peut être multiplié par quatre ou
cinq pour l'année, ce qui représente 120 à 200 tonnes de matière animale déposée
annuellement. La période de la journée au cours de laquelle les insectes sont
les plus vulnérables se situe dans la tranche horaire 13-18 h. La mortalité est
plus élevée en zone boisée qu'en zone cultivée ou urbaine.
A la suite d'une initiative de la Société Royale de
Protection des Oiseaux, un projet intitulé Big Bug Count a été lancé et 40 000
anglais se sont ingéniés à compter les insectes écrasés sur leur plaque
minéralogique. Cette étude est destinée à vérifier l'observation de la
raréfaction des insectes et des oiseaux insectivores en Grande-Bretagne. ("Le
Figaro" du 16 septembre 2004)
Distraction :
Ensure, assureur britannique, a calculé (par extrapolation d’une enquête faite
auprès d’un millier de personnes) que les insectes sont responsables de 650 000
accidents d’auto par an, en distrayant les conducteurs. La présence d’un insecte
dans la voiture perturbe 75% d’entre eux. 4% pilent, 21% lâchent le volant d’une
main pour tenter d’évacuer l’intrus (sans freiner, eux). La guêpe fait plus peur
que frelon (52 contre 14%).
La bonne réaction, si l’on ne supporte pas ce genre de compagnon de voyage, est
de s’arrêter et d’ouvrir les vitres, le tout calmement. La prévention : rouler
climatisé.
Ensure vend un filet (moustiquaire renforcée) à poser à la place de la vitre
ouverte.
 Un coléoptère plutôt "chameau"
: Un coléoptère plutôt "chameau"
:
Un Ténébrionide Stenocara sp., habitant le désert de
Namib, filtre le brouillard du matin au moyen de ses élytres pour recueillir des
gouttelettes d'eau : encore un magnifique exemple d'adaptation !
Un "scarabée" détecteur
d'incendies :
 Le Buprestide
(ce n'est donc pas un scarabée !) Melanophila acuminata repère les feux
jusqu'à 80 km de distance en détectant les rayons infra-rouges émis par le bois
en combustion. Le Buprestide
(ce n'est donc pas un scarabée !) Melanophila acuminata repère les feux
jusqu'à 80 km de distance en détectant les rayons infra-rouges émis par le bois
en combustion.
Ses larves, ne peuvent se développer que dans le bois d'arbres récemment
détruits par le feu. Repérer un incendie est donc pour les adultes une simple,
mais primordiale, question de survie.
Dès 1937, des spécialistes avaient observé une paire d'organes située sur le
thorax de l'insecte. Les expériences comportementales et physiologiques
ultérieures ont alors révélé leur incroyable sensibilité aux infrarouges, très
pratique pour la détection d'un feu de forêt. Plusieurs hypothèses furent
ensuite émises quant à l'aptitude des Melanophila de sentir la fumée, mais
aucune preuve tangible ne fut avancée.
C'est maintenant chose faite grâce aux travaux de l'équipe de Stefan Schütz et à
ceux de l'équipe de Horst Bleckmann. En reliant une antenne fraîchement excisée
de Melanophila acuminata à un chromatographe en phase gazeuse équipé d'un FID (flame-ionization
detector) et d'un électro-antennographe, les chercheurs allemands ont pu
enregistrer les réactions de l'organe aux substances émises par la combustion du
bois. Selon eux, les antennes sont particulièrement sensibles aux phénols ; les
dérivés du guaiacol (2-methoxyphénol) provoquant la plus forte réponse. Les
antennes des coléoptères peuvent déceler les phénols méthoxylés, rejetés par la
combustion incomplète de la lignine, à de très basses concentrations (ppb :
quelques parties par milliards).
Ce récepteur infaillible pourrait également servir, non seulement à trouver les
incendies, mais également à savoir quel type d'arbre brûle ! "De la même façon
que les vipères et les serpents sensibles aux infrarouges utilisent des
chémorécepteurs situés sur leur langue pour détecter les substances libérées par
leurs proies, les coléoptères Melanophila useraient de leurs chémorécepteurs
pour sentir les molécules volatiles spécifiques au bois en combustion.
Les connexions entre les deux systèmes, antennes et récepteurs thoraciques,
demeurent cependant très vagues.
Cela écrit, toutes les spéculations quant à la possible utilisation des qualités
de ces insectes en matière de prévention des incendies de forêt sont assez
fantaisistes puisque les insectes ne détectent des fumées ou des incendies que
quand ceux-ci sont déjà bien avancés, voire quand les arbres ne sont plus que
des troncs calcinés et fumants.
Chaud sapin :
Leptoglossus occidentalis (Hem. Coréidé) ponctionne les graines des
conifères. Cette punaise détecte à distance les cônes en formation grâce à des
récepteurs sensibles à l’infrarouge. En effet, les cônes sont plus chauds que
les aiguilles – ils conservent mieux la chaleur du jour et sont le siège d’un
métabolisme plus élevé.
On connaît de nombreuses plantes qui produisent de la
chaleur au niveau de leurs fleurs : leur parfum attirant pour les pollinisateurs
est renforcé. Les Coléoptères pyrophiles, comme le Bupreste pyromètre,
Melanophila acuminata, repèrent les bois incendiés aux IR émis, de même que
des punaises hématophages comme Triatoma ou Rhodnius (Hém.
Réduviidés) trouvent le vertébré à sang chaud.
C’est la première fois qu’on met en évidence ce genre de détecteur chez un
insecte phytophage.
 La Nature est vraiment bien
faite ! La Nature est vraiment bien
faite !
Stable comme un fil d'araignée
: les araignées ne tournoient jamais au bout de leur fil, comme il arrive
parfois aux alpinistes ou spéléologues suspendus à une corde. Le fil reste
stable grâce à une propriété de la structure moléculaire de la soie qui lui fait
reprendre en souplesse sa forme initiale; il est doté d'une "auto-mémoire
de forme", comme viennent de le montrer des chercheurs du laboratoire
de physique des lasers (CNRS, Université de Rennes).
Le fil amortit les forces
de torsion et, s'il a été tordu, il reprend de lui-même sa forme initiale, sans
imprimer au poids qu'il supporte l'amplitude d'un mouvement de balancier. Cette
caractéristique est vitale pour l'araignée; en restant stable, elle échappe aux
perturbations ambiantes et n'attire pas l'attention des éventuels prédateurs.
("Nature" du jeudi 30 mars, repris par "le
Figaro" du Mardi noir, très noir ...).
Insectes plongeurs :
Une équipe américaine vient de montrer (2 008) comment s'y
prennent certains insectes pour respirer sous l'eau en emprisonnant une bulle
d'air. Plus les poils implantés sur le plastron sont rapprochés, plus la bulle
résiste à de fortes pressions, autorisant les plus téméraires à plonger au-delà
de 30m !
 Un exemple de lutte biologique
intéressant : Un exemple de lutte biologique
intéressant :
Le delta du fleuve Sénégal a été totalement recouvert par la
"fougère d'eau" Salvinia molesta, algue verte prolifique, introduite
accidentellement en 1999 et qui menaçait de détruire la totalité de la flore et
de la faune. L'arrachage n'ayant donné aucun résultat, les chercheurs se sont
tournés vers une solution efficace trouvée en Afrique du Sud où cette algue
sévissait aussi : l'utilisation du Curculionidae Cyrtobagous salvinae,
originaire du Brésil et ennemi naturel de l'algue. Un millier d'individus a été
envoyé à une station biologique à des fins d'élevage; puis des lâchers ont été
réalisés dans le fleuve à partir d'avril 2001; l'algue a déjà fortement régressé
depuis et seules des poches de résistance persistent aujourd'hui ...
Le rôle de la lumière lunaire :
Une équipe composée de chercheurs suédois et sud-africains a montré
que le scarabéide rouleur africain Scarabeus zambesianus utilise avec
profit la polarisation de la lumière émise par la lune pour s'orienter et ainsi
enfouir plus rapidement sa boule d'excréments en suivant un chemin rectiligne.
Nul doute que de autres nombreux insectes utilisent également la lumière lunaire
pour s'orienter...
Pas si drôle que ça... :
Un beau soir d'été, à la tombée de la nuit, un ami polyomélitique tétraplégique
se promenait sur une petite route de la Creuse, en compagnie de son épouse. Sa
main gauche, posée sur le levier de commande de son fauteuil, fut à un moment
chatouillée par un insecte, puis un second et bientôt une bonne dizaine. A
l'examen, il s'agissait de vers luisants mâles, attirés par le petit voyant
lumineux vert (7 à 8 mm de diamètre) du boîtier de commande du fauteuil, qu'ils
avaient pris pour l'abdomen fluorescent de leurs femelles.
J. Porcher dans le bulletin de l'Acorep, numéro 20
 Pratiques "lesbiennes" : Pratiques "lesbiennes" :
Les femelles d'une espèce de Curculionide d'Amérique centrale,
Diaprepes
abbeviatus, s'accouplent entre elles devant des mâles, prétendant potentiels
auxquels cette vision doit "donner des idées" et qui, pour pouvoir alors
s'accoupler à la femelle "d'en bas", doivent d'abord repousser la femelle "d'en
haut" !
("AFP Sciences", numéro 1209, d'octobre 1999)
Insects use lesbian
ruse :
Female on female / A successful strategy
The apparent lesbianism in certain insects is probably just a ruse
to make sure the females attract the best males.
Researchers have studied small weevils native to Florida, US, and
shown how the females that mount each other generally end up
entwined with the largest males.
Ally Harari of the Volcani Center, Israel, and Jane Brockmann of the
University of Florida, US, say the behaviour they have seen in
Diaprepes abbreviatus mâyâ also account for the lesbian-like
activities seen in many other insect species...
voir :
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/481394.stm
Un petit insecte grandira t-il au cours de sa
vie ?
Non; lorsque un insecte est adulte, sa taille et ses couleurs
sont définitives (chez certains insectes, il faut quelques heures pour que les
couleurs définitives s'établissent à la sortie de la nymphe ...). Une minuscule
mouche n'est donc pas un "bébé" de mouche, mais une toute petite espèce de
mouche; et elle ne grandira pas plus !
La gay-pride des punaises :
La littérature scientifique précise que le mâle de la punaise des lits (Cimex lectularius ou
Cimex hemipterus) "serait transporté par un rut d'une intensité
incroyable, par une fureur amoureuse, vers la femelle autour de laquelle il
tourne à toute vitesse, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre...".
Mais il
saute aussi sur tout ce qui bouge, enfonçant son pénis perforateur
indifféremment à travers l'exosquelette d'autres mâles (50% des cas), dans des
femelles (30%; il serait donc plutôt "pédé"...) et même dans des animaux
"étrangers" dont certains individus ne s'en remettent jamais !
(d'après "Le stress du bigorneau" d'Isabelle Brisson, chez Plon)
L'amour vache :
Chez Callosobruchus maculatus (une bruche...), la
copulation n'est pas vraiment une partie de plaisir; le mâle, au pénis hérissé
de picots, lacère l'appareil génital de la femelle; cette dernière, dotée de
pattes arrières robustes, se débarrasse alors de son partenaire en ruant
violemment mais, une fois fécondée, sa durée de vie n'est plus que de 10 jours
au lieu d'un mois ...
(d'après un "Science et Avenir" de décembre 2000)
Tout est relatif... :
Deux mouches sont en train de dîner sur un superbe étron;
l'une des deux pète; l'autre : "T'exagères; on est à table !!"
Le coin du philosophe :
"Tous ceux qui ont eu la bonne fortune d'être mordus par la passion de
l'Histoire Naturelle, savent l'ivresse de la recherche et le chant intérieur au
moment de la trouvaille. Alors les grincements aigres des soucis se taisent.
L'hymne de la joie prend possession de l'âme. Il ne faut pas négliger cette
source précieuse, puisque, comme le dit le vieux Golaud dans Pelléas :
- "De la joie, on n'en a pas tous les jours..."
En vérité, celui qui sait regarder la Nature n'est jamais seul. Il ne connaît
jamais le verbe s'ennuyer. Il peut être abandonné par ses camarades (ndlr amère
: ou "lâché" par une quelconque bourrique...), trahi par le temps, il trouvera
toujours autour d'une cabane abandonnée de quoi être heureux."
(Dr. J. Poucel dans "le Coléoptériste")
Success
story : honey
Tout le monde a entendu
parler de ce monsieur qui s'est fait une célébrité en élevant depuis
20 ans des abeilles sur le toit de l'Opéra Garnier. Peu d'entre nous
savent en revanche qu'il y a été attiré par un copain pompier qui
élevait lui-même des truites dans les sous-sols...
Chat alors !
On connaissait les poissons-chats, voilà les
chats-oiseaux. Une chinoise a en effet récemment déclaré que deux "ailes",
longues de plusieurs centimètres, avaient poussé sur le dos de son chat. Au
départ, il n'y avait que deux bosses sur le dos de l'animal, qui n'auraient pas
tardé à se développer, formant 2 appendices comparables à des ailes. Les cas de
"chats ailés", bien que rares, sont connus des scientifiques, qui les
identifient parfois comme de longues bourres de poils, et dans d'autres cas
comme des mutations génétiques !
Il faut choisir le bon venin
!
Une équipe de scientifiques de l'Université de Californie vient de découvrir que
les scorpions disposent de deux sortes de venin pour piquer leurs proies ou
leurs agresseurs : d'abord une "prétoxine" qui cause de violentes douleurs chez
le piqué, puis le véritable venin, souvent mortel. L'explication serait que la
prétoxine, à base de sels de potassium, serait facile à produire par le
scorpion, alors que le venin létal est composé de protéines et de peptides dont
la production est épuisante pour l'arachnide. Du coup, le scorpion tenterait de
paralyser d'abord sa proie avec la prétoxine et ne recourrait au deuxième venin
qu'en cas de besoin. Conseil pratique des chercheurs : si jamais vous vous
faites piquer, regardez bien la goutte qui perle de son dard : si elle est
translucide vous aurez très mal mais la vie sauve, et si elle est plus épaisse,
vous allez mourir...
("Marianne" de la fin janvier 2003)
Amitiés particulières chez les mouches en chaleur :
 On ne prend pas les mouches homos avec du vinaigre, mais avec des neurones
chauffées à bloc ! On ne prend pas les mouches homos avec du vinaigre, mais avec des neurones
chauffées à bloc !
C'est ce que vient de démontrer le Pr. Toshiro Kitamoto, qui a introduit un gène
mutant, sensible à la température, dans les petites têtes des drosophiles
viriles; à chaud, le gène en question coupe la sécrétion d'un transmetteur
chimique, ce qui a pour effet d'interrompre les communications entre des
neurones spécifiques; à partir de 30 degrés C, les mâles qui n'avaient de gros
yeux que pour les femelles commencent subitement à s'intéresser à des congénères
du même sexe et à battre de l'aile... Remises au frais, les mouches reprennent
très vite leurs esprits et leurs comportements sexuels hétéros; c'est que le
gène mutant n'affecte que provisoirement les nerfs du goût que les mouches ont
dans la tête et sur les gambettes; des nerfs qui, en temps normal, bloquent
l'attirance entre insectes du même sexe en censurant les signaux aphrodisiaques
émis par la gent masculine sous forme de phéromones. Toshiro, du Service de
neurosciences du centre médical de City of Hope, fait valoir qu'à la différence
des autres études menées sur le même délicat sujet qui, elles, induisaient des
comportements homos irréversibles, ses propres manipulations provoquent un
"rapport mâle-mâle" qui pouvait "être activé ou désactivé" à volonté en jetant
des chauds et des froids...
Une recherche de fond qui montre que, pour devenir gays, les mouches doivent
fréquenter assidûment les saunas !
("Marianne" de fin septembre 2002)
L'homme ne pèse pas beaucoup plus lourd qu'une mouche :
C'est l'un des enseignements important de l'exploration du génome humain : le
patrimoine héréditaire de l'homme n'est guère plus important que celui d'une
mouche ou d'une petite souris; environ 25 000 gênes ont été identifiés par le
consortium de chercheurs internationaux qui a rendu publique la carte achevée du
génome humain; c'est à peine plus qu'un banal ver de terre qui possède environ
19 000 gênes ou qu'une mouche qui en possède près de 13 600. Pourtant, au début
du projet de séquençage - il y a bientôt quatorze ans - , les chercheurs
estimaient que l'homme possédait 100 000 gênes; puis ce chiffre a été revu à la
baisse pour atteindre 80 000; au final, l'homme n'aurait qu'une poignée de gênes
différents de ceux de la mouche du vinaigre..."Nous recevons une grande leçon
d'humilité, ironisait hier J. M. Claverie, directeur de recherches au CNRS. La
complexité de l'homme ne viendrait pas en fait du nombre de ses gênes mais de
leur organisation et de la façon qu'il a de les utiliser ensemble". Tout l'enjeu
pour les chercheurs va donc être de définir la fonction de chacun de ces 25 000
gênes et donc de comprendre comment ils s'assemblent les uns avec les autres.
(France Soir du 11 avril 2003)
Vive le cafard géant de compagnie !
 CANBERRA
(Reuters) - Les Australiens adoptent de plus en plus souvent des cafards géants
comme animaux domestiques à la place des chats ou des chiens, qui nécessitent
plus d'espace et de soins. (rrhhaa !! berk berk berk !!
des cafards !!) CANBERRA
(Reuters) - Les Australiens adoptent de plus en plus souvent des cafards géants
comme animaux domestiques à la place des chats ou des chiens, qui nécessitent
plus d'espace et de soins. (rrhhaa !! berk berk berk !!
des cafards !!)
Selon des professionnels australiens de la vente d'animaux de compagnie, la
demande pour les insectes, et plus particulièrement les cafards géants, a
augmenté au cours des cinq dernières années avec la baisse de la taille des
logements.
"Il faut reconnaître que ce sont des animaux de compagnie un peu hors-du-commun
(oui en effet !), mais les enfants peuvent jouer
avec eux sans se faire mal et ils nécessitent très peu d'attention"
(re-berk !! et les enfants les caressent comme les
chiens ? ils leur font des petits bisous et tout ?? rrrhhhaa re-re-berk !!),
a déclaré John Olive, un des plus importants fournisseurs de cafards géants en
Australie. (au moins ça créé des emplois...)
Les amateurs australiens de cafards ont jeté leur dévolu sur le plus gros
cafard géant du monde, le cafard creuseur ou cafard rhinocéros, originaire de l'Etat
australien du Queensland, dans le nord-est du pays.
(ben oui, autant prendre le plus monstrueux des cafards !! re-re-re-berk !!!)
Adultes, les bestioles atteignent la taille de la paume d'une main
(c'est ignoble !! re-re-re-re-berk !), soit
environ 80 millimètres et pèsent 35 grammes. Elles vivent jusqu'à 10 ans.
Bien que la tendance soit relativement nouvelle en Australie, le marché des
insectes vivants a toujours été important au Japon où des scarabées sont
disponibles dans certains distributeurs automatiques.
(?!! sont tarés ces japonais...)
Encore des cafards géants...! :
Des centaines de cafards africains géants vont être incinérés à Bangkok,
maintenant que la police n'en a plus besoin comme "preuves" dans le cadre d'une
enquête sur des trafics, a annoncé hier une responsable de la Santé. Ces cafards
avaient été importés frauduleusement après leur interdiction en Thaïlande l'an
dernier; à l'époque, objet d'un étrange phénomène de mode, les grands cafards
africains, et notamment le "cafard sifflant de Madagascar", étaient devenus les
animaux domestiques les plus en vogue chez les Siamois; les cafards africains,
qui peuvent atteindre 10 cm de long et vivre 7 ans, s'étaient arrachés sur les
marchés de Bangkok avant que les autorités n'interdisent leur vente. Les
responsables de la Santé s'étaient en effet inquiétés des risques de propagation
de la typhoïde et de la gastro-entérite que leur présence favoriserait.
(France Soir du 23 mai 2003)
Quand les poules auront des dents... :
Une équipe de chercheurs, conduite par un professeur de l'Ecole Normale
Supérieure de Lyon, est parvenue à faire pousser des dents aux poules après
transplantation de cellules souches dentaires de souris; une réussite
susceptibles d'ouvrir la voie à une révolution des soins dentaires...
(La Dépêche de Midi du 3/06/2003)
Je vois rouge !
 Les hommes sont plus attirés par des femmes portant du rouge,
tout comme les chimpanzés et les babouins, selon des travaux publiés hier
(octobre 2008) et réalisés par des chercheurs de l'Université de Rochester. Les hommes sont plus attirés par des femmes portant du rouge,
tout comme les chimpanzés et les babouins, selon des travaux publiés hier
(octobre 2008) et réalisés par des chercheurs de l'Université de Rochester.
Si
les effets aphrodisiaques du rouge sont en partie le produit d'un
conditionnement sociétal, cette étude révèle que ceci s'explique probablement
davantage par une réaction ayant des racines biologiques profondes.
Les femelles
babouins et chimpanzés rougissent lors de l'ovulation, ce qui constitue un
message sexuel qui attire les mâles ...
Venin d'araignée, espoir :
La pariwixin 1, extraite du venin d'une araignée brésilienne,
protègerait les cellules nerveuses de l'excès de glutamate responsable de la
maladie d'Alzheimer, de la sclérose en plaques et de la schizophrénie chez le
rat. Reste à Joachim Coutinho-Netto, de l'Université de São Paulo, à vérifier si
c'est aussi le cas chez l'homme ...
(Le Point, n° 1868)
Mâle ou femelle ??
Chez les Hyménoptères, les mâles
sont issus d'oeufs non fécondés, ils sont donc haploïdes et ne possèdent qu'un
chromose X; chez la plupart des Lépidoptères, les femelles sont hétérogamiques (XY)
et les mâles homogamiques (XX). L'importance du chromose X et de sa présence en
un exemplaire unique ou en doublon dans le déterminisme du sexe explique en
partie la prévalence des gynandromorphes chez les insectes; en effet la perte ou
la non séparation des chromosomes X lors de certaines divisions cellulaires au
tout début du développement embryonnaire peut déboucher sur la coexistence chez
le même individu de lignées cellulaires de type femelle et mâle et à la
production d'un imago gynandromorphe. Si l'évènement survient lors de première
division, il en résultera un individu divisé en deux parties égales (gynandromorphe
bipartie ou biparti); si l'évènement est plus tardif dans la vie embryonnaire,
il débouche sur un individu en mosaïque où les territoires mâle et femelle sont
distribués de façon plus complexe.
Les exemples de gynandromorphes restent toutefois exceptionnels chez les
insectes, même si on en connaît à travers de nombreux ordres...
Chez les coléoptères, les exemples publiés sont
relativement rares; différents exemples ont cependant été décrits ces dernières
années; ils se recrutent évidemment parmi les espèces présentant un dimorphisme
sexuel accentué (des Cétonidae, Lucanidae, Cerambycidae)... Mais de
nombreuses espèces ont un dimorphisme sexuel faible ou même inexistant, ce qui
rend l'observation des gynandromorphes très difficiles.
Les exemples de gynandromorphes bipartites restent bien sûr les mieux illustrés...
Un paradis des papillons :
Des mordus du lépidoptère viennent de créer le premier "jardin des papillons" à
ciel ouvert de France, à Digne, afin d'étudier et faire connaître certains
insectes largement ignorés du public. Sur quelque 260 espèces diurnes recensées
en France, 200 sont présentes dans les Alpes-de-Haute-Provence, explique Nicolas
Maurel, 37 ans, président de l'association "Proserpine", à l'origine du projet.
Au delà de la chasse, interdite dans ce département depuis 1978, les papillons
ont d'abord été victimes du recul de l'agriculture extensive. L'opération, dont
le coût s'élève à 12 000 euros, "nous permet d'avoir un laboratoire grandeur
nature dans lequel les spécialistes pourront étudier la biologie de ces
papillons" et le public "découvrir leur richesse" tout en les protégeant, assure
l'association.
(France Soir du 16/VI/2003)
Un nouvel ordre d'Insectes :
 Le nombres des Ordres d'insectes actuels s'élevait jusqu'à présent à 30, les
deux derniers décrits étant les Zoraptères (1913) et les Notoptères (1915);
depuis plus rien....Olivier Zompro, du groupe d'écologie tropicale de l'Institut
de Limnologie Max Plank de Plön (Allemagne) vient de décrire dans la célèbre
revue américaine Science (du 19/IV/2002) un Ordre nouveau : les
Mantophasmatidae,
dont la morphologie les situerait à première vue entre les Mantes et les
Phasmes. Le premier échantillon a d'abord été trouvé dans de l'ambre de la
Baltique vieux de 45 millions d'années; puis des espèces bien vivantes ont été
découvertes en Tanzanie et en Namibie. Une étude génétique est en cours pour
étayer la validité de ce nouveau taxon qui laisse sceptiques certains
spécialistes. La presse a largement fait écho de cette découverte... Le nombres des Ordres d'insectes actuels s'élevait jusqu'à présent à 30, les
deux derniers décrits étant les Zoraptères (1913) et les Notoptères (1915);
depuis plus rien....Olivier Zompro, du groupe d'écologie tropicale de l'Institut
de Limnologie Max Plank de Plön (Allemagne) vient de décrire dans la célèbre
revue américaine Science (du 19/IV/2002) un Ordre nouveau : les
Mantophasmatidae,
dont la morphologie les situerait à première vue entre les Mantes et les
Phasmes. Le premier échantillon a d'abord été trouvé dans de l'ambre de la
Baltique vieux de 45 millions d'années; puis des espèces bien vivantes ont été
découvertes en Tanzanie et en Namibie. Une étude génétique est en cours pour
étayer la validité de ce nouveau taxon qui laisse sceptiques certains
spécialistes. La presse a largement fait écho de cette découverte...
("Le Coléoptériste" de juin 2002)
Des micro-antennes radars :
Au Canada, des chercheurs ont entrepris des études à grande échelle sur le
Doryphore pour enregistrer ses déplacements en vol entre les champs de pommes de
terre ou sur les lieux d'hibernation : pour cela, ils ont équipé leurs cobayes
d'antennes servant de répondeurs radars; ils ont testé en chambre de vol à
l'aide de fausses antennes (tronçons de 20mm de fils métalliques...) le poids
maximal qu'un doryphore pouvait supporter en vol sans être perturbé.
("Le Coléoptériste" de juin 2002)
 Toujours le "pique-prune" : Toujours le "pique-prune" :
Le "pique-prune" fait de nouveau parler de lui dans la presse et sur les chaînes
de télé : après avoir interrompu la construction de l'autoroute qui devait
traverser la forêt de Bercé, l'Osmoderma eremita vole maintenant au secours
d'habitants de plusieurs communes du Gers dont les terres sont menacées par
l'élargissement des routes nécessaire au passage jusqu'à Toulouse des éléments
du futur Airbus géant; ces propriétaires se sont aperçus de la présence sur
leurs terres de vieux arbres hébergeant des colonies d'Osmodermes (de leurs
larves, du moins...), insectes hautement protégés; ce qui a engendré une subite
et inattendue prise de conscience pour les problèmes d'environnement...
Pas que le "pique-prune" ... !
:
 Des opposants à la ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris ont
découvert sur le trajet, à Linars plus précisément, un insecte protégé, le
Cérambycide bien connu Rosalia alpina et ont fait constater sa présence à
l'ON de la Chasse de la Charente dont les représentants ont photographié des
spécimens et ont transmis leur procès-verbal au préfet de la Charente ainsi qu'à
la DIREN de la Région Poitou-Charente. Des opposants à la ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris ont
découvert sur le trajet, à Linars plus précisément, un insecte protégé, le
Cérambycide bien connu Rosalia alpina et ont fait constater sa présence à
l'ON de la Chasse de la Charente dont les représentants ont photographié des
spécimens et ont transmis leur procès-verbal au préfet de la Charente ainsi qu'à
la DIREN de la Région Poitou-Charente.
La nouvelle inquiète la Société RFF
(Réseau Ferré de France) qui affronte une contestation grandissante, les
opposants estimant tenir là un argument pour le détournement de la ligne TGV ...
 Une espèce qui s'accroche à la vie : Une espèce qui s'accroche à la vie :
"Notre petit champion", c'est ainsi que Thomas Eisner, chercheur à l'Université
de Cornell (Ithaca, Etat de New York), surnomme Hemisphaerota cyanea. Cet
insecte puissant vit sur des feuilles de palmiers nains, où les fourmis tentent
de le renverser. Mais, quand cette chrysomèle plante ses "pieds", munis de 60
000 poils adhésifs, sur une feuille, les fourmis sont bien en peine de le faire
bouger. Sa force est à ce point phénoménale qu'il peut, par exemple, supporter
une traction de 2 g, soit 150 fois son poids...
(National Geographic, Mai 2002)
Une force inexpliquée :
 Le scarabéide Xyloryctes thestalus, équivalent
nord-américain de notre Oryctes nasicornis national (le rhinocéros...),
a fait l'objet de recherches biomécaniques de la part d'un chercheur américain,
R. Kram. Ces études rejoignent d'une certaine manière la mythologie en révélant
que ce coléo est un véritable Hercule, capable de soulever 100 fois son propre
poids tout en continuant son chemin et au prix d'une dépense d'énergie
considérablement inférieure aux valeurs prévues. Le scarabéide Xyloryctes thestalus, équivalent
nord-américain de notre Oryctes nasicornis national (le rhinocéros...),
a fait l'objet de recherches biomécaniques de la part d'un chercheur américain,
R. Kram. Ces études rejoignent d'une certaine manière la mythologie en révélant
que ce coléo est un véritable Hercule, capable de soulever 100 fois son propre
poids tout en continuant son chemin et au prix d'une dépense d'énergie
considérablement inférieure aux valeurs prévues.
Le "Guiness Book of World Records" affirmait en 1992 que certaines espèces
pouvaient porter 850 fois leurs poids; les expériences de Kram sont venues à
bout de telles affirmations fantaisistes mais montrent qu'un coléo peut donc
soulever 100 fois son propre poids, chiffre déjà considérable.
Kram a conçu pour ses expériences un dispositif original, adapté à son sujet
d'étude, le Xyloryctes restant un animal de labo peu banal ; il a collé
une pièce de Velcro sur le dos du scarabée et une pièce identique sur une petite
barre de bois recevant des charges de plus en plus lourdes à l'avant et à
l'arrière de l'insecte, à la façon d'un porteur d'eau, pour équilibrer les
charges ; l'insecte et son fardeau ont été ensuite placés sur un tapis roulant
miniature, enfermé dans une boîte servant de respiromètre pour la mesure des
échanges gazeux et de la consommation d'oxygène; l'insecte pesait 2,38g ; il a
pu porter des charges considérables, jusqu'à 100 fois son poids, pour une
consommation d'énergie 10 fois moindre que celle prévue d'après le modèle
biomécanique établi. Ce système physiologique n'est pour
l'instant pas élucidé et nécessitera des études approfondies du tissu musculaire
et du métabolisme de l'insecte.
Ces observations rejoignent celles concernant notre Lucanus cervus dont
les mâles, suspendus par leurs mandibules à un support, peuvent résister à la
traction d'un poids de 200 g fixé à leur corps, ce qui équivaudrait à une charge
de 10 tonnes pour un homme de 70 kg !!!
("La Recherche" de décembre 1996)
Pauvre douanier :
Un coléoptériste célèbre collectionnait, avec un collègue,
les scarabéides dans les bouses à la frontière italienne. Il dut repasser la
frontière pour revenir en France et il fut arrêté par les douaniers. Il faut
alors dire qu'il ramassait les bouses qu'il mettait en vrac dans un sac,
comptant le vider à l'hôtel pour en récupérer les insectes (pauvre hôtel ...). "Qu'avez
vous là dedans ? ", lui demanda le douanier curieux. "De la merde",
répondit l'entomologiste. "Soyez poli", lui demanda le douanier; et il
demanda de nouveau, "Qu'avez-vous dans ce sac ?". "De la merde",
répondit à nouveau l'entomologiste. "Suivez-moi au poste", dit le
douanier. Les 2 entomologistes allèrent à la douane et le douanier insista pour
leur faire ouvrir le sac. Notre collègue ouvrit le sac sur le bureau du douanier
et déversa le contenu sur les papiers qui l'encombraient ! Tout ceci se termina
quand même par un procès !
Insectes-médicaments :
 L'entomologiste Roland Lupoli explore les forêts primaires de Guyane. Au cours
d'un seul piégeage lumineux, il peut récolter plus de 150 espèces d'insectes
différents, potentiellement intéressantes. Sa récolte nocturne rejoindra bientôt
les laboratoires alsaciens d'une start-up en biotechnologies. Il reçoit
également des sachets d'insectes utilisés en médecine traditionnelle chinoise... L'entomologiste Roland Lupoli explore les forêts primaires de Guyane. Au cours
d'un seul piégeage lumineux, il peut récolter plus de 150 espèces d'insectes
différents, potentiellement intéressantes. Sa récolte nocturne rejoindra bientôt
les laboratoires alsaciens d'une start-up en biotechnologies. Il reçoit
également des sachets d'insectes utilisés en médecine traditionnelle chinoise...
Fin 1998, Entomed est créée; seules trois entreprises travaillent sur ce domaine
dans le monde... A terme, il s'agit de comprendre quelles molécules entrent en
jeu dans la défense des insectes, puis de les reproduire, les améliorer et les
utiliser dans nos médicaments... Les espèces les plus intéressantes sont
aposématiques : en cas de danger, elles cherchent à être vues; une façon de
signaler à leurs prédateurs qu'elles ont des substances toxiques et qu'elles
peuvent se défendre... Les insectes sont broyés, puis mis dans un solvant; après
macération, les chimistes extraient quelques centilitres d'un liquide brunâtre;
ils fractionnent ces extraits et les font réagir, in vitro, avec des cellules en
culture; si l'une de ces fractions présente une activité antimicrobienne ou
anticancéreuse, on cherche à savoir quelle molécule donne cette activité... Il
faut environ douze mois pour détecter une molécule intéressante; 24 mois
supplémentaires pour augmenter son activité au maximum; elle peut alors être
brevetée....
"La diversité des plantes et des micro-organismes est exploitée depuis fort
longtemps, mais se servir de la biodiversité des insectes pour créer des
médicaments, c'est encore tout nouveau. Entre 1999 et 2002, nous avons travaillé
sur les peptides; l'un d'eux est un antifongique, l'autre est efficace contre
les infections nosocomiales"
("National geographic" de juillet 2004)
Une autre passion qui peut s'avérer mortelle :
Un apiculteur de 90 ans a survécu à un millier de piqûres d'abeilles après avoir
renversé une ruche. Hermann Danner, apiculteur depuis 70 ans en Haute-Autriche,
avait de par son métier une certaine accoutumance au venin des abeilles, ce qui
lui a sans doute sauvé la vie.
Alors qu'il travaillait sans masque de protection la semaine dernière, il avait
trébuché et atterri la tête la première dans l'une de ses ruches; attirées par
le miel répandu sur son visage, et rendues particulièrement agressives par les
chaudes températures de juillet, les abeilles ont attaqué l'homme pendant une
demi-heure; jusqu'à ce qu'une voisine l'aperçoive et avertisse les services de
secours qui le transportèrent immédiatement à l'hôpital. "Il y avait au moins
1 000 piqûres" a raconté le médecin qui a mis une heure à extraire l'ensemble des
dards avec l'aide de quatre assistants... "C'est comme un miracle; à son âge,
même quelques centaines de piqûres pouvaient être mortelles" a-t-il dit,
ajoutant que le vieil homme avait subi "des douleurs presque insupportables"...
Hermann a passé quatre journées en soins intensifs et sa vie a été un moment en
danger; mais Hermann, qui doit quitter l'hôpital dans les prochains jours, n'a
qu'une hâte : retourner auprès de ses abeilles.
"Je ne me priverai pas de ma passion", a-t-il affirmé sur son lit d'hôpital...!
(Dans "l'Entomologiste" de septembre 2004)
A Tingo Maria, dans les années
50, la vie ne valait pas cher :
Je suis hélé sur la route du village par un groupe de gens
qui veulent venir avec moi (dans ma jeep) :
- Monsieur Daniel, tu peux nous prendre avec toi ? Nous et un petit cadavre ?
- Un quoi ?
- Un petit cadavre.
- Un quoi ? Mierda de mierda.
- Un petit cadavre; il est pas grand; il va pas t'encombrer; il pèse pas lourd.
Finalement, je conduis au village le petit cercueil, qui pue
épouvantablement, et 5 ou 6 personnes complètement ivres qui rient à s'en
décrocher la mâchoire. L'attitude devant la mort est quelque chose qui
appartient en propre à chaque peuple. Là, il n'y a pas d'universalité.
Un autre jour, un péon vient me voir :
- Monsieur Daniel, Il faut que tu me prêtes de l'argent pour que j'achète des
médicaments pour mon fils. Si tu ne veux pas, ça va me coûter plus cher.
- Comment ça, plus cher ?
- Si j'achète deux ampoules maintenant, ça me coûtera 20 soles; les enterrements
coûtent de plus en plus cher; il faudra que j'achète au moins 2 ou 3 caisses de
bière pour ne pas passer pour un ladre, et ensuite il y a le curé, puis le
cimetière.
Je suis convaincu par cette démonstration et lui prête les 20 soles.
Une pauvre femme, après avoir été soignée à l'hôpital de Tingo, vient mourir à
la plantation. Ses parents et amis pensent qu'elle a été mal soignée. Alors, ils
l'emmitouflent dans des couvertures. Certains disent qu'elle est morte, d'autres
qu'elle le sera bientôt; et ils partent pour le village, passablement éméchés,
comme il convient dans de pareilles circonstances.
Arrivés là-bas, ils font le tour des endroits où on sert à boire, avec leur
paquet qu'ils déposent chaque fois sur une chaise ou sur un banc. Tard dans la
nuit, marchant difficilement; ils tournent quelque temps dans le village,
cherchant la maison du médecin qui avait mal soignée - disaient-ils - la
défunte. L'ayant trouvée, ils abandonnent leur paquet devant la porte de la
maison...
(Extrait du très bon livre "Tingo Maria au Pérou" de Daniel
Salleron).
Dernière minute : les abeilles envahissent St.
Girons !
Une collision s’est produite entre une voiture et une camionnette à plateau
qui transportait une dizaine de ruches habitées ; le choc était très
violent… Quant aux ruches renversées sur la chaussée et démantelées, elles
laissaient échapper les essaims qui envahissaient aussitôt le quartier et les
arbres environnants. Gendarmes, pompiers et agents de la DDE se mobilisaient
pour sécuriser le site et mettre en place une déviation, le temps d’évacuer les
2 véhicules, de reconstituer les ruches sur lesquelles tournoyaient les abeilles
et d’installer des panneaux invitant les automobilistes à fermer les vitres,
tandis que l’accès était fortement déconseillé aux deux-roues et aux piétons.
Sorti de l’hôpital, l’apiculteur a attendu le soir pour tenter de récupérer
toutes ses abeilles…
(La Dépêche du Midi du 19 juin 2005)
La « mouche d’Espagne » :
C’est un petit coléoptère vert doré et brillant que l’on trouve en Espagne et
dans le sud de la France (Lytta vesicatoria est en fait un Meloïde et non un
Cantharide!). Les élytres de ces insectes sont séchés et réduits en poudre,
puis traités chimiquement pour en extraire un toxique appelé « cantharidine ».
On prétend qu’il suffit d’en verser quelques gouttes dans le verre de votre
dulcinée : même si , jusque là, elle est restée de marbre devant toutes vos
tentatives, elle est censée se transformer instantanément en insatiable obsédée
sexuelle, vous implorant d’éteindre les feux de sa passion…Vous vous souvenez de
l’histoire de ce type qui avait fait avaler quelques
gouttes à une jeune femme
et l’avait conduite devant un point de vue romantique en attendant les résultats
: la belle s’était métamorphosée en nymphomane déchaînée et, ayant épuisé son
amant après quatre assauts d’affilée, avait entrepris d’avoir un rapport sexuel
avec le levier de vitesse de la voiture du monsieur… ! C’est une charmante
histoire mais, sans doute, de la pure fiction…Voilà une version plus plausible :
10 minutes après l’ingestion, la jeune fille est prise de convulsions ; elle est
conduite aux urgences et le jeune homme au cabanon ; si elle survit (50% de
chances), ils s’en tirent bien ; si elle y passe, il est condamné pour homicide
involontaire… la belle s’était métamorphosée en nymphomane déchaînée et, ayant épuisé son
amant après quatre assauts d’affilée, avait entrepris d’avoir un rapport sexuel
avec le levier de vitesse de la voiture du monsieur… ! C’est une charmante
histoire mais, sans doute, de la pure fiction…Voilà une version plus plausible :
10 minutes après l’ingestion, la jeune fille est prise de convulsions ; elle est
conduite aux urgences et le jeune homme au cabanon ; si elle survit (50% de
chances), ils s’en tirent bien ; si elle y passe, il est condamné pour homicide
involontaire…
La cantharidine est vraiment un aphrodisiaque très efficace…pour les animaux de
ferme ! Chez l’homme, la dose efficace et la dose mortelle sont très proches ;
la cantharidine est très irritante ; une fois ingérée, elle descend dans les
reins, passe dans l’urine et arrive à la vessie ; en chemin, elle brûle la
tunique interne de la vessie et de l’urètre, et stimule par réflexe les organes
génitaux ; chez les femmes, elle provoque l’érection du clitoris, l’engorgement
des lèvres et un chatouillement vaginal ; chez les mâles, elle entraîne une
érection intense et douloureuse…
(Tout ce que vous avez toujours voulu savoir…)
Suite :
L'application d'infimes quantités de cantharide a pour effet immédiat de
stimuler les reins. Des doses trop importantes peuvent s'avérer dangereuses,
voire mortelle. Apparue dans l'antiquité, la cantharide ou mouche espagnole est
d'abord séchée, broyée et réduite en poudre. Hippocrate préconisait déjà son
emploi comme aphrodisiaque et les romains croyaient très fort à ses propriétés
stimulantes. En effet, elle peut déclencher une forte érection par la présence
d'un composé : la cantharidine. Une propriété que n'ignorait pas le marquis de
Sade, grand libertin, qui se plaisait à offrir des biscuits chocolatés à la
cantharide pour ses orgies.
La collection Oberthür :
La famille Oberthür est d’origine alsacienne. Le grand-père de René….contribua à
mettre au point la « lithographie »…L’un de ses enfants, François-Charles…a
l’idée de génie qui va changer le cours de sa vie et celle de ses descendants :
il crée l’ « Almanach des Postes »…Pour des milliers de familles modestes, le «
Calendrier des Postes » est le seul accès à l’art…Longtemps avant sa
disparition, François-Charles avait associé ses deux fils, Charles et René, à
son entreprise. Celle-ci emploie quelque 1000 personnes : l’imprimerie Oberthür,
à Rennes, est l’une des entreprises les plus importantes de la
 région et la
première imprimerie de France. région et la
première imprimerie de France.
François-Charles était amateur de papillons, notamment lycènes et zygènes….dont
il avait réuni une intéressante collection. Dès 1861, il la laisse à son aîné
Charles… ; parallèlement, il offre à son cadet, René, quelques boîtes de
coléoptères, rassemblés un peu au hasard ; cela décide de la vocation de ce
dernier qui sera coléoptériste et entrera à la SEF en 1871…Les deux frères se
livrent si sérieusement à leur passion que leurs collections prennent, en une
vingtaine d’années, des proportions considérables. La maison familiale est
envahie (on connaît…). En 1884, François-Charles décide de faire construire à
côté de celle-ci un pavillon consacré à l’entomologie….Le soin du détail est
poussé très loin : les céramiques des toilettes sont également ornées de motifs
entomologiques ! Outre les deux frères, plusieurs préparateurs ou préparatrices
surveillent, entretiennent et classent les collections que les deux frères
cherchent à accroître le plus possible ; Pour cela, ils financent les voyageurs
naturalistes de leur époque : …. En outre, ils concluent un marché avec les
principales congrégations missionnaires : en échange de la fourniture gratuite
de tous les imprimés nécessaires à leurs activités (bibles, missels,
catéchismes, bulletins, lettres paroissiales…), les missionnaires devaient
récolter, ou faire récolter par leurs ouailles, tous les insectes qui passaient
à leur portée…
Outre les matériaux qu’il se procurait auprès des voyageurs et missionnaires,
René Oberthür pratiqua une politique d’achats à grande échelle…Surtout, il pu
acquérir presque toutes les grandes collections qui furent mises en vente
pendant sa vie…
En 1925, à la mort de Charles, le Muséum de Paris ne put pas se rendre acquéreur
de sa collection de papillons, qui partit…à Londres. Désormais, le bâtiment de
Rennes fut entièrement à la disposition de René. On lui prête l’exclamation
suivante, assez peu fraternelle et certainement apocryphe : « Enfin, je vais
pouvoir m’occuper de papillons !»…Pendant toute sa vie, René Oberthür occupa la
plus grande partie de ses loisirs à travailler à sa collection ; il supervisait
lui-même l’étiquetage, la détermination et le classement ; pour faire identifier
cet énorme matériel, il avait recours aux spécialistes de toute l’Europe…
Pendant la seconde guerre mondiale, le Dr. Georg Frey, lui-même (très grand…)
collectionneur de coléoptères, qui était alors officier dans l’armée allemande,
eut soin que le bâtiment abritant la collection soit convenablement chauffé et
entretenu. René Oberthür décéda le 27 avril 1944…René Jeannel, Directeur du
Laboratoire d’Entomologie du Muséum, avait toujours gardé un œil sur les
collections des deux frères ; il n’avait pas apprécié le départ des papillons de
Charles vers le British ; mais enfin, ce n’étaient « que des papillons »… !
Après la guerre, il fit tout son possible pour que l’énorme corpus de René,
cette « Collection des Collections », suivant le mot de Frey, puisse entrer dans
le patrimoine national . Encore une fois, les Anglais menaçaient….Mais Jeannel
put obtenir le classement de l’ensemble au titre de « monument historique », ce
qui empêchait la sortie du territoire français. L’achat fut alors négocié avec
la famille pour 32 millions de francs de l’époque, montant raisonnable compte
tenu de ce qu’avait coûté la collection (20 fois plus, soit quelque 600
millions, disait-on alors), mais qui ne put pas être réuni au Muséum avant
1951….Le 13 décembre 1952, elle faisait son entrée au Laboratoire d’Entomologie,
où elle fut installée au troisième étage du 45 rue Buffon, aménagé pour
l’occasion. A son arrivée, elle comptait quelque 20 000 boîtes et 15 armoires,
le tout renfermant au moins 5 millions de spécimens, y compris des dizaines de
milliers de types. Mais seule une moitié de cet ensemble formait une collection
proprement dite…, l’autre moitié n’était qu’un immense « magasin », renfermant 2
à 3 millions de spécimens non identifiés et non classés…Enfin, une grande
Exposition entomologique fut organisée au Muséum, de mai à septembre 1953, pour
commémorer cet évènement. Elle fut inaugurée par le ministre de l’Education
Nationale, M. André Marie, qui remit à Chopard la Légion d’honneur. Ce fut la
première, la dernière et la seule fois que la République française célébra
solennellement l’entomologie, les coléoptères, leurs collections et leurs
collectionneurs…
(Dans « le Coléoptériste » de juin 2004, « René Oberthür (1852-1944) et sa
collection » par Yves Cambefort ; j’invite les lecteurs à se procurer
l’intégralité de cet excellent article…)
Lutte biologique :
Produisant 250 000 plantes par an, les serres municipales des Issards, à Albi,
n’utilisent plus d’insecticides depuis mai 2 004. La ville s’est lancée dans la « lutte biologique intégrée » pour laquelle « elle se montre précurseur » affiche
Geneviève Parmentier, l’adjointe du maire aux espaces verts. Les ravageurs des
végétaux sont combattus par des coccinelles qui mangent les pucerons (très
connu…). Les services municipaux ont recours à d’autres auxiliaires naturels,
comme les petites punaises vertes, également dévoreuses de pucerons, ou des
petites guêpes qui pondent leurs œufs dedans… (moins connu…). Pour choisir la
bonne arme en fonction du prédateur, la ville s’est adjointe le concours d’une ingénieure-conseil, Edith Mulhberger, du cabinet Hydroflor
de St-Jory. Les «
bêtes à Bon Dieu » sont expédiées à Albi dans des boîtes contenant du pop-corn,
qui évite leur écrasement pendant le transport. L’expérience est étendue aux
jardins du palais de la Berthie.
(La « Dépêche du Midi », juin 2005)
Au poste !
Le
Professeur Jean Leclercq, spécialiste des Hyménoptères, se servait d’abribus
comme d’un piège-fenêtre; il récoltait chaque année les insectes pris à
l’intérieur de la cage vitrée lors de plusieurs visites annuelles… manège
suspect, un pédophile?..., il fut intercepté lors de ses récoltes et dû
longuement s’expliquer sur ses chasses entomologiques!
Le paradichlorobenzène est-il
dangereux ? :
La cancérogénicité du produit a été étudiée chez le rat et la
souris; administré par voie orale, il a produit des adénocarcinomes rénaux chez
les rats mâles et des tumeurs hépatiques chez les souris des deux sexes. Il a
aussi été testé par inhalation (plus intéressant pour nous ...!) dans ces 2
espèces et n'a pas augmenté la fréquence des tumeurs observées ; cependant, la
durée d'exposition dans cette dernière étude était trop brève (56 à 76
semaines). plusieurs cas de leucémie ont été rapportés chez des travailleurs
exposés au paradi..., sans qu'il soit possible d'établir un vrai rapport de
cause à effet. Le Centre International de Recherche sur le Cancer considère
qu'il n'y a pas de preuve de la cancérogénicité du produit pour l'espèce
humaine, mais qu'en revanche, il y a des preuves suffisantes de sa
cancérogénicité chez l'animal. Sur ces données, il propose de classer le
paradichlorobenzène dans le groupe 2B des substances
possiblement cancérogènes pour l'espèce humaine.
Quant à la créosote, elle serait plus dangereuse; le Centre International de
Recherche sur le Cancer estime qu'il y a des preuves limitées de la cancérogénicité des créosotes dans l'espèce humaine mais que ces preuves sont
suffisantes sur l'animal. Sur ces données, il a classé les créosotes
dans le groupe 2A des substances probablement cancérogènes
pour l'homme.
Conclusion : ne dormez pas dans une pièce où serait entreposée votre
collection ! A moins évidemment que vos boîtes ne soient
rigoureusement hermétiques.
Halloween 2005 , une très sale
blague… :
Lundi 30 octobre 2005, je
regagne mon village ariégeois après une semaine passée à Paris et à Beauvais («
Mondial de l’Insecte ») ; 19 h 30, je commence à vider ma voiture des multiples
boîtes d’insectes qu’elle contient ; après une heure de va-et-vient, je me
préoccupe de ma valise : disparue ! Je fouille mon
appartement et mon jardin, les alentours de la maison, rien… ; je téléphone à
mes amis parisiens pour qu’ils vérifient que je ne l’ai pas laissée chez eux ou
devant leur maison… ; je refais dans ma tête l’itinéraire de la journée, les
arrêts essence et pipi…Je passe une très mauvaise nuit car elle contenait, outre
mes vêtements et mes affaires de toilette, deux boîtes extrêmement précieuses,
remplies de « types » des Muséums de Londres et Berlin (laissées pour photos à
notre cher éditeur ...) : une vraie catastrophe… ! Au matin, je refouille la
maison et ses alentours ; j’aperçois alors, en haut de ma rue, ma valise
ouverte, les vêtements éparpillés autour et trempés par la pluie ; je me
précipite : les boîtes ont disparu ; en fouillant les environs, je découvre un
papier (qui emballait une des boîtes) accroché au grillage d’une maison ; comme
un indice m’indiquant une direction à suivre… : les « Allées du Pouech » ; je
fouille pendant une heure cette belle Promenade massatoise, les poubelles, le
court de tennis, les bacs fleuris ; enfin, sur le dernier banc de la Promenade,
les deux boîtes, posées, trempées… ; à l’intérieur, les insectes rarissimes
avaient certes bougé mais été intacts… ! Quel soulagement !! Heureusement, nous
ne sommes pas à Clichy/Bois… ! La « blague » était vraiment très « limite » et
aurait pu avoir des conséquences désastreuses ; pour moi et pour la « Science »…
; une blague finalement assez « réfléchie » (si j’ose dire… !), aux limites
responsabilité et irresponsabilité, qui semble bien, finalement, une blague
d’adultes plus ou moins imbibés et un peu cons…!!
Après coup, j'ai reconstitué le déroulement
des "évènements" : j'ai descendu la valise de la voiture et l'ai posée le temps
de récupérer quelques lettres dans la boîte; n'ayant pas les clés, j'ai glissé
les doigts dans la fente pour pincer les lettres; au moment de retirer les
doigts, impossible, coincés (c'est le schéma du singe, de la grosse bouteille et
de la banane dans la bouteille...!); fatigué et énervé, je tire stupidement et
m'ouvre profondément le majeur; ça pisse le sang ; tellement, que j'abandonne la
valise le temps d'aller nettoyer la plaie et les vêtements; c'est à ce moment
qu'un petit malin l'a récupérée pour la monter en haut de la rue; des témoins
l'ont vue, encore fermée, vers 21h ; plus tard, un autre individu (ou plutôt un
groupe) ont eu l'idée (mauvaise...) de l'ouvrir et d'échafauder le jeu de piste... Quant à moi, dans l'affolement (la plaie était vraiment profonde et
aurait justifié un point ou deux), impossible de me rappeler ce que j'avais
fait de cette valise...!
Quelle méprise !
De Beauchamp écrivit un jour un livre sur les insectes de la
plage, notamment les Aepus, ces coléoptères subaquatiques, et il
l'intitula "Les grèves de Roscoff". L'Humanité en commanda une centaine, pensant
qu'il s'agissait d'une étude sociologique sur les grèves à la gloire du génial
Petit Père des Peuples !!
Les mygales de Jussieu :
Pour voir les mygales de Marie-louise Célerier, il faut
quasiment se glisser sous les combles de l'université Pierre et Marie Curie; au
huitième étage, face à la Seine et à Notre-Dame, on entre dans des locaux qui
sentent le bois ciré et les vieux ouvrages; elle vous emplit le cerveau, cette
atmosphère de bonne vieille recherche fondamentale qui survit en ces temps
sombres où la "rentabilité" à court terme fait figure de divinité...
Poussez quelques portes cadenassées; et là, sur chaque table et chaque recoin
d'étagères, des boîtes en plastique; dans chacune, une boule de poils; il y a
des vives, petites comme des pièces de monnaie, et des pataudes, grosse comme un
steak; au total, 300 mygales vivent ici; la gorge pique à cause des soies
urticantes que les araignées répandent en se frottant le dos de leurs pattes;
certaines sont là depuis 20 ans, la durée de vie d'une mygale. "On ne peut
pas les mettre ensemble, sinon elles se mangent" explique le professeur.
Même s'il est tentant de fantasmer sur un scénario du genre "Arac attack à la
fac", pas question de se faire peur; nous sommes au laboratoire "Fonctionnement
et évolution des systèmes écologiques", unité mixte du CNRS et de Paris VI; mais
la chercheuse fait aujourd'hui ses valises pour partir à la retraite, et
l'université ne privilégiant pas les arachnides, l'élevage devra être euthanasié.
Etudier les araignées est un travail de fourmi; il faut d'abord les dénicher;
Marie-Louise était la seule spécialiste française. "En 1971, j'ai ramené ma
première araignée d'Afrique entre mes jambes dans l'avion"; la plupart des
araignées sont nées ici, et "environ une centaine ont été apportées par les
douanes à la suite de saisies".
Une grosse partie du travail concernait l'étude des mues annuelles; chacune
étant pesée et mesurée. "Les mues permettent de comprendre le cycle de
développement des araignées"; mais le thème le plus tendance concerne le
venin; sans se laisser impressionnée par la position défensive de la mygale qui
brandit ses pattes avant, Marie-Louise l'attrape par le dos - "Je me suis
fait mordre une seule fois dans ma carrière; c'est très douloureux mais pas
mortel" - Il faut ensuite placer un bâton sous les crochets de la bestiole
pour voir sortir le fameux liquide.
 Et c'est là que je m'adresse à ceux qui se disent depuis le début que je
cherche à les apitoyer sur des monstres dont ils n'ont que faire. Sache, lecteur
dubitatif, que l'étude des araignées est utile. En montrant une mygale baptisée
Psalmopoeus cambridgei, Marie-louise raconte pourquoi : "On a
découvert que son venin contient une toxine qui s'attaque au parasite qui
transmet le paludisme." Logique, après tout, car le venin contient des
toxines à l'action paralysante. Dans le même registre, des chercheurs viennent
de découvrir que le venin pourrait bloquer la prolifération des cellules
cancéreuses; d'autres toxines agiraient sur les maladies cardiaques, et d'autres
encore sur la douleur, en raison des anesthésiants présents dans le venin. Cette
araignée que tu méprises, c'est peut-être elle qui te sauvera la vie. Et c'est là que je m'adresse à ceux qui se disent depuis le début que je
cherche à les apitoyer sur des monstres dont ils n'ont que faire. Sache, lecteur
dubitatif, que l'étude des araignées est utile. En montrant une mygale baptisée
Psalmopoeus cambridgei, Marie-louise raconte pourquoi : "On a
découvert que son venin contient une toxine qui s'attaque au parasite qui
transmet le paludisme." Logique, après tout, car le venin contient des
toxines à l'action paralysante. Dans le même registre, des chercheurs viennent
de découvrir que le venin pourrait bloquer la prolifération des cellules
cancéreuses; d'autres toxines agiraient sur les maladies cardiaques, et d'autres
encore sur la douleur, en raison des anesthésiants présents dans le venin. Cette
araignée que tu méprises, c'est peut-être elle qui te sauvera la vie.
Et malgré tout, on ne sait quasiment rien des médicaments que recèlent les
sous-bois des forêts tropicales. "Sur 2500 espèces de mygales, on a des
embryons de connaissances sur une centaine seulement"; sans oublier que
chaque espèce possède un venin composé de centaines de toxines...dont, au mieux,
seulement une ou deux ont été étudiées ! C'est dire l'univers qui reste à
explorer...!
Un univers sur lequel, l'Université ferme ses portes. Ce n'est pas faute de
jeunes chercheurs disposés à prendre le relais. Mais "tout le monde veut
récupérer le local pour en faire autre chose". Bien sûr, le recherche est un
processus dynamique, et tous les jours des thèmes disparaissent avec le départ à
la retraite du chercheur qui les a portés, pendant que de nouveaux sujets
démarrent.
Quand même, on peut regretter que les araignées soient tuées. Et ce n'est pas une
question de sensiblerie. D'ailleurs, bien qu'une mygale vive plus longtemps
qu'un chat, Marie-Louise ne voue pas de tendresse particulière à ces animaux
qu'elle considère comme du "matériel" de recherche. Sauf que "ça fait de la
peine de mettre à plat trente ans de boulot. En plus, c'est une question de
respect de la vie".
Et aussi de budget. "Nous avons rédigé un projet de création d'un centre de
ressources biologiques destiné à fournir des venins aux labos qui en ont besoin,
mais nous n'avons pas eu gain de cause". Si elles ne trouvent pas repreneur,
les mygales finiront dans un congélateur, où à - 40°, elles mourront en quelques
secondes. (Là, j'en appelle à tous mes amis amateurs
éleveurs de mygales pour essayer de les récupérer...).
Cette histoire illustre au moins deux points : d'abord, que le respect du
vivant ne doit pas se mesurer à l'aune des critères anthropomorphiques de la
sympathie que nous inspire tel ou tel animal; ensuite, que si la recherche
publique ne voyait pas ses moyens financiers rétrécir d'année en année, elle
n'en serait pas réduite à jeter à la poubelle des décennies de recherches
originales.
("Charli Hebdo" du 18/01/2006)
Des poux dans la tête :
à Tours, une chercheuse, docteur en sciences, étudie la vie des
poux, ces insectes passionnants et dévorants. Et comment l'éradiquer. Dans son
labo, depuis plus de dix ans, elle répond aux nombreuses questions de ceux que
le sujet démange.
 Une paillasse en carrelage blanc, un
microscope au garde-à-vous. Moins de 15m2,
au fond de la fac de pharmacie de Tours. Nous sommes dans un des trois ou quatre
laboratoires au monde qui élève des poux. Une paillasse en carrelage blanc, un
microscope au garde-à-vous. Moins de 15m2,
au fond de la fac de pharmacie de Tours. Nous sommes dans un des trois ou quatre
laboratoires au monde qui élève des poux.
« C'est ici que ça se passe »,
dit Berthine Toubaté, ingénieure de recherche, en montrant le coin où s'empilent
trois étuves. L'une affiche 28 °C, « la
température où ils vivent normalement. Je les nourris le matin avec du sang de
lapin ». Avant le week-end, ils sont placés dans l'étuve à 24°C,
température qui ralentit leur métabolisme et leur permet de ne pas manger
pendant deux jours. L'étuve du haut, à 34°C, sert aux éclosions.
« Ils », ce sont des poux, environ 10 000, conservés vivants dans des boîtes de Petri, ces
boîtes rondes et plates utilisées en microbiologie. Des milliers de poux
« qui passent le plus clair de leur temps à
copuler dès qu'ils ont plus de 18 jours », lâche nonchalamment
Berthine Toubaté. La majorité sont des poux de corps, élevés sur du tissu. On
trouve aussi quelques poux de tête, accrochés à un cheveu ou deux, mais ils ne
survivent pas longtemps loin d'une zone capillaire humaine et
« franchement, je ne suis pas candidate à les
cultiver sur moi », rigole Catherine Combescot-Lang.
Elle est la patronne du labo, 62 ans, tignasse frisée sympathique,
« bavarde » toujours en
mouvement. Une des trente scientifiques au monde spécialistes de cet insecte. Du
pou, elle connaît le mode de vie, le cycle de reproduction, le degré de
résistance. Elle peut affirmer, pour avoir étudié leurs enzymes et leurs
chromosomes, que poux de corps et poux de tête présentent les mêmes
caractéristiques. Les premiers, élevés au laboratoire, sont plus résistants que
les seconds. Ils servent donc avantageusement à différents tests. Elle n'a pas
fini la comparaison génétique des deux espèces : « Pas le
temps, déjà, je ne dors presque plus ! » Elle répond aux
sollicitations des industriels, écoles, particuliers, entre les enseignements
qu'elle donne à l'université. En ce moment, elle compare l'efficacité de vingt
produits anti-poux courants. Ses résultats sont très attendus...
Car le pou est devenu un phénomène de société. « Toute la journée, des gens m'appellent : « C'est horrible, comment
m'en débarrasser ? » Dans un repas mondain ou dans le train, le sujet attise les
questions. Parce que tout le monde a des problèmes de poux, que l'on soit PDG ou
employé. » Bête noire des cours de récré, le pou intéresse. Le
pou interpelle. Quelques spécimens suffisent en France à déclencher des phobies,
« alors que dans de nombreux pays, plus de la moitié des gosses en ont,
et parfois vingt à cent à chaque coup de peigne ! ». Chez nous,
il fait pleurer les enfants :
« Pour certains, c'est un drame. »
L'autre jour, « on a traité mon fils de ' pouilleux '», lui a confié
une mère désespérée. Le pou reste tabou.
C'est même une vraie question sociale, pense la chercheuse.
« On ne peut pas travailler sur les poux sans
travailler sur ce qu'il y a autour », affirme-t-elle en servant
un café-gâteaux sur une table haute coincée entre son bureau et celui de
Berthine. Elle file à son ordinateur :
des courbes montrent la chute considérable de la pédiculose à Tours, 22 %
des élèves dans les années 1990 à 3 %
aujourd'hui. Remarquable. Mais parmi les enfants atteints, elle a fait ce
constat :
« Certaines catégories sociales plutôt
' favorisées ' ont passagèrement des poux, mais ne les gardent pas, alors que
d'autres généralement ' défavorisées ', les gardent. »
Rien à voir avec l'hygiène. Qu'on se le tienne pour dit, le pou ne préfère pas
les cheveux sales. C'est autre chose :
« Qu'est-ce que quelques poux dans la
chevelure d'un enfant par rapport au chômage chronique, à l'instabilité du
ménage accablé de tracas multiples, entraînant des soucis d'argent ? »
Les produits anti-poux coûtent cher, entre 12 et 17 € le flacon. Et comme la
plupart des lotions ne tuent plus les lentes (oeufs), il faut trois
applications, à une semaine d'intervalle, pour toute la famille, même nombreuse.
Les poux creusent l'exclusion...
C'est d'ailleurs pour éviter une stigmatisation grandissante que Tours a décidé
d'agir en 1985 :
« Des parents menaçaient d'enlever leurs enfants
de l'école si tel élève avait encore des poux », se souvient
Jean-Pierre Cheneveau, inspecteur au service d'hygiène de la ville. Un programme
d'observation des élèves a été développé depuis :
une à trois visites par an, des réunions pour dédramatiser le sujet et même une
« fête des poux ». Cette politique, exceptionnelle, profite de la proximité du
laboratoire de recherche de Catherine Combescot-Lang.
« J'ai commencé mon élevage, vers 1992,
dans le service de mon mari, peu avant sa retraite. Charles Combescot était
professeur en parasitologie, ' le ' spécialiste des poux en France. »
Au microscope, Berthine « chatouille le ventre » de quelques bébêtes,
histoire de voir si elles vivent encore. Catherine reprend :
« J'avais un faible pour les invertébrés,
notamment les mollusques marins. » Mais Charles a ramené sur
terre cette fille de biologistes, étudiante à Orsay, dont il a fait son
assistante à Tours. Aujourd'hui, elle porte son labo à bout de bras. Que
deviendra-t-il à sa retraite, dans deux ans ?
Elle ne le sait pas. Le pou intéresse. Mais il ne paie pas toujours.
Au poste à nouveau :
Un
brave entomologiste français qui s’occupait de collections de Coléoptères
Silphidae au musée de Lille, voulait enrichir ce patrimoine et se mit à déposer
en forêt des cadavres de petits animaux, qu’il trouvait sur le bord des routes,
pour attirer les nécrophages (insectes qui mangent les cadavres). Manège
suspect, le voici interpellé par les forces de l’ordre, accusé de pratiquer des
rites «Vaudou» ou sataniques, il fut conduit au poste où il demeura plus de 24
heures, il fallut l’intervention du directeur du Musée pour le libérer!
Les tiques attaquent :
 Au départ, cela ne ressemble à rien; tout au plus une petite
piqûre dans les bois que l'on oublie bien rapidement. C'est par la suite que les
choses se compliquent : un mois après, cela se transforme en une grosse tache rouge, accompagnée parfois de maux de
tête, de raideurs articulaires, voire d'une immense fatigue. Et si aucun
traitement à base d'antibiotiques n'est prescrit, la maladie peut devenir
mortelle : atteinte cardiaque, méningite et même encéphalite. Au départ, cela ne ressemble à rien; tout au plus une petite
piqûre dans les bois que l'on oublie bien rapidement. C'est par la suite que les
choses se compliquent : un mois après, cela se transforme en une grosse tache rouge, accompagnée parfois de maux de
tête, de raideurs articulaires, voire d'une immense fatigue. Et si aucun
traitement à base d'antibiotiques n'est prescrit, la maladie peut devenir
mortelle : atteinte cardiaque, méningite et même encéphalite.
Cette maladie terrible, appelée
Borréliose de Lyme, provoque actuellement une
véritable psychose en Allemagne : plus de trois millions et demi d'habitants en
seraient menacés. Et surtout cette maladie peut mettre des mois à se déclarer.
Aux USA, par exemple, elle a été récemment classée maladie numéro 2 parmi les
plus dangereuses, juste après le sida ! Une réaction irraisonnée certes, mais
qui montre à quel point elle peut faire peur.
Le plus souvent, ces tiques se laissent tomber des arbres sur les promeneurs; ou
s'accrochent aux vêtements à la traversée de hautes fougères. Minuscules au
début - elles mesurent à peine 1mm - elles gonflent ensuite jusqu'à atteindre
cent fois leurs poids initial, et cela rien qu'en suçant le sang !
La maladie de Lyme n'a d'ailleurs été isolée que depuis une vingtaine d'années,
dans un petit village des USA (Lyme) où une grande partie de la population
souffrait d'arthrites mystérieuses. depuis on sait la traiter facilement, avec
quelques antibiotiques classiques.
Le meilleur moyen pour s'en prévenir est de bien regarder ses bras, ses jambes
et ses parties plus intimes, après une promenade en forêt, pour en enlever
toutes les tiques à l'aide d'éther (ce qui les fait tomber ...). Mais en cas de
doute, même quelques semaines plus tard, mieux vaut aller voir un médecin qui
vous donnera le traitement approprié.
Les écologistes, les ramasseurs de champignons, tous les adeptes de promenades
dans les bois sont désormais prévenus ... Certains experts estiment d'ailleurs
que 50 000 Français seraient chaque année atteints par la maladie de Lyme.
Dernière nouvelle (novembre
2008) : La chaleur incite les tiques du chien à s'en prendre à l'homme,
annoncent des chercheurs français, qui publient aujourd'hui leurs travaux sur le
site de la revue scientifique "PLoS Neglected Tropical Deseases". D'où un risque
d'épidémies de maladies transmises par ces tiques en cas de réchauffement
climatique. Les tiques sont des acariens qui se nourrissent du sang des animaux
et peuvent parfois piquer l'homme, à qui ils pourraient transmettre des dizaines
de pathologies comme la maladie de Lyme.
Beurk ... :
La peur des serpents et des araignées serait innée. Un
héritage génétique de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, qui se méfiaient de
leurs piqûres. Deux psychologues de l'Université de Virginie l'affirment après
avoir constaté que des enfants de moins de 5 ans à qui on présente des images
complexes repèrent quasi instantanément ces animaux. (Psychological Science).
Des joyaux ailés (qui sont
des Rutelinae !):
C'est la tête dans les nuages, dans les forêts tropicales
d'altitude du Honduras, que David Hawks et moi (Ronald D. Cave) traquons
l'insecte aux mille feux. Tels des pêcheurs ayant jeté leurs filets, nous
montons la garde auprès d'un drap de lit blanc étendu sur le sol et éclairé par
des lampes; lorsque les scarabées s'y précipitent, c'est une pluie de couleurs
qui s'abat sur le tissu.
Notre mission consiste à les récolter - afin d'estimer leur nombre, d'étudier
leur écosystème et leur répartition. Dave m'a rejoint ici en 1992. Depuis, avec
d'autres, nous avons découvert sept nouvelle espèces (de Chrysina ...) au
Honduras et exhumé une huitième, considérée comme disparue.
Ces joyaux ailés ont aussi attiré l'attention des collectionneurs; la valeur
d'un spécimen rouge vif peut atteindre 2000 F , tandis qu'un splendide doré vaut
dans les 3500 F; certains conservateurs craignent que, avec leur tête ainsi mise
à prix, les scarabées soient voués à une disparition certaine;
un point de vue que notre étude ne validera pas forcément.
La chasse aux insectes ne ressemble en rien à un safari; des millions d'œufs,
de larves et autres pupes demeurent enfouis sous terre, tandis que seuls les
adultes (les imagos) intéressent les collectionneurs; ce ne sont pas les
passionnés d'entomologie qui menacent cependant le plus ces scarabées, mais la
disparition de leur environnement à mesure que les forêts tropicales font place
aux cultures. Selon nous, la récolte réglementée de ces joyaux par les habitants
locaux - puis dans un avenir plus ou moins proche, la pratique de l'élevage -
pourrait bien ralentir ce processus. En cas de développement de cette activité,
il y a fort à parier que les habitants accordent davantage de valeur à une forêt
peuplée de scarabées qu'à un lopin de terre nue.
(Extrait de l'excellent article de nos collègues américains
paru dans le "National Geographic" de février 2001; accompagné de superbes
photos; on peut voir certaines de ces photos dans ma
rubrique "Galerie d'images")
Now I regard species of Chrysina at my lights simply
as
old friends and no longer feel the urge to collect them in long series, if at
all. I have heard stories of collectors and dealers with considerably less
restraint collecting hundreds of specimens from the same mountain canyons, year
after year. This annual carnage has led some people to wonder out loud whether
or not Arizona’s Chrysina are in real need of some sort of legal
protection. Nearly 30 years ago, Arnett and Jacques (1981) declared that both
C. beyeri and C. gloriosa, which they
mistakenly thought were the only species in the United States, were “…endangered
and should not be collected.” However, on a warm and dry night in Madera Canyon
this past July, all three species of Arizona’s Chrysina turned up at my
light in good numbers. One species, C. gloriosa, was there in
incredible abundance. Still, it would be worthwhile for a university or
governmental agency to study the overall impact of intensive collecting on
Chrysina populations in Madera Canyon and other popular collecting sites in
southeastern Arizona.
Commonly known as jewel scarabs, the genus Chrysina
is replete with incredibly beautiful, often
metallic species. It includes nearly 100 species, most of which occur in
Mexico and Central America. The four species in the United States are relics of
a rich Neotropical fauna that expanded northward during more favorable (wetter)
periods. For the past 10,000 years or so, these species were able to adapt to an
increasingly warmer and drier climate by taking refuge in the high elevations of
mountains.
Les plus petits insectes, des
as de la miniaturisation :
L'exosquelette condamne les insectes à la petitesse. Les
mouches et les guêpes parasites internes, limitées par la taille de leur hôte,
rassemblent les plus petites espèces. Le mâle aptère d'une petite guêpe parasite
mesure à peine 0,14 mm, 139 microns pour être précis ! Sa femelle est une géante
en comparaison, avec ses 0,2 mm; ces minuscules animaux se développent dans les
œufs des psoques, des insectes proches des pucerons qui ne dépassent pas
eux-mêmes quelques mm de long à l'âge adulte. Sachant que jusqu'à 3 mâles
peuvent sortir d'un œuf de psoque, on comprend que la limitation de ressource
alimentaire ne leur autorise pas une croissance soutenue. Et pourtant,
cette minuscule goutte de protéine permet la croissance de
3 merveilleuses petites machines vivantes en état de fonctionnement, respectant
en tout point l'organisation complexe des insectes les plus gros...
("Les insectes petits mais costauds", chez Belin)
Chikungunya :
les tribulations du "tigre asiatique"
On l'a d'abord repéré en septembre, dans un jardin
public de Menton; les lieux ont été traités, mais cela n'a pas suffi; début
octobre, Aedes albopictus, également appelé le "tigre asiatique" en
raison de son aspect zébré noir et blanc et de son agressivité - il pique
le jour, surtout au crépuscule - était signalé dans d'autres quartiers de
Menton, puis à Nice; depuis le froid a eu raison de lui; "les adultes meurent
l'hiver, mais des oeufs peuvent subsister et éclore le moment venu; on le saura
aux alentours de juillet" indique Christophe Lagneau, directeur du
laboratoire de l'EID Méditerranée. Chaque année, il neutralise les larves de
moustiques sur 300 000 hectares, de l'étang de Berre jusqu'à Cerbère. Culex ou
Anophèles, tels sont les ennemis habituels. Mais depuis 2000, dans le cadre d'un
partenariat entre les autres EID et le centre de démoustication de Martinique,
les chasseurs de moustiques traquent aussi l'insecte vecteur de l'épidémie de
chikungunya, la maladie qui sévit actuellement à La Réunion. "Ce moustique
est présent dans le nord de l'Italie depuis le début des années 90; mais nous
avons établi cette surveillance, à la demande de la Direction Générale de la
Santé, après que des foyers ont été signalés dans l'Orne et dans la Vienne, en
1999" précise C. Lagneau.
 Tour du monde des pneus usagés :
Comment diable "le tigre asiatique", originaire d'Asie comme son nom l'indique,
est-il arrivé jusque-là ? Grâce aux voitures, plus exactement aux pneus usagés;
"les femelles d'Aedes albopictus pondent en bordure de petites collections
d'eau, telles que l'on peut en trouver dans ces pneus usagés lorsqu'ils sont
exposés à l'air libre; les larves voyagent ensuite avec les pneus", explique
C. Lagneau. Le moustique a donc trouvé avec ce commerce des pneus un moyen de
transport idéal, qui l'aide à effectuer son tour du monde. Des pneus importés
d'Asie lui auraient ainsi permis de découvrir l'Amérique du Nord dès 1972; on
l'a signalé en Albanie en 1979, au Brésil en 1986, en Italie en 1990; au fil de
ses pérégrinations, l'insecte tropical a su s'adapter; "il semblerait que les
larves soient susceptibles d'éclore pendant plusieurs, voire jusqu'à un an; il
s'adapte par ailleurs à un climat tempéré : il supporterait l'isotherme 5°,
voire 0°; on l'a signalé à Anvers, en Belgique, c'est dire ..." dit C.
Lagneau. Tour du monde des pneus usagés :
Comment diable "le tigre asiatique", originaire d'Asie comme son nom l'indique,
est-il arrivé jusque-là ? Grâce aux voitures, plus exactement aux pneus usagés;
"les femelles d'Aedes albopictus pondent en bordure de petites collections
d'eau, telles que l'on peut en trouver dans ces pneus usagés lorsqu'ils sont
exposés à l'air libre; les larves voyagent ensuite avec les pneus", explique
C. Lagneau. Le moustique a donc trouvé avec ce commerce des pneus un moyen de
transport idéal, qui l'aide à effectuer son tour du monde. Des pneus importés
d'Asie lui auraient ainsi permis de découvrir l'Amérique du Nord dès 1972; on
l'a signalé en Albanie en 1979, au Brésil en 1986, en Italie en 1990; au fil de
ses pérégrinations, l'insecte tropical a su s'adapter; "il semblerait que les
larves soient susceptibles d'éclore pendant plusieurs, voire jusqu'à un an; il
s'adapte par ailleurs à un climat tempéré : il supporterait l'isotherme 5°,
voire 0°; on l'a signalé à Anvers, en Belgique, c'est dire ..." dit C.
Lagneau.
Pour Didier Fontenille, chercheur à l'IRD de Montpellier, pas de doute :
Aedes albopictus est en pleine expansion et s'apprête à coloniser la
planète; "il progresse, c'est vrai, mais pour l'instant, il n'est pas en
mesure de détrôner les autres, chez nous" tempère le professeur Deudet, du
laboratoire de parasitologie du CHU de Montpellier; lequel rappelle la
compétition acharnée qui règne entre les espèces; dans le sud des USA, notre
Aedes a ainsi supplanté Aedes egypti, ce qui n'est pas un mal : le
second est le vecteur de la fièvre jaune ...!
Restent les risques en métropole de Chikungunya ou de dengue, virus dont
albopictus peut être l'hôte; les spécialistes se veulent rassurants; "bien
sûr, une personne peut transporter le virus jusqu'ici, mais il faudrait ensuite
qu'il soit transmis à quelqu'un d'autre par le moustique; or ce n'est pas la
saison; donc, il n'y a aucun risque actuellement", illustre le Pr. Deudet;
cet été ? "Peu probable", renchérit le parasitologue, qui évoque nos "habitats
plus soignés, nos "habitudes domestiques différentes", et "une
lutte contre les moustiques plus efficace"; cependant, on n'est pas à
l'abri, prévient-il : "surtout dans quelques années, si le réchauffement
climatique que l'on nous prédit se produit".
(Dans "L'Indépendant" du
17/02/2006)
Dernières nouvelles :
Aedes albopictus
peut
transmettre le chikungunya et/ou la dengue ! Lors d'une double épidémie au
Gabon, en 2007, des chercheurs français ont analysé 800 personnes et 20groupes
de moustiques (selon espèce et distribution) : le "moustique tigre" apparaît
comme le principal vecteur de transmission. Sur les 321 patients infectés, 275
avaient le chi., 54 la dengue, et 8 les 2 maladies. Reste à savoir si la même
piqûre peut délivrer les deux virus à la fois ...
Eté 2009, les moustiques
attaquent :
Tous aux abris, les voilà! Cette année,
2 nouvelles espèces de moustiques arrivent. Et ils sont particulièrement
virulents. Dans le sud mais aussi dans le nord et dans les villes ...
 La guerre aux moustiques est de nouveau lancée. Comme chaque été, les
vacanciers sont nombreux à battre l'air pour essayer de les éloigner. Les yeux
des scientifiques se tournent cette année vers un ennemi nouveau : l'Aedes
albopictus; venu d'Italie il y a 4 ans, ce moustique est plus connu pour
l'épidémie de Chikungunya qu'il a provoqué en 2006-2007 à La Réunion. "Il ne
vivait qu'en Asie il y a 10 ans; aujourd'hui, il est présent dans le 06, le 83
et la Corse; dans un avenir proche, il sera capable de transmettre cette
l'IRD. La guerre aux moustiques est de nouveau lancée. Comme chaque été, les
vacanciers sont nombreux à battre l'air pour essayer de les éloigner. Les yeux
des scientifiques se tournent cette année vers un ennemi nouveau : l'Aedes
albopictus; venu d'Italie il y a 4 ans, ce moustique est plus connu pour
l'épidémie de Chikungunya qu'il a provoqué en 2006-2007 à La Réunion. "Il ne
vivait qu'en Asie il y a 10 ans; aujourd'hui, il est présent dans le 06, le 83
et la Corse; dans un avenir proche, il sera capable de transmettre cette
l'IRD.
Egalement appelé "tigre asiatique", il s'est rapidement adapté; n'importe quel
point d'eau stagnant leur permet de développer leurs œufs, "des jouets
d'enfant, des vases et même des pneus; c'est d'ailleurs par cette voie qu'ils se
sont introduits en France", poursuit le spécialiste; "les pneus sont
stockés à l'extérieur; dès qu'il pleut, les femelles y pondent leurs œufs;
lorsque les pneus sont transportés, l'œuf éclot dans un pays différent. "
Pas de quoi s'alarmer pour l'instant; il n'est pas encore capable de transporter
le parasite en France; plus virulent que les autres, c'est à l'heure de
l'apéritif, quand le soleil décline, qu'il assaille ces victimes.
Le second à sévir répond au doux nom de Culex pipiens . Lui, c'est la
nuit qu'il attaque, réveillant les dormeurs les plus profonds avec ce bruit
inimitable, provoqué par le battement très rapide de ses ailes (400 à 2300 par
seconde). Ses lieux d'habitation sont, lui aussi, les eaux stagnantes urbaines
dans lesquelles il se développe : piscines ou bassins abandonnés, récupérateurs
d'eau des jardins et même fosses sceptiques. "La meilleure façon pour s'en
prévenir est encore de vider régulièrement ces récipients ou d'y implanter des
prédateurs; les poissons par exemple se nourrissent des larves de moustique"
précise le chercheur.
' qui provoque
la démangeaison. Lorsqu'elle pique, la femelle, la seule qui attaque, inocule
des protéines qui anesthésient la peau; c'est la réaction à ces substances qui
provoque des démangeaisons plus ou moins intenses suivant les personnes;
d'ailleurs la même piqûre est une question d'injustice; attiré par la chaleur
que dégage le corps, le moustique s'en prendra ensuite à celui qui dégage le
plus de CO2. et si certains se font piquer des dizaines de fois dans la nuit,
les petites bêtes, elles, ne font leur repas de sang que tous les 4 jours, pour
permettre à leurs œufs de se développer.
Un coup de cafard :
Vous ne vous êtes sans doute jamais dit, en regardant une
blatte : "Elle n'a pas l'air en forme", mais plutôt : "Où ai-je mis
l'insecticide ?" Cette créature qui nous répugne pourrait pourtant nous
aider à percer certains mystères du vieillissement. Ce processus se résume t-il
à une défaillance mécanique, une décrépitude des articulations et des muscles ?
Ou bien vieillir est-il un problème plus général né quelque part dans un cerveau
à bout de course ? Les blattes sont d'excellents sujets d'étude : ce sont de
gros insectes, ce qui facilite l'analyse de leur système nerveux relativement
simple. Et elles nécessitent peu de soins : il suffit se les placer dans une
poubelle, de badigeonner le rebord de vaseline pour décourager les évasions, de
leur jeter de la pâtée pour chien de temps en temps, et tout le monde il est
content.
 Ce n'est pas un hasard si les blattes existent depuis plus de 300
millions d'années. L'un de leurs atouts est leur étonnante capacité à s'enfuir
en cas de danger. Les plus rapides ont beau ne détaler qu'à 5km/h, c'est
amplement suffisant pour se réfugier dans une fissure du mur le plus proche.
Christopher
Comer, spécialiste de neurosciences à l'université de l'Illinois, étudie le
comportement des blattes en fuite."Quand vous lui soufflez dessus, la blatte
déguerpit en 50 millisecondes", explique t-il. "Et si vous tapotez
vivement l'une de ses antennes, elle peut tourner les talons et disparaître en
15 à 20 millisecondes". A titre de comparaison, le cerveau humain a
généralement besoin de 200 millisecondes pour répondre à un stimulus. Mais,
comme nous, les blattes vieillissent. Angela Ridgel, de la Case Western Reserve
University (Ohio), a réalisé des films à grande vitesse (125 images par seconde)
montrant des blattes courant dans un étroit couloir, sur une surface
transparente. Elle a noté qu'environ 60 semaines après leur dernière mue, elles
commencent à trébucher; leurs pattes antérieures se prennent dans celles du
milieu et les vieilles blattes dérapent dans les côtes.......... Outre leur aide
précieuse dans la compréhension du vieillissement, les recherches sur les
cafards pourraient bénéficier aux programmes spatiaux. Il précise que leurs
mécanismes de fuite prouvent l'existence de deux circuits
indépendants... Certaines expériences ont montré que, même décapité,
l'insecte parvient à se déplacer. "Imaginez que l'on veuille concevoir un
système de commande pour un Rover martien; on pourrait baser son fonctionnement
sur le type de double circuit des blattes". Et si le Rover tombe en panne,
les ingénieurs auront toutes les raisons d'avoir le cafard ! Ce n'est pas un hasard si les blattes existent depuis plus de 300
millions d'années. L'un de leurs atouts est leur étonnante capacité à s'enfuir
en cas de danger. Les plus rapides ont beau ne détaler qu'à 5km/h, c'est
amplement suffisant pour se réfugier dans une fissure du mur le plus proche.
Christopher
Comer, spécialiste de neurosciences à l'université de l'Illinois, étudie le
comportement des blattes en fuite."Quand vous lui soufflez dessus, la blatte
déguerpit en 50 millisecondes", explique t-il. "Et si vous tapotez
vivement l'une de ses antennes, elle peut tourner les talons et disparaître en
15 à 20 millisecondes". A titre de comparaison, le cerveau humain a
généralement besoin de 200 millisecondes pour répondre à un stimulus. Mais,
comme nous, les blattes vieillissent. Angela Ridgel, de la Case Western Reserve
University (Ohio), a réalisé des films à grande vitesse (125 images par seconde)
montrant des blattes courant dans un étroit couloir, sur une surface
transparente. Elle a noté qu'environ 60 semaines après leur dernière mue, elles
commencent à trébucher; leurs pattes antérieures se prennent dans celles du
milieu et les vieilles blattes dérapent dans les côtes.......... Outre leur aide
précieuse dans la compréhension du vieillissement, les recherches sur les
cafards pourraient bénéficier aux programmes spatiaux. Il précise que leurs
mécanismes de fuite prouvent l'existence de deux circuits
indépendants... Certaines expériences ont montré que, même décapité,
l'insecte parvient à se déplacer. "Imaginez que l'on veuille concevoir un
système de commande pour un Rover martien; on pourrait baser son fonctionnement
sur le type de double circuit des blattes". Et si le Rover tombe en panne,
les ingénieurs auront toutes les raisons d'avoir le cafard !
Les cafards sont de fines
mouches :
Comment se fait-il que les blattes, capables de courir à
environ 5 km/h, parviennent à filer sous votre nez quand vous vous apprêter à
les écraser ? La réponse est simple ; les minuscules poils de leurs cerques
captent les variations de l'air; la descente d'une chaussure vers le sol
provoque un courant à basse fréquence qui diffère des mouvements normaux de
l'air, dès que l'insecte détecte quelque chose de suspect, il détale. Vous
pouvez malgré tout déjouer le système de vigilance des blattes en les visant
avec l'embout d'un aspirateur; elles interprètent la succion comme un courant
d'air venant de la direction opposée et s'enfuient par conséquent droit vers
l'aspirateur !
MacCain vainqueur ??!!
Opposé à Obama,
McCain a remporté indiscutablement l’épreuve. Une course de 6 pieds de long dans
un couloir en plexiglas, disputée par 2 Blattes souffleuses de Madagascar,
Gromphadorhina portentosa (Blatt. Oxyhaloïdé), organisée – comme avant
chaque élection présidentielle états-unienne par l’Association de lutte contre
les ravageurs du New-Jersey depuis 1941.
Et la blatte républicaine a battu la démocrate dans le second concours, pour la
présidence.
Cette course est réputée indiquer le prochain président dans 86% des cas !!!
Guérir le paludisme avec un herbicide ?
Rappel :
chaque année, plus de 500 millions de personnes
dans le monde sont atteintes de paludisme et plus d'un million en meurent, selon
l'OMS. La capacité du parasite, Plasmodium falciparum, à développer des
résistances aux traitements rend la lutte antipaludique périlleuse. Or, à
l'heure actuelle, il n'existe aucune alternative efficace aux associations
médicamenteuses comportant de l'artémisinine, molécule issue de la pharmacopée
chinoise; quant au vaccin, bien peu de candidats prometteurs ont été mis au
point. On comprend donc l'urgence de rechercher de nouveaux traitements aux
modes d'action inédit !
C'est en 1997 que 2 équipes indépendantes découvrent que certains parasites
(dont P. falciparum ...) possèdent un petit organite normalement présent
chez les plantes, un plaste....Tout l'enjeu étant de trouver des traitements qui
attaquent le parasite sans affecter les cellules humaines... Un raisonnement
qui amène... à réaliser les premiers essais sur l'homme d'une molécule
herbicide, la fosmidomycine... Mené en 2002, le premier essai clinique contre
le palu s'avère prometteur : l'herbicide est efficace et bien toléré. après
administration à des patients pendant 5, 4 et 3 jours, les taux de guérison sont
de 89, 88 et 60%. le biologiste travaille désormais à combiner la fosmidomycine
avec d'autres antipaludiques au mode d'action différent pour en augmenter
l'efficacité...
(L'article entier dans Science et Vie d'août 2008)
La superbe histoire de la
vanille :
 La
vanille (Vanilla planifolia) naquit dans la forêt tropicale mexicaine.
Elle appartient à une famille d'orchidées (Vanillia) qui compte de
nombreux membres, mais elle seule exhale un si doux parfum. Il séduisit le
peuple Totomac, sur la côte du golfe du Mexique, probablement le premier à
cultiver le vanillier, voilà plus de 1000 ans ..... Quand les Aztèques
vainquirent les Totomac, ils leur réclamèrent un tribut annuel en gousses de
vanille, qu'ils mélangeaient à leur boisson chocolatée. A leur tour, les
conquistadors espagnols apprécièrent la vanille qu'ils tentèrent vainement
d'acclimater en Afrique et en Asie . Il faudra attendre le coup de pousse
d'Edmond Albius pour que la culture du vanillier se répande hors de son berceau
natal. Madagascar est devenu le premier producteur mondial; mais, aujourd'hui,
la vanille naturelle n'assure plus que 5% de la consommation mondiale;
l'industrie alimentaire lui préfère la vanille artificielle, fabriquée par
milliers de tonnes à partir du bois. La
vanille (Vanilla planifolia) naquit dans la forêt tropicale mexicaine.
Elle appartient à une famille d'orchidées (Vanillia) qui compte de
nombreux membres, mais elle seule exhale un si doux parfum. Il séduisit le
peuple Totomac, sur la côte du golfe du Mexique, probablement le premier à
cultiver le vanillier, voilà plus de 1000 ans ..... Quand les Aztèques
vainquirent les Totomac, ils leur réclamèrent un tribut annuel en gousses de
vanille, qu'ils mélangeaient à leur boisson chocolatée. A leur tour, les
conquistadors espagnols apprécièrent la vanille qu'ils tentèrent vainement
d'acclimater en Afrique et en Asie . Il faudra attendre le coup de pousse
d'Edmond Albius pour que la culture du vanillier se répande hors de son berceau
natal. Madagascar est devenu le premier producteur mondial; mais, aujourd'hui,
la vanille naturelle n'assure plus que 5% de la consommation mondiale;
l'industrie alimentaire lui préfère la vanille artificielle, fabriquée par
milliers de tonnes à partir du bois.
Ce sont les Espagnols qui baptisèrent cette plante vainilla, mot
dérivé du latin vagina (également à l'origine de vagin !), signifiant
étui, gousse. Le plus amusant, c'est que cette orchidée aurait continué
longtemps à végéter dans sa patrie natale sans un esclave noir de 12 ans, Edmond
Albius. Né en 1829 sur l'île Boubon (La Réunion), cet orphelin de naissance fut
adopté par Beaumont, son maître qui l'instruisit en botanique. Quelques années
avant la naissance d'Edmond, le vanillier avait
été introduit sur l'île dans l'espoir qu'il produise la gousse parfumée; il
semblait s'y plaire, donnant de superbes fleurs ... mais de gousses : point !
Désespoir.
A l'époque, personne ne se doutait que la plante avait besoin d'un
insecte entremetteur pour assurer ses besoins sexuels;
 chaque fleur possède bien
des organes mâles et femelles, mais un hymen empêche l'autofécondation; pour
transférer le pollen de l'organe mâle (l'anthère) à l'organe femelle (le
stigmate), le vanillier mexicain s'est assuré les services d'une abeille locale
(Euglossa viridissima) en lui faisant miroiter un orgasme ...
A cette
fin, le rusé vanillier s'est dessiné une fleur ressemblant à une abeille
femelle, poussant même la tromperie jusqu'à émettre un parfum très sexe !
L'abeille mâle, toute émoustillée, se précipite sur ce qu'elle prend pour une
femelle consentante, déchire les membranes protectrices, tente un accouplement,
puis, comprenant sa méprise, s'enfuit, furieuse, mais enduite de pollen; trop
bête pour en tirer une leçon, l'insecte recommence aussitôt avec une autre fleur
où il dépose son pollen : le vanillier est aux anges, il peut accoucher d'une
gousse ! chaque fleur possède bien
des organes mâles et femelles, mais un hymen empêche l'autofécondation; pour
transférer le pollen de l'organe mâle (l'anthère) à l'organe femelle (le
stigmate), le vanillier mexicain s'est assuré les services d'une abeille locale
(Euglossa viridissima) en lui faisant miroiter un orgasme ...
A cette
fin, le rusé vanillier s'est dessiné une fleur ressemblant à une abeille
femelle, poussant même la tromperie jusqu'à émettre un parfum très sexe !
L'abeille mâle, toute émoustillée, se précipite sur ce qu'elle prend pour une
femelle consentante, déchire les membranes protectrices, tente un accouplement,
puis, comprenant sa méprise, s'enfuit, furieuse, mais enduite de pollen; trop
bête pour en tirer une leçon, l'insecte recommence aussitôt avec une autre fleur
où il dépose son pollen : le vanillier est aux anges, il peut accoucher d'une
gousse !
Ce n'est qu'en 1836 que cette mystification fut découverte fortuitement par
Morren. Ce botaniste belge goûtait paisiblement une tasse de café dans un hôtel
de Vera Cruz (Mexique) quand son attention fut captée par le manège d'une
minuscule abeille noire en train de virevolter autour d'une fleur de vanille.
Intrigué, il s'installe pour mieux observer et constate que l'insecte, tartiné
de pollen, pénètre dans la fleur; Morren patiente et voit la fleur se fermer;
quelques jours plus tard, constatant l'apparition d'une gousse, il comprend le
rôle joué par l'insecte. Bientôt il conçoit une technique de pollinisation
artificielle qu'il teste avec succès au Jardin Botanique de Liège; mais elle
s'avère trop compliquée pour être utilisée dans une plantation. C'est alors
qu'intervient le génie du jeune Edmond. Un jour de l'année 1841, Beaumont
découvre deux gousses sur ses vanilliers; stupéfait, il interroge son personnel;
bientôt le jeune Edmond avoue : c'est lui le coupable;
avec un éclat de bambou, il a eu l'idée de déchirer la membrane protégeant
l'anthère, puis d'un adroit geste rapide du pouce de transférer le pollen de
l'anthère vers le stigmate. En 1848, l'abolition de l'esclavage libère
Edmond, qui reçoit le nom d'Albius en référence à la couleur blanche de la fleur
de vanille; il devient garçon de cuisine; il est emprisonné pour un vol qu'il
n'a pas commis, puis libéré eu égard à son invention. Ce
qui ne l'empêcha pas de mourir dans la misère en 1888, dédaigné par tous ces
Blancs qui lui devaient leurs fortunes. Pauvre Edmond !!
L'espion Frézier qui ramena sa
fraise !
En 1711, Le Roi-Soleil confie à Amédée-François Frézier,
officier du génie maritime, la délicate mission de se rendre au Pérou et au
chili pour, officiellement, servir de conseiller militaire aux colonies
espagnoles: le monarque vient en effet de placer son petit-fils sur le trône
d'Espagne. Mais, secrètement, le roi charge Amédée de rapporter le plan de
toutes les places fortes et le maximum d'informations sur ces colonies. Les
alliances se renversent si vite !! Le 7 janvier 1712, l'espion du roi embarque à
bord du navire corsaire "Saint Joseph", et après 160 jours de traversée,
débarque à Concepcion, au Chili. accueilli à bras ouverts, Frézier sillonne la
côte du Pacifique durant deux ans et demi. Or cet ingénieur de 29 ans, à
l'esprit digne du siècle des Lumières, est un fondu de botanique; entre 2
forteresses, il visite l'arrière-pays, s'intéressant aux coutumes locales et aux
plantes cultivées; c'est ainsi qu'il découvre dans les champs des fraises
énormes et blanches; il n'avait jamais rien vu de tel en France; il écrira : "On
y cultive des campagnes entières d'une espèce de fraisier différent du nôtre par
les feuilles plus arrondies, plus charnues et fort velues. ses fruits sont
ordinairement gros comme une noix, et quelquefois comme un œuf de poule; ils
sont d'un rouge blanchâtre et un peu moins délicats au goût que notre fraise des
bois." Frézier décide d'en ramener quelques plants en France; quand le
navire regagne Marseille, le 17 août 1714, après 6 mois de navigation, 5 ont
survécu; l'espion en remet 2 à M. Roux de Valbonne, l'officier du bord chargé
des réserves en eau, sans qui les plantes seraient mortes de soif; il offre un
pied à son ami Antoine Jussieu, directeur du Jardin Royal (aujourd'hui Jardin
des Plantes), et un autre au jardinier de Versailles; il garde le dernier pour
lui qu'il plante près de Plougastel. Coïncidence extraordinaire : ce nom de
Frézier est une déformation du mot fraise !!
J'aurai pu faire beaucoup
d'argent ! :
A cours de fonds, de nombreux musées cherchent de nouvelles
sources d'aide financière. Depuis un an, le Zoologische Staatssammlung München (ZSM
ou Muséum de Munich ...) met en œuvre une nouvelle initiative de financement.
Pour 5000 DM et 10 000 DM, respectivement, un individu ou un établissement
choisit un animal; le donateur reçoit un document confirmant que l'espèce a été
nommée en son nom (ou du nom de quelqu'un de son choix), un dessin original
(dont une copie est publiée) et dix tirés-à-part de l'article publié. Les
documents et les dessins sont présentés lors de cérémonies qui ont lieu deux
fois par année. Une société d'amis du muséum, la "Freunde der Zoologischen
Staatssamlung", administre les fonds à des fins de recherche zoologique.
L'argent sert à l'achat de collections ou de livres, au financement de voyages à
des fins scientifiques et à l'acquisition d'équipement instamment nécessaire.
L'approche a de grands mérites. Elle permet de recueillir, en cette période de
compressions budgétaires par les gouvernements surendettés, des fonds grandement
nécessaires. Elle rehausse en outre le profil des travaux taxinomiques et attire
l'attention sur le nombre de nouvelles espèces en voie d'être décrites et de
celles qui ne le sont pas encore. Enfin et surtout, elle forge un lien entre les
gens et les espèces sauvages, un nom étant un puissant symbole spirituel.
(dans "Nature" du 17 avril 1997)
(ndlr : les astronomes font de même en dédiant de nouvelles étoiles ou planètes
découvertes à de généreux donateurs...!)
Papillon cherche
parrain :
Qui n’a pas eu envie de choisir le nom
scientifique d’une espèce d’insecte tout juste découverte ? Pour vous qui avez
noté quelques binoms « latins » au cas où, voici l’occasion du siècle – une très
belle occasion car, pour une fois, il ne s’agit pas d’une variante indiscernable
d’une teigne microscopique ni de quelque insignifiant thrips mais d’un beau et
grand papillon orange. De la famille des Brassolidés (Nymphalidés), du groupe
des Opsiphanes, il vient d’être découvert dans le désert de Sonora
(Mexique).
Proche de lui, on connaît (trop bien) O. tamarindi sous le nom commun de
Chenille verte du bananier plantain, un redoutable défoliateur.
Mais foin de cette digression agricole, comment fait-on pour profiter de cette
aubaine (avant le 2 novembre 2007) ? Il suffit d’aller sur le site
iGAVEL et de faire une offre. Eh oui, ce n’est pas gratuit : l’université
de Floride a en effet mis aux enchères le nom (uniquement le nom, c’est bien
précisé) de ce papillon nouveau pour la science ; la somme recueillie servira
aux recherches sur les Lépidoptères du Mexique et à leur protection.
Pour vous éviter de perdre du temps avec des
surenchères un peu trop faibles, sachez qu’en 2005, le nom d’une nouvelle espèce
de singe (de Bolivie) a été adjugé pour 450 000 € !!
Art (de la promotion) et insectes :
Pour l’éternité Roy Orbison (1936-1988) survit dans Orectochilus
orbisonorum (Col. Gyrinidé). C’est Quentin Wheeler – directeur de
l’International Institute for Species Exploration (université de
l’Arizona, États-Unis) - qui a nommé ce gyrin indien en l’honneur du
“plus grand chanteur du monde” (dixit Elvis Presley). Pour sa
production lexicale, Q. Wheeler est bien connu, y compris de nos
services : je l’ai épinglé en 2005 pour avoir créé, pour 3 silphes
nouveaux pour la science, les noms d’espèce bushi, cheneyi,
rumsfeldi. L’annonce a été faite lors d’un concert commémoratif, le
25 janvier 2008 ; Q. Wheeler y a en outre présenté Whirligig,
infographie signée Charles J. Kazilek, « œuvre d’art entre Warhol et
Darwin ».
Pourquoi pas ??
Le docteur Kraatz, célèbre coléoptériste allemand, éprouvait
une telle passion pour ses recherches et sa collection qu'il demanda par
testament à être incinéré et que ses cendres soient déposées dans un carton à
insectes. Il repose donc, pour l'éternité (?!), au milieu de sa collection,
conservée à l'Institut d'Eberswalde.
(Boll. Soc. Ent. Aragonesa,13, 1995)
L'Ariège, mon cher
département, se "méditerranéise" :
"Ce sont les témoignages de deux de nos fidèles lecteurs,
l'un à Ganac, l'autre à Madières, qui nous ont, pour ainsi dire, mis la puce à
l'oreille : il y aurait des cigales en Ariège; presque un comble dans un
département qui se veut avant tout montagnard ...On peut leur faire confiance et
, surtout, ne leur dîtes pas qu'il s'agissait de grillons ! Ils sont certains
d'avoir entendu des cigales et ne sont sûrement pas les seuls. Abondante en
Provence, la cigale a en réalité un habitat planétaire; d'autant que selon les
scientifiques, il en existerait 4500 espèces dans les régions chaudes et
tempérées du globe. Est-il possible que l'espèce ait mis une patte dans notre
département ? "Il est tout à fait raisonnable de le penser, répond le
Directeur de la F. D. de la Chasse, car nous assistons à une "méditerranéisation"
de notre climat et de notre relief; que ce soit la faune ou la flore, il y a des
exemples qui ne trompent pas, comme l'apparition du chêne vert, l'espèce la plus
commune de la région méditerranéenne. Idem avec les coteaux qui deviennent secs
et font penser à la garrigue, l'abaissement des forêts. Et le vent d'autan qui
est de plus en plus présent ..."
Autre exemple encore cité par Jean Guichou, l'apparition du guêpier, un oiseau
de la taille d'un merle au plumage aux brillantes couleurs; présent en
Languedoc, en Provence, il a également fait son apparition en Ariège, sur l'Hers
entre autre, probablement attiré par les anciennes sablières et les berges
sablonneuses des rivières.
("La Gazette Ariégeoise")
Dernière heure : des cigales ont été
entendues dans les environs de mon cher village de Massat; encore plus à
l'ouest, encore plus loin de la Méditerranée ... !!
Les 21 glaciers de mes chères
Pyrénées :
auront disparu avant 2050 en raison du réchauffement
climatique. Un pronostic funeste donné hier (5/09/2008) par une équipe de
chercheurs espagnols qui a désigné la montée progressive de la température, un
total de 0,9°C de 1890 jusqu'à maintenant, comme le principal responsable.
De 1990 à nos jours, le dégel a déjà provoqué la
disparition totale des glaciers les plus petits et la réduction de 50 à 60% de
la superficie des plus grands !
L'asticot-thérapie :
 "Comme le montre, de façon ludique, cette passionnante
exposition ("Insectes, je vous aime", au Muséum de Lyon,
cet été 2006), l'entomophagie n'est pas la seule utilité que l'homme
trouve à l'insecte. Ces bestioles se révèlent également d'une grande utilité en
médecine, où l'on pratique très sérieusement ... l'asticot-thérapie. Au
XVI ème siècle, le chirurgien Ambroise Paré avait remarqué que les grands
blessés, dont les plaies étaient envahies d'asticots, survivaient mieux que les
autres et évitaient même l'amputation. On a récemment
compris, qu'en se nourrissant des tissus morts, les asticots éliminaient les
microbes et désinfectaient les plaies grâce à la sécrétion d'allantoïne. De
plus, en remuant, ils exerçaient un massage bénéfique à la cicatrisation. Une
thérapie aussi efficace que n'importe quel traitement moderne et nettement moins
coûteuse. Durant l'année 2002, l'asticot-thérapie a été réintroduite dans
quelque 2000 centres de soins à travers le monde. Mais sans grand succès à cause
de la réticence des patients ... "Comme le montre, de façon ludique, cette passionnante
exposition ("Insectes, je vous aime", au Muséum de Lyon,
cet été 2006), l'entomophagie n'est pas la seule utilité que l'homme
trouve à l'insecte. Ces bestioles se révèlent également d'une grande utilité en
médecine, où l'on pratique très sérieusement ... l'asticot-thérapie. Au
XVI ème siècle, le chirurgien Ambroise Paré avait remarqué que les grands
blessés, dont les plaies étaient envahies d'asticots, survivaient mieux que les
autres et évitaient même l'amputation. On a récemment
compris, qu'en se nourrissant des tissus morts, les asticots éliminaient les
microbes et désinfectaient les plaies grâce à la sécrétion d'allantoïne. De
plus, en remuant, ils exerçaient un massage bénéfique à la cicatrisation. Une
thérapie aussi efficace que n'importe quel traitement moderne et nettement moins
coûteuse. Durant l'année 2002, l'asticot-thérapie a été réintroduite dans
quelque 2000 centres de soins à travers le monde. Mais sans grand succès à cause
de la réticence des patients ...
(Dans "Aujourd'hui en France")
Dernière nouvelle (10/2008)
: Les sécrétions de l'asticot de la mouche verte, Lucilia sericata,
contiennent un puissant antibiotique. En labo, ce composé, baptisé sératicine,
est efficace contre 12 souches différentes de staphylocoques dorés résistantes
aux antibiotiques, ainsi que contre d'autres bactéries impliquées dans des
infections nosocomiales. Prochaine étape : synthétiser la molécule et la tester
sur l'homme; pour l'heure, les quantités extraites des asticots sont beaucoup
trop faibles pour espérer une utilisation à grand échelle.
Bonjour à tous :
Généraliste de mon état (spécimen rare), mes premières
chasses furent consacrées autant à des coups de filets aux gestes rouillés qu'à
des prospections sous multiples roches, ainsi qu'à des fouilles dans les souches
pourries encore à demie-gelée...
Pour faire diversion aux lépidoptéristes :p mes premières
captures (mise à part celle du premier mars...voir message du 03-03-04) furent
surtout des insectes d'autres ordres. J'ai notamment capturé (débusqué serait le
mot plus exact) trois vespidés dans une souche pourries (en passant, j'oublie le
nom latin mais tsé là les grosses guêpes noires et blanches qui piquent en
t.....). Coudons j'imagine que ce sont les "reines" qui survivent à l'hiver car
les spécimens trouvés semblaient de taille plus importante que les ouvrières
régulièrement rencontré l'été. Ah oui parmi ces trois pseudo-reines se trouvait
une guêpe germanique elle aussi de belle taille. J'ai aussi trouvé plusieurs de
ces petites "guêpes" d'un cm avec le bout des antennes jaune et un point de la
même couleur sur leur thorax noir ainsi qu'un abdomen rougeâtre...vous savez
celles qui bougent les antennes comme des pompiles...(désolé pour la perte de
mémoire des noms latin...alcool à l'appui...à cause de la victoire des habs:P).
Elles étaient plus de 6 dans la même cavité dans une autre souche pourries. Elle
vivent pourtant en mode solitaire mais plusieurs hyménos hivernent en gang je
pense. En tout cas selon Mister Fabres cela est observable chez plus d'une
espèce (les serpents le font bien eux). Toujours dans les hyménos j'ai vu
plusieurs terriers d'abeilles (mégachille?) dans le sable de la bute mentionnée
dans le message du trois mars. J'ai aussi aperçu ces abeilles en vol mais le
filet ne fut pas assez preste, diantre. Pour changer j'ai attraper en vol (vu
leur démarche aérienne définitivement plus baba) quatre scarabées d'environ 8 mm
que je raccorde à la famille des scarabeinae vu l'absence de tarse sur les
pattes antérieurs mais dont l'identification n'est pas encore établie. Sous les
pierres, hormis les nombreux nid de fourmis s'activant presto à reprendre vie,
les dizaines de millipèdes, diplopodes et grillons, j'ai fais la découverte de
quelques carabes des taille ridicule et de trois espèces de staphylinidae dont
ce qui me semble être Ontholestes cingulathus, qui est de loin (selon moi) le
plus impressionnant de nos staphylins. Et puis pour finir en beauté j'ai vu pas
mal de dityques et de gyrins dans un étang ainsi qu'une chrysomèle du genre
calligrapha qui y pataugeait bien malgré elle. Bain oui évidement que j'ai vu
des tites vanesses et des Mot-Riaux mais je crois qu'il furent mentionné par
d'autres avant moi...Est-ce que je me trompe? :P
Ne prenez pas trop peur, je ne vous ferez pas l'inventaire de
chacune de mes chasses cet été bien que ce n'est pas l'envie qui me manque...Je
crois juste qu'il ne faut pas oublier les pauvres autres petites bibittes qui
sont elles aussi fières du retour de la belle saison!
À tous chers collègues entomologistes, Une EXCELLENTE saison
de chasse, des surprises et la réalisation de vos plus beaux fantasmes
entomologiques! (un des miens c'est d'attraper un lépido avec mon filet en
faisant un front-flip dans une trail...je vais me pratiquer sur ma trampoline
avant...me semble de voir le gars avec son filet sur la trempo en train de se
prendre pour un entomo-ninja...!!!)
Ok cé assez : Sioux soon!
Victor VERMETTE - Représentant de la section Montréal
La biodiversité
de l'Île de Santo :
La France organise une
campagne d'exploration de la plus grande île du Vanuatu :
 Dans
la grande tradition des expéditions scientifiques du XVIIIème
siècle, celles de James Cook ou de La Pérouse, le projet Santo 2006
appareillera au début du mois d'août pour 5 mois de recherche sur
l'île d'Esperito Santo; la biodiversité que renferme cette île, la
plus grande de l'archipel, va être l'objet d'études des 160 "savanturiers"
de 25 nationalités différentes ..."Au rythme où vont les choses, il
faudrait 1000 ans pour décrire l'intégralité des espèces vivantes",
précise Philippe Boucher, spécialiste des mollusques au Muséum. Et
d'ici là, plus de la moitié pourrait avoir disparu ... Dans
la grande tradition des expéditions scientifiques du XVIIIème
siècle, celles de James Cook ou de La Pérouse, le projet Santo 2006
appareillera au début du mois d'août pour 5 mois de recherche sur
l'île d'Esperito Santo; la biodiversité que renferme cette île, la
plus grande de l'archipel, va être l'objet d'études des 160 "savanturiers"
de 25 nationalités différentes ..."Au rythme où vont les choses, il
faudrait 1000 ans pour décrire l'intégralité des espèces vivantes",
précise Philippe Boucher, spécialiste des mollusques au Muséum. Et
d'ici là, plus de la moitié pourrait avoir disparu ...
Le but de l'opération est de faire "un arrêt sur image" de l'état de
la biodiversité de l'île à un moment donné, depuis le plus haut
sommet (1800m) jusqu'à 1000m au fond de la mer; les 4000 kilomètres
carrés de l'île constituent à bien des égards un terrain de choix
pour se pencher sur la faune et la flore. .... L'équipe ne compte
pourtant pas découvrir de nouvelles espèces d'oiseaux ou de grands
mammifères, mais compte se concentrer sur les "petites bêtes"."Il
faut arrêter avec cette focalisation sur des animaux
"charismatiques" comme les ours blancs", déclare Olivier Pascal,
botaniste et Directeur des programmes de Pro-Natura.
Les insectes, par exemple, dont 80% demeurent inconnus à ce jour,
sont les principaux garants de l'équilibre des écosystèmes. De plus,
ils pourraient être d'excellents indicateurs des changements
environnementaux. Et c'est là l'un des premiers objectifs des
chercheurs. Alors que la disparition de nombreuses espèces vivantes
n'est plus à démontrer, certains parlant même d'une sixième grande
vague d'extinction, ils espèrent modéliser la place des insectes au
sein des écosystèmes pour déterminer des espèces témoins, afin de
déceler des modifications dans le milieu naturel ...
(Dans le JDD du 23/VII/2006)
Les entomologistes inventorient le vivant :
Chez les entomologistes, chaque spécialiste s'occupe de son « piège
». Il est tantôt« Malaise » (capture en plein vol),
« lumineux », « Winkler » (faune du sol), « battant » (insectes
associés aux plantes), autant de noms étranges que de méthodes de
capture. Ces petites bêtes s'appellent arthropodes, hyménoptères
(guêpes), coléoptères, papillons nocturnes, arachnides.
Premier bilan : pour les papillons de nuit, 5 500 spécimens pour une
estimation de 350 espèces auront été collectés par le Dr Roger
Kitching, de Griffith University (Australie).
Pour les araignées, Christine Rollard a identifié 23 espèces
présentes à Santo, parmi lesquelles 5 sont inconnues ailleurs.
Dans les galeries souterraines, le nombre des espèces de
micro-invertébrés est de 30 à 40 % supérieur à celui des régions
tropicales du Sud-Est asiatique.
Sous le sol de Santo :
Jamais une telle diversité de micro-invertébrés du sol n'avait
encore été observée en Asie.
La présence d'une nouvelle espèce de cloporte, un taxon d'origine
marine qui se serait adapté à l'eau douce, est soupçonnée.
Côté grottes, gouffres et siphon, dix-neuf personnes ont enfilé leur
combinaison dès la mi-octobre. L'équipe constituée par Louis
Deharveng a sillonné pendant un mois les grottes et les réseaux
calcaires de la partie orientale de l'île et découvert un réseau
souterrain de plusieurs kilomètres. Il n'aura pu être complètement
parcouru lors de cette mission. Mais déjà, après avoir exploré
dix-huit kilomètres de grottes, ils ont trouvé huit espèces de
chauve-souris, les seuls mammifères endémiques de l'île, et cinq
espèces de crustacés d'eau douce.
Les merveilles entomologiques d'une île préservée (ce n'est plus
Santo, mais Vanikoro !) :
Ayant déjà contribué à l'opération Lapérouse en 2003, Henri-Pierre
Aberlenc, entomologiste au Cirad, a pris part à l'expédition 2005.
Il a collecté, sur l'île, entre trois et quatre mille insectes
représentant plus d'un millier d'espèces différentes dont certaines
sont encore inconnues des scientifiques.
Le passalide Gonatas naviculator de Vanikoro © Cirad, H.P. Aberlenc
 Parmi
ces merveilles, figure la larve de Gonatas naviculator (Percheron,
1844), une espèce de coléoptère de la famille des Passalides, dont
des spécimens adultes n'avaient auparavant été recensés qu'à peu de
reprises : en 1844, le spécimen type décrit par Percheron, à la fin
du XIXe siècle cinq couples pris par le Docteur Philippe François,
et, en 2003 et en 2005, une série d'adultes pris par Henri-Pierre
Aberlenc. Une poignée d'exemplaires sont disséminés dans d'autres
collections. La larve était totalement inconnue jusqu'à ces
dernières semaines. Elle a pu être prélevée en de nombreux
exemplaires à trois stades successifs de croissance. Ces exemplaires
ont été déposés au Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) de
Paris, à côté des exemplaires du Dr François, et dans la collection
d'insectes du Cirad. Une étude de l'ADN viendra par la suite
compléter l'étude purement morphologique. Parmi
ces merveilles, figure la larve de Gonatas naviculator (Percheron,
1844), une espèce de coléoptère de la famille des Passalides, dont
des spécimens adultes n'avaient auparavant été recensés qu'à peu de
reprises : en 1844, le spécimen type décrit par Percheron, à la fin
du XIXe siècle cinq couples pris par le Docteur Philippe François,
et, en 2003 et en 2005, une série d'adultes pris par Henri-Pierre
Aberlenc. Une poignée d'exemplaires sont disséminés dans d'autres
collections. La larve était totalement inconnue jusqu'à ces
dernières semaines. Elle a pu être prélevée en de nombreux
exemplaires à trois stades successifs de croissance. Ces exemplaires
ont été déposés au Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) de
Paris, à côté des exemplaires du Dr François, et dans la collection
d'insectes du Cirad. Une étude de l'ADN viendra par la suite
compléter l'étude purement morphologique.
Tri des insectes pris par les pièges jaunes © Cirad, H.P. Aberlenc
 Henri-Pierre
Aberlenc a également retrouvé deux espèces endémiques de Vanikoro
précédemment décrites dans la littérature : le passalide déjà cité
et le charançon Elytrurus lapeyrousei, découvert par Dumont
d'Urville. A l'heure actuelle, la moisson d'espèces nouvelles pour
la science et endémiques de Vanikoro se chiffre à trois : les
coléoptères buprestides Maoraxia bourgeoisi - dédié à Yves et Hugues
Bourgeois - et Agrilus funebris vanikorensis, ainsi que le
coléoptère psélaphien Laperouseus conani - dédié à la fois à
Lapérouse et à Alain Conan - qui représente non seulement une espèce
nouvelle mais aussi un genre nouveau. Le chercheur suppose que
d'autres espèces, en cours d'étude, pourront être qualifiées de
nouvelles : des coléoptères ténébrionides, une cigale, des punaises,
des mouches, etc. Henri-Pierre
Aberlenc a également retrouvé deux espèces endémiques de Vanikoro
précédemment décrites dans la littérature : le passalide déjà cité
et le charançon Elytrurus lapeyrousei, découvert par Dumont
d'Urville. A l'heure actuelle, la moisson d'espèces nouvelles pour
la science et endémiques de Vanikoro se chiffre à trois : les
coléoptères buprestides Maoraxia bourgeoisi - dédié à Yves et Hugues
Bourgeois - et Agrilus funebris vanikorensis, ainsi que le
coléoptère psélaphien Laperouseus conani - dédié à la fois à
Lapérouse et à Alain Conan - qui représente non seulement une espèce
nouvelle mais aussi un genre nouveau. Le chercheur suppose que
d'autres espèces, en cours d'étude, pourront être qualifiées de
nouvelles : des coléoptères ténébrionides, une cigale, des punaises,
des mouches, etc.
Un piège lumineux © Cirad, H.P. Aberlenc
Quelques espèces ont été prélevées en alcool absolu afin de pouvoir
en réaliser le séquençage Adn dans le cadre du projet barcoding(1).
Cette technique permet de comparer les espèces entre elles. Elle
apporte une information complémentaire à celle tirée de l'étude
morphologique.
 L'étude
entomologique est doublée d'une étude biogéographique. Elle consiste
à déterminer l'origine géographique des espèces collectées, par
quels chemins elles sont arrivées à Vanikoro et permet même parfois
d'estimer la date de leur arrivée. D'après les premiers résultats,
l'essentiel du peuplement provient de Papouasie-Nouvelle-Guinée et
du Sud-Est asiatique. Le peuplement s'est fait d'ouest en est. Pour
certaines espèces, Vanikoro représente en effet la limite orientale
de répartition. L'étude
entomologique est doublée d'une étude biogéographique. Elle consiste
à déterminer l'origine géographique des espèces collectées, par
quels chemins elles sont arrivées à Vanikoro et permet même parfois
d'estimer la date de leur arrivée. D'après les premiers résultats,
l'essentiel du peuplement provient de Papouasie-Nouvelle-Guinée et
du Sud-Est asiatique. Le peuplement s'est fait d'ouest en est. Pour
certaines espèces, Vanikoro représente en effet la limite orientale
de répartition.
Cet insecte est une punaise indéterminée qui a été trouvée à
Vanikoro lors de la mission 2005. © Cirad, H.P. Aberlenc
L'inventaire et l'étude de la totalité des espèces collectées
s'étalera sur plusieurs années. Pas moins de vingt chercheurs,
répartis dans cinq pays à travers le monde - l'Angleterre, la
France, l'Italie, la Nouvelle-Calédonie et la République Tchèque -
sont déjà associés à ce travail depuis 2003. L'étude des diptères,
très prometteuse en espèces inédites et remarquables, ne pourra
certainement pas être terminée d'ici plusieurs dizaines d'années en
raison du manque de spécialistes dans ce domaine.
Cependant, d'ores et déjà, il s'avère que cette île petite et
relativement isolée est remarquablement préservée : sa richesse
biologique est étonnante pour un aussi petit territoire.
Dernières nouvelles : Même ce qui semble se situer au milieu de
nulle part recèle toujours une diversité de vie incroyable. Au cours
de 5 mois d'études sur l'île de Santo, plus de 150 botanistes,
zoologistes marins et autres spécialistes ont passé au peigne fin
les montagnes, les forêts, les grottes, les récifs et l'océan en
quête d'organismes vivants. L'équipe internationale a recensé plus
de 10 000 espèces, dont des crustacés, des insectes, des plantes, et
même un champignon fluorescent. Il se pourrait qu'environ 2 000
d'entre elles soient inconnues pour la Science. Ces découvertes
fourniront un repère pour mesurer les changements à venir dans cette
région. "80% des espèces de la planète restent à découvrir",
souligne un des chefs de l'expédition. A une époque où on s'inquiète
surtout de ce que le monde perd, cette aventure nous rappelle tout
ce qui reste à trouver !
Le criquet italien :
 Invasion
de criquets dans le Sud-Aveyron ; « Saint Affrique, ce n’est pas
l’Afrique ! » (Article revue de presse) Invasion
de criquets dans le Sud-Aveyron ; « Saint Affrique, ce n’est pas
l’Afrique ! » (Article revue de presse)
21 juillet 2005, La Dépêche du Midi, Le Monde, Maroc Infos, RFI,
France 3, AFP et Webagri
L’alerte a été lancée à la veille du 14 juillet par la chambre
d’agriculture de l’Aveyron : des criquets par milliers dévorent les
champs du sud du département. Un peu étonné, un site d’information
marocain publie un gros titre sur la présence de criquets sur le sol
français. L’article reprend en fait in-extenso une chronique de
Radio-France Internationale qui se demande si les phénomènes
d’invasions de criquets pélerins « jusqu’à présent limités à
l’Afrique de l’Ouest et du Nord, sont en train de toucher l’Europe
du fait du réchauffement de la planète et des changements
climatiques ». « Saint-Affrique, ce n’est pas l’Afrique »,
relativise toutefois Dominique Delpiroux dans La Dépêche du Midi,
qui explique que les éleveurs aveyronnais, pour agacés qu’ils soient
de voir leurs champs de luzerne dévastés, « se gardent bien de
comparaisons indécentes ». Dès le 16 juillet, la préfecture de
l’Aveyron, citée dans un article du Monde en date du 18 juillet,
réagissait en faisant savoir que « cela n’a rien à voir avec les
invasions que connaissent les pays africains ». Le journaliste du
Monde, Philippe Gagnebet, décrivait
« un criquet rouge entre 4 et 5cm reconnaissable à ses
ailes rouges lorsqu’il s’envole et qui se déplace en essaim ». Son
confrère de La Dépêche explique aujourd’hui qu’il s’agit d’un
criquet italien, calliptamus italicus. Sa collègue de RFI, Colette
Thomas, pensait avoir à faire à Psophus stridulus, en raison des
ailes rouges de l’insecte. « Les invasions de criquets sont si rares
en France que les instituts spécialisés en agronomie ne travaillent
pas sur ces insectes », affirme la journaliste. France 3 Sud
explique que malgré son nom, le criquet italien existe à l’état
endémique dans la zone sèche des Grands Causses, proche du Larzac,
tout en soulignant que les mœurs de ce criquet sont insuffisamment
connues, en raison même de la rareté de ses épisodes de
prolifération jusqu’ici. En juillet 2004, une colonie de criquets
italiens avait déjà envahi l’aéroport de Nice. Une dépêche de
l’agence France-Presse relatait alors que la Chambre de commerce et
d’industrie avait décidé de traiter l’essaim « à l’aide d’un produit
phytosanitaire ». Mais cette fois, les autorités et les agriculteurs
eux-mêmes se montrent plus prudents. Il s’agit de trouver un produit
efficace contre le criquet mais auquel résistent d’autres espèces,
notamment l’abeille, et qui reste inoffensif pour le bétail,
explique rapidement le site professionnel Webagri, qui souligne que
le produit qui se montre le plus efficace en Afrique est... le
Fipronil. (Revue de Presse Quotidienne. Mission Agrobiosciences. 21
juillet 2005, La Dépêche du Midi, Le Monde, Maroc Infos, RFI, France
3, AFP et Webagri)
Si des invasions de criquets se produisent épisodiquement en France,
d’autres criquets sont sur la liste des espèces protégés, comme le
criquet de la Crau (site du CIRAD)- Lien sélectionné par la Mission
Agrobiosciences
Accéder aux articles concernant "Criquets et Afrique"- édités par le
magazine Web de la Mission Agrobiosciences
¿Salieron del mar los insectos?
TEMAS: biología,
zoología, entomología, insectos
Un prestigioso biólogo alemán
que estudia la fauna marina en la ría de Ferrol respalda la tesis
emergente que atribuye a los crustáceos el pasado de los insectos en el
proceso evolutivo.
Wolfgang Wägele, prestigioso biólogo marino alemán, forma parte de un
grupo de científicos convencidos de que muchos insectos son en realidad
el resultado de una evolución terrestre de ciertos crustáceos. La
corriente es todavía minoritaria en la comunidad de zoólogos y
estudiosos de la evolución de las especies, pero Wägele está convencido
de que bajo el mar se esconden las claves del pasado de los insectos.
Según esta tesis, cangrejos, cigalas y otros parientes cercanos
emergieron en algún momento a la superficie, se adaptaron al nuevo medio
y tomaron la tierra.
«Los insectos son crustáceos terrestres», explica
Wolfgang Wägele. «Tienen en su cerebro estructuras muy similares a las
de los cangrejos, pero hasta hace poco nadie sabía por qué». Lo cuenta
el científico en un laboratorio de la estación de biología de A Graña,
en Ferrol. Está trabajando en ella con un grupo de alumnos de la
Universidad de Bonn que preparan sus tesis doctorales. Han viajado por
carretera desde Alemania hasta la ría ferrolana para recoger muestras de
la fauna marina local.
Secretos :
Está por ver si las aguas de Galicia y la vida que
contienen contribuirán a desvelar los secretos científicos que se
esconden tras la evolución de los insectos. Lo seguro es que en esta
tierra los científicos tienen material para estudiar. «En la playa de
Doniños hay un animal muy raro, la Mystacocarida», cuenta Wägele,
mientras señala en un libro el dibujo de esta peculiar especie. Tiene la
forma de un ciempiés y su tamaño es mínimo: medio milímetro.
«La ría de Ferrol es muy rica en fauna», cuenta el
biólogo alemán. «Con las mareas, el agua va cambiando y se renueva mucho».
No considera que esté especialmente sucia, pese a carecer de sistema de
depuración. «Siempre se nota algo, por la actividad en los puertos y eso...
Pero en otras zonas en las que hemos estado cerca de puertos hay más
suciedad», asegura.
Wägele ha conocido también otras zonas de Galicia,
entre ellas la ría de Arousa. «Es una zona parecida a ésta, aunque el
agua está más caliente, y por esa razón hay otras especies», explica el
biólogo. En cuanto a Ferrol, no es la primera vez que viene, ni será la
última. «Volveremos aquí con alumnos y también para dar cursos de
zoología». Tal vez lo haga con nuevas certezas sobre el parentesco
evolutivo entre los crustáceos y los insectos.
Fuente: La Voz de Galicia
Enquête sur la comédie de la
mort :
Certains, parmi le peuple des
six-pattes, feignent la mort subite. Puis, des dizaines de minutes plus tard,
s'éveillent et décampent. Pourquoi cette étrange tactique ?
Tiens ! Aujourd'hui, Fabre se cache derrière un meuble. Dehors, c'est
vacarme de cigales et océan de lumière. Lui, immobile, dans la grande
pièce-laboratoire de l'Harmas, scrute. Sur une table, à 10 pas de là, un scarite;
ce petit prédateur, redouté éventreur des sables, a été tracassé par notre
savant. tripoté, roulé entre les doigts, retourné sur le dos; jusqu'à ce que,
figé, il ne remue plus une mandibule. Alors Jean-Henri file et va se cacher comme
un gamin; un quart d'heure, une heure; montre en main, il patiente; jusqu'à ce
que le minuscule insecte veuille bien remuer et filer à toutes pattes; à ce
moment-là, inépuisable, il recommence son manège; secoue la bestiole jusqu'à la
torpeur; et va de nouveau se cacher pour guetter le retour au mouvement. Pour un
éventuel visiteur, la question devient : l'entomologiste aurait-il fini par
souffrir des ardeurs solaires ? Sa raison l'aurait-elle abandonné ?
On répondra qu'une fois de plus une question empoisonnée s'est emparée de
l'esprit du chercheur; une interrogation qui nécessite quelques stratagèmes :
pourquoi certains insectes simulent-ils la mort ? Pourquoi restent-ils des
dizaines de minutes, parfois des heures, statues immobiles ?
Alors il observe, obsessionnel; et note : 17 minutes de totale immobilité, puis
20, 25 et- 33 et encore 50 minutes lors de 5 expériences consécutives sur le
scarite.
Avouons notre idée d'enfance, celle que nous avons forgée en jouant au chat avec
quelques laborieux six-pattes tombés entre nos griffes, c'est que l'insecte
compte nous décourager. Et comment ! Gamin, nous nous fatiguons d'aussi peu de
velléité à décamper ou à réagir; et abandonnons la créature jugée morte pour
d'autres jeux.
Fabre aussi le constate; mais en se dissimulant dans un coin de son bureau, il
renifle une méprise du géant humain sur les intentions du nain : "L'attitude
mortuaire n'est pas une supercherie de l'insecte en danger; ici, rien n'intimide
plus l'animal; autour de lui, tout est silence, repos; s'il persiste dans son
immobilité, ce ne saurait être maintenant pour duper "intelligemment" l'ennemi
...".
Coma de stress : A cette thèse, plusieurs
arguments; d'abord le scarite en question ne craint nul prédateur; ce chasseur
nocturne n'est même pas menacé par le bec des oiseaux; pire, pendant
l'immobilité, ce faux mort se réveille et décampe au moindre risque de danger
inconnu; qu'une mouche vienne l'explorer de sa trompe et le voici qui remue,
s'agite et se carapate. Plus encore, tous les insectes ne pratiquent pas ce jeu;
le scarite lisse, cousin minuscule du scarite géant, et qui aurait bien plus de
raison de feindre la mort s'il s'agissait de se protéger, décampe pour sa part
obstinément, sans jamais jouer cette comédie du grand sommeil ...
Autre expérience avec un bupreste, un énergumène sensible à la chaleur et au
froid; Fabre le terrorise, puis le plonge dans un bocal refroidi d'une douzaine
de degrés; gagné ! Avec la diminution de température le coma se prolonge; la
mort est simulée jusqu'à 5 heures, au lieu d'une demi-heure en conditions
normales; voilà notre détective sur la piste d'une catalepsie que le froid
perpétue ... Fabre se souvient alors de son enfance; et du jeu pratiqué avec
d'autres garnements : mettre des troupes de dindons en hypnose en leur glissant
la tête sous l'aile, puis en les balançant un instant dans cette posture; une
occupation aussi étrange que drôle pour une bande d'écoliers. Le rapprochement
avec les insectes est troublant; car les six-pattes s'éveillent doucement, au
contraire de sauter sur leurs membres pour s'enfuir s'ils étaient en situation
de crainte; non, décidemment, tout se passe comme si les minuscules étaient en
hypnose, en syncope.
Une autre légende met Fabre dans
cette idée : celle des scorpions qui se suicident. Fabre fait l'expérience du
feu qui désespère l'animal; la Provence est riche de scorpions blancs; mais au
lieu de laisser l'animal pour mort une fois les braises éteintes, il patiente
encore; et l'arthropode, dont on dit qu'il se suicide en se piquant, s"éveille
et s'enfuit au bout d'un long laps de temps; lui aussi était dans un coma. Ainsi
donc, si on extrapole, la crainte mettrait tous ces animaux dans une torpeur
profonde; un simple coma de stress ...
(Par Patrice Lanoy)
Un tueur de palmiers sur la
Côte :
 Alerte au tueur de palmiers sur la Côte
d'Azur, où des inspections systématiques
vont tenter désormais de s'opposer à la très redoutable invasion d'un insecte
capable de dévorer l'intérieur de ces arbres symbole de la Riviera; plus connu
sous le nom de charançon rouge et mesurant de 2 à 4 cm, le Rhynchophorus
ferrugineus représente un véritable fléau. Sa capacité de nuisance a pu
encore être mesurée l'an dernier en Espagne, dans la célèbre palmeraie d'Elche,
près de Valence; pas moins de 3 000 arbres infectés ont dû être abattus. Alerte au tueur de palmiers sur la Côte
d'Azur, où des inspections systématiques
vont tenter désormais de s'opposer à la très redoutable invasion d'un insecte
capable de dévorer l'intérieur de ces arbres symbole de la Riviera; plus connu
sous le nom de charançon rouge et mesurant de 2 à 4 cm, le Rhynchophorus
ferrugineus représente un véritable fléau. Sa capacité de nuisance a pu
encore être mesurée l'an dernier en Espagne, dans la célèbre palmeraie d'Elche,
près de Valence; pas moins de 3 000 arbres infectés ont dû être abattus.
Sur la Côte, les spécialistes prennent donc très au sérieux la récente
apparition, à la mi-octobre dernier, de premiers cas de contamination repérés à
Sanary. "Ces insectes sont désormais présents à la La Croix-Valmer,
Sainte-Maxime et Grimaud , dans la région tropézienne. Egalement dans les
Alpes-Maritimes, où la localité de Saint-Martin-du-Var a été touchée. La Corse
n'est pas épargnée non plus."
Si l'on sait qu'il n'existe actuellement aucun moyen de traitement naturel ou
chimique, la menace pèse désormais sur plus de 100 000 palmiers recensés sur la
Côte. Apte à se déplacer en volant sur environ 7 km, cet envahisseur se
reproduit à une vitesse considérable; chaque femelle laisse sa trace sous la
forme de 100 à 300 œufs et larves; lesquelles, une fois écloses dans les
anfractuosités de l'arbre, creusent des milliers de galeries, rongeant alors
complètement le palmier de l'intérieur
L'arbre se transforme inéluctablement en une coquille vide, avec le danger non
négligeable de le voir brusquement s'effondrer sur une chaussée ou dans un
jardin. Un seul remède, plutôt onéreux (4000 euros par arbre infecté)
s'imposerait alors aux pouvoirs publics et aux particuliers après le repérage
d'un sujet infecté : un abattage pur et simple et une incinération.
Une Croisette ou une Promenade des Anglais sans leurs palmiers n'est plus une
perspective inconcevable ...
Là ou comme ailleurs sur la Côte,
depuis quelques jours, on traque la moindre apparition des signes d'infection :
chute de palmes, présence de sciure à la base du tronc, présence aussi de cocons
de la taille d'un œuf de poule à la base des palmes ...
La grande fête des insectes :
Les insectes, animaux à sang froid, profiteront-ils du
réchauffement climatique ? La question était encore théorique il y a quelques
années; les entomologistes répondent désormais, sans ambiguïté, par
l'affirmative ...
 L'évolution est déjà visible à travers l'expansion géographique de certaines
espèces et l'apparition de nouveaux comportements; prenons la pyrale et la
sésamie, deux papillons dont les larves se nourrissent des tiges et des épis de
maïs; traditionnellement, la pyrale (Ostrinia nubilalis) se contentait d'une génération par an; de
son côté , la sésamie, sensible au gel continu en hiver, restait cantonnée au
sud du pays. "Tout cela est en train de changer; on retrouve désormais la
sésamie dans la région Centre, en Indre et Loire, où elle n'avait jamais été vue
auparavant; on en a aussi vu dans la plaine de Caen, tandis que des pyrales
étaient signalées en Belgique" confirme ... Cette remontée vers le nord
s'accompagne chez la pyrale d'une augmentation du nombre de générations
annuelles, le voltinisme ...; l'insecte peut désormais effectuer trois cycles
dans la saison, ce qui accentue la pression sur les récoltes; le multivoltinisme
s'observe aussi chez le carpocaspe des pommiers et poiriers; "dans les années
1970, à Avignon, on n'avait que deux générations par saison; on en compte
désormais trois; on se retrouve dans la situation du Maroc, il y a 30 ans"
constate ... L'évolution est déjà visible à travers l'expansion géographique de certaines
espèces et l'apparition de nouveaux comportements; prenons la pyrale et la
sésamie, deux papillons dont les larves se nourrissent des tiges et des épis de
maïs; traditionnellement, la pyrale (Ostrinia nubilalis) se contentait d'une génération par an; de
son côté , la sésamie, sensible au gel continu en hiver, restait cantonnée au
sud du pays. "Tout cela est en train de changer; on retrouve désormais la
sésamie dans la région Centre, en Indre et Loire, où elle n'avait jamais été vue
auparavant; on en a aussi vu dans la plaine de Caen, tandis que des pyrales
étaient signalées en Belgique" confirme ... Cette remontée vers le nord
s'accompagne chez la pyrale d'une augmentation du nombre de générations
annuelles, le voltinisme ...; l'insecte peut désormais effectuer trois cycles
dans la saison, ce qui accentue la pression sur les récoltes; le multivoltinisme
s'observe aussi chez le carpocaspe des pommiers et poiriers; "dans les années
1970, à Avignon, on n'avait que deux générations par saison; on en compte
désormais trois; on se retrouve dans la situation du Maroc, il y a 30 ans"
constate ...
... L'étude des pucerons révèle elle aussi l'impact du changement climatique. "Nous
ne constatons pas d'augmentation de la quantité de pucerons, mais de leur
diversité". Des espèces probablement présentes sur le territoire en faible
quantité, qui étaient "sous le radar", deviennent "piégeables"; le nombre moyen
d'espèces capturées chaque année est ainsi passé de 168, entre 1978 et 1982, à
211 actuellement.... Par ailleurs, la date de début de migrations des pucerons
est toujours plus précoce : ... , depuis trente ans, elles ont commencé en
moyenne un jour plus tôt chaque année; les pucerons qui s'attaquent à la pomme
de terre et à la betterave ont donc gagné un mois d'activité sur cette période !
La chenille processionnaire, premier "défoliateur forestier" français, offre un
exemple supplémentaire de progression. Les colonies meurent lorsque la
température descend sous -16 °C; pour que les chenilles sortent du nid pour se
nourrir, il faut une température supérieure à 9°C pendant le jour et à 0°C la
nuit. "Au sud du Bassin Parisien, ces contraintes ont été levées ces 10
dernières années " assure ... Dans le Briançonnais, des populations
implantées expérimentalement ont survécues à 1850 m en face sud, alors que le
"front" en altitude est actuellement limité à 1200m ... En latitude, ce front
progresse vers le nord d'environ 5 km par an, conditionné essentiellement par
les faibles capacités de vol des femelles imagos, alourdies par leurs œufs. "Les
colonies atteindront Paris en 2025" estime ..., qui cherche à savoir si les
pins bordant les autoroutes ne facilitent pas leur progression.
... On ne compte plus les signalements de bestioles exotiques repérées bien plus
au nord que leur "niche" d'origine. Ces délocalisations sont une des facettes de
la mondialisation ! Ces insectes - dont 41 "ravageurs" nouveaux introduits en
France métropolitaine entre 2000 et 2005 - ont profité des circuits commerciaux
pour coloniser de nouveaux territoires.
(Une partie de l'excellent article de Hervé Morin dans "Le
Monde" du 27/XII/ 2006)
Complètement piqué !
C’est grâce à un moustique, un vulgaire moustique, que la
police finlandaise a mis la main sur un suspect. La bestiole se trouvait dans
une voiture volée abandonnée, retrouvée à Seinäjoki. En passant le véhicule au
peigne fin, les enquêteurs y ont trouvé l’insecte gorgé de sang humain.
L’analyse ADN a révélé l’identité d’un homme déjà fiché. Le suspect nie les
faits, rapporte le tabloïd Ilta-Sanomat, mais n’exclut pas que le sang
puisse lui appartenir. La justice doit encore décider si la preuve suffit à
l’inculpation. A suivre !
Le vin à coccinelles :
Cette année là, la coccinelle à sept points pullulait dans le
Pays de Retz (à l'ouest de Nantes), y compris dans les vignes où des centaines
d'individus s'étaient faufilés entre les grains de raisin. Les vignerons n'ayant
rien remarqué, les grappes furent pressées avec leurs squatters. Quand vint le
temps de l'assemblage, les œnologues restèrent perplexes devant un arôme qu'ils
ne pouvaient identifier. En effet, les alcaloïdes contenus dans le corps des
coccinelles avaient été pressé en même temps que le raisin. Plus de 1000 hl de
ce vin finalement imbuvable furent jetés à l'égout !
(D'après J. P. Coutanceau)
 Les Coccinelles
: Les Coccinelles
:
Comme
pour les "bousiers", c'était en Vendée, et c'était il y a
longtemps...
La saison battait son plein et les plages étaient prises d'assaut
par des milliers de vacanciers avides de soleil et de flots bleus.
C'est alors que des nuées de coccinelles se sont abattues sur le
littoral, au grand dam des corps dénudés assaillis de toutes parts à
l'instar de vulgaires colonies de pucerons ...
À l'époque le phénomène faisait quasiment la une des médias, et le
monde scientifique se perdait en conjectures tandis que les langues
allaient bon train dans les chaumières, ou plus exactement dans les
" bourrines "...
Les entomologistes, eux, se frottaient les mains car de telles
abondances sont exceptionnelles et souvent prometteuses d'espèces ou
de variations quasi introuvables en temps normal.
En compagnie d'un ami âgé (en fait Michel C., mon maître es
entomologie!), nous chassions sur le haut de la dune surplombant la
plage, et ne savions où donner du flacon tant les coccinelles de
toutes sortes abondaient. C'est alors qu'un grand gaillard en
maillot de bain nous interpelle, et vient vers nous en gesticulant.
Intrigués nous l'attendons, et là... surprise !
L'homme captait les coccinelles comme un aimant la ferraille. Elles
arrivaient et se posaient sur lui par dizaines, et sitôt chassées
sitôt revenues. L'explication était certes classique (il transpirait
beaucoup suite à un long footing, et bon nombre d'insectes
apprécient ce type d'effluves), mais le résultat n'en demeurait pas
moins spectaculaire.
Bien entendu ce qui devait arriver arriva...
Bras levés, et juché sur un promontoire naturel, notre gaillard
tournait lentement sur lui-même tandis que mon vieil ami se livrait
à une inspection corporelle en règle, tout en " picorant " du bout
des doigts les bestioles jugées ça et là intéressantes.
Cet ami était plutôt frêle et petit, et la disparité des statures
ajoutait encore à la cocasserie de la situation. Le comble a été
atteint quand notre vacancier s'est figé dans une pose digne d'une
statue antique, et que le vieil homme s'est mis à graviter autour de
cet éphèbe d'un nouveau genre, tout en continuant de " picorer " les
fameuses coccinelles au gré d'une cuisse, d'un torse, d'une
épaule... ou d'un maillot !
Ce jour-là j'ai eu le sentiment que toute la plage nous regardait...
et c'était sans doute vrai !
J'ai emprunté cette excellente anecdote au très intéressant et
sympathique site de notre collègue André Lequet dont je recommande
très vivement la visite :
http://perso.orange.fr/insectes.net/index.htm
Un an à regarder voler les
papillons des jardins français :
L'observatoire des papillons des jardins (OPJ) donne son
premier bilan après un an de fonctionnement :
C'est symboliquement le jour du printemps que le premier bilan de l'OPJ a
été rendu public; un rendez-vous que les organisateurs voudraient maintenir
chaque année à la même date. Cet observatoire a été lancé par le Muséum (MNHN),
l'Association Noé Conservation et la fondation Nicolas Hulot pour sensibiliser
le grand public aux enjeux de la biodiversité. Enjeux principalement liés aux
changements climatiques, à la politique agricole commune et au programme Natura
2000 qui ont une action sur la faune et la flore.
Partant du fait qu'en Europe 50 % des papillons de prairie avaient disparu en
quinze ans, l'Observatoire essaie de constituer un véritable réseau de
surveillance de la biodiversité. pour que le projet réussisse, il faudrait que
la France, qui n'a pas de grande tradition naturaliste comme la Grande-Bretagne
(hum !!!), les Pays-Bas ou les Etats-Unis, parviennent à mobiliser un public de
plus en plus large de volontaires. A titre d'exemple, en Grande-Bretagne, 20 000
bénévoles parcourent chaque année 2 861 aires d'observation; alors qu'en France,
si environ 15 000 observateurs se sont inscrits sur le site Internet de l'OPJ (www.noeconservation.org),
seuls 5 000 à 6 000 d'entre eux y participent régulièrement.
Les premiers résultats de l'OPJ sont intéressants; ils se concentrent sur 28
espèces de papillons communs parmi les plus répandus alors qu'il en existe 260
espèces de jour et 4 827 de nuit; d'ores et déjà, ils indiquent que le nord du
Bassin Parisien (Picardie) compte en moyenne 10 espèces recensées par commune,
contre 19 pour le sud-ouest du Bassin (Beauce). La côte du Languedoc présente
une richesse inférieure à celle de la Côte d'Azur.
Bassins miniers incriminés
:
Dans certaines régions, comme le bassin du Creusot et L'ouest de la Moselle, les
bassins miniers sont incriminés pour justifier le faible nombre de papillons.
Dans la région parisienne, c'est le tissu urbain. Alors que pour d'autres zones,
comme le nord de la Dordogne, les Hautes-Pyrénées, le sud de l'Alsace et le nord
de la Franche-Comté, l'explication nécessitera des analyses supplémentaires.
Il a également été observé que le cycle de vie des papillons
comme l'aurore se déroule entre avril et juin tandis que la belle -dame est
visible d'avril à octobre; cette donnée témoin permettra de faire des
comparaisons durant les années suivantes, d'observer d'éventuels décalages et de
les corréler avec les phénomènes météorologiques, notamment.
Par ailleurs, certains papillons, comme le brun du pélargonium, une espèce
invasive venant d'Afrique du Sud, se propage vers le nord.
Forts de ces renseignements qui seront complétés dans les
années à venir, les jardiniers en herbe devraient adopter des comportements plus
favorables aux papillons et à l'environnement. Les jardins français représentent
plus d'un million d'hectares, soit environ 2 ù de la surface de la France.
Sensibilisées depuis 3 ans à ce sujet, les Côtes d'Armor ont installé 100
hectares de refuges à papillons grâce à l'Association Vivarmor.
(Le Figaro des 24-25 mars 2007)
 Entomologie / Biologie
en Patagonie : Entomologie / Biologie
en Patagonie :
Resp. Jean-Jacques
Menier et
Christian Clot
Lors de
l'expédition 2004, nous avons été surpris de constater qu'un nombre
impressionnant d'insectes couraient sur le glacier
Marinelli. Des insectes de
plusieurs centimètres, au corps effilé et avec de longues pattes comme nous n'en
avions encore jamais vu sur un glacier. Certes, cela ne veut pas dire
grand-chose vu nos connaissances restreintes en entomologie. Cependant il n'est
pas impossible que le caractère préservé de la Cordillera Darwin ait permis le
développement d'espèces uniques.
Ce que
nous avons fait.
Selon une procédure
mise en place avec le musée d'histoire naturelle, nous avons ramené un certain
nombre d'échantillons pour être analysés dans le calme d'un laboratoire. Ces
insectes entre 1 et 2 cm, de couleur noire et plus rarement orangée, Du groupe
des Plécoptères, des insectes analogues ont été récemment découverts sur le
Hielo
Patagonico Sur, en 2004 et ont été nommés Dragons de Patagonie. Il est
possible que ceux observés en Cordillère de Darwin par Karine
Meuzard, Christian
Clot durant leur première expédition en 2004 et ramenés par
Ultima Cordillera
2006 soient arrivés durant la glaciation du canal de Magellan, voilà 40 000 ans
et se soient développés depuis en totale autarcie. Une espèce passionnante,
méconnue, qui intéresse aujourd’hui autant les entomologistes que les chercheurs
sur le développement de la vie dans la glace : l’adaptation de ces insectes à la
vie dans la glace ouvre de nombreux questionnements. Les échantillons ramenés
pour étude sont les premiers au monde venant de ce secteur, séparé du continent
par la mer.
Les portables soupçonnés de
décimer les abeilles :
Les abeilles seraient menacées d'extinction par ... le téléphone portable. C'est
en tout cas la thèse que vient de publier le professeur Jochen Kunh, de
l'Université de Landau, en Allemagne. Selon ce chercheur, les champs magnétiques
émis par les mobiles provoqueraient des interférences avec le système de
navigation naturel des abeilles et les empêcheraient de retrouver leur ruche.
désorientées, perdues, incapables de s'alimenter, elles n'auraient pour seule
issue que la mort.
Pour Jochen Kuhn, ce phénomène pourrait expliquer la multiplication à travers le
monde depuis quelques années des cas de colony collapse disorder (CCD),
ces ruches retrouvées un beau matin totalement vidées de leur colonie, la reine
ayant été abandonnée avec ses oeufs par les ouvrières. Les chercheurs allemands
ont mené diverses expériences et ont notamment remarqué qu'à chaque fois qu'ils
plaçaient un portable près d'une ruche, celles qui fabriquaient le miel
refusaient d'y pénétrer.
Une diminution de près de 30 % en dix ans :
"Il y a quelques années, une étude avait déjà accusé les lignes
électriques à haute tension d'être à l'origine du même phénomène. Mais
finalement, les scientifiques n'ont jamais vraiment pu prouver cette hypothèse.
cette histoire de portable est possible, mais selon moi ce n'est pas la raison
principale de la baisse du cheptel apicole que nous constatons effectivement
depuis une dizaine d'années" sou ligne Philippe Lecompte, président du
réseau biodiversité pour les abeilles. En France, le nombre d'abeilles a diminué
de 30 % en dix ans. Pour le défenseur de la nature, cette baisse s'explique
plutôt par la modification du paysage botanique changeant le bol alimentaire des
abeilles, l'apparition de deux nouveaux parasites au début des années 2000, et
surtout depuis octobre 2005, l'arrivée d'un frelon asiatique. Repéré pour la
première fois dans le Lot et Garonne, Vespa velutina se développe à
grande vitesse. Son hobby principal ? Certainement pas téléphoner avec son
mobile, mais bel et bien manger ses cousines européennes !
(A. E., dans "Aujourd'hui en France")
Ce n'est pas une bonne
nouvelle pour la baise, mais c'est sans doute une bonne nouvelle pour la Planète
:
Depuis 50 ans (en 2008), la production de spermatozoïdes,
chez l'homme, a diminué de moitié. En 20 ans, les hommes parisiens ont perdu 40%
de leurs spermatozoïdes, soit près de 2% chaque année, selon une étude menée par
le Professeur Jouannet, ancien chef de service de Biologie de la Reproduction à
Cochin. De plus, les quelques spermatozoïdes qui restent sont de moindre
qualité, moins mobiles et difformes !!
La faune et la flore en cours d'inventaire :
Si vous les voyez tendre l'oreille à l'écoute des oiseaux un carnet à la main,
soulever des plaques de caoutchouc sous lesquels se chauffent des serpents ou se
promener de nuit, en voiture, avec un appareil à ultrasons qui sort par la
vitre, ne soyez pas surpris. Ces amateurs et scientifiques aguerris réalisent
tout simplement, avec la plus grande attention, l'atlas de la biodiversité
seine-et-marnaise; ils donnent d'ailleurs rendez-vous aux curieux ce 16 juin
2007 pour évoquer les premiers résultats après deux ans de cette enquête unique.
Le Conseil Général de Seine-et-Marne est le seul en France à avoir engagé
une telle démarche, entourée d'un solide protocole scientifique. "Quand nous
l'avons lancée avec les Associations partenaires, nous savions que c'était
l'unique façon d'obtenir des résultats incontestables et dont nous pourrions
estimer l'évolution en permanence", affirme Jean Dey, vice-président du Conseil
Général chargé de l'eau, de l'air et de la terre. Côté scientifique, l'étude est
menée avec le Conservatoire botanique national du Bassin parisien et l'Unité
mixte de recherche formée de chercheurs du CNRS ou encore de l'Université Paris
VI; 8 associations sont aussi totalement investies et missionnées pour les
études de terrain par le département
"Je découvre des espèces que je n'ai jamais rencontrées !
":
"C'est un projet ambitieux, très bien organisé scientifiquement, confirme Bruno
Mériguet, entomologiste de l'Opie (Office pour les Insectes et leur
environnement); nous nous sommes impliqués à fond en collectant les insectes
avec 10 bénévoles. Je découvre également des espèces que je n'ai jamais
observées !". Difficile de connaître l'évolution de ces espèces pour le moment,
selon certains scientifiques, depuis 1880, plus de 200 variétés de plantes et
beaucoup d'oiseaux ont disparu. "Nous assistons aussi à une homogénéisation des
espèces, notamment à cause de la disparition de certains habitats, ou encore de
la présence de grandes surfaces de cultures céréalières, explique Olivier
Renault, chargé de mission biodiversité et réseaux naturels; mais nous étudions
tous les milieux grâce à un échantillonnage aléatoire, y compris les zones
industrielles ou le bord des autoroutes. Et il reste de bonnes nouvelles, comme
un oiseau, le Guêpier d'Europe ou des papillons rares qu'on trouve plus qu'on ne
l'espérait."
Les premiers résultats serviront notamment à proposer aux élus locaux les
meilleures pistes possibles d'aménagement du territoire, pour ne pas rompre les
liaisons entre les espèces. un budget de 1,3 millions d'euros sur trois ans a
d'ores et déjà été débloqué par le département. Mais pour que l'étude de
l'évolution soit intéressante, les recherches devront s'inscrire dans la durée.
(L. Parny, "Seine-et-Marne matin" du samedi 16 juin 2007)
 Un dynastinae amazonien à St. Girons (09) : Un dynastinae amazonien à St. Girons (09) :
Il y a quelques jours (fin juillet 2007), un voisin et ami de Massat,
travaillant aux papeteries de Lédar ("banlieue" de St. Girons), me ramène un
scarabée qu'il ne connaissait pas et qui lui paraissait un peu gros pour la
région...
Et pour cause ! Il s'agissait d'un superbe mâle d'Enema Pan
(dynaste néotropical très commun dans toute l'Amazonie), probablement sorti
d'une palette; ces papeteries n'important pas de bois tropicaux, mais utilisant
un très grand nombre de palettes.
Je l'ai gardé vivant le plus longtemps
possible pour observer un peu ses mœurs (nocturnes ...).
Du nouveau : d'une palette sûrement pas... La larve est effectivement trop
grosse; l'imago devait être coincé quelque part; peut-être dans de la terre...
Carabes et réchauffement
climatique :
 Mes derniers piégeages de carabes en Ariège se sont avérés
désastreux; ils m'ont cependant permis de constater que l'on trouve splendens
de plus en plus haut ; jusqu'à peu de temps limité en altitude à 700-800m, on le
trouve de plus en plus fréquemment au-delà de 1000m, repoussant les populations
de punctatoauratus encore plus haut et s'hybridant plus souvent
avec ce dernier. Mes derniers piégeages de carabes en Ariège se sont avérés
désastreux; ils m'ont cependant permis de constater que l'on trouve splendens
de plus en plus haut ; jusqu'à peu de temps limité en altitude à 700-800m, on le
trouve de plus en plus fréquemment au-delà de 1000m, repoussant les populations
de punctatoauratus encore plus haut et s'hybridant plus souvent
avec ce dernier.
"L'eau de Karabe" :

Ce superbe pot en faïence, ayant contenu de "l'eau de karabe",
est conservé dans la fameuse Pharmacie du XVIIIe siècle de l'hotel-dieu de St.
Lizier (Ariège); je n'ai pas trouvé grand-chose sur cette eau de Karabe;
si quelqu'un en sait plus ...
Après recherches, il pourrait s'agir d'une eau (ou d'un sirop) de Karabé, autre
nom de l'ambre jaune ou succin ...
Mission périlleuse au cœur
des Yungas :
Au cours d'une
récente expédition dans les forêts qui couvrent les contreforts des
Andes, des entomologistes ont prélevé de minuscules insectes tapis
au sommet d'immenses arbres tropicaux. Un exploit physique, destiné
à percer les secrets de l'évolution. Et qui contribue, au passage, à
la préservation d'écosystèmes menacés. Reportage au cœur des Yungas
argentines :
Les indiens Guarani qui vivent dans les épaisses et humides forêts
des Yungas, sur les contreforts orientaux des Andes, racontent une
curieuse histoire sur le « Yaguareté », le plus grand félin
d'Amérique du Sud. Le jaguar serait toujours invisible aux yeux des
hommes, mais ne cesserait de les observer, tapi sous les couverts
végétaux. Si les Indiens disent vrai, alors le félin a surpris
récemment un insolite ballet aérien au cœur des Yungas : trois
hommes suspendus au bout de longues cordes rouges et jaunes,
progressant en équilibre sur la cime des cèdres, des urundels et des
robles, les arbres les plus courants dans la zone, et prélevant de
mystérieux échantillons dans les branches les plus élevées, au moyen
de perches et de nappes tendues dans les feuillages. Elagueurs des
sommets ? Touristes en quête de sensations fortes ? Vous n'y êtes
pas. Eric Guilbert, Cyrille D'Haese et Lionel Picart participent à
une expédition scientifique, Cafotrop-Energia-Muséum, qui s'est
déroulée en Argentine durant la première quinzaine de juin. Les deux
premiers sont entomologistes au Muséum national d'histoire
naturelle, à Paris. Le troisième est guide de « tree climbing », une
technique de grimpe d'arbre permettant d'accéder en toute sécurité
aux plus hautes branches, et dans le plus grand respect de la
nature.
En compagnie de deux collègues argentins du Museo de La Plata, Diego
Carpintero et Sara Montemayor, nos trois explorateurs ont sillonné
les épaisses forêts tropicales, pour y traquer les insectes de leurs
rêves, répondant aux noms de Tingides – insectes qui constituent une
famille de punaises – et collemboles. Renouvelant en profondeur deux
cents ans de pratique d'entomologie, ces scientifiques ne se
contentent pas des bords de route et des sentiers de promenade pour
collecter leurs spécimens. Tournant les yeux vers le ciel, ils vont
au contraire chercher les insectes là où ils se trouvent : au sommet
des arbres, dans la canopée, qui marque la limite entre le ciel et
la couverture végétale. « Ce milieu est encore largement méconnu,
essentiellement pour sa difficulté d'accès, explique Eric Guilbert,
responsable de la mission et co-créateur de la société Cafotrop, qui
a pour vocation d'exploiter le « tree climbing » à des fins
scientifiques. Pourtant, les études déjà menées ont montré que la
canopée renferme une grande richesse biologique. C'est pourquoi nous
avons décidé d'y concentrer nos efforts. »
Une fois en hauteur, parfois à 40 mètres au-dessus du sol, les
scientifiques prélèvent les « sols suspendus» qui les intéressent,
c'est à dire les mousses et les plantes qui poussent sur les
branches. Ou battent les feuillages pour faire tomber dans leurs
nappes suspendues les précieux insectes.
Seuls problèmes rencontrés dans les cimes des Yungas, mais aussi du
Gabon ou de Nouvelle-Calédonie, où Cafotrop a également réalisé des
missions : la présence de serpents, de guêpes ou de fourmis, dont
les piqûres à l'acide formique font redescendre les chercheurs
illico ! Parfois, les rencontres sont plus agréables, comme celle
d'un oiseau tropical, ou d'un groupe de singes venu assister au
curieux spectacle des entomologistes voltigeurs. Mais au-delà de ces
péripéties, et de l'apparence d'aventure sportive qui se dégage de
la mission, les objectifs scientifiques sont bien réels. En
collectant leurs insectes, les biologistes du Muséum accèdent en
effet à des informations capitales sur l'évolution du vivant. Les
études se déroulent de retour au laboratoire, où les échantillons
sont analysés. Un véritable travail de fourmi, qui s'étale sur
plusieurs années, tant le nombre d'insectes prélevés est grand, et
les études minutieuses. Ainsi, pour la seule mission des Yungas, 820
spécimens, dont 614 hétéroptères et 206 collemboles, ont été
collectés sur quatre sites. Un chiffre encore provisoire, puisque
tout le contenu des pièges à insectes posés sur le terrain n'a pas
été trié. L'ensemble représente, pour l'instant, quinze familles de
punaises et cinq familles de collemboles. Chaque insecte est décrit
morphologiquement, tout d'abord au microscope optique, puis au
microscope électronique à balayage, qui permet des grossissements
jusqu'à 90 000 fois : « Nous pouvons ainsi visualiser l'ultrastructure
des insectes, comme des orifices glandulaires, des microvalvules ou
des insertions de poils, explique Cyrille D'Haese. Ils nous
permettent de situer chaque espèce dans les arbres phylogénétiques
que nous construisons, basés sur leurs relations de parenté. » Cette
étude morphologique est associée à une analyse de l'ADN de certains
individus. Le séquençage d'une portion de gène, et sa comparaison
avec d'autres espèces, permet également de déterminer les liens de
parenté. Enfin, l'étude d'individus à des stades larvaires
différents fournit des informations sur les vitesses de
développement embryonnaire des insectes. Autant de données qui sont
compilées et traitées par de puissants calculateurs afin de tester
des hypothèses évolutives concernant des moments clés de l'histoire
de la vie. Des événements survenus à des périodes très reculées, il
y a 200 ou 300 millions d'années, et dont ces insectes portent la
trace dans leur génome et leur morphologie. Exemples : la sortie des
eaux de certains groupes d'insectes, ou l'apparition de formes
extravagantes, comme ces ailes immenses dont sont dotées plusieurs
espèces de Tingides.
Il arrive aussi que certains insectes contribuent à résoudre des
questions plus inattendues : « En établissant les différences
phylogénétiques entre des groupes vivants sur des continents
différents, on peut déduire les dates de leur séparation, explique
Cyrille D'Haese. Ces informations peuvent servir aux géologues, qui
s'intéressent aux mouvements de la croûte terrestre, et à la
chronologie de la séparation des continents. » Outre l'intérêt
scientifique que représentent les insectes, la mission poursuit un
second objectif, tout aussi important. À travers les connaissances
acquises sur les groupes d'insectes qu'ils étudient, les chercheurs
mettent en valeur la richesse écologique et biologique des forêts
explorées, et encouragent les mesures de sauvegarde. Cafotrop
concentre en effet ses efforts sur des zones appelées « hot-spots »,
connues pour leur biodiversité. Preuve de cette richesse : les 25
hot-spots répertoriés, couvrant à peine 1,4% de la surface de la
Terre, contiennent les deux cinquièmes des espèces vivantes connues.
Or, ces zones sont grandement menacées. Ainsi, la réserve de
biosphère des Yungas, qui s'étend sur 1,3 million d'hectares dans
les provinces très pauvres du nord de l'Argentine, est soumise à de
fortes menaces dues aux activités humaines : déforestation,
pollutions industrielles, fragmentation des espaces vitaux d'espèces
animales du fait de la construction de routes ou de pistes.
Les décideurs argentins suivront-ils les recommandations des
chercheurs qui, comme Eric Guilbert et Cyrille D'Haese, militent
pour leur protection ? On peut l'espérer, pour ces zones naturelles
dont la valeur écologique est inestimable… Mais aussi pour la survie
du « Yaguareté » sacré des Indiens Guaranis, qui hante
silencieusement les forêts des Yungas.
Pedro Lima (à Buenos Aires)
Voici le site où l'on peut trouver l'intégralité de cet excellent
article, avec de superbes photos :
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_article=8283
Une araignée venimeuse dans
les étals :
 Faire les courses au supermarché peut se révéler bien plus
périlleux que prévu. Une dangereuse araignée brésilienne, la Phaneutria
nigriventer, plus communément appelée "araignée-banane" vient en effet
d'être découverte sur les étals d'une grande surface de la ville néerlandaise de
Bolsward. Or, son venin entraîne de terribles souffrances et même des
paralysies. Chez l'homme, la morsure peut également s'accompagner d'une
douloureuses érection persistante pouvant mener, dans certains cas, à
l'impuissance. La charmant bête a heureusement été capturée par un vétérinaire.
Les amateurs de bananes ont eu chaud au slip ! Faire les courses au supermarché peut se révéler bien plus
périlleux que prévu. Une dangereuse araignée brésilienne, la Phaneutria
nigriventer, plus communément appelée "araignée-banane" vient en effet
d'être découverte sur les étals d'une grande surface de la ville néerlandaise de
Bolsward. Or, son venin entraîne de terribles souffrances et même des
paralysies. Chez l'homme, la morsure peut également s'accompagner d'une
douloureuses érection persistante pouvant mener, dans certains cas, à
l'impuissance. La charmant bête a heureusement été capturée par un vétérinaire.
Les amateurs de bananes ont eu chaud au slip !
(dans Marianne)
La consommation d’insectes aquatiques est un aspect méconnu des sociétés
rizicoles :
L’île de Bali (Indonésie) est plus célèbre pour ses superbes paysages de
rizières étagées que pour l’entomophagie de ses habitants, lesquels se
régalent de libellules (“nymphes” et adultes) et d’abeilles (larves, nymphes et
miel). Une tradition séculaire, singulière
par son ampleur passée, menacée de désintérêt.
■
Une ressource alimentaire essentielle des sociétés rizicoles :
Dans
le monde, plusieurs sociétés rizicoles consomment des libellules et d’autres
insectes aquatiques. Thaïlandais et Laotiens mangent les libellules adultes
frites ou rôties. Au Laos,
Anax
guttatus
(Odonate Aeschnidé) est capturée au moyen d’une chandelle placée au milieu d’un
grand bol d’eau. Les Vietnamiens en consomment également les larves. Les
Japonais mangent les libellules cuites, ainsi que plusieurs Coléoptères
aquatiques (Dytiscus,
Cybister…)
qu’ils attirent à l’aide d’une tête de poisson salée immergée. À Madagascar, les
populations des hauts plateaux consomment les larves séchées des grosses
libellules. Comme leurs lointains parents indonésiens, les riziculteurs des
ethnies Merina et Betsileo apprécient les libellules frites. Sur le continent
africain, les Pangwés du Sud du Cameroun consomment les larves et leur trouvent
des qualités diurétiques que les Balinais attribuent aux insectes adultes.
■
Les libellules balinaises
Il
existe à Bali plus de 45 espèces de libellules. Les Balinais interrogés en
distinguent une quinzaine, rassemblées sous le vocable
capung,
un même nom local désignant parfois plusieurs espèces distinctes. Toutes les
demoiselles et les libellules capturées sont consommées, principalement celles
des espèces des genres
Anax,
Crocothemis
et
Neurothemis
(Libellulidés)
(d’après Pemberton, 1995). Les libellules sont consommées dans l’ensemble de
l’île mais les noms vernaculaires, les méthodes de capture et les région à
l’autre. Dans deux localités, parmi les espèces capturées et consommées, j’ai pu
identifier
Orthetrum sabina,
O.
glaucum,
Potamarcha obscura,
Crocothemis servilia,
Neurothemis ramburii,
ainsi que
Cratilla lineata assidua,
Trithemis aurora
et
Pantala flavescens.
Les Balinais connaissent les habitudes de certaines libellules :
O.
sabina
se
rencontre dès le matin tandis que
C.
servilia
vole
le soir ; la grande libellule
gelandok
(de
cou eur jaune, non identifiée) a la particularité de s’installer à l’envers,
croyances peuvent différer d’une alors que celle appelée
mas
(mêmes caractéristiques) se pose rarement. Les larves, appelées
belau’k
ou
blauk,
sont récoltées dans les rizières inondées de préférence lorsque les pousses de
riz atteignent une vingtaine de centimètres. Elles se vendent le matin sur
certains marchés de l’intérieur de l’île : une portion comprenant une centaine
de larves se vend l’équivalent d’environ 0,50
e.
Elles seront consommées grillées ou en friture.
■
Techniques de capture :
De
nos jours, seuls les enfants continuent à chasser les libellules. Les méthodes
de capture varient selon les régions, le matériel à disposition et les terrains
prospectés. Deux techniques utilisent la sève collante du jacquier (Artocarpus
heterophyllus)
et parfois celle d’un frangipanier (Plumeria
sp.). La première consiste à approcher lentement une longue et fine tige dont
l’extrémité est enduite de sève et, d’un coup sec, à coller la libellule au
repos. La seconde, rapportée par Pemberton, consiste à agiter en cercle
au-dessus d’une rizière une boule de sève placée à l’extrémité d’une longue
tige, puis à attendre que les libellules se laissent prendre à cet appât.
Connaissant la voracité des insectes, les Balinais utilisent également de
petites libellules (Acisoma
panorpoides
ou
Diplacodes trivialis)
comme appât vivant. La captive est agitée à l’extrémité d’une perche : il suffit
alors d’attendre quelques minutes pour qu’une libellule plus grosse fonde sur
cette proie, laquelle est rapidement capturée. Une méthode plus simple consiste
à attraper les insectes à la main. Pour ce faire, les enfants saisissent
l’insecte par l’arrière, entre le pouce et l’index. Une technique plus brutale
consiste à assommer les libellules, au repos ou en vol, avec un éventail ou un
balai de tiges. Une fois leurs ailes coupées à la main, elles sont embrochées
sur une tige ou placées dans un sac.
■
Entomophagie domestique :
jusqu’à trois fois par jour. Ces pratiques se sont estompées progressivement
pour disparaître à la fin des années 1970. Avec les poissons, les anguilles, les
grenouilles et les escargots, tous pêchés en rizière, les insectes
représentaient auparavant une part indispensable des apports journaliers en
protéines. À chaque repas, une vingtaine d’insectes, accompagnés de maïs, de
fruits du jacquier et de patates douces cuisinés, étaient servis avec le riz.
Denrée chère, la viande de porc, comme celle de poulet, était réservée aux
nombreuses fêtes religieuses, familiales ou communautaires, ponctuant le
calendrier hindouiste balinais.
Aujourd’hui encore, chaque Balinais a pour obligation de consommer au moins une
fois dans son existence des libellules. Au premier anniversaire de l’enfant (de
3 mois à 210 jours, c’est-à dire une année balinaise), lors du repas qui suit la
cérémonie de purification où les premiers cheveux sont coupés, des libellules,
mais aussi des sauterelles frites, sont ainsi offertes. Certains Balinais se
souviennent également avoir suivi un régime forcé de libellules dans leurs
premières années pour soigner leur incontinence nocturne. Plusieurs modes de
cuisson et recettes culinaires simples permettent de préparer les insectes. Si
les libellules peuvent être rôties à même la flamme, les moins pressés
préféreront une cuisson avec épices. Les insectes peuvent alors soit être
emballés et rôtis dans une feuille de bananier, soit être bouillis accompagnés
d’épices. Mais les libellules seront le plus souvent frites dans un large wok :
les insectes entiers sont mélangés à de l’ail, à une variété de gingembre (Kaemferia
galanga),
à des feuilles de curcuma (Curcuma
domestica),
à des piments (Capsicum
sp.), du sucre, du sel, et parfois aussi à de la noix de coco râpée. Les larves
de libellules frites avec des épices constituent un mets fortement apprécié des
connaisseurs. Comme dans d’autres pays, la dégradation de leur écosystème
constitue une menace pour les insectes aquatiques. De l’avis même des Balinais,
l’abondance des libellules a été considérablement réduite par l’usage des
insecticides dans les rizières et les vergers. Le désintérêt actuel des Balinais
pour les plats de libellules s’explique par une amélioration générale du niveau
de vie sur l’île (grâce au tourisme notamment) et à la diversification des
menus. À entendre les Balinais, le manque d’enthousiasme des enfants, plus
prompts à jouer, à la sortie de l’école, aux jeux vidéo chez un voisin qu’à
courir les rizières à la recherche de libellules, serait aussi en cause…
■
Autres insectes consommés et utilisés à Bali :
Les
Balinais consomment également des Hyménoptères : principalement des larves et
des nymphes d’abeilles sans aiguillon et de deux variétés de guêpes. Deux
espèces d’abeilles sont concernées :
nyawan limpe
(Melipona
favosa,
Apidé, Méliponiné) et
nyawan kerang
(non
identifiée). Les nids sont collectés à l’état sauvage dans les jardins et les
forêts mais peuvent aussi provenir d’élevages, le collecteur abandonnant un
petit morceau du couvain pour permettre à celui-ci de se reconstituer (une
nouvelle récolte
pouvant avoir lieu après une quinzaine de jours). Une plante odorante (krasi)
est utilisée pour garder les abeilles à distance. Les nids et leurs larves se
vendent le matin au marché pour l’équivalent d’environ 3
€
le
kilogramme. Après avoir prélevé le miel, les rayons sont bouillis. Les larves et
les nymphes sont tamisées, puis recuites avec une mixture d’épices. Le résidu de
cire fondue flottant à la surface, à qui les Balinais accordent des vertus
thérapeutiques, est donné sous forme de boulettes à tout volatile précieux et à
la patte cassée (coq de combat et volailles domestiques). Les Balinais
consommaient aussi différents criquets (balang,
famille des Acridiidés) récoltés dans les rizières. Cuisinés de la même façon
que les libellules, ils étaient préférés grillés. Deux petits Orthoptères
comestibles sont aussi utilisés dans la préparation d’une huile de massage.
Auparavant les Balinais consommaient les larves de fourmis tisserandes (Oecophylla
smaragdina,
semangga
en
Balinais), ainsi que de grosses larves d'un Coléoptère, nommées
jubel
(non
identifié), que les paysans prélevaient dans les petits talus bordant leurs
rizières.
L’auteur
:
Nicolas Césard est ethnologue. Ses travaux sur les insectes portent
principalement sur l'Indonésie et l'Amazonie.
Contact :
ncesard[at]wanadoo.fr
Au Japon, la crise fait chuter le cours du
scarabée :
Yumiko Tanuma saisit entre ses
doigts un scarabée long de huit centimètres. "Il est
mignon", prononce-t-elle, lui souriant tendrement pendant qu'il
remue umiko Tanuma saisit entre ses doigts un scarabée long de huit
centimètres. "Il est mignon", prononce-t-elle, lui souriant
tendrement pendant qu'il remue les mandibules. Il peut être mignon,
vu son prix. Ce scarabée est vendu l'équivalent de 300 dollars [un
peu plus de 1 800 FF] au grand magasin Tobu, où travaille Mlle
Tanuma.
 Triste
nouvelle pour les nombreux propriétaires japonais de scarabées : il
y a encore cinq ou dix ans, ils n'auraient pas trouvé un tel insecte
à moins de 6 000 dollars. Cette dégringolade du prix des scarabées
est une véritable catastrophe. Il est vrai qu'une telle dépréciation
touche pratiquement tous les investissements des Japonais, qu'il
s'agisse de la porcelaine ancienne, des chevaux de course ou des ohkuwagata, variété
très rare de scarabées cerfs-volants vivant cachés dans le bois
pourri, qui sont chassés et domestiqués depuis des générations au
Japon. Triste
nouvelle pour les nombreux propriétaires japonais de scarabées : il
y a encore cinq ou dix ans, ils n'auraient pas trouvé un tel insecte
à moins de 6 000 dollars. Cette dégringolade du prix des scarabées
est une véritable catastrophe. Il est vrai qu'une telle dépréciation
touche pratiquement tous les investissements des Japonais, qu'il
s'agisse de la porcelaine ancienne, des chevaux de course ou des ohkuwagata, variété
très rare de scarabées cerfs-volants vivant cachés dans le bois
pourri, qui sont chassés et domestiqués depuis des générations au
Japon.
Les habitants de l'archipel ont la passion des insectes depuis plus
de mille ans. Dans la "bulle économique" des années 80, ces animaux
étaient devenus une marchandise précieuse. Les grands magasins
avaient commencé à en vendre à des prix qui, jusqu'au début des
années 90, atteignaient 7 000 dollars pièce.
L'effondrement des marchés boursier et immobilier a appauvri la
population, entraînant une baisse des prix. Mais les forces du
marché ont également contribué à accroître l'offre et à faire
éclater la "bulle entomologique" au Japon. Sans compter que des
entomologistes sont parvenus à élever des ohkuwagata.
Avec l'explosion de l'offre, les prix ont entamé une baisse
catastrophique. De nombreux grands magasins ont cessé de vendre des
insectes, les scarabées ayant perdu une bonne part de leur attrait.
Par les temps qui courent, presque tous les ohkuwagata proviennent
d'élevages, et la plupart des spécimens sont affichés à moins de 100
dollars pièce.
"Cet accroissement de l'offre va se poursuivre à cause de
l'élevage", explique Kikuo Iwaguchi, entomologiste de l'Université
d'agriculture et de technologie de Tokyo. "Les prix vont baisser,
baisser, baisser." D'ici dix ans, à l'en croire, les petits ohkuwagata pourraient
être offerts à moins de 5 dollars.
Autre facteur de baisse des prix, le marché parallèle des scarabées
importés. On trouve des ohkuwagataailleurs en Asie, et, à l'époque
où les spécimens japonais se vendaient à des prix exorbitants, des
voyageurs ont commencé à en introduire en contrebande au Japon. Les ohkuwagata étrangers
ont par ailleurs l'avantage de rester actifs toute l'année, alors
que les variétés japonaises hibernent plusieurs mois.
Tobu propose encore un couple d'ohkuwagata au prix de 12 500
dollars. S'ils sont si chers, c'est qu'ils ont les yeux blancs, une
rareté. Mais, jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas trouvé
preneur.
Les ohkuwagata vivent quatre ou cinq ans, si bien que les
propriétaires disposent d'un certain temps pour profiter de leurs
petits compagnons. De plus, comme ils ne volent pas beaucoup,
l'investissement ne risque guère de disparaître par la fenêtre. Bien
entendu, il faut regarder où l'on met les pieds...
Beetlemania :
Chez nos amis nippons et taïwanais, c'est la «folay» : le
scarabée (beetle en anglais) rhinocéros, oui l'insecte qui doit son nom à
ses pinces rassemblées gracieusement en «cinquième position» au-dessus de sa
«tête». Un peu écartées, les pinces, façon «je vous ai compris», peut-être. Mais
on s'égare.
Au Japon, donc, et à Taiwan, c'est le nouvel animal de compagnie des enfants
depuis qu'il y a 3 ans, certains vendeurs animaliers ont eu l'idée de les mettre
en vitrine. Et ça s'arrache au prix fort, vu que la bestiole, pourtant d'un
relatif retour affectif, peut chiffrer jusqu'à 300 euros. Les collégiens les
trimballent dans des terrariums portables, les laissent marcher sur leurs bras
avec leurs petites pattes collantes. Tu me diras, ça pue moins qu'un chat et sa
caisse, c'est moins dangereux qu'un doberman, ça bouffe moins qu'un berger
allemand. Quoi, c'est moyen l'éclate, aussi ? Peut-être, mais les Japonais ayant
la passion des insectes depuis plusieurs siècles, on va pas se permettre de
contredire.
D'autant que la personne est total inoffensive, se nourrit de miel et de sève et
vit environ cinq ans, le temps de lui apprendre quelques petits tours ou
d'organiser, comme c'est le cas là-bas, des combats. Le jeune Nippon est rare
aujourd'hui qui n'a pas élevé son lucane ou son capricorne, joué à des jeux
vidéo ou échangé avec ses copains des cartes à collectionner. Il y a même un
dessin animé cultissime au Japon : Mushiking, le roi des scarabées.
A Taiwan, un chercheur en entomologie a estimé le marché annuel des coléoptères
et des produits qui y ont trait, depuis les aliments spécifiques jusqu'aux jeux
et jouets, à 3 milliards de dollars taïwanais (66 316 664 euros). Pour de bonnes
et diverses raisons, on n'a pas essayé personnellement les géotrupes : après la
volée de bois vert qu'on s'était prise avec les bernard-l'hermite (bourreau de
crabes, déforesteur de plages, insulteur de l'espèce animale, etc.), on ne se
serait pas risqué à importer les bestioles, et basculer dans l'illégalité.
D'autre part, ça n'est pas bon pour l'environnement. Vertueux du géotrupe, nous
sommes. Nonobstant, si quelqu'un pouvait en trouver un, même petit, le pagourium
lui est ouvert.
 Entomomachie : Entomomachie :
Ambiance combat de boxe, spots, caméra
suspendue aux cintres, supporteurs agglutinés autour de l’estrade, d’autres
devant un écran géant. Nous sommes au XXe Tournoi de combats de
grillons de Pékin (Chine), organisé – pas du tout clandestinement - à l’occasion
de la Semaine dorée d’octobre. Personnage remarquable : Kon Jinbao, éleveur. Sa
production annuelle, 10 000 têtes. Les prix ? Gratuit dans la nature et moins de
0,5 € chez un paysan (la capitale du grillon est désormais Ningyang, province de
Shandong). Mais un champion vaut jusqu’à 2 000 €.
Les concurrents (il n’y a que des messieurs) sont gardés 3 jours, hors de portée
de leur propriétaire, chacun dans une petite jarre, avec une compagne, nourris
tous pareil. Il y a 3 catégories : poids léger, moyen et lourd. Le combat est en
3 reprises ; gagne le grillon qui reste, perd celui qui se sauve. Rares sont les
épanchements d’hémolymphe.
Les paris sont prohibés, mais ça mise gros. C’est un sport propre : il n’y a pas
de dopage - ou alors très rarement…
Gladiateurs miniatures :
A l'échelle d'un insecte, avec ces 7
cm de long, un scarabée dynastinae (rhinoceros) du genre Xylotrupes est un titan
doté d'une force prodigieuse. Une puissante pince, formée par deux cornes
noires, lui confère des qualités de combattants bien connues dans le nord de la
Thaïlande. C'est ainsi que, chaque mois de septembre, des habitants de la
Province de Chiang Mai, friands de jeux et de paris, délaissent les combats de
coqs pour organiser des joutes de coléoptères. Des rencontres officielles se
déroulent alors sous le regard de centaines de passionnés lors d'un festival
retransmis par la télévision nationale ! "Il est remarquable qu'une relation
forte et originale entre l'homme et l'animal ait pu transformer certains
villageois en experts du comportement des insectes", expliquent des
anthropologues français, membres d'Artmap, une équipe de recherche
interdisciplinaire. Capturés dans la nature, les scarabées mêles subissent une
sélection rigoureuse en fonction, notamment, de leur taille et de la forme de
leurs cornes. Tout en étant choyés, ils sont soumis à un véritable entraînement
de gladiateurs ! "Le jour de la rencontre, ces coléoptères sont stimulés par
des phéromones libérées par deux femelles retenues captives à l'intérieur d'un
rondin de bois tenant lieu de ring et percé d'un petit trou. Les adversaires
cherchent alors à se déséquilibrer à la manière de lutteurs. après plusieurs
reprises, le combat se termine au bout de 20 minutes par l'épuisement du vaincu
" !



Elevage
d'insectes en Thaïlande :
 The
appreciation of beetles in Asian culture far exceeds anything most non-beetle
enthusiasts will tolerate in Western culture. For example, beetles are a common
food item on the menu. The first bite of food I had during my trip to Guangdong
Province, China in 2006 was sautéed
Cybister
japonicus.
It was on a visit to Tailand in October 2007, however, that I saw an example
firsthand of how the Oriental culture views scarabs with admiration. The
appreciation of beetles in Asian culture far exceeds anything most non-beetle
enthusiasts will tolerate in Western culture. For example, beetles are a common
food item on the menu. The first bite of food I had during my trip to Guangdong
Province, China in 2006 was sautéed
Cybister
japonicus.
It was on a visit to Tailand in October 2007, however, that I saw an example
firsthand of how the Oriental culture views scarabs with admiration.
Tailand is a country known for some fantastic insect species, but I went there
looking for natural enemies of the cycad aulacaspis scale. After examining the
cycad collection at the Queen Sirikit Botanic Garden near Chiang Mai, we were
headed back to town when our guide and cooperator, Dr. Amporn Winotai of the Tai
Department of Agriculture, alerted the driver to pull off the road a moment. Dr.
Winotai was already fully aware of my interest in Coleoptera, particularly
scarabs. Being in the back of the van and thus not able to see much outside to
the front and side, I was curious to know why we had stopped. Upon exiting the
vehicle, there in front of me was a meager roadside stand of poles, thatched
roof, and a few benches and dangling from horizontal bars were a great number of
sugarcane stalks about 1-2 feet in length. Grasping each stalk was a living male
Xylotrupes gideon!
I was struck with awe and delight because my host had stopped at a small
business selling this marvelous dynastine scarab as pets. Each male had a piece
of yarn tied to its bifurcate pronotal horn and the other end of the yarn tied
to a nail inserted into the bottom of the sugarcane stalk. Some beetles were
feasting on the sweet sugarcane, leaving a small pile of powder directly below
them.
Xylotrupes gideon
is widely distributed in Southeast Asia and is not considered
uncommon. A search on the Internet found a very large number of sites with
images and notes about this insect, indicating it is a very popular beetle. Most
of the
Xylotrupes
at the stand outside Chiang Mai ranged in price from 80 to 120
baht (about $2.50 - $4); the larger the specimen and its horns, the higher the
price. One unique specimen had six
tarsal segments on a leg, and the owner
wanted $20 for him. The Insect Company (www. insectcompany.com) depicts a Tai
specimen with 7 legs. No female
X. gideon
were for sale or even exhibited, maybe because they are “boring”
without horns, but I preferred to think the businessman left them in the wild so
as to protect the perpetuation of the local population and the production of his
livestock. I picked out three handsome gentlemen, paid my money, and hung the
treasures inside our rented van. Upon returning to my hotel room, I hung the
stalks in a suitable place and then went to a local restaurant to feast on fried
bamboo caterpillars and breaded grasshoppers (among other traditional food
items). When I returned to the hotel, I saw beneath each stalk the expected
remnants of sugarcane fed upon by my new friends. I admired my pets for a few
minutes and then went to bed. About 4:00 AM, I was awakened by a buzzing sound.
I turned on the lamp light and lo and behold there was each male flying in a
perfect circle below its stalk, still tethered by the yarn tied to the nail and
its pronotal horn. This was fun to watch for a few minutes, but I had to sleep.
So I placed each beetle back on its stalk and went back to bed.
We spent another day in Chiang Mai, so I left the pet beetles in the room to
feed on the succulent sugarcane. Returning to the hotel room, it was obvious the
maid had arranged the bed and swept the floor; there was relatively little
sugarcane dust below each stalk. I wonder what thoughts went through her head
when she entered the room and saw my prizes.
Curiosity? Disgust? Ambivalence? Unfortunately, the time spent with my dynastine
pals was ephemeral.
Our return flight to Bangkok was very early the next morning, so with deep
remorse I untethered each fellow and dunked him in a bath of ethyl alcohol. The
three males now reside in a unit tray at home, with a short piece of yarn tied
to their horn.
Ça, c’est de larve culinaire !
Une employée
Thaïlandaise prépare des larves pour les cuire, dans la cuisine d’"Insects Inter"
à Bangkok.
Les insectes seront Mardi au menu d’une réunion des Nation Unies
qui se tient en Thaïlande, où des experts examinent leur valeur diététique et
les possibilités d’exploitation de ces créatures dont on se délecte dans
certains pays.
MushiKing :
Se faisant passer pour des entomologistes
d’instituts de recherche, des individus écument les collines arides des monts
Amanus, au sud-est de la Turquie, au grand dam des associations locales de
protection de la nature. Ces Allemands et ces Japonais, en se livrant une
concurrence féroce, ramassent - ou rachètent aux paysans -, pour les expédier
vivants au Japon, les plus beaux spécimens du cerf-volant Lucanus cervus
akbesianus (Col. Lucanidé). L’imago mâle, noir, de 60 à 90 mm de long dont
35 pour les mandibules, très beau et très combatif, est vendu 250 € pièce au
Japon.
La chasse est acharnée et la sous-espèce est en voie de disparition ; pourtant,
elle n’a aucune vertu aphrodisiaque ou thérapeutique supposée. Cette destruction
de masse sert à l’amusement des gamins (de 6 ans) japonais, traditionnellement
très intéressés par les insectes en élevage, mais présentement fous d’un jeu
vidéo .
MushiKing (le roi des insectes), basé sur des duels de lucanes (de kuwagata), se
joue sur console et est accompagné d’un dessin animé. On doit acquérir des
cartes à insérer dans la machine. Celles-ci s’achètent (0,6 €) jusque dans les
supérettes de quartier et/ou se gagnent si l’on est vainqueur d’un combat, qui
se déroule selon le principe pierre-papier-ciseaux.
La passion de posséder un très bel insecte bien vivant ne s’assouvit pas, bien
au contraire, par la maîtrise de son image virtuelle…
Le Barcoding du vivant :
... En 2003, Paul Meyer, de l'Université de Guelph (Ontario),
propose de créer un barcoding universel, valable pour toutes les espèces
vivantes. Il a choisi le gène du cytochrome c oxydase I (COI), porté par l'ADN
mitochondrial, qui contient 648 nucléotides comportant des modifications d'une
espèce à l'autre; par exemple les COI de l'homme et du chimpanzé se distingue
par 60 nucléotides.
La proposition de Meyer fait un tabac; aussitôt se constitue le Consortium
for the Barcode of Life (CBOL) qui rassemble aujourd'hui 160 centres de
recherches et muséums répartis dans 50 pays. Le Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris en fait bien évidemment partie. Directeur du Département
Systématique et Evolution, Michel Veuille revient juste d'un symposium organisé
par le CBOL à Taïwan; son enthousiasme est grand, car il juge que la taxonomie
s'en trouve totalement révolutionnée. "Juste un exemple : lorsque nous allons
en forêt tropicale faire un inventaire de la faune, nous récoltons des centaines
d'espèces d'insectes que seuls de très rares spécialistes sont capables
d'identifier; il nous faut les leur envoyer et cela prend des mois. avec le barcoding, il n'y en aura plus que pour quelques jours". A condition que le
CIO du scarabée puisse être confronté à une liste de référence. Or
l'établissement d'une telle liste est un travail cyclopéen; à ce jour, la
Zoologie a décrit 1,8 million d'espèces, et il en reste peut-être dix fois plus
à découvrir (si ...). Pour s'attaquer à cette montagne, les scientifiques se
sont répartis en groupes spécialisés : il y a celui des poissons, celui des
moustiques, des chauves-souris, des papillons ...; environ 31300 espèces ont
déjà été barcodées, l'objectif étant d'arriver à 500 000 d'ici à 5 ans ...
... Michelle Veuille ... rappelle aussi que la méthode a servi à identifier de
nouvelles espèces; l'exemple le plus célèbre est la découverte d'une espèce
inconnue de baleine à bec : l'analyse de l'ADN mitochondrial de 5 cétacés
échoués sur la côte californienne a permis de découvrir qu'il était suffisamment
différent de celui des espèces recensées pour en justifier la création d'une
nouvelle !
(Extrait d'un très bon article dans "Le
Point" du 15/XI/2007)
Le fichier du vivant :
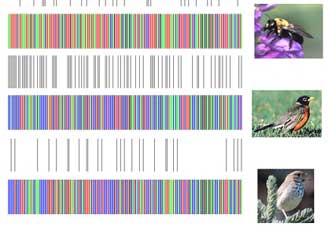 Imaginez un inspecteur du contrôle sanitaire d'un aéroport
découvrant un insecte dans les bagages d'un passager : s'agit-il d'une espèce
étrangère susceptible de nuire aux récoltes locales ? Le problème est qu'il
pourrait bien n'y avoir qu'une poignée d'experts capables de l'identifier. Le
biologiste évolutionniste Paul Hebert a proposé un système utilisant l'ADN pour
identifier les animaux. Il veut mettre au point un catalogue électronique
répertoriant ce qu'il appelle les code-barres de toutes les espèces animales.
Chaque code serait représenté par une série de 645 A, C, G et T, à savoir les
abréviations des bases qui composent l'ADN (adénine, guanine, cytosine,
thymine). Cette séquence de 645 lettres se trouvent dans un gêne commun à tous
les animaux et, pourtant, varie d'une espèce à l'autre. A l'avenir, une nouvelle
espèce pourrait d'abord être connue par son code-barres; le nom scientifique en
latin venant plus tard. Imaginez un inspecteur du contrôle sanitaire d'un aéroport
découvrant un insecte dans les bagages d'un passager : s'agit-il d'une espèce
étrangère susceptible de nuire aux récoltes locales ? Le problème est qu'il
pourrait bien n'y avoir qu'une poignée d'experts capables de l'identifier. Le
biologiste évolutionniste Paul Hebert a proposé un système utilisant l'ADN pour
identifier les animaux. Il veut mettre au point un catalogue électronique
répertoriant ce qu'il appelle les code-barres de toutes les espèces animales.
Chaque code serait représenté par une série de 645 A, C, G et T, à savoir les
abréviations des bases qui composent l'ADN (adénine, guanine, cytosine,
thymine). Cette séquence de 645 lettres se trouvent dans un gêne commun à tous
les animaux et, pourtant, varie d'une espèce à l'autre. A l'avenir, une nouvelle
espèce pourrait d'abord être connue par son code-barres; le nom scientifique en
latin venant plus tard.
Au cours d'un récent essai en aveugle du système, Hebert s'est vu confier les
pattes de 200 espèces de papillons de nuit; après avoir réduit en poudre chaque
patte pour obtenir un échantillon d'ADN et analyser son code-barres, Hebert et
ses collègues ont pu identifier chaque espèce, ce que même un spécialiste de ces
papillons aurait bien du mal à faire, y compris s'il disposait de l'animal
entier (nombre d'insectes sont identifiables par leurs organes sexuels, après
dissection de l'abdomen. Ce système de code-barres pourrait aussi aider les
biologistes à identifier une espèce au cycle de vie complexe, quand il ne
dispose que d'un oeuf ou d'une larve; de nombreux invertébrés (plus de 95% de
toutes les espèces animales) ne sont reconnaissables que sous leur forme adulte;
le code-barres résout le problème, car le schéma de l'ADN est constant, de la
conception à la mort.
("National Geographic" de juillet 2004)
L'inventaire du vivant obsède
les chercheurs :
Pressés par le temps, les scientifiques veulent accélérer le
recensement de la biodiversité. Une chance de survie pour les taxonomistes.
Après des décennies de
purgatoire, c'est le retour en grâce des cabinets de curiosités. Un peu partout
sur la planète des missions scientifiques s'organisent pour collecter le vivant,
identifier, classer, compter et comparer les espèces.
« L'engouement du
public pour la biodiversité a révélé la masse d'ignorance des scientifiques sur
le sujet. Avec le contingent encore inexploré du tissu vivant dans le monde du
petit et de l'infiniment petit, le champ exploratoire est considérable »,
observe un taxonomiste de l'université d'Aix-Marseille, l'une des rares en
France à former de jeunes docteurs à cette discipline désuète.
C'est aux Etats-Unis que les
chercheurs ont d'abord osé sortir le plumeau à poussières. Sous l'impulsion du
biologiste Dan Janzen, un vaste programme baptisé « All Taxa
Biodiversity Inventory » a été lancé en 1998 dans le Great
Smoky Mountains National Park au
sud des Appalaches. Chaque année, il parvient à lever entre 250.000 et 400.000
dollars pour enrichir sa collection de lichens, d'insectes et autres
gastéropodes. En dix ans, son équipe a ainsi découvert près de 6.000 espèces
nouvelles dans le périmètre du parc, dont 874 étaient jusqu'alors inconnues de
la science.
A l'heure où la planète
s'inquiète pour la perte de sa biodiversité, ces résultats ont convaincu
d'autres équipes de renouer avec cette curiosité qui régnait dans les sociétés
savantes du XIXe siècle, après que le premier inventaire des espèces a ouvert en
1760 l'âge d'or de la taxonomie. Oubliée avec les débuts de l'ère industrielle,
puis presque rejetée au ban de la science après les glorieuses découvertes de la
biologie moléculaire, la discipline ne trouvait plus guère d'écho qu'auprès
d'associations de passionnés. «
Au point que les
amateurs découvrent aujourd'hui plus d'espèces que les scientifiques
», regrette Pierre Commenville, directeur adjoint du Parc national du
Mercantour, un des 10 « hot spot » de la biodiversité du pourtour méditerranéen.
Pour se joindre à l'effort
international et pallier à ce qu'ils qualifient de « handicap taxonomiste », 24
instituts de recherche, muséums d'histoire naturelle et jardins botaniques
répartis dans 13 pays d'Europe ont eu l'idée de créer un réseau d'échanges
baptisé Edit (European Distributed Institute of
Taxonomy). Le but de ce
consortium, coordonné depuis la France par le Muséum national d'histoire
naturelle, est de faire entrer la description des espèces dans l'ère
industrielle. « La taxonomie est à la base de la connaissance du vivant, mais
elle souffre aujourd'hui d'un sérieux manque de considération et de moyens »,
explique Gaël Lancelot, l'un des animateurs du réseau : manque d'accès à
l'information, manque de personnel compétent, manque d'infrastructures... Edit
doit permettre d'organiser des structures de concertation, de décision et de
gestion communes, pour créer de nouveaux outils facilitant le travail des
taxonomistes, améliorer l'accès à l'information, ou élaborer des standards
d'inventaire des espèces. Le réseau regroupe notamment le tiers des collections
mondiales et 20 % des taxonomistes professionnels de la planète.
Budget important
Avec cette force de frappe,
l'organisation a investi un territoire de 2.500 km2 regroupant le Parc national
du Mercantour et son voisin italien, le Parco naturale Alpi Marittime, pour y
conduire le plus vaste inventaire des espèces jamais réalisé en Europe. Près de
160 chercheurs et une quarantaine d'associations sont mobilisés par l'opération
qui a démarré cette année. Leurs moyens sont considérables : le budget d'Edit se
monte à 11,9 millions d'euros sur cinq ans au titre du 6e plan-cadre de
recherche et développement européen, auxquels s'ajoutent une subvention de
300.000 euros du ministère français de l'Ecologie pour l'inventaire, une autre
de 45.000 euros par an de la Fondation Albert-de-Monaco, et un financement sur
deux ans (2010-2011) de 1,7 million d'euros provenant du programme Interreg.
Ces financements ne seront pas
de trop car c'est un travail de fourmi qui attend les chercheurs. « Des
inventaires de la faune et de la flore ont déjà été réalisés dans nos parcs,
mais ils sont fragmentaires et très incomplets. La zone transfrontalière où nous
nous situons est ce qu'on appelle un «triple point» qui subit des influences
méditerranéennes, montagnardes et continentales. A cause de cette position
géographique, la région abrite un nombre considérable d'espèces. Or nous n'en
connaissons qu'une infime partie », explique l'écologue Marie-France
Leccia,
qui coordonne les recherches et la logistique de l'opération prévue pour durée
au moins dix ans.
Protéger les insectes
Environ 1.700
espèces d'insecte (sur 35.000 en France) ont été identifiées dans les deux
parcs. Il y en aurait plus de 8.000 au total.
Même chose pour les champignons (200 espèces déterminées sur au moins un millier
restant à découvrir), les lichens (300 espèces ont été identifiées dans une
seule des 7 vallées du Mercantour), les araignées (plus de 316 espèces déjà
recensées), les mousses, etc. « Des centaines de familles dans tous les
groupes sont couvertes », résume Marie-France
Leccia.
Ce vaste
inventaire ne va pas servir qu'à satisfaire les collectionneurs.
« Nous
jetons les bases d'un suivi de la biodiversité à long terme », explique
Pierre Commenville, le directeur adjoint du Mercantour. Certaines espèces
serviront de marqueurs biologiques pour mesurer l'impact des pressions
extérieures (fréquentation, pollution, réchauffement climatique...). D'autres
devraient permettre de mieux comprendre les interactions naturelles et
d'identifier notamment les espèces dites « clef de voûte » constituant un
chaînon essentiel de la biodiversité. Les taxonomistes viennent par exemple de
découvrir que les larves d'un coléoptère longicorne qu'ils connaissaient déjà
étaient étroitement impliquées dans la dégradation du bois mort des sapinières
de Ligurie. « Si on veut protéger ces forêts, il faut protéger l'insecte »,
résume Pierre Commenville. La réhabilitation de l'infiniment petit est sur les
rails.
LSID :
Examinons les 50 pages de la publication de Norm Johnson et ses collaborateurs,
publiée en ligne dans la dernière livraison de Zootaxa (n° 1776, du 26
mai 2008). Il s’agit d’une révision du genre Heptascelio (Hym.
Platygastridés), qui vit (en Asie et en Afrique) en parasite des œufs d’un
Orthoptère Théricleidé.
Pas moins de 8 espèces nouvelles pour la science ! Cependant, la nouveauté qui
justifie que l’on en parle dans l’entomosphère, c’est l’emploi, pour la première
fois, du code LSID pour des insectes.
Acronyme de Life Science Identifier, cet objet informatique à la syntaxe précise
sert à tout identifier, sans ambiguïté. Tout ? Les taxons, les auteurs, les
collections, les références bibliographiques…
Par exemple, l’auteur principal a comme LSID : urn:lsid:zoobank.org:author:3508C4FF-F027-445F-8417-90AB4AB8FE0D
tandis que sa trouvaille, Heptascelio albipes Masner, van Noort &
Johnson, n. sp., s’identifie sans erreur par urn:lsid:zoobank.org:act:B1E0E252-4038-4D6B-B633-B149677D7A08.
Personne n’imagine s’exprimer en ces termes ni retenir le moindre bout de code,
à part les premiers éléments, mais les ordinateurs et les bases de données
qu’ils hébergent sont très à l’aise avec ces expressions.
Nom d'un cafard, c'est la jungle :
bushi, rumsfeldi, cheneyi... Chaque année, 15 000
espèces sont découvertes et baptisées en toute liberté. Des chercheurs
proposent de créer le premier registre d'état civil des animaux, ZooBank.
 «moisissure gluante» (slime-mold, dans le texte). C'était il y a
un an, en avril, le 26 précisément, et non le 1er comme on pourrait le
penser. La conversation était aussi sérieuse que l'hommage du scientifique
au chef d'Etat était sincère. Républicain et professeur à l'université
Cornell, Wheeler venait d'achever un vaste examen des collections d'insectes
nord-américains, au terme duquel il avait annoncé, dans l'austère Bulletin
du Muséum américain d'histoire naturelle, la découverte de 65 espèces
appartenant au genre Agathidium. A trois d'entre elles, il avait
donné les noms, respectivement, du président américain, de son
vice-président et de son secrétaire à la Défense, «des hommes qui ont le
courage de leurs idées», devait-il expliquer à la presse. Ainsi, Bush,
Cheney et Rumsfeld entraient au panthéon de la zoologie, sur les élytres d'Agathidium
bushi, crapahutant au sud de l'Ohio, et Agathidium cheneyi et Agathidium rumsfeldi, tous deux résidant au Mexique... «moisissure gluante» (slime-mold, dans le texte). C'était il y a
un an, en avril, le 26 précisément, et non le 1er comme on pourrait le
penser. La conversation était aussi sérieuse que l'hommage du scientifique
au chef d'Etat était sincère. Républicain et professeur à l'université
Cornell, Wheeler venait d'achever un vaste examen des collections d'insectes
nord-américains, au terme duquel il avait annoncé, dans l'austère Bulletin
du Muséum américain d'histoire naturelle, la découverte de 65 espèces
appartenant au genre Agathidium. A trois d'entre elles, il avait
donné les noms, respectivement, du président américain, de son
vice-président et de son secrétaire à la Défense, «des hommes qui ont le
courage de leurs idées», devait-il expliquer à la presse. Ainsi, Bush,
Cheney et Rumsfeld entraient au panthéon de la zoologie, sur les élytres d'Agathidium
bushi, crapahutant au sud de l'Ohio, et Agathidium cheneyi et Agathidium rumsfeldi, tous deux résidant au Mexique...
Une gloire, en effet, puisqu'il est dans la tradition naturaliste de nommer
une nouvelle espèce, qu'elle soit rose ou puceron, d'après son souverain ou
mécène. «Peu importe l'esthétique du spécimen, précise Philippe Bouchet,
professeur au département Systématique et Evolution au Muséum national
d'histoire naturelle à Paris. Pour un naturaliste, toutes les espèces sont
précieuses, et leur découverte, une victoire.» Ainsi Victoria est-elle,
outre une reine, un pigeon ; Roosevelt, un élan, et Rothschild, une girafe.
Que l'Amérique républicaine, si peu soucieuse du réchauffement climatique,
soit célébrée à jamais par d'honnêtes coléoptères, voilà qui a agacé bien
des dents d'écologistes politiques et scientifiques. L'affaire a cependant
eu le mérite d'attirer l'attention sur la foire aux noms d'espèces dans
laquelle se démène la taxonomie zoologique, au risque d'y perdre son latin,
et éventuellement son âme.
«Sur les 14 000 espèces animales qu'on estime nommées chaque année, la
moitié sont des insectes», souligne Simon Coppard, de l'ICZN. Or, rien qu'en
entomologie, on dénombre 1 100 journaux susceptibles de publier la
description d'une nouvelle espèce. Sans compter la «déferlante de
e-publications», relève Philippe Bouchet, et les comptes rendus de congrès
qui font l'objet de livres. Difficile de suivre l'actualité des découvertes
dans ces conditions, d'autant plus que «50 % d'entre elles, pour les
insectes, sont le fait de naturalistes amateurs». Résultat, personne ne peut
répondre à cette question simple : combien d'espèces vivantes ou ayant vécu
(dinosaures compris) connaît-on ?
L'ICZN a donc proposé une solution, simple, publiée dans la revue Nature :
créer, d'ici deux ans, ZooBank, une base de données où les zoologistes
enregistreront gratuitement les noms de leurs découvertes et la décriront
selon un formulaire normalisé. En accès libre, en ligne, et en réseau avec
les bases documentaires zoologiques existantes, ZooBank contribuera «à faire
de la taxonomie animale une science vraiment moderne», selon Andrew Polaszek,
qui estime que «l'avenir» d'une telle base est au travail pionnier de «géolocalisation
d'espèces» réalisé par l'entomologiste américain Brian Fisher en association
avec Google Earth : sur le site du chercheur, on suit la répartition
mondiale de diverses espèces de fourmis, et notamment celle de sa dernière
découverte. Il l'a baptisée, très naturellement, Proceratium google.
Tous les Diptères de la Terre :
En 1950, Eugène Séguy évaluait à 100 000 le nombre d’espèces de cet ordre. On
compte actuellement 156 599 Diptères actuels et fossiles, répartis en 154
familles et 11 671 genres. L’effectif s’accroît d’environ 800 nouvelles espèces
décrites chaque année.
Ils sont tous répertoriés dans une
base de données (Biosystematic Database of World Diptera - BDWD) accessible
gratuitement. C’est à Chris Thompson (ARS Systematic Entomology Laboratory,
Washington, États-Unis) et à ses collaborateurs qu’on doit cette compilation,
bien organisée, facile à consulter, et qui livre pour beaucoup de taxons des
informations sur la biologie, la répartition et les éventuelles nuisances.
Les plantes possèdent aussi
une sorte de code-barres :
Les plantes possèdent un gène qui permettrait de les
identifier à la manière d'un code-barres. C'est ce que vient de découvrir
Vincent Sovolainen, de l'Imperial College de Londres. Le gène matK possède des
séquences ADN qui changent d'une espèce à l'autre et aiderait ainsi à
différencier plus facilement les plantes, y compris des espèces proches qui, à
première vue, paraissent semblables. A partir de 1600
spécimens d'orchidées collectés au Costa Rica, le chercheur a réussi à
distinguer plus de 1000 espèces différentes; découvrant que l'une des espèces
connues auparavant se divisait en fait en deux espèces spécifiques.
Les chercheurs espèrent développer un appareil portable qui, comme un lecteur de
code-barres, identifiera instantanément une espèce de plante dans son milieu
naturel.
(Science et vie d'avril 2008)
M. SOULA : un exemple de plus, qui
montre qu'il y a, en fait, bien plus d'espèces distinctes que ne le croient
beaucoup de systématiciens, en particulier américains.
Enfin !!!
Tout le monde l'affirme, personne ne l'a prouvé : le cerveau
des femmes fonctionnent différemment de celui des hommes. Des neurologues
espagnols ont mis en évidence une différence anatomique entre les 2 sexes au
niveau du néocortex temporal, impliqué dans les comportements sociaux et les
processus émotionnels. Les femmes ont, dans
cette zone, une densité moins élevée (évidemment !!) de synapses, ces
points de contact entre les neurones qui assurent la transmission des messages.
Les chercheurs se déclarent incapables d'expliquer cette différence ...
La terrible coccinelle asiatique :
  "Certains jours, je reçois plus d'une vingtaine d'appels
au secours; de gens inquiets de voir s'agglutiner des milliers de coccinelles
sur la façade de leur maison" explique le naturaliste Vincent Ternois,
patron de l'Observatoire permanent pour le suivi de la coccinelle asiatique en
France. "Certains jours, je reçois plus d'une vingtaine d'appels
au secours; de gens inquiets de voir s'agglutiner des milliers de coccinelles
sur la façade de leur maison" explique le naturaliste Vincent Ternois,
patron de l'Observatoire permanent pour le suivi de la coccinelle asiatique en
France.
Au départ Harmonia axyridis devait être l'alliée du jardinier écolo. Une
coccinelle qui dévore jusqu'à 270 pucerons par jour et seulement sur votre
parcelle, puisqu'elle vole comme un fer à repasser ! Mais le rêve a tourné au
cauchemar. Commercialisée au milieu des années 90 après avoir été importée et testée
par l'INRA, la donzelle s'est mise à boulotter ses cousines indigènes, à se
reproduire de façon anarchique et même à voler ! "Elle est désormais présente
dans toute la moitié nord de la France, avec déjà des incursions en Rhône-Alpes.
D'ici 3 ans, elle aura colonisé tout le territoire" prévient Vincent Ternois.
La solution ? "Actuellement, elles cherchent un abri
pour l'hiver; il faut colmater fenêtres, aérations et dessous de portes. Dans
certains cas, la pose de moustiquaires peut s'avérer nécessaire. De toutes
façons, il n'est plus possible d'enrayer l'extension de l'espèce. Il faut
apprendre à vivre avec".
(Toujours extrait du "Le Point" du
15/XI/2007)
Une incroyable préscience de
Darwin :
Les orchidées, dont la pollinisation est assurée par des
insectes au terme d'une extraordinaire adaptation, intriguaient Darwin. Il avait
constaté que le pédoncule étrangement modifié de la fleur avait son équivalent
chez des plantes plus simples, dénotant un processus d'évolutions parallèles. En
observant l'orchidée de Madagascar Angraecum sesquipedale, avec son
éperon nectarifère de 28 cm de long, il supposa qu'un papillon doté d'une trompe
de la même longueur, adaptée pour recueillir le nectar, devait vivre à
Madagascar, où il n'était pas allé. Quarante ans plus tard, 2 entomologistes
découvrirent le sphinx de Madagascar Xanthopan morgani predicta,
confirmant l'hypothèse de Darwin. Cette adaptation mutuelle - le papillon et la
fleur, la fleur et le papillon - est appelée coévolution.
(Extrait du "National Geographic" de novembre 2004)
Un papillon
hybride qui tourne le dos à ses parents :
 Spécimen d'Heliconius
heurippa conçu par hybridation en laboratoire. (Christian Salcedo,
University of Florida, Gainesville) Spécimen d'Heliconius
heurippa conçu par hybridation en laboratoire. (Christian Salcedo,
University of Florida, Gainesville)
En seulement trois générations, des biologistes ont créé en
laboratoire une nouvelle espèce de papillon en mariant deux espèces existantes.
Le Dr Frankenstein n’a rien à voir là-dedans : le papillon obtenu volette déjà
dans la nature. L’objectif des chercheurs était de démontrer que l’hybridation
peut permettre la création de nouvelles espèces. Ils publient leurs travaux dans
la revue Nature.
Mauricio Linares (Universidad de los Andes, Colombie) soupçonnait depuis
longtemps le papillon Heliconius heurippa d’être le fruit d’une
hybridation entre Heliconius cydno et Heliconius melpomene. Ce
processus est rare, surtout chez les animaux.
Souvent, lorsque deux espèces s’hybrident, leurs rejetons ne sont pas viables ou
sont stériles comme dans le cas de la mule. Parfois certains individus ainsi
conçus, qui cumulent les stocks de chromosomes des deux parents, survivent et
forment une nouvelle lignée. Plus rarement, l’hybridation donne naissance à un
individu qui a le même nombre de chromosomes que ses parents (au lieu de les
additionner). Cependant ces spécimens finissent souvent par se reproduire avec
les deux espèces parentes et ne créent pas une nouvelle espèce.
C’est ce phénomène rare de spéciation par hybridation dite homoploïde que
l’équipe de Linares et Jesus Mavarez (Smithsonian Tropical Research Institute)
affirme avoir observé. C’est ainsi que l’Heliconius heurippa serait né.
Dans le cas de ce papillon coloré, les dessins des ailes auraient joué un rôle
déterminant dans la spéciation. En effet Mavarez et Linares ont constaté en
laboratoire que les hybrides préféreraient se reproduire avec des individus
porteurs des mêmes couleurs et qu’ils fondaient rarement une famille avec les
deux espèces dont ils sont issus.
Forts de cet exemple, les chercheurs suggèrent que l’hybridation contribue
peut-être davantage qu’on ne pense à la spéciation. Ils soupçonnent déjà deux
autres espèces d’Heliconius d’être des hybrides H. cydno et H.
melpomene.
Les imbéciles vivent-ils plus
longtemps ?
Plus une mouche fait travailler son cerveau,
moins elle vit longtemps !
Chez les mouches, l'intelligence n'est pas un facteur de longévité ! Des
chercheurs suisses ont appris à des drosophiles à associer une odeur de
nourriture à un goût. au bout de 30 ou 40 générations, cette capacité d'apprentissage
était devenue innée; mais, en contrepartie, la durée de vie de ces mouches était
écourtée : environ 46 jours contre 54 pour une mouche normale. Pourquoi ?
En consommant plus de ressources, le cerveau
prend de l'énergie vitale ...
Horreurs :
Les rapports secrets de la CIA sur les techniques
d’interrogatoire applicables aux prisonniers spéciaux détenus à Guantanamo, tout
récemment rendus publics, évoquent le « confinement with insects » (mémo
de mai 2005).
 Le Palestinien Abou Zubaida, hôte de ces lieux, a peur des insectes. On
recommanda donc de l’enfermer en compagnie d’un insecte soit disant venimeux. En
fait, on utilisa une chenille (son identité reste inconnue). Pour les avocats
assurant l’encadrement juridique des méthodes d’interrogatoire poussées, en
prenant la précaution de signifier à la victime que l’insecte ne pouvait en
aucun cas lui infliger une blessure grave ni le tuer, c'était impeccable. Le Palestinien Abou Zubaida, hôte de ces lieux, a peur des insectes. On
recommanda donc de l’enfermer en compagnie d’un insecte soit disant venimeux. En
fait, on utilisa une chenille (son identité reste inconnue). Pour les avocats
assurant l’encadrement juridique des méthodes d’interrogatoire poussées, en
prenant la précaution de signifier à la victime que l’insecte ne pouvait en
aucun cas lui infliger une blessure grave ni le tuer, c'était impeccable.
Les insectes ne furent pas utilisés que pour terroriser les entomophobiques.
Quelques supplices particulièrement cruels les ont mis en oeuvre, dont certains
ont été en usage jusqu’au tout début du XXe siècle.
Plutarque a décrit le scaphisme, en usage en Perse (IVe
siècle avant JC) selon lui. La victime, enfermée dans une coque, la tête seule
dépassant, gavée de miel et de lait, est petit à petit (2 semaines) dévorée par
les asticots.
Si la victime est attachée, enduite de miel et de bouillon de poisson, à un
poteau ou liée à un pilori, on parle alors de cyphonisme, où interviennent
surtout guêpes et abeilles. En Sibérie, la victime, attachée nue à un pieu,
succombe exsangue aux piqûres des taons et autres Diptères vulnérants. Quant à
l’émir de Boukhara (actuel Ouzbékistan), il utilisait des réduves (punaises
prédatrices à digestion extra-orale) élevés exprès pour faire souffrir
longuement ses prisonniers confinés au fond d'un puits. Enfin, les westerns ont
popularisé la technique des Apaches, plaçant les condamnés sur une fourmilière.
Notre collègue
et ami Conrad Gillett au Belize (Las Cuevas) :
But
it was not only dynastids that proved to be diverse at the lights. The rutelids
were alsoery impressive and consisted among others of
Macropoides crassipes,
Macropoidelimus mnizechi,
the newly described
Epichalcoplethis monzoni Soula
(a
few of our specimens were subsequently designated paratypes),
Pelidnota belti, Pelidnota centroamericana,
Pelidnota prasina
(or similar species) (Figure 17). On one occasion we were able to take a
portable battery powered light quite deep into the forest and this yielded
Chrysina
(Plusiotis)
diversa,
which I believe is also a new country record.
Combien de temps vit un
insecte ?
Cela va de quelques jours à plusieurs années; mais, en
général, pas très longtemps. Dans la plupart des cas, la larve vit plus
longtemps que l'imago; ce dernier ne fait qu'assurer l'accouplement et la ponte.
Ensuite, ils meurent rapidement, sauf ceux qui s'occupent des larves sorties de
l'ceuf. En climat tempéré, l'hiver prolonge la durée de vie de certains insectes
qui entrent en diapause. Un schéma type serait de quelques jours pour l'ceuf,
puis plusieurs semaine en tant que larve et, enfin, quelques jours ou semaines
pour l'adulte; chez ceux à métamorphose complète, on peut ajouter quelques
semaines pour le stade de nymphe.
Les cycles complets les plus courts sont ceux de la mouche domestique (Musca
domestica), une quinzaine de jours, et de certains moustiques, une semaine
seulement !
Pour les cycles complets les plus longs, on peu citer certains longicornes (10 à
40 ans) ou certains buprestes (20 à 50 ans).
Les larves de nos scarabées (y compris donc "mes" RUTELINAE ...) vivent de 2 à 4
ans (quelques semaines pour la nymphe) pour une vie d'adulte de quelques
semaines.
Les imagos de papillons de jours ne vivent guère plus de 45 jours; le cycle
complet est souvent très court puisque beaucoup d'espèces ont plusieurs
générations par an. Certaines espèces, comme le citron, peuvent cependant
hiverner, en diapause évidemment; et vivre 10 mois en tout.
Certains adultes, qui ne se nourrissent pas, peuvent avoir une vie extrêmement
courte : quelques heures, voire quelques minutes pour les éphémères (leurs oeufs
se dispersent dans l'eau sous leurs cadavres qui flottent ...) ! Mais la larve
vit bien plus longtemps !
La reine des abeilles vit de 2 à 5 ans, alors que l'ouvrière ne vit que quelques
semaines. Les reines de termites peuvent vivre jusqu'à 15 ans. Une reine de
fourmi noire des jardins a vécu 30 ans en captivité.
La Maison des Papillons :
 C'est au 45 de la rue Buffon que se trouve la troisième
collection de papillons du monde. L'endroit est magique, composé d'une
succession de salles semi-obscures, où s'alignent des murs entiers de tiroirs en
bois précieux, d'armoires de rangement, de casiers, de vitrines et de rayonnages
contenant des milliers d'écrins. Ce cabinet de curiosités
est le domaine exclusifs des chercheurs. Il ne se visite pas. Il rassemble plus
de 3 millions de spécimens, surtout des imagos étalés et conservés à sec,
mais aussi de nombreuses chenilles et chrysalides ainsi qu'un ensemble de 45 000
préparations microscopiques. L'essentiel des insectes
provient de collections privées comme celle, classée monument historique
et riche en papillons exotiques, de Mme Aimée Fournier de Horrack. C'est au 45 de la rue Buffon que se trouve la troisième
collection de papillons du monde. L'endroit est magique, composé d'une
succession de salles semi-obscures, où s'alignent des murs entiers de tiroirs en
bois précieux, d'armoires de rangement, de casiers, de vitrines et de rayonnages
contenant des milliers d'écrins. Ce cabinet de curiosités
est le domaine exclusifs des chercheurs. Il ne se visite pas. Il rassemble plus
de 3 millions de spécimens, surtout des imagos étalés et conservés à sec,
mais aussi de nombreuses chenilles et chrysalides ainsi qu'un ensemble de 45 000
préparations microscopiques. L'essentiel des insectes
provient de collections privées comme celle, classée monument historique
et riche en papillons exotiques, de Mme Aimée Fournier de Horrack.
C'est le Professeur Jacques Pierre qui règne sur ce petit monde avec trois
spécialistes des lépidoptères rattachés au Muséum, sa femme Claude,
technicienne, et deux fidèles assistantes, Rose et Marguerite, "mes deux fleurs"
comme il aime à les appeler. Homme de terrain - ses expéditions l'ont conduit
aux quatre coins du globe - , mais aussi darwiniste convaincu, philosophe par
extension, poète à ses heures, cet homme, avec ou sans filet, est passionné et
passionnant. Les insectes sont un matériau privilégié pour
étudier l'origine et la biodiversité des espèces car ils représentent 90% du
monde animal. Passionné, Jacques Pierre voltige d'une théorie de l'Evolution
à l'autre, d'observations in natura en découvertes de laboratoire. Il fourmille
d'anecdotes, s'enthousiasme pour ses bestioles et se pose un milliard de
questions. savez-vous comment les monarques du Mexique, ces papillons migrateurs
qui parcourent des milliers de kilomètres entre le Canada et les forêts du
Michoacan, ont réussi à survivre tout en agitant leurs ailes striées d'orange et
de noir à la barbe des oiseaux ? Tout simplement en cessant de devenir
comestibles ! L'étude de ces insectes se révèle passionnante, d'autant que
l'existence de ces graciles invertébrés est fragilisée par la modification de
leur milieu naturel. Le réchauffement climatique, la destruction massive des
forêts, et bien sûr, la pollution, les mettent en danger. Si leur environnement
est saturé de pesticides, les papillons, qui se nourrissent de nectar,
s'empoisonnent et deviennent stériles. Dans les zones de culture où l'on rase
tous les bosquets, haies, friches et bords de route, ils ne trouvent plus ni
plantes nourricières ni lieux où pondre. Pour Jacques
Pierre, la protection de certaines espèces n'est pas la bonne solution, elle
engendre la contrebande et empêche les scientifiques de faire leur travail. Seul
le maintien des habitats a un sens pour la sauvegarde de la faune.
Quant au commerce des papillons, il est essentiel aux
chercheurs qui n'ont ni le temps ni les moyens de se procurer les plus rares.
Autrefois, quelques riches collectionneurs avaient recours à des correspondants
sous les tropiques, souvent des pères missionnaires ou des planteurs qui
formaient des indigènes à la capture des papillons.
Aujourd'hui, des chasseurs indépendants publient des catalogues sur Internet
et fournissent les amateurs privés en spécimens souvent trop coûteux pour les
collections nationales (ajout Soula : mais les collections privées finissent tôt
ou tard dans les collections nationales !). C'est pourquoi
Jacques Pierre soutient le développement des fermes d'élevage afin d'inciter les
populations autochtones à protéger leur environnement et donc à sauvegarder les
papillons. Sur la côte kényane, près de Malindi, la forêt Sokoké, dont
les espèces endémiques sont particulièrement prisées, est aujourd'hui protégée.
Au Mexique, l'élevage des lépidoptères de couleur blanche
prend son envol avec les lâchers de papillons qui remplacent celui des colombes
à l'occasion des mariages et autres célébrations.
Malgré l'abondance du travail qui reste à
fournir, les entomologistes spécialistes du sujet sont, eux aussi, une espèce en
voie de disparition.
(Dans "ELLE" de novembre 2007)
16 000 espèces menacées
d'extinction (apparemment sans compter les
insectes ...) : Un rapport alarmant de deux
sénateurs :
"... On sait que 12% des espèces d'oiseaux,
23% des mammifères, 32% des amphibiens et 42% des tortues sont d'ores et déjà
menacées d'extinction mondiale. Mais ce rapport pointe l'accélération du
processus ces trente dernières années. Les parlementaires réclament d'urgence
l'équivalent pour la biodiversité du groupe d'experts intergouvernementaux pour
l'observation du climat.
Claude Saunier : "Il n'y a pas eu de message scientifique très fort dénonçant
l'effondrement de la biodiversité mondiale, alors que
c'est aussi grave que ce qu'on annonce sur le réchauffement. Aujourd'hui
16 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Le rythme de disparition des espèces a été 10 à 100 fois
plus important que les rythmes naturels d'extinction au cours des 200 dernières
années. En 2050, il pourrait être de 100 à 1000 fois supérieur au rythme actuel.
En 360 ans, la Beauce a perdu plus de 30% des composés organiques de son sol.
Chaque jour en France, 165 ha de milieux naturels sont détruits pour faire des
constructions. 7% des espèces marines ont disparu depuis 1950. 60% des coraux
sont affectés par l'activité humaine et 20% ont disparu en 30 ans.
La disparition des forêts tropicales humides se poursuit à
un rythme de 13 millions d'hectares par an dont 6 millions de forêts primaires
alors que ce milieu héberge la moitié de la flore mondiale. "
Est-ce si grave pour l'homme ? "Evidemment. Prenez l'exemple du
poisson. Le monde puise 90 millions de tonnes de poissons par an alors que la
ressource s'épuise. En Atlantique Nord, 18% des stocks sont déjà épuisés. Au
rythme actuel, le thon rouge disparaîtra bientôt de Méditerranée.
Si on ne fait rien d'ici à 2050, on privera l'humanité de 20% des protéines
animales. C'est irresponsable."
"... L'effondrement des colonies
d'abeilles dans le monde est inquiétant car près de 20 000 espèces apparentées
aux abeilles contribuent à la survie et à l'évolution de plus de 80 % des
espèces de fleurs. Plus de la moitié des molécules de nos médicaments
proviennent de la Nature. Une équipe du Muséum a récemment trouvé, dans la baie
de Concarneau, une éponge qui héberge 10 bactéries très actives contre les
staphylocoques dorés. La biodiversité sert aussi la Technologie et l'industrie.
Pour concevoir des drones miniatures, on tente d'imiter le vol de la libellule.
Un ruban adhésif très collant s'est inspiré de la structure des pattes du gecko
et les pare-brises anti-pluie imitent la structure des feuilles du nénuphar."
(Dans "Aujourd'hui en France" du 12/XII/2007)
Le gène de la migration :
 Une des plus fascinantes énigmes du monde animal est en passe
d'être résolue. Depuis des années Steven M. Reppert, titulaire de la chaire de
neurobiologie à l'Université du Massachussetts, se passionne pour la migration
des monarques. Ces magnifiques papillons américains effectuent chaque année des
milliers de kilomètres entre le Canada et une forêt de pins mexicaine. Une des plus fascinantes énigmes du monde animal est en passe
d'être résolue. Depuis des années Steven M. Reppert, titulaire de la chaire de
neurobiologie à l'Université du Massachussetts, se passionne pour la migration
des monarques. Ces magnifiques papillons américains effectuent chaque année des
milliers de kilomètres entre le Canada et une forêt de pins mexicaine.
Comment ces insectes, dotés d'un minuscule cerveau, sont-ils capables de tracer
leur chemin avec la précision d'une sonde spatiale ? Dans la revue PLoS,
Reppert fournit les clés du fondement génétique de ce mystère. Il a découvert
que l'ADN du monarque contient un gène codant pour la protéine cryptochrome
CRY2a, unique dans le monde animal. Simultanément, elle régule l'horloge interne
du papillon et réinitialise son compas solaire. En un mot, le papillon utilise
le soleil pour maintenir le cap et son horloge interne pour ajuster sa
trajectoire.
L'horloge fonctionne comme un sablier où le sable serait une protéine dont le
cycle de synthèse et de destruction dure 24 heures. Dès les premiers rayons du
soleil, le CRY2, sensible à la lumière, réinitialise l'horloge. D'après Reppert,
cette protéine servirait également à transmettre l'heure au compas solaire. Le
système paraît simple et rivalise de précision avec le système de navigation
d'une sonde spatiale.
(Dans "Le Point" du 10/01/2008)
Les insectes du Jurassique étaient friands de
squelettes de dinosaure :
Pourquoi de nombreux squelettes de dinosaures découverts par
les paléontologistes sont-ils incomplets ? Parce qu'ils ont été mangés par des
petits insectes de l'époque ! Telle est la conclusion à laquelle sont parvenus 2
chercheurs de l'Université de Brigham Young (Utah). En examinant les restes d'un
camptosaurus vieux de 146 millions d'années, ils ont découvert des marques
présentes sur les os. Ils en ont déduit qu'elles avaient été creusées par un
coléoptère de la famille des DERMESTIDAE, famille d'insectes détritiphages qui
existe encore de nos jours (hélas pour les Collections d'insectes !). Ils ont
identifié les coupables en moulant les microscopiques empreintes de dents
d'insectes (plutôt mandibules ...), et en les comparant à celles d'insectes
contemporains connus pour être des mangeurs d'os. Ces coléos. opéraient
probablement quelques mois après la mort des dinosaures, une fois leur carcasse
détériorée par d'autres prédateurs. Les chercheurs ont pu aussi déduire les
conditions climatiques de l'époque, puisque les DERMESTIDAE vivent toujours
aujourd'hui : environ 60 à 80% d'humidité pour une température de 25 à 30°...
(Suite de l'article dans Science et Vie d'août 2008)
Aventure scientifique en forêt amazonienne :
Jamais répertorié par l’Institut
géographique national (IGN), pas davantage perturbé par l’homme, le
lac Toponowini récemment découvert au sud-est de la Guyane par
l’association Alabama, devrait provoquer une importante avancée
scientifique. C’est du moins l’avis d’une équipe de scientifiques du
programme Ecofit qui étudie les paléoclimats des forêts tropicales
et revient d’une mission sur les lieux. Avec en filigrane, l’étude
du passé du climat guyanais et la compréhension du cycle du mercure.
Tout commence en 1996. Appelé pour une évacuation sanitaire au
village amérindien de Trois-Sauts, enclavé au sud-est de la Guyane,
un hélicoptère du Samu de retour vers le centre hospitalier de
Cayenne est dévié de son parcours à cause d’un orage tropical. A
bord, le docteur Gerald Egmann, membre de l’association
d’explorateurs Alabama: «On a vu une sorte de montagne avec, autour
du dôme, une couronne de nuages et en bas de l’eau. C’était comme
dans un film de King-Kong». Trois ans plus tard, le médecin repasse
au même endroit. Il aperçoit de nouveau l’étendue d’eau. Cette fois
là, il n’omet plus de noter les coordonnées qui s’inscrivent sur le
GPS.
Le 18 décembre 2001, cinq membres d’Alabama sautent d’un hélicoptère
dans le lac avec des canoës gonflables pour rentrer vers Cayenne à
la pagaie. Le lac de forme ovale mesure 120 mètres de diamètre sur
sa longueur, un peu moins de 100 mètres de large. Cette
reconnaissance confirme l’intérêt du site. En juillet 2002, Gérald
Egmann et Eric Pellet, président d’Alabama, déposent leur découverte
à la préfecture de Guyane, à l’IGN et à la Société des explorateurs
à Paris. Arrêtée pour octobre, l’expédition, d’un coût de 50 000
euros, est présentée aux pouvoirs publics dans un dossier où figure
un faux itinéraire, afin de préserver l’endroit des curieux.
Le 5 octobre, quinze personnes bardées chacune de trente kilos sur
le dos, quittent Cayenne pour remonter le fleuve Oyapock à la
frontière du Brésil, puis la rivière Camopi avant d’ouvrir un layon
de cinq kilomètre en forêt jusqu’au lac baptisé Toponowini. En
remontant la rivière Camopi, le groupe croise un anaconda de sept
mètres de long. Pour Aïmawalé Opoya, un amérindien de l’ethnie
Wayana participant à l’expédition, c’est un signe «selon les
légendes de son peuple, l’anaconda est le gardien du lac», raconte
Nicolas Brehm, ichtyologiste, délégué en Guyane pour Nancie, le
Centre international de l’eau et membre de l’expédition.
Jean-Philippe Champenois, entomologiste pour Entomed, (un
laboratoire de recherche de médicaments à partir d’insectes) les
rejoint alors par hélicoptère. Il collecte 300 spécimens d’insectes
toujours en cours d’identification. Mi-décembre, il estimait avoir
«peut-être trouvé une nouvelle espèce de coléoptère longicorne».
Enfin, en douze jours de présence, l’expédition ne repère ni trace
d’un passage de l’homme, ni vestiges de la ville de Manoa, une cité
amérindienne de légende recouverte de feuilles d’or que le mythe
situe en Amazonie au bord d’un lac. «Retrouver l’Eldorado, c’était
aussi notre espoir» confie Eric Pellet. Mais, selon les géographes
en pointe sur le sujet, l’Eldorado, s’il existe, se situerait bien
plus au nord dans une région comprise entre le sud du Guyana et
l’Etat brésilien du Roraima.
Une possible découverte du passé de l’Amazonie
En revanche, le Toponowini suscite l’espoir d’une avancée
scientifique: «C’est une découverte exceptionnelle. Les lacs sont
rares en forêt tropicale» souligne Marie-Antoinette Mélière, membre
de l’équipe Ecofit (Ecosystèmes et paléosystèmes des forêts
intertropicales). Cette enseignante, chercheur en géophysique de
l’environnement à l’Université de Grenoble a d’ores et déjà acquis
«la certitude que le lac remonte au moins à plusieurs centaines
d’années, voire même à plus du millénaire si l’on se fie à
l’épaisseur des sédiments lacustres recueillis, un mètre ce qui est
considérable pour un lac d’altitude en Amazonie». Une estimation
corroborée, selon Philippe Gaucher, de la mission pour la création
du Parc du sud de Guyane par «la hauteur des arbres autour du lac».
Les carottes d’un mètre, analysées au carbone 14, livreront leur
verdict dans plusieurs mois. Les scientifiques espèrent alors
pouvoir commencer à remonter le passé climatique de la Guyane sur
des milliers d’années. «Si le lac a 5000 ans, on pourra peut-être
prouver qu’autour, à l’époque, s’y trouvait de la forêt sèche ou de
la savane», escompte Philippe Gaucher.
Concernant la faune, seules trois espèces de poissons ont été
répertoriées, ce qui s’explique par la position originale du lac, en
tête de bassin versant et ajoute d’ailleurs à sa rareté. Deux
caïmans à lunettes et quelques hérons égayent aussi les lieux.
Enfin, concernant la flore, «une fougère du littoral guyanais pousse
sur les rives du lac, ce qui est étonnant» confie Nicolas Brehm.
En 2000, un autre lac avait été «redécouvert» au centre de la Guyane
par Scott Mori du New-York Botanical Garden après avoir été repéré
en 1972 par un botaniste, Jean-Jacques de Granville avant d’être
perdu de vue. Ce lac, le Matechou, situé au nord-ouest de la petite
commune de Saül, serait «moins intéressant» selon Philippe Gaucher
«car les arbres sur la rive tombent au fond du lac et le perturbent
ce qui ne semble pas le cas pour le Toponowini, beaucoup plus
large».
Les explorateurs d’Alabama, pour leur part, ne semblent pas prêts à
s’arrêter en chemin. Il y a plusieurs années, ils s’étaient lancés
sur les traces de l’explorateur Jules Crevaux rejoignant le fleuve
Amazone à pied depuis la Guyane. Aujourd’hui, ils viennent de
repérer leur deuxième lac «toujours au sud-est de la Guyane et a
priori tout aussi inconnu» assure Eric Pellet.
L'argent qui manque, toujours
... :
La faune et la flore françaises sont heureuses
d'apprendre que, pour les protéger mieux, le gouvernement vient de créer la
Fondation Scientifique Française pour la Biodiversité;
celle-ci réunit les 8 Instituts français de recherche, les grandes ONG écolos et
les entreprises; mais ce grand "machin" est peu financé par l'Etat : les caisses
sont vides !!
Beurk ... :
La peur des serpents et des araignées serait innée. Un
héritage génétique de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, qui se méfiaient de
leurs piqûres. Deux psychologues de l'Université de Virginie l'affirment, après
avoir constaté que des enfants de moins de 5 ans auxquels on présente des images
complexes repèrent quasi instantanément ces animaux. (Psychological Science).
A Antibes, alerte aux abeilles
butineuses-chieuses :
Soumis à un bombardement de déjections
d'hyménoptères, les habitants ne peuvent même plus jouir de leurs jardins.
Depuis quelques jours, les habitants d'Antibes sont victimes de
mystérieux bombardements; un déluge de gouttes d'un jaune sale, avec des pointes
de marron et parfois de rouge, qui s'écrasent sur leurs balcons et éclaboussent
le linge dans leurs jardins. Du coup, dans certains quartiers, on ne mange plus
dehors. Comme explications, les scientifiques locaux privilégient la thèse de
ruches clandestines. Selon le Pr. Faucon, responsable de l'Unité de recherche
sur les abeilles de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, il s'agit de "chiures
d'abeilles; quand elles ingurgitent du pollen, explique t-il, elles
assimilent l'intérieur du pollen mais ne digèrent pas l'enveloppe." Les
insectes, particulièrement actifs au printemps, stockent ces déchets dans leurs
"ampoules rectales" et lâchent le tout en vol. Après la sardine qui a bloqué le
port de Marseille et le sanglier nageur du Lavandou, voici l'abeille chieuse
d'Antibes. Ah, la Provence !!
(d'après Marianne)
Tueuse de parasite :
On découvre parfois des espèces au hasard des explorations
scientifiques. Mais, quand ils ont commencé leurs recherches, ces 2
entomologistes australiens savaient ce qu'ils cherchaient : un "lutteur
biologique capable de protéger les eucalyptus. "Chez nous, il existe des
centaines de petite guêpes qui provoquent des galles chez cet arbre, précise
J. La Salle. Heureusement, elles causent rarement de problèmes, car
d'autres guêpes se nourrissent de leurs larves,
limitant leur nombre ! Pourtant, certaines de ces guêpes nuisibles pour l'arbre
se sont répandus en dehors des frontières australiennes, notamment jusqu'au
Bassin méditerranéen". En Israël, en particulier, les pertes économiques
dues à Leptocybe invasa, sont telles que les entomos. se sont mis en
quête d'une solution. Ils ont alors commencer à étudier de près la guêpe "utile"
qu'est Silitrichodes kryceri; ils l'ont identifiée puis décritent, puis
ont vérifié qu'elle pouvait s'adapter en Israël sans perturber l'écosystème.
Après une période de quarantaine et 4 années d'étude, S. kryceri a été
officiellement déclarée apte à protéger les eucalyptus d'Israël; elle s'est
avérée un parasitoïde efficace : un organisme qui, au
contraire de nombreux parasites, tue son hôte. Aujourd'hui, les
hyménoptères représentent près de 10% de toutes les espèces décrites; ils
comprennent des espèces très petites, hyperspécialisées, qui font de ce groupe,
encore mal connu, le plus diversifié chez les insectes; ils dépassent même les
coléos. de ce point de vue.
 Gare aux supermoustiques : Gare aux supermoustiques :
Mylène Weill n'en est toujours pas revenue; dans son
laboratoire de l'institut des Sciences de l'Evolution, à l'Université de
Montpellier, la chercheuse du CNRS a vu sous son microscope un "double mutant";
comprenez, un supermoustique équipé de gênes le rendant résistant aux 2 familles
d'insecticides les plus utilisés dans le monde. "D'habitude, quand un
moustique fabrique une résistance, c'est pour un seul insecticide et, en prime,
il le paie d'un fardeau génétique qui le rend moins véloce pour échapper aux
prédateurs ou encore moins prolifique" explique Mylène, qui vient de
cosigner une étude sur le sujet (1). Or, là, les double mutants gardent la
forme. Résultat : la stratégie qui consistait, quand un moustique devenait
résistant aux pyrétrinoïdes, à lui vaporiser des organophosphorés, et vice et
versa, tombe à l'eau. Pour l'instant, ces supermoustiques n'ont été identifiés
qu'en Afrique mais, d'après les scientifiques, ils devraient augmenter en nombre
et vite se répandre sur la planète. Une menace qui arrive au plus mauvais
moment. "Nous n'avons quasiment plus de médicaments
efficaces contre les maladies véhiculées par les moustiques, prévient
Mylène; il faudrait développer au plus vite de
nouvelles molécules. Mais apparemment ce n'est pas suffisamment rentable pour
l'industrie pharmaceutique ..."
1 : "Costs and benefits of multiple resistance to insecticides for Culex quinquefasciatus mosquitoes"
(Le Point 1860)
Les insectes et l'Art , Simon
Messagier :
 Simon
Messagier est peintre, graveur, céramiste. Né à Paris en
1958, il est le fils cadet de Jean Messagier, peintre, graveur,
sculpteur et de Marcelle Baumann, céramiste.En même temps que
son passage aux Beaux-Arts de Paris et à l'Académie Charpentier,
il fréquente le MNHN, où il hante la section d'entomologie.
Passion profonde, il exerce le métier d'entomologiste de 1976 à
1984 pour se consacrer finalement à l'art, puis unir ces deux
centres d'intérêt. Simon
Messagier est peintre, graveur, céramiste. Né à Paris en
1958, il est le fils cadet de Jean Messagier, peintre, graveur,
sculpteur et de Marcelle Baumann, céramiste.En même temps que
son passage aux Beaux-Arts de Paris et à l'Académie Charpentier,
il fréquente le MNHN, où il hante la section d'entomologie.
Passion profonde, il exerce le métier d'entomologiste de 1976 à
1984 pour se consacrer finalement à l'art, puis unir ces deux
centres d'intérêt.
Il travaille alors à la transcription des points de jonction
entre art et science. D'une part, avec l'apport de la nature et
d'autre part avec sa représentation artistique grâce aux moyens
du dessin, de la peinture et de la céramique. Ses recherches
débouchent au début des années 2000 sur "Révélaberration",
alliance non seulement de l'art et de la science, mais aussi
d'une dimension psychologique et sociale évidente liée aux deux
domaines.
Décelant dans l'aberration de l'Ornithoptera victoriae
epiphanes, exemplaire unique de papillon en vente à Drouot,
toute la richesse de la contradiction du monde actuel, il décide
de le signer et de revendiquer lors d'un "manifeste" regroupant
plusieurs acteurs des domaines concernés cette évidente
aberration, traversée de l'inconscient.
Ses chers papillons :
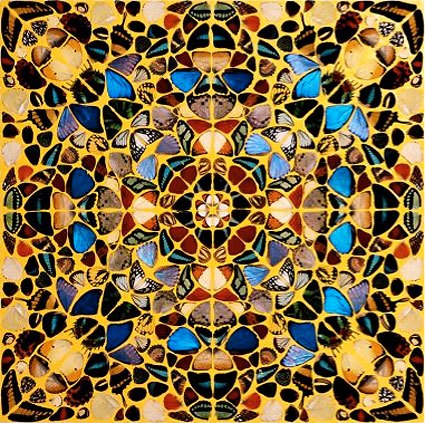 2 840 909 €, c’est le prix d’un tableau rectangulaire de 8,23m de large,
entièrement réalisé avec des ailes de Lépidoptère soigneusement collées, qui
vient d’être vendu directement (aucune galerie n’a touché de pourcentage) aux
enchères chez Sotheby à Londres, 4 fois sa valeur estimée. Intitulée Ascended,
datée de 2008, l’œuvre (à voir
ici) est signée Damien Hirst (d'où sa valeur monétaire). 2 840 909 €, c’est le prix d’un tableau rectangulaire de 8,23m de large,
entièrement réalisé avec des ailes de Lépidoptère soigneusement collées, qui
vient d’être vendu directement (aucune galerie n’a touché de pourcentage) aux
enchères chez Sotheby à Londres, 4 fois sa valeur estimée. Intitulée Ascended,
datée de 2008, l’œuvre (à voir
ici) est signée Damien Hirst (d'où sa valeur monétaire).
Les 33 autres « butterfly paintings » proposés – les plus anciens étant de 2005
- ont trouvé également preneur, à des prix inespérés. Il y aurait de 300 à 400
œuvres de cette lignée dans le monde. Et aussi, du même, des « fly paintings »
comme cette étoile géante recouverte d’un enduit fait de mouches (bien
cadavériques – détail
ici).
D. Hirst a déclaré arrêter la production (il a une kyrielle d’assistants) de
tableaux d’insectes pour se consacrer plus à sa série de bocaux de formol géants
conservant un zèbre, une licorne, un veau…
Un fossile vivant de fourmi :
Une espèce de fourmi, jusque là inconnue et appartenant à une
lignée de ces insectes remontant à 120 millions d'années a été découverte en
Amazonie. "Elle est probablement la descendante des plus anciens ancêtres de
ces insectes" a déclaré Christian Rabeling, entomologiste de l'Université
d'Austin, qui a mis au jour ce spécimen.
Septembre 2008
Une tribu inconnue découverte
au cœur de l'Amazonie :
Ils vivent dans l'enfer vert amazonien. Ils habitent des
huttes de paille, se peignent le corps entièrement en rouge ou en noir; ils
cultivent le manioc; et lorsqu'un hélico les survole, ils décochent des flèches
contre cet intrus... En somme, ils ignorent tout de la civilisation; et il vaut
mieux pour eux. La Fondation nationale de l'Indien, la FUNAI, vient de publier
quelques rares photos d'une tribu sans aucun contact avec le monde extérieur, un
des peuples les plus isolés du globe. Une révélation pour le reste de
l'humanité, même si la FUNAI connaît leur existence depuis une vingtaine
d'années ! Mais la fondation avait gardé le secret pour préserver la
tranquillité de ce berceau oublié de l'humanité.
Si la FUNAI a décidé de montrer ces clichés, c'est parce que ce petit peuple est
menacé par l'avancée inexorable de bûcherons pilleurs de forêts, de chercheurs
d'or ou de planteurs de coca. Pour échapper à ces peu glorieux représentants de
l'espèce humaine dans le secteur, les tribus sont obligées de se déplacer.
Pour José Carlos dos Reis Meirelles, de la FUNAI, "leur avenir dépend de
nous. Si ces région sauvages, qui de toute façon ne sont pas cultivables, ne
sont pas préservées, ces indiens mourront". Pour lui, pas question d'aller
faire de la sociologie avec ces hommes d'un autre espace-temps : les étudier, ce
serait les détruire.
(La Dépêche du Midi)
Une tribu isolée découverte au
Brésil (2008) :
L'une
des dernière tribus isolées d'Amérique du sud a été repérée et
photographiée au Brésil © GLEISON MIRANDA/FUNAI
L'une des dernière tribus isolées d'Amérique du sud a été repérée et
photographiée au Brésil, dans l'État d'Acre, à la frontière du
Pérou, a annoncé le 29 mai 2008 le département brésilien pour les
affaires indiennes (Funai).
Les photos aériennes (voir toutes les photos) montrent des membres
de la tribu, peints en rouge, brandissant arcs et flèches, ainsi que
leurs habitations. Selon l'ONG Survival International , près de 100
tribus isolées seraient présentes dans le monde, essentiellement au
Brésil et au Pérou. Elles sont menacées par la déforestation.
"Nous avons survolé la zone pour montrer leurs maisons et pour
prouver leur existence", a expliqué José Carlos dos Reis Meirelles
Junior, qui travaille à la Funai. "C'est très important, dans la
mesure où certains doutent de la présence de ces dernières tribus"
en Amazonie, lesquelles sont dans l'isolement le plus total.
Ségolène de Larquier
Un vrai "Koh Lanta" :
Aurélien Brulé s'apprête à vivre son Koh Lanta
personnel. Le 17 septembre 2008, ce jeune français de 29 ans se fera déposé par
hélicoptère (pas très écolo, ça !) en plein milieu d'une des dernières forêts
primaires de Bornéo, très loin de tout village habité; il emportera avec lui 10
kilos de riz et quelques croquettes pour son chien, un golden retriever, "pour
protéger mon camp des ours et des panthères", explique-t-il avec le sourire;
mais aussi pour l'avertir si jamais quelques Dayak et Punan (autrefois coupeurs
de tête ...) approchaient ... Pourtant, ce grand gaillard n'est pas une tête
brûlée : voilà 10 ans qu'il vit à Bornéo où il a fondé l'Association Kalaweit,
qui récupère les gibbons, utilisés comme animaux de compagnie, pour les
rééduquer à la vie sauvage. En s'immergeant durant un mois dans l'une des
jungles les plus menacées de la planète, Chanee (c'est son nom indonésien)
désire attirer l'attention du monde entier sur la nécessité de la préserver;
encore lui faudra-t-il revenir avec toute sa tête !!
Mules :
Farcis à la cocaïne (3 g chacun), une centaine
de longicornes péruviens – déclarés insectes morts – ont été pris à l’aéroport
d’Amsterdam, en juillet 2007. Vus au scanner, ils avaient une drôle d’allure.
Effectivement, leur abdomen était incisé (dorsalement !) et agrafé
(maladroitement !). Une faute entomologique qui aura fait perdre aux trafiquants
8 000 €.
HORREUR ! L'air "pur" des
montagnes serait finalement plus pollué que celui des villes !
Les forêts produisent naturellement de grandes quantités
d'hydrocarbures (surtout les conifères); si, au gré des vents, les oxydes
d'azote, produits par la pollution "classique" des voitures, survolent une
forêt, ils réagissent immédiatement avec les hydrocarbures naturels pour créer
de l'ozone (réactions chimiques qui sont favorisées par le fort rayonnement
solaire !).
Ainsi : le taux d'ozone en forêt de Rambouillet peut-être 12 fois supérieur à
celui du XIIIème arrondissement de Paris !
De fortes concentrations ont été mesurées dans les forêts des Landes !
Au Pic du Midi, le taux d'ozone a été multiplié par 5 depuis le siècle dernier !
Les randonneurs n'avalent pas moins de 100μg
d'ozone par m3 d'air; soit la valeur admise par l'OMS sur une durée
de seulement 8h!
Une si vieille nouvelle espèce
:
 "Dans notre métier, on voyage régulièrement; mais bien
souvent, c'est en traversant le couloir qu'on découvre de nouvelles espèces".
Thierry Deuve, entomologiste au Muséum d'Histoire naturelle depuis 1989 parle
d'expérience. Conservée dans la collection de coléoptères du Muséum (ndlr : la
plus importante du monde), l'une des dernières espèces qu'il a décrite -
Brachinus solidipalpis, un carabique de la Famille des Bombardiers -
attendait qu'on veuille bien l'étudier depuis ...1843 ! D'après l'étiquette qui
les ornait, les sept spécimens existants ont été collectés à Manille
(Philippines). Depuis, plus aucune trace d'eux dans la nature. Les bombardiers
vivent en forêt et, aujourd'hui, il ne reste plus guère d'arbres dans la
capitale philippine, l'une des villes les plus peuplées du monde. Deux
hypothèses : soit l'espèce a bel et bien disparu, soit elle vit discrètement
dans une autre forêt de cette région. "Même si l'on sait que
la déforestation et l'usage des pesticides sont à
l'origine de beaucoup d'extinctions d'insectes, nous n'avons pas la
preuve formelle de la disparition de B. solidipalpis", assure T.
Deuve, résolument optimiste. La destruction d'un coléoptère a-t-elle tant
d'importance, dans un Ordre qui en compte des centaines de milliers ? "Oui,
car c'est ça la biodiversité. Les différences entre ces espèces peuvent être de
l'ordre de celles qui existent entre la panthère et le jaguar : c'est énorme,
mais seuls les entomologistes les voient". La preuve, c'est que
les carabiques ont fait parler d'eux dans la première moitié du XXème siècle :
l'étude de leur répartition en Asie du sud a servi à
défendre la Théorie de Wegener sur la dérive des Continents. Du coléoptère aux
mouvements des terres, il n'y avait qu'un pas. "Dans notre métier, on voyage régulièrement; mais bien
souvent, c'est en traversant le couloir qu'on découvre de nouvelles espèces".
Thierry Deuve, entomologiste au Muséum d'Histoire naturelle depuis 1989 parle
d'expérience. Conservée dans la collection de coléoptères du Muséum (ndlr : la
plus importante du monde), l'une des dernières espèces qu'il a décrite -
Brachinus solidipalpis, un carabique de la Famille des Bombardiers -
attendait qu'on veuille bien l'étudier depuis ...1843 ! D'après l'étiquette qui
les ornait, les sept spécimens existants ont été collectés à Manille
(Philippines). Depuis, plus aucune trace d'eux dans la nature. Les bombardiers
vivent en forêt et, aujourd'hui, il ne reste plus guère d'arbres dans la
capitale philippine, l'une des villes les plus peuplées du monde. Deux
hypothèses : soit l'espèce a bel et bien disparu, soit elle vit discrètement
dans une autre forêt de cette région. "Même si l'on sait que
la déforestation et l'usage des pesticides sont à
l'origine de beaucoup d'extinctions d'insectes, nous n'avons pas la
preuve formelle de la disparition de B. solidipalpis", assure T.
Deuve, résolument optimiste. La destruction d'un coléoptère a-t-elle tant
d'importance, dans un Ordre qui en compte des centaines de milliers ? "Oui,
car c'est ça la biodiversité. Les différences entre ces espèces peuvent être de
l'ordre de celles qui existent entre la panthère et le jaguar : c'est énorme,
mais seuls les entomologistes les voient". La preuve, c'est que
les carabiques ont fait parler d'eux dans la première moitié du XXème siècle :
l'étude de leur répartition en Asie du sud a servi à
défendre la Théorie de Wegener sur la dérive des Continents. Du coléoptère aux
mouvements des terres, il n'y avait qu'un pas.
(National Geographic, juin 2008)
Le bed bug :
Il a ressurgi vers l'an 2000
en Amérique du Nord, après un demi-siècle de discrétion presque absolue. Le
changement de millénaire n’y est pour rien. La Punaise des lits, Cimex
lectularius (Hém. Cimicidé) sévit désormais dans les meilleurs hôtels, les
dortoirs des collèges les plus chers, les appartements les mieux placés, ainsi
que dans les abris des sans logis. L’insecte était absent du Sheraton d’Arligton
(Virginie, États-Unis), qui a accueilli les 300 participants à une conférence de
2 jours sur le sujet. Lesquels se sont accordés sur le fait qu’on manque
d’insecticides efficaces, depuis le bannissement du DDT, et que les méthodes de
lutte alternatives restent à mettre au point.
Depuis l’an 2000, la Punaise des lits pullule. On la trouve toujours dans les
matelas et les meubles mais aussi dans les téléphones portables et les claviers
d’ordinateur.
Un scorpion géant :
Une pince fossile ayant appartenu à un scorpion de mer,
trouvée dans le sud de l'Allemagne, a récemment été étudiée. Elle suggère que ce
maxiscorpion nommé Jaekelopterus rhenaniae, qui dominait les mers vers
350 Ma (Dévonien inférieur), mesurait 2,50m ! De quoi émettre l'idée que
d'autres arthropodes géants (libellules, mille-pattes ...) ont pu atteindre de
telles proportions à cette époque, jusqu'à ce que de terribles amphibiens ou
poissons armés jusqu'aux dents ne viennent les faire disparaître ...
Le commerce des papillons
sauve les papillons !
http://pronaturafrance.free.fr/papillon.html
 L'ambre du Liban : L'ambre du Liban :
Les
informations contenues dans les inclusions biologiques de l'ambre du Liban sont
capitales, car il s'agit de l'ambre le plus ancien du monde. Entre 125 et 135
millions d'années : "Nous possédons le plus vieux lézard (130 millions
d'années) pour une lignée que les chercheurs croyaient âgées d'à peine 30
millions d'années", explique Dany Azar, paléoentomologiste au MNHN. Ainsi
que le plus vieil accouplement et le plus ancien phénomène de parasitisme. Mais
aussi le plus vieux papillon et le plus vieil insecte social : un termite. En 6
ans, un grand nombre de nouvelles espèces ont été décrites : 76 au total ! "Nous
n'avons pu étudier que 3 gisements sur les 75 découverts à ce jour. Avec le
pillage de l'ambre du Liban, c'est une partie du patrimoine mondial qui est
perdu pour la Science. Il est donc essentiel que l'Etat libanais protège par des
lois cette mémoire de la vie".
(National Geographic de mai 2001)
Une araignée microscopique :
Le fossile d'une minuscule araignée, appelée
Cenotextricella simoni (53 Ma), découverte dans de l'ambre du bassin
parisien, a été étudiée par un paléontologue britannique et une équipe belge
grâce à une technique habituellement réservée au milieu médical. En effet, une
tomographie aux rayons-X a été pratiquée (technique dite VHR-CT ou Volumetric
High-Resolution Computed Tomographie). Des images en 3 dimensions ont ainsi été
obtenues et ont permis de visualiser les organes internes fossilisés.
L'ambre de Charente :
Des paléontologues de l'Université de Rennes ont découvert 356 insectes,
araignées et acariens dans 640 pièces d'ambre du Crétacé de Charente, grâce à
une technique très sophistiquée qui permet de mettre en 3D ces minuscules
animaux (ndlr : sans doute la même technique que dans la rubrique précédente
...) qui sont inclus dans l'ambre opaque de cette région. Pour plus
d'informations et quelques images :
www.esrf.eu/PressAndMedia/pressreleases/amber/
Dernières nouvelles - une
faune du Crétacé tirée de l'ambre :
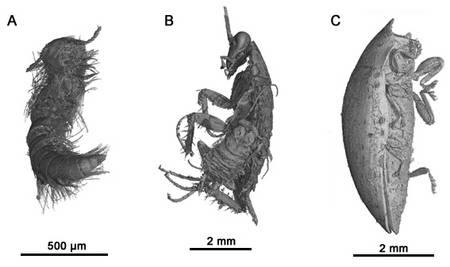 Elles étaient prisonnières de 2kg de petits cailloux
jaunâtres; et voilà que grâce au synchrotron de Lyon, la faune et la flore de la
Charente-Maritime d'il y a 100 millions d'années refait surface dans toute sa
diversité ! Les rayons X à haute densité de l'accélérateur français ont révélé
pas moins de 356 "inclusions' animales et végétales, qui attendaient bien cachés
dans 640 petits morceaux d'ambre complètement opaques; les frêles empreintes ont
été laissées par une armée de gastéropodes, insectes, araignées et plantes qui
vivaient en France à l'époque des dinosaures; de ces reliques, on distingue
désoemais le moindre poil, que ce soit sur des modèles virtuels ou sur des
moulages en résine que Paul Tafforeau, paléontologue à l'ESRF tient aujourd'hui
dans ses mains. Un trésor et un coup de maître pour les scientifiques
français... Elles étaient prisonnières de 2kg de petits cailloux
jaunâtres; et voilà que grâce au synchrotron de Lyon, la faune et la flore de la
Charente-Maritime d'il y a 100 millions d'années refait surface dans toute sa
diversité ! Les rayons X à haute densité de l'accélérateur français ont révélé
pas moins de 356 "inclusions' animales et végétales, qui attendaient bien cachés
dans 640 petits morceaux d'ambre complètement opaques; les frêles empreintes ont
été laissées par une armée de gastéropodes, insectes, araignées et plantes qui
vivaient en France à l'époque des dinosaures; de ces reliques, on distingue
désoemais le moindre poil, que ce soit sur des modèles virtuels ou sur des
moulages en résine que Paul Tafforeau, paléontologue à l'ESRF tient aujourd'hui
dans ses mains. Un trésor et un coup de maître pour les scientifiques
français...
Tout a commencé en 2000, lorsque le paléontologue Didier Néraudeau ramène d'une
carrière charentaise 60kg d'ambre, antique résine fossile; en 4 ans, lui et son
équipe parviennent à faire parler le bel ambre translucide couleur de miel, qui
dévoile sans pudeur toute la faune et la flore tombée dedans lors de sa
formation; mùais le chercheur aimerait bien aissi faire parler son disgracieux
cousin opaque, qui représente 80% de sa récolte ! La solution ? L'ESFR de
Grenoble .........."si l'ambre conserve les formes 3D, les inclusions sont
vides : ce sont des moulages en creux; les rares fois où de la matière organique
a été identifiée dans l'ambre, elle était toujours altérée". Le rêve de
trouver une tique ou un moustique et d'en tirer une goutte de sang (donc de
l'ADN) antédiluvien n'a donc guère de chance de se réaliser ! .........
Les spécimens récupérés mesurent de 0,8mm pour une sorte de mite à 4mm pour une
guêpe, avec, entre les 2, tout un cortège de mouches, araignées, crustacés,
fourmis ... 53% seulement des familles sont connues et, même si on peut
rapprocher un individu d'une famille, il est inconnu comme espèce. On prend
enfin la mesure de la biodiversité de l'époque que peinait à raconter le bel
ambre translucide.
Et les inclusions révèlent bien d'autres choses ....(Lire la totalité de
l'article dans l'excellent "Science et Vie d'août 2008)
On a retrouvé une toile d'araignée vieille de 140 millions
d’années :
Les araignées ont appris à tisser
des toiles plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, comme en témoigne le
fragment découvert emprisonné dans l’ambre et daté de 140 millions d’années.
Hemiptera Ibaeidae :
Pourquoi entreprendre des expéditions coûteuses à la recherche d’une espèce
d’insecte nouvelle pour la science ? Il suffit d’un ou deux clics, sur son
micro, chez soi.
Mindarus harringtoni (Hem. Aphididé) vient en effet s’être découvert
(2007) par Richard Harrington, vice-président de la Royal Entomological Society
du Royaume-Uni, dans un bout d’ambre vieux de 50 millions d’années acheté 20
livres sur ebay.
 Découverte d'insectes fossiles
dans l'ambre d'Amazonie (28 août 2006). Découverte d'insectes fossiles
dans l'ambre d'Amazonie (28 août 2006).
Au Nord du Pérou, il y a 15 à 12 millions d'années, des insectes,
acariens et autres arthropodes se sont fait piéger dans la résine le long de
troncs d'arbre ou de branches. Une équipe internationale de paléontologues et de
géologues les a retrouvés fossilisés dans l'ambre. Cette découverte est la
première du genre en Amazonie occidentale. Grâce à elle, les chercheurs prouvent
l'existence précoce d'une grande biodiversité terrestre dans la région, dans un
environnement forestier et sous un climat chaud et humide". Ces résultats sont
publiés en ligne sur le site des Proceedings of the National Academy of
Sciences.
Termitière fossile :
La plus grande et la plus ancienne termitière fossile du monde a été trouvée
au Tchad. Celle-ci a révélé un âge de l'ordre de 3 à 7 Ma et s'étend sur un
hectare (?!). Bien que découverte en 1997, elle n'a été authentifiée que
récemment.
Un
éphémère de 300 millions d’années :
Des chercheurs
de l'Université Tufts ont découvert ce qu'ils croient être le plus
ancien fossile d'un insecte volant dans un affleurement rocheux près
de North Attleboro, dans le Massachusetts.
L'empreinte retrouvée à North Attleboro (Crédit : Tufts University /
Richard J. Knecht et Jacob Brenner)
L’empreinte, d’environ sept centimètres de long retrouvée sur un
éperon rocheux à proximité d’un centre commercial, représente le
thorax, l’abdomen ainsi que six pattes d’un insecte dont l’aspect
extérieur rappelle une libellule. Selon son découvreur, géologue à
l’Université de Tufts, il serait en réalité un très lointain cousin
des éphémères.
Le fossile a été retrouvé dans une couche de boue solidifiée
d’aspect rouge bordeaux, vieille de 312 millions d’années. Il
constitue la plus ancienne trace de passage d’un insecte vivant
enregistrée dans la roche, elle est sans doute due au bref
atterrissage de l’animal sur une nappe de boue. Sur la roche, il n’y
a aucune trace d’ailes mais les chercheurs ont découvert les restes
fossilisés d’une aile, appartenant probablement à la même espèce, à
proximité du site.
Il y a 312 millions d’années les insectes constituaient déjà une
classe largement répandue sur la Terre tandis que les premiers
reptiles, ancêtres des dinosaures, commençaient à peine leur essor.
A cette époque, le sud de la Nouvelle-Angleterre (région qui
correspond au nord-est des Etats-Unis) était beaucoup plus proche de
l’équateur ce qui suggère que cette région pourrait être une source
importante de découvertes dans l’avenir.
Des insectes vieux de 95 millions d'années, fossilisés dans la
résine, ont été mis au jour en Ethiopie : une découverte inédite en Afrique.
Insectes, araignées, champignons, nématodes et plantes qui vivaient
il y a 95 millions d’années dans une forêt tropical africaine ont
été fossilisés dans la résine. Découvert en Ethiopie, cet ambre
livre aux scientifiques de précieuses informations sur la diversité
des espèces à l’époque du Crétacé (il y a entre 145 et 65 millions
d’années).
 Une petite guêpe parasite piégée dans l'ambre
découvert en Ethiopie. (Alexander R. Schmidt) Une petite guêpe parasite piégée dans l'ambre
découvert en Ethiopie. (Alexander R. Schmidt)
Cette découverte est exceptionnelle pour le continent africain,
soulignent Alexander Schmidt (Université de Göttingen, Allemagne),
Vincent Perrichot (Université de Rennes/CNRS) et leurs collègues
dans les PNAS. Relativement communs dans l’hémisphère nord, les
dépôts d’ambres datant du Crétacé sont quasi inexistants pour
l’ancien supercontinent du Sud, le Gondwana. "Les seuls gisements
d’ambres de l’hémisphère sud connus sont au Brésil et en Afrique du
Sud, précise Vincent Perrichot, mais ils n"».'ont livré à ce jour
aucun insecte fossile en inclusion".
Pas moins de 30 arthropodes ont été piégés dans la résine devenue
ambre jaune retrouvée par un géologue éthiopien et envoyé au
laboratoire d’Alexander Schmidt. Coléoptères, lépidoptères,
diptères, hyménoptères, collemboles… la collection est variée. Elle
contient l’une des plus vieilles fourmis fossilisées connues et le
second plus vieux spécimen d’araignée de la famille des Linyphiidae
(une petite araignée qui vit sous sa toile tissée en nappe).
 «Cette
fourmi, âgée de 93 à 95 millions d’années, est la plus ancienne pour
le Gondwana, explique le paléo-entomologiste. Les plus anciennes
fourmis ont été découvertes en France (Charente-Maritime) et en
Birmanie et elles ont 100 millions d’années». La fourmi éthiopienne
montre que ces insectes avaient déjà une large distribution
géographique au milieu du Crétacé, et qu'ils pourraient avoir une
origine plus ancienne que supposée jusqu'alors.. «Cette
fourmi, âgée de 93 à 95 millions d’années, est la plus ancienne pour
le Gondwana, explique le paléo-entomologiste. Les plus anciennes
fourmis ont été découvertes en France (Charente-Maritime) et en
Birmanie et elles ont 100 millions d’années». La fourmi éthiopienne
montre que ces insectes avaient déjà une large distribution
géographique au milieu du Crétacé, et qu'ils pourraient avoir une
origine plus ancienne que supposée jusqu'alors..
Pour mieux décrire la fourmi, Vincent Perrichot travaille avec une
équipe de synchrotron de Grenoble. «Elle est enroulée sur elle-même
(cf photo, ndlr) et certaines parties importantes pour
l’identification sont cachées. Nous allons donc réaliser un scan
haute résolution et la reconstituer en 3D. Je pourrai ensuite
pratiquer une coupe virtuelle».
L’ambre lui-même –la résine fossile- est d’un très grand intérêt.
«Il est très dur et très translucide, alors que les ambres du
Crétacé sont souvent fragiles et opaques», relève le spécialiste
français. L’analyse physico-chimique a de plus révélé qu’il est
unique, différente des autres résines fossiles étudiées jusqu’à
présent.
Cette résine pourrait provenir d’un conifère encore inconnu ou d’un
angiosperme –une plante à fleurs- ce qui serait vraiment atypique.
Toutes les résines fossiles connues du Crétacé sont issues de
gymnospermes, autrement dit de conifères. Le Crétacé correspond au
début de la diversification des espèces de plantes à fleurs.
Cette découverte relance l’intérêt des recherches d’ambre en Afrique
et plus généralement dans l’hémisphère sud. «Il est vrai que dans
certains pays les terrains ne sont pas facilement accessible, par
exemple avec la forêt tropicale, précise Vincent Perrichot, mais
c’est surtout le manque de prospection qui explique que nous ayons
moins de gisements d’ambre au sud».
Cécile Dumas - Sciencesetavenir.fr - 06/04/10
Les
premiers insectes :
Fouisseurs, giboyeurs, suceurs de sang, frugivores, herbivores, ou même
coprophages, les insectes se sont adaptés à tous les modes de vie et ont envahi
tous les milieux, même les plus hostiles. Ces invertébrés à six pattes sont
partout et en grande quantité : près d'un million d'espèces ont été à ce jour
répertoriées et les spécialistes estiment qu'il en existe entre 3 et 70
millions(I) !
Quand sont-ils apparus ? Nul ne le sait précisément car il
n'existe aucune preuve fossile de leur origine. Les premiers vestiges
incontestables d'insectes ont été découverts à Gilboa, près de New York, dans
des terrains vieux de 385 millions d'années (Dévonien moyen)(1). Il s'agit
d'archéognathes, des insectes dépourvus d'ailes et dont les pièces buccales
saillent hors de la tête. Ces formes sont déjà très modernes et l'on pense que
les archéognathes sont apparus plus tôt, dès le Silurien moyen (vers 430
millions d'années). De petite taille (quelques millimètres), ils peuplaient le
sol et la litière, aux côtés d'autres arthropodes, grands amateurs de détritus.
Les premiers insectes ailés (ptérygotes) apparaissent plus tard, au Carbonifère,
il y a quelque 325 millions d'années. Delitzschala bitterfeldensis ,
découvert l'an dernier dans la région de Bitterfeld-Delitzsch, en Allemagne, est
le plus ancien représentant connu d'un groupe aujourd'hui disparu, les
paléodictyoptéroïdes(2). Ces insectes primitifs étaient dotés de deux paires
d'ailes bien développées, et d'une paire de lobes sur les flancs du premier
segment thoracique, souvent interprétés comme étant des ailes rudimentaires. A
la différence de la plupart des ptérygotes actuels, ils étaient incapables de
les replier sur le dos au repos. Des pièces buccales très spécialisées leur
permettaient de déchirer les cônes des plantes ou bien de percer les ovules afin
d'en sucer le contenu(II).
Les insectes se sont considérablement diversifiés
au Carbonifère supérieur et au Permien inférieur (entre 320 et 280 millions
d'années), probablement en liaison avec le développement des plantes
vasculaires. A l'aube de l'ère secondaire, les principales lignées d'insectes
ailés sont déjà représentées. Certaines ont disparu comme les protodonates,
ancêtres géants des libellules actuelles ; les autres, les plus nombreuses, ont
survécu : éphémères, blattes, hémiptères (pucerons, cigales, punaises, etc.),
orthoptères (grillons, sauterelles, criquets, etc.), coléoptères (scarabées,
carabes, staphylins, etc.), diptères (moustiques, mouches, tipules, etc.), etc.
Il est généralement admis que tous les insectes déri-vent d'un même ancêtre :
ils forment un groupe monophylétique défini par un certain nombre de caractères
évolués (dits apomorphes) parmi lesquels : la présence d'un organe sensoriel
complexe dans le deuxième segment de l'antenne ; un flagelle (extrémité de
l'antenne) dépourvu de muscle ; le tarse de la patte subdivisé en tarsomères ;
ou encore l'existence d'un long appendice filiforme (ou paracerque) à
l'extrémité de l'abdomen. Mais quel est cet ancêtre ? Faut-il le rechercher du
côté des entognathes hexapodes (ensemble des diploures*, protoures* et
collemboles) ? Ou parmi les autres grands groupes d'arthropodes, à savoir les
crustacés*, les myriapodes* et les arachnides* ?
Les hexapodes ont une
origine phylogénétique commune : leur corps est divisé en trois (tête, thorax,
abdomen) et leur thorax est équipé de pattes bien développées. On a cru pendant
longtemps que les diploures, qui ressemblent aux poissons d'argent, étaient les
plus proches parents des insectes. Mais aucun des critères utilisés pour
apparenter les deux groupes n'était convaincant. Tombée un temps en désuétude,
cette thèse refait pourtant aujourd'hui surface. Les hexapodes ont également été
rapprochés de leurs cousins myriapodes (mille-pattes, iules). On les réunit
traditionnellement au sein d'un supertaxon, les trachéates ou atélocérates. Et
pour cause : tous ces invertébrés sont pourvus de tubes de Malpighi (organes
d'excrétion), d'un système de trachées respiratoires et n'ont plus qu'une seule
paire d'antennes.
Ce schéma ne fait pas l'unanimité : il se pourrait que ces
trois caractéristiques soient le fruit d'une adaptation à la vie terrestre et
donc qu'insectes et myriapodes aient évolué indépendamment les uns des autres.
On s'est aperçu que les tubes de Malpighi et les trachées existent également
chez de nombreux arachnides (animaux terrestres). La seconde paire d'antennes
qui sert habituellement à la locomotion aquatique et à la filtration n'est,
quant à elle, plus nécessaire en cas de vie terrestre.
Finalement, si l'on
exclut les diploures et les myriapodes, qui sont les plus proches parents des
insectes ? Les crustacés, répondent les spécialistes de phylogénie moléculaire
après avoir comparé les arn ribosomiaux (12S et 18S) de différentes espèces
d'arthropodes(3).
Les myriapodes auraient pour leur part une origine
indépendante. Ces résultats, même s'ils demandent à être confirmés (le nombre
d'espèces étudiées reste encore insuffisant), sont compatibles avec le fait que
crustacés et insectes partagent de nombreux caractères évolués : cuticule,
structure segmentée de la tête, cœur en position dorsale, système circulatoire
ouvert, etc. La structure cellulaire et le plan de développement de leurs
systèmes nerveux et sensoriel sont en outre similaires mais différents de ceux
des myriapodes.
Dans ce schéma, auquel bien des adeptes de l'analyse
morphologique refusent pour l'instant d'adhérer, crustacés et insectes auraient
un ancêtre commun. Mais lequel ?
Fabienne Lemarchand
Mort aux vaches ! :
Le slogan fait fureur en ce moment dans le lobby
aéronautique; accusées d'être en partie à l'origine du réchauffement planétaire,
plusieurs compagnies aériennes ont récemment pointé du doigt, dans une campagne
de publicité, la responsabilité des élevages bovins dans le dérèglement
climatique. Les chiffres leur donnent raison : les éructations et les
flatulences de nos placides ruminants sont responsables de près de
20% des émissions mondiales de méthane, l'un des gaz à effet de serre les plus
nocifs.
Les vaches larguent dans l'atmosphère une centaine de millions de tonnes
de méthane, dont le pouvoir de réchauffement est considérable; une molécule de
méthane provoque un effet de serre vingt fois plus important qu'une molécule de
CO2 .Un pot catalytique spécial bovin ayant peu de chances de voir le jour, les
chercheurs travaillent depuis plusieurs années à la modification du régime
alimentaire des ruminants ...
Les émissions de gaz à effet de serre
du secteur herbivore représentent 11% des émissions nationales; 80% de ces
émissions proviennent des bovins (19 millions de têtes en France, 90 millions en
Europe, 1379 millions dans le monde ...). Selon un rapport des Nations Unis paru
en 2006, le secteur de l'élevage émet dans son ensemble 18% des gaz à effet de
serre de la Planète, les Transports 26% et l'industrie 22%.
S'il y a
tant de vaches, de Transports, et d'Industrie, c'est qu'il y a trop d'humains !!
Et les gaz produits par les
humains ? J'en connais qui en dégage vraiment beaucoup !!
Dénatalité !!! Et décroissance
?!
Il n’y a pas que les vaches.
Les insectes aquatiques contribuent au réchauffement planétaire par leurs
flatulences. Des bactéries de leur tube digestif produisent en effet, à partir
de nitrates, du protoxyde d’azote. Ce gaz, connu sous le nom de gaz hilarant,
est un psychotrope (en vente libre) qui provoque (tant qu’il est inhalé) une
sensation de bien-être et inhibe la douleur. Il est aussi un très puissant gaz à
effet de serre.
Comme chez les vaches, la quantité produite dépend beaucoup de l’alimentation :
plancton ou dépôts.
Le phénomène vient d’être mis en évidence par une équipe danoise (institut
Max-Plank de Brème, Allemagne), sur plusieurs animaux dont des chironomes.
Un homme meurt écrasé par une
foule d'acheteurs à New York :
Aux Etats-Unis, le "Black Friday",
jour suivant la fête de Thanksgiving, marque traditionnellement le
début des achats de Noël avec notamment des soldes très importantes
dans les magasins qui ouvrent leur porte dès le petit matin.
Vendredi 28 novembre, cette tradition a pris une tournure tragique
dans un magasin Wal-Mart de Long Island, dans l'Etat de New York. Un
employé qui venait d'ouvrir les portes pour laisser entrer une foule
impatiente a été écrasé par les acheteurs qui se ruaient sur les
produits. L'homme, âgé de 34 ans, est mort de ses blessures.
Dénatalité !!! Et décroissance ?!
Un site néerlandais sur les insectes de
Nouvelle-Guinée :
http://www.papua-insects.nl/about%20us/about%20us%20fr.htm
Le palmarès 2008 des Ig Nobels :
Cocorico ! L’Ig Nobel de biologie est
décerné à la France (Marie-Christine Cadiergues, Christel Joubert et Michel
Franc). Ils ont montré que les puces des chiens sautent plus haut que les puces
de chat !!
On continue à persécuter les
entomologistes pour des motifs absurdes, alors que le grand massacre de la
Nature s'amplifie :
Dear friends and
colleagues,
You might be aware of the incident of the arrest of Dr. Petr Švácha, the scientist who is arrested by the forests officials in West Bengal, India for collecting Beetles and beetle larvae in Singalila National Park, Darjeeling. They have apparently been accused of collecting for the 'Chinese Medicine market', and the beetles they have
collected have been valued at 6000-7000 rupees EACH SPECIMEN!
Une pétition circule que tous les entomologistes
se devraient de signer ...
Les insectes se
reproduisent par millions; si certains sont menacés, c'est par l'intolérable
prolifération humaine et tous ses effets néfastes; comme la déforestation,
les insecticides, les diverses pollutions, les voitures ...
Pas à cause des entomologistes !
Quand va-t-on
arrêter d'emmerder les entomologistes !?
Today (July 16,
2008), I was speaking with the Czech embassy as well as with Emil Kucera.
I was advised by our embassy to initiate a new petition organized by the
Czech Entomological Society. The reason is the real risk of splitting their
case into two separate trials where Kucera would be sentenced.
Text of the
petition can be found here:
http://www.petitiononline.com/h3e09s05/petition.html
For the moment,
the petition has been signed by the members of the Committee of the Czech
Entomological Society. I am sincerely asking you to support this petition by
your sign and disseminate the link on it to your colleagues – entomologists
as well as to your friends and acquaintances.
Sincerely,
Vladislav
Malý
50 species per day
discovered in 2006 :
(5/27/2008) 16,969 species were
discovered in 2006 according to a report compiled by Arizona State University's
International Institute for Species Exploration, the International Commission on
Zoological Nomenclature, the International Plant Names Index, and Thompson
Scientific. En 2006, selon la
liste rouge de l’UICN, les espèces identifiées peuvent être
décomposées comme suit[2] :
Faut pas être dégoûté !
Des chercheurs britanniques ont découvert une nouvelle espèce
de bactéries dans la bouche humaine; baptisée Prevotella histicola, cette
bactérie n'est qu'une des millions présentes dans notre bouche, aux côtés d'une
énorme variété de microbes incluant virus, champignons, protozoaires ...
"Chaque millilitre de salive en contient 100 000 000, explique le Pr.
William Wade, et il y a plus de 600 espèces différentes de bactéries dans la
bouche. Environ la moitié d'entre elles restent à décrire". Cette découverte
devrait permettre de mieux comprendre la composition des micro-organismes de la
bouche, et aider les chercheurs à imaginer de nouvelles mesures de prévention et
de nouveaux traitements contre les caries et gingivites, les plus courantes des
maladies infectieuses de la bouche.
Et le vagin alors !!!!!!!
Dans le même esprit ...
Pas la peine de rechercher bien loin la biodiversité :
notre
peau abrite au moins 112 000 espèces de
microbes différentes. Les chercheurs de l'Institut national de recherches sur le
génome humain ont eux-mêmes été étonnés par cette extraordinaire moisson
récoltée sur 2 sites (nez, coude, utérus ...) de 10 volontaires (lavés ou pas
???!). Cet inventaire est réalisé pour mieux comprendre comment la peau agit
comme première ligne de défense contre les envahisseurs !
revue "Sciences"
L'entomologiste au service de
la biodiversité :
La tâche de l’entomologiste est multiple. D’une part il
classe et décrit les espèces d’insectes afin d’inventorier la biodiversité, d’en
connaître l’évolution : cette activité constitue ce que l’on appelle la
systématique.
Avec le concours d’autres zoologistes, et par le biais de diverses méthodes,
l’entomologiste systématicien met en regard cette évolution avec celle des
autres animaux, contribuant en quelque sorte à établir la "généalogie" de tous
les êtres vivants qui peuplent la planète. D’autre part, l’entomologiste étudie
la biologie des insectes : de quelles plantes ou de quels animaux se
nourrissent-ils ? Dans quelles conditions particulières se développent-ils ?
Quels sont les milieux favorables aux
imagos(forme
adulte, définitive, de l'insecte sexué) ? Quels comportements adoptent les
différentes espèces ? Ces recherches s’inscrivent au sein de diverses autres
disciplines, comme l’écologie
et l’éthologie.
Par le passé, ces études étaient généralement réalisées dans l’optique d’une
recherche fondamentale pure. Aujourd’hui, elles s’effectuent de plus en plus
souvent dans le cadre de programmes de conservation. À l’échelle de l’Europe
tout d’abord, pour des programmes émanant de
Natura 2000(engagements
des États membres afin de conserver les habitats et les espèces sur les zones
appartenant au réseau écologique européen Natura 2000). Au plan national
ensuite, où, plus localement, elles peuvent être sollicitées par l’État, une
région, un département, une commune ou une association, dans l'objectif
d'établir un état des lieux et de définir les zones à sauvegarder (réserves
naturelles, etc.).
Ainsi,Gérard Luquet a participé entre 1996 et 2003 à une étude
pluridisciplinaire des pelouses calcaires du sud de l’Essonne. En raison de leur
forte valeur patrimoniale, ces pelouses ont été retenues pour faire partie du
futur réseau Natura 2000. Elles hébergent en effet des espèces telles que
l’écaille chinée (papillon) et le lucane cerf-volant (coléoptère), classées
d’intérêt européen, et bien d’autres espèces remarquables. Par ailleurs, ces
pelouses calcaires sont rares et menacées, car elles évoluent spontanément vers
la forêt depuis la disparition de l’agropastoralisme.
À terme, la banalisation de la flore et de la faune menace. L’intégration dans
le réseau Natura 2000 constitue un gage aux termes duquel le site sera conservé
dans son état actuel ; aucune artificialisation n’y sera admise. Plus
localement, à Saint-Cyr-la-Rivière, l’élaboration du PLU (Plan Local
d’Urbanisme)s’est appuyée sur une étude naturaliste, comportant un volet
entomologique, afin d’éviter toute construction dans certaines zones dont le
caractère exceptionnel avait été mis en évidence. Dans le sud-ouest de
l’Essonne, les membres du Groupe d’Inventaire des Lépidoptères d’Île-de-France
(GILIF) ont, quant à eux, engagé une étude afin de recenser la faune
lépidoptérique du site du Bajolet. Celui-ci abrite de nombreuses espèces
protégées à l’échelon régional ; pour certaines d’entre elles, ce site
représente leur dernière station connue en Île-de-France. L’association compte
se fonder sur ces études pour s’opposer à l’exploitation des carrières d’argile
que le site recouvre.
Pour autant, l’entomologiste n’a pas vocation à "mettre sous cloche" tous les
rubans de verdure sur lesquels il travaille. Son rôle consiste aussi à
conseiller les propriétaires pour qu’ils conservent davantage la biodiversité de
leurs espaces. En 2006, Gérard Luquet a par exemple rendu un avis sur la
transformation d’une prairie de Gif-sur-Yvette en pâture destinée aux chevaux. "Nous
n’avons pas déconseillé cette entreprise, nous avons formulé des recommandations
pour limiter les pertes de faune : éviter les charges trop importantes en
bétail, maintenir les haies et les végétaux autochtones en place, conserver des
îlots de broussailles et, surtout,surveiller l’usage des helminthicides
(traitements contre les vers intestinaux)." En effet, ces substances
médicamenteuses se retrouvent dans les défécations équines dont se nourrissent
les insectes coprophages. Ceux-ci s’empoisonnent, victimes de la très forte
toxicité des helminthicides vis-à-vis des insectes.
  L’entomologiste du Muséum a également participé à la rédaction de la Charte de
l’Environnement. Celle-ci s’adresse aux responsables de communes franciliennes,
afin de les guider vers une gestion plus écologique. En les incitant, par
exemple, à planter des érables ou des chênes plutôt que des platanes d’origine
asiatique ; des genévriers (autochtones en plaine) et non d’autres résineux
(originaires des montagnes). Globalement, la prise de conscience est indéniable.
Mais l’équilibre entre préservation des milieux naturels et développement du
tissu socio-économique demeure un exercice difficile. En somme, un travail de
développement durable. L’entomologiste du Muséum a également participé à la rédaction de la Charte de
l’Environnement. Celle-ci s’adresse aux responsables de communes franciliennes,
afin de les guider vers une gestion plus écologique. En les incitant, par
exemple, à planter des érables ou des chênes plutôt que des platanes d’origine
asiatique ; des genévriers (autochtones en plaine) et non d’autres résineux
(originaires des montagnes). Globalement, la prise de conscience est indéniable.
Mais l’équilibre entre préservation des milieux naturels et développement du
tissu socio-économique demeure un exercice difficile. En somme, un travail de
développement durable.
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus ; ordre des coléoptères). La gestion
forestière, en éliminant les vieux arbres et le bois mort, élimine à la fois son
habitat et sa nourriture. Aussi, comme la plupart des coléoptères mangeant du
bois, il est en forte régression dans nos forêts et tend globalement à se
raréfier. C'est pourquoi il est protégé au niveau européen.
Les pelouses calcaires du Sud de l’Essonne ont été retenues
pour faire partie du réseau Natura 2000. Elles hébergent en effet des espèces
comme le coléoptère lucane cerf-volant et le papillon écaille chinée, classées
d’intérêt européen. Ce classement garantit la conservation du site dans son état
actuel.
Des milliers d'insectes rares
en quête d'un nouvel écrin :
 Plus de dix mille spécimens, parmi lesquels des papillons
rarissimes, des araignées géantes, des scorpions de plus de quarante centimètres
et des centaines d'insectes dont certains n'ont jamais pu être répertoriés.
C'est le trésor que cache, pour quelque temps encore, le petit musée éducatif
d'entomologie dirigé par Murielle Mouflard. Une richesse que cette passionnée de
la vie animale partage bénévolement depuis quatre ans avec tous ceux qui en
expriment le souhait. Ses principaux visiteurs étant avant tout les enfants des
écoles du département. Plus de dix mille spécimens, parmi lesquels des papillons
rarissimes, des araignées géantes, des scorpions de plus de quarante centimètres
et des centaines d'insectes dont certains n'ont jamais pu être répertoriés.
C'est le trésor que cache, pour quelque temps encore, le petit musée éducatif
d'entomologie dirigé par Murielle Mouflard. Une richesse que cette passionnée de
la vie animale partage bénévolement depuis quatre ans avec tous ceux qui en
expriment le souhait. Ses principaux visiteurs étant avant tout les enfants des
écoles du département.
Une collection fabuleuse
Tous les ans, Murielle fait ainsi découvrir sa fabuleuse collection à une
trentaine de classes. C'est toujours elle qui dirige la visite, renseigne,
explique et répond aux questions des enfants. Pour découvrir son musée il suffit
de l'appeler et de prendre rendez-vous. La visite est gratuite. Car à lui seul
cet exercice, qu'elle maîtrise désormais parfaitement, la comble de bonheur.
Mais hélas son activité est sérieusement compromise depuis que la propriétaire
des murs, contrainte par des raisons économiques, a demandé à Murielle de
libérer cet espace d'une centaine de mètres carrés en vue de le louer.
Mais hélas son activité est sérieusement compromise depuis que la propriétaire
des murs, contrainte par des raisons économiques, a demandé à Murielle de
libérer cet espace d'une centaine de mètres carrés en vue de le louer.
« Les deux subventions d'un total de 1200e que m'octroient la commune et le
département, couvrent à peine les frais de fonctionnement et d'entretien,
déplore Murielle. Ne pouvant payer ce loyer, je vais donc devoir partir et
stocker toute la collection dans mon garage. »
Tous
les ans, Murielle fait ainsi découvrir sa fabuleuse collection à une trentaine
de classes. C'est toujours elle qui dirige la visite, renseigne, explique et
répond aux questions des enfants. Pour découvrir son musée il suffit de
l'appeler et de prendre rendez-vous. La visite est gratuite. Car à lui seul cet
exercice, qu'elle maîtrise désormais parfaitement, la comble de bonheur.
Une perspective que la conservatrice envisage en désespoir de cause.
« Je suis prête à léguer ma collection à la commune
qui me proposera un local et m'acceptera comme conservatrice bénévole »,
annonce-t-elle depuis plusieurs jours à qui veut l'entendre.
Et d'ajouter : « On m'a proposé de me racheter une partie de la collection.
Mais ce sont mes bêtes. Et je préférerai encore les brûler plutôt que de les
vendre. »
Si ça, ce n'est pas de la passion...
Un berger contre le criquet
hérisson :
"Et les 200 000 obus tirés par les militaires à Canjuers,
ils ne le dérangent pas, eux, le criquet hérisson ?" peste sans
retenue le
berger de Bauduen, dans le haut Var, contre le président de l'Association pour
la protection des lacs et cites du Verdon, qui, pour bloquer le permis de
construire de sa future bergerie, invoque la présence sur place d'une espèce
rare : le criquet hérisson, ou Prionotropis hystrix azami, un orthoptère
protégé par un arrêté ministériel de 2007 . ...........
(La totalité de l'article dans le JDD du dimanche 27/VII/2008)
A l'écoute de la biodiversité
:
Pour explorer la Nature, certains ont l'œil. L'équipe menée
par l'entomologiste Alain Sueur, du MNHN, préfère tendre l'oreille ! Jusqu'ici,
pour connaître l'état de la biodiversité d'un territoire, il fallait passer par
son inventaire : la collecte et le piégeage des différentes espèces, puis leur
identification; une somme de travail, parfois indispensable, mais coûteuse en
temps et en argent. "Nous proposons une autre approche, rapide, peu onéreuse
et, surtout, non invasive, avance J. Sueur.
Accessible avec un micro, un bon enregistreur et un simple logiciel,
téléchargeable gratuitement. Le principe est simple : une partie des
animaux se manifestent par leur production sonore; les oiseaux chantent, les
mammifères crient, les amphibiens coassent et les insectes par leurs appels
sexuels très variés; un enregistrement de cet
environnement sonore global donne une mesure relative, un indice de la
biodiversité ". Plus l'ambiance sonore est complexe et riche en
fréquences différentes, plus le lieu étudié est riche en espèces. L'indice
acoustique obtenu ne permet pas d'identifier les espèces ni même les groupes
d'animaux présents; en revanche, il pourrait s'avérer un support utile à la
gestion et à la protection des milieux "Nous avons testé notre indice dans
2 forêts sèches de Tanzanie, l'une intacte, l'autre dégradée; les résultats sont
très probants". Reste à affiner cet outil en mesurant les sons au cours du temps
(dans la journée, la nuit, à diverses saisons ...) et à différentes hauteurs;
voire dans des rivières ! Une idée qui devrait faire du bruit !
(Dans National Geographic de mars 2009)
Voitures papillon :
Un jour viendra où les constructeurs de voiture proposeront,
comme teinte de carrosserie, une "iridescence papillon" ou un "noir scarabée".
Des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie sont parvenus à imiter la
coloration des insectes basée non pas sur des pigments, mais sur la structure de
la surface. D'où une moindre pollution.
Octobre 2008
Le travail des abeilles est estimé à 153
milliards d'euros :
Une étude de l'INRA et du CNRS a chiffré la
valeur de l'activité de pollinisation des insectes, majoritairement
des abeilles, à 153 milliards d'euros sur les principales cultures
alimentaires de l'homme.
 "La majorité des cultures fruitières,
légumières, oléagineuses et protéagineuses, de fruits à coques,
d'épices et de stimulants (café, cacao), bénéficie de
l'activité pollinisatrice des animaux" expliquent les
chercheurs français et allemands qui ont réalisé l'étude. "La majorité des cultures fruitières,
légumières, oléagineuses et protéagineuses, de fruits à coques,
d'épices et de stimulants (café, cacao), bénéficie de
l'activité pollinisatrice des animaux" expliquent les
chercheurs français et allemands qui ont réalisé l'étude.
35 % de la production mondiale de nourriture est directement
dépendante des pollinisateurs, 60 % provient des cultures comme les
céréales qui ne dépendent pas de ces insectes, et pour 5 %,
l'importance du rôle des pollinisateurs est encore inconnue.
L'étude a calculé la valeur totale du service de
pollinisation des insectes, dont l'estimation a été
réalisée sur la base des prix en vigueur en 2005 : le montant
s'élève à 153 milliards d'euros, soit 9,5% de la
valeur de la production agricole mondiale.
"Les résultats montrent que les équilibres alimentaires mondiaux
seraient profondément modifiés pour trois catégories (les fruits,
les légumes et les stimulants) en cas de disparition totale
des pollinisateurs : la production mondiale ne
suffirait plus à satisfaire les besoins aux niveaux actuels.
Les régions importatrices nettes comme l'Union européenne seraient
plus particulièrement touchées.", expliquent l'INRA et le CNRS.
Le déclin des abeilles et autres insectes pollinisateurs aurait un
impact catastrophique sur l'agriculture mondiale : il diminuerait la
production agricole, et augmenterait les prix de l'alimentation,
aggravant
la crise
alimentaire mondiale qui sévit actuellement.
"Pour évaluer cette perte, les chercheurs ont émis différentes
hypothèses en termes de réaction des prix à une offre agricole
diminuée. Selon ces hypothèses, la perte pour le consommateur serait
comprise entre 190 milliards d'euros (faible réaction des prix) et
310 milliards d'euros (forte réaction des prix)" explique
l'étude. Elle réaffirme l'importance de la préservation des abeilles,
dont des
colonies
entières sont décimées de façon très inquiétante,
notamment par les
pesticides
utilisés dans l'agriculture.
Lundi 22 septembre 2008
 Les "curiosités" de NKM : Les "curiosités" de NKM :
Elle
appelle ça son "cabinet de curiosités", Nathalie Koscinsko-Morizet, secrétaire
d'Etat à l'Ecologie, a transformé le bureau qu'elle occupe à l'hôtel de
Roquelaure en "show-room" du Muséum National d'Histoire Naturelle. Cet été
(2008), elle a en effet fait venir plusieurs pièces qui croupissaient dans les
coulisses du muséum. Entre autres raretés exposées derrière les portes vitrées
de la pittoresque bibliothèque, à côté du portrait du chef de l'Etat : un ibis
rouge empaillé, des crânes d'hommes de Cro-Magnon et de Neandertal, des
grenouilles dans un bocal de formol, l'énorme patte d'un allosaure ou un
cadre contenant des espèces de charançons ...
(ndms : sur la photo, c'est un cadre de Papillio ulysses que l'on
aperçoit ...).
Et même, bien en vue sur son bureau, la pointe d'une flèche extraite de la
défense d'un éléphanteau : Avis à ces rivaux !! Manière pour la secrétaire
adjointe de l'UMP, qui roule dans une petite 308 écologique et s'éclaire aux
ampoules basse tension, de valoriser la biodiversité.
Amateur de libellule :
"Cette libellule est la première espèce que je décris"
Laurent Juillerat en est encore tout ému. Toute nouvelle espèce qu'il soit, ce
mâle Neoneura angelensis ne présente pourtant rien de très spécial ...
tout comme la majorité des millions d'insectes des forêts tropicales qui restent
à identifier (ndms : si on fout un peu la paix aux entomologistes qui veulent
chasser avant études !!). Sauf que notre découvreur est un taxonomiste amateur.
"Mon but n'est pas de collectionner des spécimens, mais de faire de la
recherche sur la faune", précise Laurent Juillerat.
Car, pour lui, comme pour tout taxonomiste, amateur ou
non, mettre en lumière une espèce inconnue constitue l'aboutissement d'une
passion. La taxonomie, qui décrit le vivant
et établit la classification des espèces, est d'ailleurs la seule science, avec
l'Astronomie, pratiquée très largement par des non-professionnels éclairés. Ils
ont décrit plus de la moitié des nouvelles espèces européennes ces dernières
années - notamment chez les mollusques et les insectes. "Les entomologistes
amateurs ont un rôle très important dans la description du vivant" note
Jean-Yves Rasplus, un ancien taxonomiste amateur devenu entomologiste à l'INRA.
"Ils investissent beaucoup dans les recherches qu'ils développent, et
produisent, pour certains, des travaux de haute qualité dans le domaine de la
systématique descriptive". L'apparition de nouvelles méthodes
d'investigation (moléculaire, micro-anatomique ....) au cours de la
dernière décennie a rendu plus difficile pour les amateurs d'explorer le vivant
de la même manière que les professionnels. Leur apport reste cependant très
précieux pour sa connaissance. Une chance, car les amateurs de libellules ne
sont pas près de baisser leur filet.
(Cette très intéressante chronique est dans le dernier
National Geographic : achetez-le !)
Beaucoup plus d'espèces qu'on ne le croit :
(et, en particulier, que ne le croient nos collègues américains)
Une girafe masai mâle, avec des taches irrégulières,
peut-elle s'accoupler avec une femelle réticulée aux motifs ronds ? Dans les
zoos, peut-être, mais pas dans une savane d'Afrique de l'Ouest; des études
génétiques suggèrent une explication : au lieu d'une
seule espèce de girafe, comme on le pensait, il pourrait en exister au moins 6 !
Pour la reproduction, les girafes s'en tiennent à leurs semblables - un signe de
spéciation - sans doute en observant les dessins du pelage. Il faudra
des années pour que la classification change...
La "Fourmi de Mars" se
cachait en Amazonie :
Complètement aveugle, plutôt pâle, avec d'imposantes
mandibules au-dessus de la tête, une étrange fourmi adaptée à la vie souterraine
a été dénichée au Brésil, dans la forêt amazonienne, par des entomologistes
américains et allemands; ce qui lui a valu le nom de "fourmi de Mars" ou
Martialis heureka. Ne ressemblant à aucune autre lignée, elle a été classée
dans une nouvelle Sous-Famille. L'analyse de son ADN indique que cette lignée
serait vieille d'environ 120 millions d'années.
Le rêve !
You may well ask “Just what the heck is a weevil person doing writing an article
in
Scarabs?”
Well, this past summer I had the opportunity to visit the southern state of
Chiapas, México and on one fine sunny day high in the mountains I experienced
what can only be described as the scarab collector’s wet dream! Let me tell you
about it. For a number of years I have been working in Chiapas in collaboration
with ECOSUR, a small college located in San Cristobal de las Casas in the Altos
of Chiapas. My project has been surveying the leaf litter inhabiting weevils of
mid and high elevation forests. We’ve been fortunate to visit and sample
numerous forests, some only small fragments, and many otherwise inaccessible
unless one has proper permission from the indigenous inhabitants. Often this
requires meetings with officials from the local ejido, then a town meeting to
approve permission. But enough of logistics, let’s get to the real story!One
area we have worked is the La Sepultura Biosphere Reserve, located about 25
kilometers southwest of the town of Villaflores in the Sierra Madre de Chiapas
of western Chiapas. We work out of a small town named Sierra Morena at about
1,200 meters elevation. Sierra Morena sits in a valley between two higher
mountains, Cerro Bola to the south and Tres Picos to the north.
 Cerro Bola
(16º.13464 N 93º.60077 W) is just under 2,000 meters and is a nice sharp peak
with a definite summit. Leaf litter faunas change as one moves up in elevation
so this one day, June 14, we thought it worthwhile to spend the 3 hours to walk
up to the peak and take some samples, which we suspected would be quite
different from the samples from between 1,400 meters and 1,600 meters we had
previously taken. The day was sunny and the rains had not yet arrived so things
were quite dry. Quite a few trees had not leafed out and the litter was dry and
sandy. When we arrived at the peak we noticed that the litter here was moister,
perhaps due to clouds collecting at the summit and depositing moisture in the
form of mist or light rain. Within a few minutes of our arrival my keen coleopterological eye spotted a large green beetle on a leaf about 10 feet up in
one of the taller trees right at the peak. I asked one of my much younger, spry
and lighter colleagues if he could climb up that tree and fetch me that beetle.
“Sure” he said and promptly scaled the trunk. As he reached out for the beetle
he commented “There’s another one over there” and pointed to another, clearly
visible on another leaf. He then noted as he scanned the upper foliage of the
tree that “there are quite a few of these up here.” I approached him and peered
up to get a better look. Sure enough I could now see about 10 or more beetles
clinging to the branches and leaves of the tree. “Why don’t I just shake the
tree and they should fall down?” he asked. I agreed that this seemed a suitable
arrangement, so he shook the tree. At this point I must suggest that the true
scarab enthusiast find a comfortable seat, sit down, close your eyes, relax and
try to imagine this scenario. Picture the tree shaking and the large, bright
green beetles falling. First one or two, then 10, 20… then a hundred, then
hundreds. It was literally raining
Chrysina!! Cerro Bola
(16º.13464 N 93º.60077 W) is just under 2,000 meters and is a nice sharp peak
with a definite summit. Leaf litter faunas change as one moves up in elevation
so this one day, June 14, we thought it worthwhile to spend the 3 hours to walk
up to the peak and take some samples, which we suspected would be quite
different from the samples from between 1,400 meters and 1,600 meters we had
previously taken. The day was sunny and the rains had not yet arrived so things
were quite dry. Quite a few trees had not leafed out and the litter was dry and
sandy. When we arrived at the peak we noticed that the litter here was moister,
perhaps due to clouds collecting at the summit and depositing moisture in the
form of mist or light rain. Within a few minutes of our arrival my keen coleopterological eye spotted a large green beetle on a leaf about 10 feet up in
one of the taller trees right at the peak. I asked one of my much younger, spry
and lighter colleagues if he could climb up that tree and fetch me that beetle.
“Sure” he said and promptly scaled the trunk. As he reached out for the beetle
he commented “There’s another one over there” and pointed to another, clearly
visible on another leaf. He then noted as he scanned the upper foliage of the
tree that “there are quite a few of these up here.” I approached him and peered
up to get a better look. Sure enough I could now see about 10 or more beetles
clinging to the branches and leaves of the tree. “Why don’t I just shake the
tree and they should fall down?” he asked. I agreed that this seemed a suitable
arrangement, so he shook the tree. At this point I must suggest that the true
scarab enthusiast find a comfortable seat, sit down, close your eyes, relax and
try to imagine this scenario. Picture the tree shaking and the large, bright
green beetles falling. First one or two, then 10, 20… then a hundred, then
hundreds. It was literally raining
Chrysina!!
As
they fell, some took wing, some hit the ground and stayed there, some ended up
on my clothes and on me, some fell onto lower vegetation. Then a few seconds
later, as if on some magical cue they all started to fly. At first I grabbed a
few from my clothes but soon my hands were full and being a weevil guy, my
biggest vial would only hold half a hind leg of one of these easts, so employing
my quick PhD-given thinking skills, I decided to use one of the pillow cases
that I use for bagging the leaf litter samples downhill. Stuffing the ones on my
hands into the bag, I collected about 20 or so more on my body and then started
picking them off the lower vegetation and ground. In all I must have grabbed
about75 specimens in about 5 minutes of frenzied collecting! For every one I
got, five flew away. Not to mention that the tarsal claws on these guys were
like fine needles, easily piercing the skin and drawing blood when one pulled
them off your arm or hand. But when one sees hundreds of
Chrysina
within arm’s length, pain is not a factor, right ? By now the reader will be
breathing heavily and in need of a cool drink, perhaps if one is of advanced
years, even a sedative or a nap. So, let me sum up. Benigno Gómez of México has
confirmed the species as
Chrysina triumphalis
Morón. At the present time, all specimens are still in Mexico. The beetles were
not mating and did not appear tobe feeding on the tree. I think it’s significant
that this was at the end of the dry season and perhaps the beetles had
congregated in a moister area to await the onset of rains. Even for a weevil
guy, this was a very exciting day, but I can only imagine the range of raw
emotions racing through the minds of you scarab collectors at this climactic
moment. I think it’s significant that this was at the end of the dry season and
perhaps the beetles had congregated in a moister area to await the onset of
rains. Even for a weevil guy, this was a very exciting day, but I can only
imagine the range of raw emotions racing through the minds of you scarab
collectors at this climactic moment.
(Dans
l'excellente revue Scarab's de nos collègues américains)
 La pollinisation des insectes
rapporte gros : La pollinisation des insectes
rapporte gros :
153
milliards d'euros par an, soit 9,5 % de la valeur de la production
agricole mondiale, c'est la valeur de l'activité pollinisatrice des insectes !
En s'appuyant sur le cours marchand des cultures et sur des calculs de
dépendance vis-à-vis des pollinisateurs, Bernard Vaissière (INRA) estime à 100
milliards d'euros l'impact des pollinisateurs sur la production de fruits et
légumes et 39 milliards sur celle des oléagineux. Les 14 milliards restants
concernent le café, le cacao ou encore les épices.
Sauvons les abeilles !!
Un indien dans la ville
(pas Mimi Siku, un vrai !) :
 Lorsqu'il reprendra l'avion pour retourner dans son village
natal, au fin fond de l'Amazonie, Benki Pyanko n'aura qu'un seul regret : ne pas
avoir pu se baigner dans la Seine. "C'est fou comme les berges de votre fleuve
sont bétonnées" constate-t-il amèrement. Quand les touristes du monde entier
s'émerveillent devant la beauté et la grandeur de la Tour Eiffel, lui ne retient
de la Ville Lumière que son bruit infernal et son air vicié. "Lorsqu'on arrive à
Paris, c'est un véritable choc" confie l'indien ashaninka, viscéralement attaché
à sa terre et à son mode de vie. Lorsqu'il reprendra l'avion pour retourner dans son village
natal, au fin fond de l'Amazonie, Benki Pyanko n'aura qu'un seul regret : ne pas
avoir pu se baigner dans la Seine. "C'est fou comme les berges de votre fleuve
sont bétonnées" constate-t-il amèrement. Quand les touristes du monde entier
s'émerveillent devant la beauté et la grandeur de la Tour Eiffel, lui ne retient
de la Ville Lumière que son bruit infernal et son air vicié. "Lorsqu'on arrive à
Paris, c'est un véritable choc" confie l'indien ashaninka, viscéralement attaché
à sa terre et à son mode de vie.
Leader d'une communauté indigène descendant des Incas (ndms : c'est la
communauté dont Jéromine Pasteur a partagé la vie ...), il lutte depuis de
nombreuses années contre la déforestation qui menace chaque jour la survie de
son peuple. A l'occasion du Festival international du film d'environnement,
l'agence régionale Natureparif l'a invité à témoigner de son combat contre les
tronçonneuses et pour la sauvegarde de la faune et de la flore locales. Pour
stopper la pression des exploitants forestiers autour de leur village, situé à
l'est du Pérou, les Ashaninkas ont tout fait pour mobiliser la communauté
internationale. Ils ont finalement réussi à obtenir du gouvernement, il y a 10
ans, la protection de leurs terres amazoniennes.
Soutenus par diverses associations, ils ont su utiliser les technologies
nouvelles pour faire parler d'eux dans le monde. Grâce à l'installation d'une
antenne de connexion Internet haut débit, les villageois ont pu dialoguer avec
des ONG et avertir en temps réel les autorités régionales lorsque des
exploitants illégaux de bois ont investi leur territoire. "35 ans après que nos
terres eurent obtenu leur statut de réserve, les invasions de bûcherons se sont
accentuées" témoigne Benki. Le leader indigène est alors devenu "un agent de
protection de la forêt". Semer, reboiser, veiller
attentivement sur la faune et la flore en danger est son quotidien et sa
priorité. Les villageois ont ainsi réussi à sauver une espèce de tortue pourtant
en voie de disparition, deux espèces de porcs sauvages dont le territoire de
reproduction était menacé, et des abeilles, victimes de la fumée des brûlis
incessants. "Le fait de voir comment les gens vivent en ville ne fait que me
renforcer dans mon combat pour le respect de la forêt, des peuples et de
leurs traditions", souligne Benki, "J'espère que mon village ne sera pas
gagné par un tel degré d'urbanisation et je veux montrer que des alternatives
sont possibles. Connaître votre monde c'est important pour sauver le notre".
C'est une ethnie très attachante, que je connais bien; on peut
les côtoyer facilement quand on va chasser les insectes à l'est de Satipo. M.
Soula
Voir absolument :
www.jerominepasteur.com
Une araignée qui fait la roue
:
L"araignée du genre Cebrennus, découverte récemment au Sahara
(2008), fait la roue en repliant ses 8
pattes autour du corps pour échapper à ses ennemis. Son découvreur, Ingo
Rechenberg, pense s'en inspirer pour créer un véhicule adapté à des missions sur
Mars !
Les abeilles envahissent
Toulouse :
Les abeilles auraient-elles perdu leur sens de l'orientation
? Un essaim a affolé, mardi (12 mai 2009)pendant près d'une heure, les passants
de la place de La Trinité, en plein centre-ville; la centaine d'abeilles avait
élu domicile sur les sacoches d'un vélo stationné sur cette place animée, ce qui
a contraint la police municipale a coupé la circulation. "C'était
impressionnant car elles se sont rapidement regroupées en une 1/2 heure pour
former un énorme tas. L'enlèvement des essaims n'étant plus du ressort des
pompiers, un apiculteur est intervenu pour chasser les bestioles ", raconte
le patron d'un bar voisin. selon les apiculteurs, les essaims en ville sont de
plus en plus fréquents. Frédéric Belfils, apiculteur dans l'agglomération,
pratique la majorité de ses interventions au mois de mai et juin, période où les
ouvrières récoltent le pollen. "Les abeilles
survivent actuellement mieux en ville qu'à la campagne où l'utilisation de
pesticides et de produits phytosanitaires menace leur habitat. Il y a aussi de
plus en plus de citadins qui décident d'élever des ruches sur leur toit, ce qui
les attire. J'interviens régulièrement en centre-ville. Il m'est même arriver
d'enlever un essaim sur la place Wilson !". L'apiculteur a été
une nouvelle fois été appelé hier midi pour procéder à une intervention dans le
centre de l'Union; accroché sur la branche d'un arbre un essaim de 25 000
abeilles a été rapidement maîtrisé par l'apiculteur qui les a guidées à l'aide
d'une balayette dans un carton-ruchette; les abeilles sont ensuite récupérées
par le professionnel qui les incorporera dans ses ruches de production l'an
prochain après les avoir mises en quarantaine pour éviter les maladies.
Bijoux de fantaisies :
 Georges
est allé rendre visite à des membres de la tribu des Sequoia qui vit en bordure
de la rivière Haouarico en Équateur. Les femmes de cette tribu fabriquent de
magnifiques bijoux et pièces d'ornementation
à l'aide de scarabées de l'espèce
Chrysophora chrysochlora, qui appartient à la famille des
Scarabaeidae et
à la sous-famille des Rutelinae. Très communs dans la forêt équatoriale, ces
scarabées possèdent des élytres, ces ailes rigides recouvrant le corps de
l'insecte, qui rutilent de mille reflets métalliques en raison d'un phénomène
d'irisation. Considérées comme de véritables joyaux, ces élytres sont combinées
à diverses graines multicolores récoltées dans la forêt, afin de créer des
colliers, des boucles d'oreilles, voire des casques d'honneur destinés au chef
de la tribu. Georges
est allé rendre visite à des membres de la tribu des Sequoia qui vit en bordure
de la rivière Haouarico en Équateur. Les femmes de cette tribu fabriquent de
magnifiques bijoux et pièces d'ornementation
à l'aide de scarabées de l'espèce
Chrysophora chrysochlora, qui appartient à la famille des
Scarabaeidae et
à la sous-famille des Rutelinae. Très communs dans la forêt équatoriale, ces
scarabées possèdent des élytres, ces ailes rigides recouvrant le corps de
l'insecte, qui rutilent de mille reflets métalliques en raison d'un phénomène
d'irisation. Considérées comme de véritables joyaux, ces élytres sont combinées
à diverses graines multicolores récoltées dans la forêt, afin de créer des
colliers, des boucles d'oreilles, voire des casques d'honneur destinés au chef
de la tribu.

http://photo.net/photodb/
À quoi leur servent les ailes postérieures ?
Deux entomologistes états-uniens, Benjamin Jantzen et Thomas Eisner (de Carnegie
Mellon et de l’université Cornell) se sont posé les premiers cette question et
ont expérimenté. Munis d’une paire de ciseaux, ils ont pratiqué leur ablation
sur des papillons de Bombyx disparate (Lymantria dispar, Lymantriidé -
mâles) et de Piéride de la rave, Pieris rapae (Piéridé). Puis ils les ont
lâchés, ainsi que des individus non modifiés, dans une cage, sous la
surveillance de caméras.
L’analyse des trajets de vol des papillons diptères – à la surface alaire
réduite de pas loin de la moitié – révèle que leur comportement est très peu
modifié : ils effectuent toutes les figures habituelles, un peu moins vite
toutefois ; le rayon minimum de virage est inchangé.
Ils sont toutefois incapables d’un brusque écart, moyen d’échapper à une chauve
souris et, chez les papillons de nuit, les ailes postérieures auraient
essentiellement pour avantage d’autoriser des manœuvres d’esquive.
Dans le cas des papillons de jour, elles augmenteraient la surface d’affichage
de signes et de couleurs aposématiques.
Scorpion contre cancer :
Depuis quelques années, les biologistes
testent la capacité anticancéreuse de la chlorotoxine isolée du poison
de scorpion. des chercheurs de l'Université de Washington ont
découvert qu'ils pouvaient doubler son efficacité à réduire la prolifération des
cellules cancéreuses en lui attachant des nanoparticules d'oxyde de fer. La
réduction atteint 98 % !
Pauvre Afrique ! Des zoos dans
la savane :
Avec le boom démographique,
les réserves animalières d'Afrique, cernées par les agriculteurs et les
éleveurs, ne seront bientôt plus que des zoos. Une étude
menée dans le Parc du Masaï Mara (Kénya; que fait Obama ?!!) par le Fonds
Mondial pour la vie sauvage montre que 95 % des girafes, 80% des phacochères,
76% des antilopes et 67% des impalas ont disparu. Gnous, zèbres et gazelles ne
sont pas mieux lotis, ni même les lions. La solution : freiner l'agriculture et
favoriser l'élevage extensif aux portes du parc.
(Dans Le Point)
PS de M. Soula : et arrêter la
prolifération humaine !!
Insectes ou robots ?


Scorpion, Chrysina beyeri ou robots ??
Voir le très curieux site :
http://www.insectlabstudio.com
Le parc régional Ariège-Pyrénées :
145 communes, 42 000 habitants
Le territoire du PNR s'étend sur 2 500
km2 soit la moitié de la superficie du département. Il concerne 145 communes ;
13 cantons, 3 « pays », 14 communautés de communes. Sa population est de 42 000
habitants, soit 30 % de la population de l'Ariège. Sa densité est de 17
habitants au km2.
L'ensemble du territoire est en zone d'économie montagnarde et 39 communes sont
en zone de haute montagne.
Massat est pratiquement au
centre du Parc !!

Seulement 1 % du territoire en zone urbaines, industrielles ou commercialisées
pour 47 % de forêts dont 39 % de feuillus, essentiellement du hêtre : le parc
mise sur la filière bois et l'énergie bois dans le cadre du Plan Climat.
13 % de pelouses et pâturages d'altitude ; 12,4 % de prairies de piémont ; 10 %
de terres cultivées ; 8 % de roches nues.
13,9 % des actifs travaillent dans le secteur agricole et forestier ; 15,8 %
sont dans le secteur industriel ; 7,9 % sont dans la construction ; 62,3 %
travaillent dans le tertiaire public et privé.
 L'archéoentomologie : L'archéoentomologie :
L’archéoentomologie est issue de
l’entomologie du Quaternaire. Nées toutes deux il y a plus de trente
ans en Angleterre, la plupart des méthodes d’études mises au point en
entomologie du Quaternaire ont été reprises en archéoentomologie.
Schématiquement, les recherches archéoentomologiques telles qu’elles sont
pratiquées actuellement relèvent de deux approches, complémentaires et parfois
combinées.
L’une a pour but principal d’analyser l’impact des
activités humaines sur le paléoenvironnement à travers les
perturbations subies par les faunes d’insectes grâce à l’analyse des successions
d’assemblages d’insectes subfossiles extraits de sédiments de sites naturels,
tels que lacs, tourbières, bras morts de rivières, de préférence situés à
proximité des zones d’anciens habitats. Par ses méthodes de prélèvement sur le
terrain et d’interprétation des données cette démarche est comme on le verra
très voisine de celle suivie lors de recherches paléoclimatiques et
paléoécologiques "classiques" en milieu non anthropisé.
Le deuxième aspect de l’archéoentomologie est peut-être chez nous le moins
connu. Cette approche se propose plutôt d’obtenir des
informations originales sur les divers aspects du mode de vie de nos ancêtres
à partir de la composition des assemblages d’insectes, essentiellement
sinanthropes, contenus dans les sédiments anthropogéniques échantillonnés au
cours de fouilles archéologiques...
Restes d’insectes archéologiques
Scarabées téléguidés :
Longtemps, l'armée américaine a financé des recherches dont
l'objectif était de produire de minuscules drones capables de voler pendant des
heures, de filmer et d'envoyer les images à qui de droit. Mais malgré la
miniaturisation galopante des technologies employées, et le succès commercial
des Picooz, ces robots espions tardaient à quitter l'univers de la
science-fiction pour celui, plus viril, des champs de bataille. Quand soudain
Michel Maharbiz et ses collègues de l'université de Berkeley eurent une idée
géniale : plutôt que de passer leur vie à essayer de construire des robots
scarabées qui filment, pourquoi ne pas téléguider des scarabées sur lesquels on
fixerait des caméras…
Aussitôt dit, aussitôt fait, six électrodes sont posées sur les globes oculaires
et les muscles nécessaires à l'envol de l'animal, un microprocesseur, un
récepteur radio et une batterie sont accrochés sur son dos. Les signaux
électriques envoyés depuis un ordinateur "dirigent" le scarabée : des pulsations
à fréquence oscillatoire actionnent les ailes, une courte pulsation les arrête.
Une petite décharge sur le flanc gauche pour aller à gauche, une à droite pour
tourner à droite. Il s'agit officiellement du premier "wireless beetle system".
Les scarabées choisis mesurent de 4 à 8 cm de long et pèsent de 4 à 10 grammes,
sont particulièrement endurants et peuvent sans mal porter une caméra et même un
détecteur de chaleur…
Des fourmis mangent des
crapauds buffles !
Les fourmis carnivores pourraient stopper la prolifération
des envahissants crapauds buffles en Australie. Face à ses fourmis, des
chercheurs de l'Université de Sydney ont comparé la réaction des grenouilles
australiennes de souche et de crapauds buffles, importés des USA dans les années
1930. Alors que les grenouilles restent à distance, les crapauds laissent les
fourmis les attaquer; et les dévorer !
Science et Vie, Juin 2009
10 jours d'hôpital à cause
d'une araignée :
La morsure d'araignée a provoqué sur le biceps droit de F. ,
59 ans, une nécrose impressionnante. "De 15cm de long, 7cm de largeur et 1cm
de profondeur" décrit le Dr. A.
devenus noirs et a
déclaré "ne jamais avoir vu une telle plaie après une piqûre d'insecte".
Dans un mois, une greffe de peau permettra à la victime de s'en tirer avec
une cicatrice.
La mésaventure de F. a débuté il y a près d'un mois pendant sa sieste (ndlr :
pas la peine d'aller crapahuter en Amazonie !!). "Au moment où je me
tournais pour changer de position, j'ai ressenti une piqûre plus violente que
celle d'un moustique" a t-il expliqué. L'homme déclare une réaction
allergique et son état se détériore rapidement; le lendemain matin, sa femme et
sa fille le découvrent inconscient; il est transporté à l'hôpital où il restera
10 jours !
Quelle araignée a pu piquer F. ? Dans un premier temps, l'insecte
désigné était la Loxosceles reclusa, une araignée violoniste, nom
vernaculaire qui lui a été donné à cause de sa forme et dont la morsure provoque
une nécrose de ce type. Mais aucun individu de cette espèce n'a pour l'instant
été identifié en France; cet insecte vit normalement au Mexique (ndlr :
décidemment, quel pays !) et dans certaines régions du sud des USA. Devant le
nombre d'appels, la Préfecture du Vaucluse a jugé nécessaire de publier un
communiqué pour préciser que "rien ne permet d'affirmer qu'une araignée
d'origine américaine soit responsable des lésions cutanées constatées.
L'accident reste isolé et sans causes précises. "
Rappelons à ce journaliste
d'Aujourd'hui en France que les araignées (8 pattes) ne sont pas des insectes (6
pattes) !!
Scarabée et microfluide :
 Le Stenocora est un petit scarabée (ndlr : en fait,
Stenocara ! Et non pas un Scarabée mais un Tenebrionidae !) squattant les
dunes de Namibie, en bordure de l'Atlantique. Le matin, il se met en posture de
supplication, attendant que l'humidité de l'air se condense sur sa carapace; les
gouttelettes coulent vers sa bouche pour l'abreuver. En examinant la surface des
élytres, des chercheurs britanniques ont noté la présence de minibosses aux
sommets hydrophiles pour capter l'eau de la brume et aux pentes hydrophobes pour
améliorer la glisse des microgouttes. Le Stenocora est un petit scarabée (ndlr : en fait,
Stenocara ! Et non pas un Scarabée mais un Tenebrionidae !) squattant les
dunes de Namibie, en bordure de l'Atlantique. Le matin, il se met en posture de
supplication, attendant que l'humidité de l'air se condense sur sa carapace; les
gouttelettes coulent vers sa bouche pour l'abreuver. En examinant la surface des
élytres, des chercheurs britanniques ont noté la présence de minibosses aux
sommets hydrophiles pour capter l'eau de la brume et aux pentes hydrophobes pour
améliorer la glisse des microgouttes.
En 2006, d'autres scientifiques du MIT ont
réalisé une peau synthétique de même nature qui pourrait servir à fabriquer des
puces microfluides. Il s'agit de boîtiers microscopiques destinés à effectuer
des centaines d'analyses chimiques à l'intérieur même des cellules du corps.
Le Point n° 1922 de juillet 2009
Nabokov entomologiste :
 Vladimir
Nabokov est aussi un distingué lépidoptériste. Dans les années 1940,
il fut chargé de l'organisation de la collection de papillons du
Museum of Comparative Zoology de l'Université Harvard. Ses écrits
dans ce domaine sont très pointus et on lui doit la création de
nombreuses espèces. Comme il était en outre spécialisé dans la peu
spectaculaire sous-famille Polyommatinae des Lycaenidae, cet aspect
de son œuvre et de sa vie a été peu étudié. Vladimir
Nabokov est aussi un distingué lépidoptériste. Dans les années 1940,
il fut chargé de l'organisation de la collection de papillons du
Museum of Comparative Zoology de l'Université Harvard. Ses écrits
dans ce domaine sont très pointus et on lui doit la création de
nombreuses espèces. Comme il était en outre spécialisé dans la peu
spectaculaire sous-famille Polyommatinae des Lycaenidae, cet aspect
de son œuvre et de sa vie a été peu étudié.
Le paléontologue et écrivain Stephen Jay Gould a évoqué, dans un de
ses essais (réunis dans le volume I Have Landed), les papillons de
Nabokov. Il y note que celui-ci était à l'occasion un scientifique
stick-in-the-mud (borné, qui ne veut rien savoir) ; en particulier,
il n'a jamais accepté que la génétique ou le nombre de chromosomes
soient des critères permettant de distinguer les espèces d'insectes.
Gould note aussi que de nombreux supporters de Nabokov ont tenté
d'attribuer une valeur littéraire à ses écrits scientifiques. À
l'inverse, d'autres prétendent que son œuvre scientifique enrichit
son œuvre littéraire. Gould, lui, défend une troisième voie et
accuse les deux précédentes de sophisme. Au lieu de considérer que
l'une des deux facettes du travail de Nabokov a causé ou stimulé
l'autre, il avance que les deux facettes naissent de l'amour de
Nabokov pour le détail, la symétrie et la contemplation.
Tandis que Jünger baissait les yeux sur les armures scintillantes
des coléoptères, Nabokov levait les siens vers les ailes diaprées
des lépidoptères. Pour le reste, les deux cas sont identiques: même
précocité, même acharnement, même compétence, même goût de la
collection. Comme Ernst, son frère jumeau, Vladimir a également
transmué sa passion en œuvre d'art: le chapitre VI d'Autres rivages.
Avec ce ton mi-altier, mi-humoristique qui le distingue de toutes
les autres créatures vivantes, il se souvient du premier papillon
qui croisa sa route, lorsqu'il avait sept ans.
Dès lors, les chasses solitaires dans la propriété campagnarde de
ses parents s'accompagnent de lectures immenses. A neuf ans, il
connaît par cœur les papillons européens. A onze ans, le monde
entier est son jardin; il dévore les périodiques publiés dans
plusieurs langues; et il commence à harceler les plus grands
entomologistes vivants avec de prétendues découvertes d'espèces
nouvelles (les dits savants répliquant à leur collègue en culotte
courte que ses «trouvailles» sont répertoriées depuis longtemps...).
La Révolution bolchevique n'est pas un événement suffisant pour
tempérer son enthousiasme. En mars 1918, au bord de la mer Noire,
Nabokov est soupçonné d'avoir adressé des messages à un navire
britannique avec son filet... Il réussit tout de même à émigrer et
attrape des proies aériennes des Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux
Alpes-Maritimes. Son arrivée aux Etats-Unis en 1940 marque une nette
aggravation de son idée fixe: il va passer les vingt étés suivants à
sillonner son pays d'adoption, et en particulier les montagnes
Rocheuses, avec femme et enfant.
Cette période est extrêmement fructueuse, puisqu'elle lui permet de
rejoindre Jünger dans les encyclopédies spécialisées grâce à une
espèce inconnue attrapée dans l'Utah et baptisée Eupithecia nabokovi.
Les lépidoptères menacent même de l'emporter sur la littérature.
Dans les années 1940, Nabokov classifie les collections de
l'université de Harvard, étudie au microscope les organes génitaux
d'innombrables spécimens, multiplie les publications scientifiques.
Bien qu'il ne possède aucun diplôme, il se situe désormais à
mi-chemin entre l'amateur éclairé et le savant professionnel. Ses
travaux font autorité en ce qui concerne les Lycénidés, famille de
rhopalocères (papillons de jour) qui rassemble des espèces telles
que les azurés et les cuivrés. «Ces années passées au musée de
Harvard, confiera-t-il plus tard, ont été les plus délicieuses et
les plus excitantes de toute ma vie d'adulte.»
Heureusement pour nous, il finira par revenir au roman, sans pour
autant renoncer à son «petit monde». Dans Pnine, il décrit le vol
d'un Lycæides melissa samuelis, l'un de ses plus chers compagnons.
Ses pérégrinations entomologiques à travers l'Amérique nous valent
les paysages immenses et les motels grotesques de Lolita. Et pas
besoin d'être sorcier pour deviner d'où vient la nymphette qui
volète jusqu'au filet d'Humbert Humbert.
A Montreux :
Et puis, il y a les papillons... Nabokov, on le sait était un
lépidoptériste de haut vol, qui travaillait alors d'arrache-pied à
un ouvrage de taxinomie (qui ne verra finalement jamais le jour).
Souvent, de bon matin, les clients du Montreux Palace voient donc
passer dans le hall un solide gaillard en élégant short beige,
grosses chaussures de montagne aux pieds, filet à papillons en
main... Il saute dans un tortillard et monte jusqu'aux Rochers-de-Naye,
ou au Château-d'Oex, qui inspirera la très explicite station suisse
de Sex dans L'Original de Laura. Si besoin est, il emprunte aussi le
téléphérique : "Je trouve que glisser au soleil du matin de la
vallée jusqu'à la limite des arbres dans ce siège magique, et
considérer d'en haut ma propre ombre - avec un filet à papillons
fantôme tenu dans un poing fantôme - dont le profil assis glisse
doucement sur la pente fleurie en contrebas, au milieu de la danse
des nacrés et du volettement des damiers, tient de l'enchantement et
du rêve", écrira-t-il dans Ada ou l'Ardeur. "Au retour de ses
promenades, il s'arrêtait parfois pour montrer, très fier, un beau
spécimen au barman", raconte aujourd'hui Gisèle Sommer, assistante
exécutive du Montreux Palace.
Le Nabokov code :
 Si
vous passez vos vacances du côté de Saint-Pétersbourg, auriez-vous
l’amabilité de faire un détour par la rue Bolchaya Morskaya, et une
halte au musée Nabokov, avant de poster un commentaire pour
l’édification des fidèles de "La République des livres" ? Juste pour
nous éclairer ce que la passion de Vladimir Nabokov pour les
insectes écailleux pouvait nous dire de l’écrivain. Un vrai mystère
pour les admirateurs (je suis de l’immense secte) de Lolita, La
Défense Loujine, Ada, Brisure à senestre sans oublier bien sûr Le
Don qui a achevé de lui donner sa stature de "classique moderne") Il
avait attrapé son premier papillon à 7 ans (il y a cent ans
exactement) et écrit son premier poème à 14 ans. Dès lors, il ne
cessa de pratiquer ces deux activités en parallèle. L’exposition qui
se tient actuellement à Saint-Pétersbourg a pour but de réconcilier
les deux Nabokov, l’artiste et le scientifique, et de donner la clef
du rapport entre création littéraire et chasse aux papillons.
D’ailleurs, elle s’intitule "Le code Nabokov" Si
vous passez vos vacances du côté de Saint-Pétersbourg, auriez-vous
l’amabilité de faire un détour par la rue Bolchaya Morskaya, et une
halte au musée Nabokov, avant de poster un commentaire pour
l’édification des fidèles de "La République des livres" ? Juste pour
nous éclairer ce que la passion de Vladimir Nabokov pour les
insectes écailleux pouvait nous dire de l’écrivain. Un vrai mystère
pour les admirateurs (je suis de l’immense secte) de Lolita, La
Défense Loujine, Ada, Brisure à senestre sans oublier bien sûr Le
Don qui a achevé de lui donner sa stature de "classique moderne") Il
avait attrapé son premier papillon à 7 ans (il y a cent ans
exactement) et écrit son premier poème à 14 ans. Dès lors, il ne
cessa de pratiquer ces deux activités en parallèle. L’exposition qui
se tient actuellement à Saint-Pétersbourg a pour but de réconcilier
les deux Nabokov, l’artiste et le scientifique, et de donner la clef
du rapport entre création littéraire et chasse aux papillons.
D’ailleurs, elle s’intitule "Le code Nabokov"
Nabokov s’était abîmé les yeux à force de passer des heures à son
microscope à étudier les lépidoptères avec toute la rigueur
scientifique requise. Après huit années de pratique intensive
après-guerre au Musée de zoologie comparée de l’Université de
Harvard, à examiner la structure des organes génitaux mâles, il n’y
voyait plus clair et du cesser les recherches qu’il avait menées
avec succès sur les lycénidés, puis sur les "bleus", l’une des
sous-familles des nords-américains. D’après son biographe Brian
Boyd, la Société entomologique de Cambridge le snobait ; il est vrai
que ce n’était pas un professionnel, qu’il ne vivait pas de ça et
qu’il n’avait pas reçu de formation universitaire ad hoc ; n’empêche
qu’il était devenu en parfait autodidacte un spécialiste mondial des
rhopalocères (à l’exclusion des phalènes), ses articles
scientifiques et ses communications en témoignent. Mais il n’en
conserva pas moins un souvenir ébloui de ses expériences et demeura
jusqu’à ses derniers jours un entomologiste dans l’âme et un
collectionneur. Cela n’a pas empêché certains thésards de n’y voir
qu’une affectation, une sorte de "pose littéraire" destinée à
adoucir son image.
C’est pour balayer cette rumeur que Dmitry Sokolenko, un
microbiologiste de 29 ans, a monté cette exposition. Outre les
papillons de la collection de l’écrivain, elle est constituée de
citations tirées de ses livres et surtout de photographies prises au
microscope. En donnant à voir ce que Nabokov a vu pendant des
années, le commissaire de l’exposition voudrait entériner l’idée que
la méticulosité du prosateur, dont la qualité de la langue était
l’une des plus riches et des plus précises tant en russe qu’en
anglais, est intrinsèquement liée à la méticulosité du chercheur.
Difficile en effet d’imaginer que sa passion du détail telle qu’elle
se révèle dans Feu pâle ou dans Pnine pour ne citer que ceux-là,
soit étrangère à ses jours et ses nuits passés, parfois sans
discontinuer, au-dessus du dépoli sous l’oeil du microscope. Ne
disait-il pas, avec la malice et le goût de la provocation dont il
était coutumier, que " les crochets miniatures d’un papillon mâle ne
sont rien comparés aux serres d’aigle de la littérature qui me
déchirent jour et nuit".
Photos courtesy of the Estate of Vladimir Nabokov et Philip Halsman)
La chenille qui grignote la
forêt méditerranéenne (été 2009) :
Les scientifiques sont inquiets; depuis le fin de l'hiver, 3000 ha de forêt dans
le Massif des Maures (Var) et 1000 ha en Corse du sud ont été décimés par le
bombyx disparate (Lymantria dispar), un papillon dont la chenille
est très vorace. Un avis a été transmis à la préfecture de région pour informer
les randonneurs de cette invasion particulièrement dévastatrice cette année.
Signalé sur les hauteurs de Marseille, dans le Luberon, au pied du Ventoux, en
Corse et, surtout, dans l'immense massif forestier des Maures, la chenille fait
des ravages; elle se nourrit des feuilles de chênes-lièges, chênes pubescents et
arbousier. A La Môle, près ce St. Tropez, des parties de forêt sont complètement
rongées. Les chênes-lièges étaient déjà mal en point à cause de la sécheresse;
là, ils résistent très mal et sont littéralement dévorés; ce phénomène fait
pourtant partie d'un cycle naturel, même si la prolifération est impressionnante
cette année; on retrouve des paysages comme en hiver : arbres nuls et sols non
protégés.
Actuellement, l'imago sort de sa chrysalide et beaucoup de pontes sont en cours.
dans certains villages de l'arrière-pays provençal, l'insecte s'est même
installé dans les parc et les jardins, ce qui ne manque pas d'inquiéter la
population au vu des dégâts provoqués. Mais le bombyx
n'est absolument pas urticant; il suffit, avec un gant, de frotter l'écorce de
l'arbre où se nichent les pontes; elles sont visibles et ressemblent à des
mini-éponges de couleur écrue; inutile d'utiliser des produits chimiques; cela
détruirait l'écosystème environnant.
Pour l'heure aucun remède naturel n'existe, mais une campagne pourrait être
lancée si le dépérissement des arbres se poursuivait; la préfecture de région a
été alertée par le ministère de l'Agriculture sur le caractère non dangereux du
bombyx : "il faut rappeler que ces papillons sont sans
danger sur la santé des personnes; mais les randonneurs vont devoir s'habituer à
eux, car il risque d'être encore plus nombreux l'année prochaine"
pensent les forestiers.



 Papillons et écrans télé : Papillons et écrans télé :
Les ailes de papillons de la famille des Morphos, aux
couleurs éclatantes, n'utilisent pourtant aucun pigment; l'effet coloré est
obtenu grâce à des micro-écailles qui décomposent et diffractent le lumière (ndlr
: couleurs physiques et non chimiques !). Le français Serge Berthier, de Paris
VII, a longtemps étudié ce phénomène, donnant l'idée à la société californienne
Qual-comm de l'utiliser pour réaliser des écrans plats (ndlr : je croyais, qu'en
France, on avait des idées !!!). Le procédé, baptisé Interferometric Modulatin (Imod)
est composé de dizaine de milliers de microscopiques doubles miroirs commandés
électriquement pour émettre de la couleur; une technologie très économe. Une
usine de Taïwan a commencé la production d'écran Mirasol basés sur l'Imod
destinés aux téléphones portables, consoles de jeux et ordinateurs.
Le frelon asiatique nous
envahit !

Voir :
http://zebulon1er.free.fr/Frelon.htm
et cette excellente enquête :
http://www.inra.fr/opie-insectes/pdf/i143villemant-haxaire-streito.pdf
Ce ne sont pas les libellules !
La quasi-abscence de moustiques en Camargue cet été n'est pas
due à un lâcher de libellules, comme une rumeur le prétend ! Selon Gaël Hemery,
du parc naturel régional, qui s'amuse de cette bêtise, les moustiques ont été
victimes de la sécheresse estivale. Quant aux libellules, elles ont proliféré
grâce aux fortes pluies printanières.
Privé d'antennes :
Pour remplacer les insecticides, le biologiste britannique,
Antony Hooper propose de détruire l'odorat des insectes nuisibles afin de les
rendre incapables de repérer les plantes dont ils se nourrissent. Il étudie déjà
une molécule pouvant saturer les récepteurs des antennes qui servent de nez aux
insectes.
On va l'essayer !
Chaque fois qu'ils accueillaient des patients mordus par la
Banana Spider, baptisée ainsi parce que cette grosse araignée se cache dans les
régimes de bananes, les urgentistes brésiliens constataient que les hommes qui
se tordaient de douleur sur les brancards bandaient tous comme des ânes. Un
détail qui a intrigué le Dr. Romulo Leite; ce toxicologue brésilien, en poste à
la faculté de médecine de Géorgie (USA), a eu l'idée d'utiliser le venin de
l'araignée pour fabriquer un Viagra naturel; une fois identifiée, la toxine
érectile, de son petit nom Dubbed Txa-6, a été inoculée avec un effet boeuf
(c'est le cas de le dire !) sur des rats mâles. La substance pourrait être
encore plus efficace que le Viagra, parce qu'elle enclanche directement dans le
cerveau la clé de contact de l'érection; les neurones ordonnent illico la
libération d'oxyde nitrique, une molécule qui fait grimper en flèche la pression
sanguine et, par un jeu de domino, fait enfler le pénis !
 Le
froid, connais pas : Le
froid, connais pas :
Le ténébrion rugueux (Upis ceramboides)
est un coléo d'Alaska n'ayant froid ni aux yeux ni ailleurs, car il supporte
parfaitement une température de - 60° C sans engelures. c'est qu'une énorme
molécule non protéique, présente dans ses cellules fixe les cristaux de glace
pour les empêcher de grossir.
Le Ténébrion rugueux, Upis ceramboides, Ténébrionidé, vit en Alaska (États-Unis). L’hiver venu, il
cherche un endroit sec et y attend les beaux jours, assez confiant : il survit à
-76°C. Et ce grâce à un antigel d’un type tout à fait original, qui ne contient
que très peu de protéines, à la base des antigels d’insectes connus. La
molécule, un
xylomannane, associe un sucre et un acide gras, qui est le même que
celui de la paroi cellulaire. Elle agirait donc à ce niveau, protégeant le
contenu de la cellule du gel fatal.
Travaux dirigés par Kent Walters de
l’université Notre Dame, à Fairbanks, publiés dans les
PNAS (1er décembre).
Forgotten species : discovering the shimmer of Maathai's Longleg
Jeremy Hance
-
mongabay.com - January 13, 2010
Few species receive less respect and less conservation attention than insects.
This despite the fact that they are some of the most diverse species on the
planet andthey provide a number of essential services to humankind, including
pollination, pest control, production (for example honey and silk), waster
recycling, and indications of habitat health.
Scientists are not only unsure
just how many species of insects are threatened in world; they are equally
uncertain how many insects exist. Currently there are nearly a million insect
species described by science, but millions more likely exist. It's probable that
innumerable insect species have vanished before even being catalogued by
entomologists.
Fortunately, the beautiful emerald dragonfly Maathai's
Longleg Notogomphus maathaiae avoided this fate. Discovered only in 2000
in the forested mountains of Kenya, the dragonfly is named after Nobel Prize
winner Wangari Maathai.
 The typical morning for that time of the year. The sky was clear in the morning
and only becoming cloudy in the afternoon. The day was perfect for collecting
dragonflies, an activity I have been involved in for the last 10 years. Least
did I know that, that day would be most eventful. After 3 hours in the thickets
along streams running down the mountain, I was just about to break off for lunch
when by sheer luck my eyes rested on what appeared a strange dragonfly belonging
to the Clubtail family. The dragonfly was resting in a sunny spot on twigs of a
shrub close to a waterfall of the Rongai River. The single male was patient
enough to allow me a closer glimpse and then with a sweep of my large net, I
caught the male. Especially the bright green sides of the thorax where unusual
and I thought immediately that this might be a new species to science." The typical morning for that time of the year. The sky was clear in the morning
and only becoming cloudy in the afternoon. The day was perfect for collecting
dragonflies, an activity I have been involved in for the last 10 years. Least
did I know that, that day would be most eventful. After 3 hours in the thickets
along streams running down the mountain, I was just about to break off for lunch
when by sheer luck my eyes rested on what appeared a strange dragonfly belonging
to the Clubtail family. The dragonfly was resting in a sunny spot on twigs of a
shrub close to a waterfall of the Rongai River. The single male was patient
enough to allow me a closer glimpse and then with a sweep of my large net, I
caught the male. Especially the bright green sides of the thorax where unusual
and I thought immediately that this might be a new species to science."
Her
thought turned out to be correct: later Clausnitzer discovered a specimen in the
Nairobi Museum, but no one had realized it was an undescribed species.
"Kenya is a well studied country—the discovery of a new species (new to science)
was quite astonishing," Clausnitzer says.
She decided to name the emerald
dragonfly after Kenyan activist and conservationist Wangari Maathai. Founder of
the Greenbelt Movement, Maathai has linked the importance of conserving natural
resources, including forests (such as the dwindling forests where the dragonfly
was found), with poverty alleviation.
Maathai was awarded the Nobel
Peace Prize for her life's work the same year as the new shimmering dragonfly
was discovered.
Like Maathai, dragonflies are environmental guardians
according to Clausnitzer: "With their amphibious habits, dragonflies have proved
to be useful indicators of habitat quality above and below the water surface.
Industrial effluent, agricultural pesticides, siltation, eutrophication and the
clearing of forests in watershed areas affect not only dragonflies, but also our
well-being. Water quality is an important issue for large parts of Kenya, since
the highlands, where most streams and rivers originate are densely populated.
Some species, which where once common in the highlands disappeared already from
large areas due to the changes in water quality."
The dragonfly is listed as
Endangered on the IUCN Red List. Currently, being listed is a rarity for
insects, but Claunitzer says that more will need to be done to save Maathai's
Longleg than simply acknowledging it is imperilled. Clausnitzer recommends
"protection of the remaining forests and reforestation," along with "general
awareness to keep and restore forests in the highlands, especially along
waters."
Complètement con !
Michigan, Etats-Unis - Sean Murphy, employé dans une animalerie, a battu le
record du monde du nombre de blattes siffleuses de Madagascar dans la bouche. Il
a introduit seize blattes vivantes dans sa bouche.
Le record du monde du nombre de
blattes siffleuses de Madagascar
vivantes introduites dans la bouche
était de 11 blattes. Sean
Murphy, employé
dans une animalerie en
a introduit 16, battant ainsi le record précédemment détenu par Travis Messler.
La performance de
Sean Murphy a été filmée dans l'animalerie où il travaille. Il voulait d'abord
ne mettre que 12 blattes dans sa bouche, mais s'est finalement surpris lui-même
à en introduire 16. La blatte
siffleuse de Madagascar est un
insecte qui mesure de
5 à 10 centimètres.
Le Guinness
des Records doit maintenant
homologuer la performance, afin que M. Murphy soit officiellement le recordman.
Il a ajouté que l'année prochaine, il essaiera d'introduire 20 blattes dans sa
bouche.
Les insectes éclairent le monde
Dans le but de ne pas se cogner dans les meubles la nuit, l’usage de
lucioles, coyouyous et autres clindindins, maintenus en captivité, est vieux
comme le monde (le Nouveau Monde précisément). Tout nouveau est le principe de
la veilleuse entomophage.
Une sphère trouée entoure des diodes
électroluminescentes (LED) émettant dans l’ultraviolet, très attirante pour les
phalènes, moucherons et autres maringoins ; elle surmonte un entonnoir qui
débouche dans un réservoir lequel alimente une pile à combustible qui alimente
les diodes - voir l’Épingle Pile
à mouches de 2005.
Le
combustible, on l’a compris, est fourni – après fermentation - gracieusement par
les insectes volants piégés.
Document de l'OPIE
 Des
mouches portant des banderoles !!
Francfort, Allemagne - Lors du
dernier Frankfurt Book Fair qui s'est tenu ce mois-ci en Allemagne,
l'éditeur Eichborn a réussi à se faire remarquer : des centaines de
mouches équipées de banderoles à son
nom ont en effet volé dans tout le bâtiment.
Cette nouveauté marketing est baptisée "fly-vertising". C'est la
première fois que des mouches sont utilisées comme support
promotionnel.
Plus de 200 mouches ont été équipées de petites banderoles depapier attachées
par un fil de cire. Le fil était conçu pour se casser quelques
heures plus tard et décharger ainsi l'insecte. Le poidsde cet
attirail publicitaire était calculé pour que les mouches, fatiguées,
viennent se poser sur les visiteurs du salon et soient ainsi
remarquées.
Pare-brise :
Après une longue route, le
pare-brise de la voiture se retrouve souvent constellé
d'invertébrés écrasés. En grattant ces restes, serait-il possible de
déterminer la biodiversité en insectes des régions traversées grâce
à l'analyse de l'ADN ? Un article du Genome Research répond à cette
question. C'est oui.
Les avancées du séquençage génétique ont atteint de telles capacités
qu’il est possible d’effectuer des analyses à une échelle et une
profondeur encore inenvisageables il y a peu. La métagénomique permet
notamment de séquencer de l’ADN sans préparation, directement à
partir d’échantillons récoltés dans la nature d'une manière
quelconque, voire brutale, par exemple comme des insectes collés sur
un pare-brise.
Traditionnellement utilisée pour l’étude des bactéries, la
métagénomique peut aussi être appliquée pour mesurer la biodiversité
d'organismes complexes. Le directeur de recherche Anton Nekrutenko,
de l’Université de Penn State, et son équipe l'ont brillamment
démontré avec deux voitures.
Mouche à longues pattes (Condylostylus), bientôt en exclusivité sur
un pare-brise ? © Opo Terser CC by
La bouillie d’insectes, c’est excellent !
Ces deux voitures ont effectué deux trajets bien différents, l'une
de la Pennsylvanie au Connecticut et l'autre du Maine à New
Brunswick au Canada. A l'arrivée, les chercheurs ont gratté les
pare-brise des véhicules qui avaient bien sûr accumulé des insectes.
Cette bouillie a été introduite dans le pipeline métagénomique Galaxy développé
pour l’occasion.
Un tel pipeline incorpore toutes les étapes de l’analyse d'ADN,
depuis le traitement des données de séquençage brutes jusqu’à la
conception d’arbres d’évolution. La technique s'est révélée
excellente et des résultats directement exploitables ont pu être
obtenus.
« La métagénomique est encore une "science molle", signale
Nekrutenko, où l’identification précise de l’abondance
des espèces dans des échantillons complexes [contenant de l’ADN de
plusieurs espèces] est un très, très grand défi. » De plus, les
banques de données ADN sont encore pauvres entaxons d’insectes, mais
la baisse des coûts devrait permettre d’étoffer rapidement le
catalogue génomique des espèces. A quand une installation
généralisée dans tous les lavomatiques ?
 Un charançon rarissime découvert dans les cavernes des glacis du Palais Princier
: Un charançon rarissime découvert dans les cavernes des glacis du Palais Princier
:
Un charançon
aveugle du genre
Troglorhynchus a pu être recueilli sous une pierre et identifié
à une espèce décrite en
1895 sur un seul exemplaire trouvé à Nice, conservé au
Muséum d'Histoire naturelle de Paris, et jamais reprise depuis ! "
Articles "récoltés" par l'OPIE
Menace sur un genre nouveau de curculionidé :
G. Alziar informe de la présence d’un charançon du genre
Troglorhynchus (genre
nouveau), dont c’est la seule localité connue, dans une grotte du Paillon qui
serait menacée par une carrière. Il faut rassembler des éléments d’information
sur le projet de carrière (DREAL), sur le foncier et le PLU

http://lesmouches.canalblog.com/
Migration de papillons :
 Sentir des odeurs, évaluer la direction du vent ou repérer des vibrations
sonores : on savait les antennes des papillons –et d’autres insectes- capables
de cela. Surprise : chez les monarques, papillons migrateurs, les antennes
possèdent en plus une horloge circadienne qui joue un rôle crucial dans leur
navigation. Sentir des odeurs, évaluer la direction du vent ou repérer des vibrations
sonores : on savait les antennes des papillons –et d’autres insectes- capables
de cela. Surprise : chez les monarques, papillons migrateurs, les antennes
possèdent en plus une horloge circadienne qui joue un rôle crucial dans leur
navigation.
Privés de leurs antennes, les papillons monarques (Danaus
plexippus) sont déboussolés, ont constaté Steven Reppert et ses collègues
de l’Université du Massachusetts (Worcester, E-U). Ces neurobiologistes savent
qu’au cours de sa migration de plus de 3.000 kilomètres de l’Amérique du Nord
vers le Mexique, le monarque utilise la position du Soleil dans le ciel pour
s’orienter.
Cependant, pour conserver leur cap vers le sud tandis que le
Soleil décrit sa courbe est-ouest, les papillons s’appuient sur leur horloge
circadienne. Ce compteur de l’alternance jour/nuit calé sur un cycle de 24
heures permet de compenser la boussole solaire.
Ayant découvert il y a
quelques années une horloge circadienne dans le système nerveux central du
monarque, l’équipe de Reppert pensait que la correction de la navigation se
faisait dans le cerveau.
Ils ont donc été surpris de constater que,
privés de leurs antennes, les monarques sont désorientés, alors même que
l’horloge circadienne centrale fonctionne normalement. Les chercheurs ont alors
peint les antennes des papillons avec une couleur claire ou foncée. Ceux qui ne
peuvent plus capter la lumière avec leurs antennes dévient leur direction vers
le nord/ nord-ouest, tandis que les autres, avec une peinture claire ou sans
peinture, volent toujours vers le sud, rapportent les chercheurs dans la revue Science publiée
aujourd'hui.
Les papillons monarques possèdent donc une horloge au bout
des antennes, indépendante de celle du système central, qui joue un rôle de
premier plan pour maintenir le cap pour la migration. Le fonctionnement de cette
horloge et ses connections avec le cerveau de l’insecte demeurent mystérieux !
Cécile Dumas
Toutes des salopes !
Si les mâles leur offrent quelques morceaux de
viande, les femelles chimpanzés du Parc National de Taï (CI) acceptent deux fois
plus de s'accoupler !
Homoparentalité :
Un couple de manchots pédés d'un zoo allemand
a couvé un œuf rejeté du nid d'un couple hétéro voisin, puis s'est occupé à
merveille du rejeton !
Mouche ivre :
La mouche à fruit ne refuse jamais un verre
d'alcool; jusqu'à tomber par terre ! Un chercheur de l'Université de Californie
a même observé qu'après un régime sec l'insecte renoue avec l'alcoolisme à la
première goutte. Cette addiction est déterminée par des gènes spécifiques, comme
chez l'homme ! A suivre ...
Madame Muscle :
Au bout des 25 000 épreuves de vol
qu’ils ont fait subir à des imagos de la Mouche du vinaigre, Frank Schnorrer et
son équipe (institut Max-Planck), ont déterminé les 2 000 gènes qui pilotent la
formation de ses muscles alaires. Des muscles qui en font une athlète hors pair,
dans les toutes premières du règne animal : ils développent en effet une
puissance de 100 W par kg (poids vif).
Chez
Homo sapiens,
le coureur du Tour de France égale le culturiste avec un petit 30 W/kg. Ces deux
dernières catégories de musculeux, bien au fait que beaucoup de gènes sont
communs entre eux et le Diptère
Drosophila
melanogaster, espèrent que ces recherches
déboucheront sans tarder sur une amélioration de leurs performances. D’autres y
voient des pistes pour le traitement ciblé de maladies.
Mesdemoiselles, venez donc voir mes estampes
japonaises !

Les
costauds et les couillus :
Les concurrents, de diverses
nationalités, ont subi des mois d’épreuves dans un laboratoire anglais. À la
fin, c’est le Scarabée taureau, un Européen, qui a été déclaré champion du
monde.
Ontophagus taurus (Col. Scarabéidé) est l’insecte le plus fort
de l’Univers. Il peut pousser 1 141 fois son poids vif. Pour faire image, disons
que cela correspond à un humain capable de pousser une file de 6 autobus à
impériale bourrés de passagers.
La rédaction d’Insectes félicite le
vainqueur et rappelle que ce résultat a été obtenu à l’eau pure et à la bouse,
grâce à une prédisposition pour les combats très durs entre mâles.
Toutefois,
cette gloire ne concerne que certains Taureaux. Il en est en effet qui émergent
petits avec des cornes courtes et qui ne poussent personne ; à la dissection, il
apparaît qu’ils ont des testicules nettement plus gros. Les deux formes sont
bien distinctes et correspondent à deux stratégies sexuelles. Les gros aux
grandes cornes, les costauds, défendent l’entrée de la galerie de « leur »
femelle. Les petits, eux, capables de se faufiler, profitent d’un moment de
distraction de leur part pour contribuer, avec prédominance, à la descendance de
Madame.
Les Ontophages ont servi surtout à des études sur l’allocation des
ressources entre organes et sur la sélection sexuelle.
Un peu délirant ...
Adrian
Dyer
trained
bees to
associate
sugary
rewards
with
pictures of
human faces. The
results
seemed to
indicate
that
bees
could
actually
identify a
human face.
New research,
however, indicates that the situation is more complex—and more
fascinating—than this early study suggested.
 Martin
Giurfa from the Université de
Toulouse, France was drawn to the 2005 study because he
believed that,
while the bees were able to recognize a face, they were not interpreting it as such. Giurfa explains: Martin
Giurfa from the Université de
Toulouse, France was drawn to the 2005 study because he
believed that,
while the bees were able to recognize a face, they were not interpreting it as such. Giurfa explains:
Because the insects were rewarded with a drop of sugar when they chose human photographs, what they really saw were strange flowers. The important question
was what strategy do they use to discriminate between faces.
To test her question,
Giurfa teamed up with Dyer and Aurore Avargues-Weber, another scientist studying bees. The group of researchers designed a new set of tests,
published in Journal of
Experimental Biology to gain a more complete understanding of the
bee's recognition and
identification capabilities.
First, they placed cards with simple face-like
images—made of dots for eyes
and sticks for a nose
and mouth—next
to cards with non-face-like
patterns. When the
bees went towards the face-like
images, they were rewarded with a sugar solution. After several trials, the solution
was removed. Even without the reward, the bees gravitated towards the face-like
images.
Next, the team tested the bees' ability to interpret the proportions of
the pattern. One card with the dots and sticks
spread apart was placed next to a card that had a more standard face
proportion. After similar trials with the sugar solution, the reward was removed. Astonishingly, the bees continued to return to the
image they had previously been rewarded for.
Finally, researchers placed the stick and dot
pattern over the actual
image of a face.Bees were
able to identify the
pattern, even when distracted by the more complex background. When the pattern was rearranged—for example, the mouth was placed above the eyes—however,
the bees treated them as unknown patterns.
Researchers were quick to say, however, that these findings do not imply bees are capable of identifying individual faces.
Indeed, while a bee, once trained, may never forget a face, they probably won't be able to identify your face.
Sur les traces d'un
charançon disparu :
 Lorsqu'ils
ont commencé à étudier le contenu de carottes sédimentaires prélevées à Crozet,
un chapelet d'îles subantarctiques, Jean-David
Chapelin-Viscardi et Philippe Ponel, de l'Institut
méditerranéen d'écologie et de paléoécologie (Imep)1,
à Aix-en-Provence, ne s'attendaient pas à ce qu'un coléoptère inconnu leur
révèle une page d'histoire de l'archipel. Soit le témoignage d'un bouleversement
écologique survenu à la fin du XVIIIe siècle.Première
surprise : les deux chercheurs observent, dans des sédiments datés entre 1400 et
1800, des restes par dizaines d'un charançon n'appartenant à aucune espèce
connue. Or, comme le précise Philippe Ponel,
« lorsque l'on travaille sur des fossiles récents d'insectes, la quasi-totalité
des espèces observées dans les sédiments ont des représentants actuels ». En
l'occurrence, non seulement l'espèce est nouvelle, mais aussi le genre ! Lorsqu'ils
ont commencé à étudier le contenu de carottes sédimentaires prélevées à Crozet,
un chapelet d'îles subantarctiques, Jean-David
Chapelin-Viscardi et Philippe Ponel, de l'Institut
méditerranéen d'écologie et de paléoécologie (Imep)1,
à Aix-en-Provence, ne s'attendaient pas à ce qu'un coléoptère inconnu leur
révèle une page d'histoire de l'archipel. Soit le témoignage d'un bouleversement
écologique survenu à la fin du XVIIIe siècle.Première
surprise : les deux chercheurs observent, dans des sédiments datés entre 1400 et
1800, des restes par dizaines d'un charançon n'appartenant à aucune espèce
connue. Or, comme le précise Philippe Ponel,
« lorsque l'on travaille sur des fossiles récents d'insectes, la quasi-totalité
des espèces observées dans les sédiments ont des représentants actuels ». En
l'occurrence, non seulement l'espèce est nouvelle, mais aussi le genre !
Pour en apprendre davantage, les deux
entomologistes expédient les fragments de leur coléoptère, baptisé Pachnobium dreuxi, à Jean-François Voisin,
au Muséum national d'histoire naturelle, à Paris. Ce spécialiste des collections
subantarctiques les compare alors avec l'innombrable matériel entomologique
ramené de Crozet au cours du XXe siècle et dont une fraction importante n'a pas
encore été étudiée de près. C'est la deuxième surprise : il exhume deux
spécimens complets qui confirment que l'insecte n'a jusqu'alors jamais été
décrit. « C'est extrêmement rare de faire une découverte dans ce sens. D'abord
sous forme fossile et ensuite dans des collections entomologiques
contemporaines », s'enthousiasme Philippe Ponel.
Reste à comprendre comment un charançon dont
les restes pullulent dans les sédiments récents a presque totalement disparu
aujourd'hui (à deux spécimens près). Pour Philippe
Ponel, « il faut probablement y voir la conséquence
de l'arrivée de l'homme sur Crozet, à la fin du XVIIIe siècle ». Découvert en
1772, l'archipel a en effet rapidement été occupé par des pêcheurs accompagnés
d'un cortège d'animaux domestiques. Une hypothèse renforcée par le fait que les
sédiments n'ont révélé aucune modification climatique durant cette période.
Par ailleurs, Nathalie Van der Putten, au
département de géographie de l'université de Gand, en Belgique, qui a extrait
les sédiments, a montré que la disparition de
Pachnobium dreuxi
coïncide non seulement avec des changements considérables dans les populations
d'autres espèces d'insectes, mais aussi avec la raréfaction de certaines
plantes, comme le chou des Kerguelen. « C'est la parfaite illustration de
l'extrême fragilité des écosystèmes insulaires qui, du fait de leur isolement,
sont sensibles à la moindre modification », conclut Philippe Ponel.
Mathieu Grousson
Working to
save the 'living dead' in the Atlantic Forest,
an interview with Antonio Rossano
Mendes Pontes
 (09/23/2009)
The Atlantic Forest may very
well
be the
most
imperiled tropical
ecosystem in
the world: it
is
estimated
that
seven percent (or
less) of the original
forest
remains.
Lining the
coast of
Brazil,
what
is
left of the
forest
is
largely
patches and fragments that are
hemmed in by
metropolises and monocultures.
Yet,
some areas are
worse
than
others,
such as the
Pernambuco
Endemism Centre, a
region in the
northeast
that has
largely been
ignored by
scientists and
conservation efforts. Here, 98 percent of the
forest
is gone, and 70 percent of
what
remains are patches
measuring
less
than 10 hectares. Due to
this
fragmentation all large mammals have gone
regionally
extinct and the
small
mammals are
described by Antonio
Rossano Mendes Pontes, a
professor and
researcher
at the
Federal
University of
Pernambuco, as the 'living
dead'. (09/23/2009)
The Atlantic Forest may very
well
be the
most
imperiled tropical
ecosystem in
the world: it
is
estimated
that
seven percent (or
less) of the original
forest
remains.
Lining the
coast of
Brazil,
what
is
left of the
forest
is
largely
patches and fragments that are
hemmed in by
metropolises and monocultures.
Yet,
some areas are
worse
than
others,
such as the
Pernambuco
Endemism Centre, a
region in the
northeast
that has
largely been
ignored by
scientists and
conservation efforts. Here, 98 percent of the
forest
is gone, and 70 percent of
what
remains are patches
measuring
less
than 10 hectares. Due to
this
fragmentation all large mammals have gone
regionally
extinct and the
small
mammals are
described by Antonio
Rossano Mendes Pontes, a
professor and
researcher
at the
Federal
University of
Pernambuco, as the 'living
dead'.
Sperme de moustique
Les moustiques anophèles mâles éjaculent un bouchon à la suite de leur sperme
pour éviter que ce dernier ne ressorte du vagin de leur compagne une minute
après l'acte. Flaminia Catteruccia (Collège impérial de Londres) a découvert que
ce bouchon est indispensable à la fécondation. D'où son idée de créer une
substance anti-bouchon qui stopperait ainsi la repro duction de ces moustiques
vecteurs du paludisme.es
moustiques anophèles mâles éjaculent un bouchon à la suite de leur sperme pour
éviter que ce dernier ne ressorte du vagin de leur compagne une minute après.
Si c'était le capitalisme qui pouvait sauver
la biodiversité ?!
Aujourd'hui, tout s'achète. Même des morceaux de nature ! Depuis le début des
années 1990, une poignée de riches particuliers épris d'écologie, pour protéger
les quelques rares espaces vierges de la planète de l'exploitation commerciale,
acquièrent des étendues de terres sauvages avant de les sanctuariser. On les
appelle « écobarons ». Face à la montée du phénomène, le journaliste américain
Edward Humes leur a consacré un livre, sorti cette année aux Etats-Unis. Ted
Turner, le fondateur de CNN, a ainsi acheté quelque 8 000 kilomètres carrés de
terres dans l'ouest des Etats-Unis et 32 000 hectares en Argentine ; Roxanne
Quimby, créatrice des produits de soins Burt's Bees, 15 000 hectares de la forêt
du Maine. Quant à Douglas Tompkins, cofondateur de la marque de vêtements
Esprit, il possède un parc de près de 140 000 hectares autour des marais de
l'Ibera, au coeur de la Patagonie, et espère faire de la région un parc national
de 1,3 million d'hectares d'ici à vingt ans.
Si vous avez de l'argent à dépenser intelligemment, achetez un bout de forêt
tropicale !
Inventaire en ligne :
Voulez-vous savoir quels animaux, quelles
plantes ont été recensés dans votre commune par les naturalistes ? Si le
mammouth ou le renne ont brouté dans votre jardin durant la préhistoire ? Ou
bien si une zone protégée se trouve à proximité de chez vous ? La réponse est
donnée par l'inventaire du patrimoine naturel le plus complet au monde publié
sur la Toile par le Muséum National d'Histoire Naturelle :
http://inpr.mnhn.fr
Espèce prévisible :
 Vérifier
la théorie sur le terrain : voilà ce qui a conduit Sean à fouiller en pleine
nuit les abords d'un ruisseau perché à 2400m d'altitude, au bord d'un glacier
des Trinity Alps, dans le nord de la Californie. "C'était l'habitat parfait
pour un carabique du genre Nebria, se souvient-il. J'ai retourné une
première roche, et ils étaient là : 2 exemplaires d'une nouvelle espèce, assez
caractéristiques avec leur couleur noir terne et leurs élytres aplatis".
Nebria praedicta le bien nommé venait d'être identifié par la Science. Mais
l'entomologiste n'a pas fait mouche du premier coup par hasard. Dans les années
80, son collègue David avait remarqué que, dans un même type d'habitat, on
trouvait non pas une mais 2 espèces de carabiques en association. Aussi quand
Nebria turmadodecima a été découvert dans les Trinity Alps, en 81, les
scientifiques ont prédit qu'un nebria "frère" de celui'ci devait
exister. Ce qui s'est vérifié lors de l'expédition de Sean. "J'étais
surexcité par cette découverte, raconte-t-il. La seule chose qui m'a
inquiété pendant mes recherches nocturnes (les Nebria sont nocturnes ...), c'est
ce grondement sourd de la glace en train de s'effondrer". Car le glacier
qui constitue l'habitat de cette nouvelle espèce recule rapidement. A peine
découvert, Nebria praedicta est déjà considéré comme en danger -
victime probable, lui aussi, du changement climatique-. Vérifier
la théorie sur le terrain : voilà ce qui a conduit Sean à fouiller en pleine
nuit les abords d'un ruisseau perché à 2400m d'altitude, au bord d'un glacier
des Trinity Alps, dans le nord de la Californie. "C'était l'habitat parfait
pour un carabique du genre Nebria, se souvient-il. J'ai retourné une
première roche, et ils étaient là : 2 exemplaires d'une nouvelle espèce, assez
caractéristiques avec leur couleur noir terne et leurs élytres aplatis".
Nebria praedicta le bien nommé venait d'être identifié par la Science. Mais
l'entomologiste n'a pas fait mouche du premier coup par hasard. Dans les années
80, son collègue David avait remarqué que, dans un même type d'habitat, on
trouvait non pas une mais 2 espèces de carabiques en association. Aussi quand
Nebria turmadodecima a été découvert dans les Trinity Alps, en 81, les
scientifiques ont prédit qu'un nebria "frère" de celui'ci devait
exister. Ce qui s'est vérifié lors de l'expédition de Sean. "J'étais
surexcité par cette découverte, raconte-t-il. La seule chose qui m'a
inquiété pendant mes recherches nocturnes (les Nebria sont nocturnes ...), c'est
ce grondement sourd de la glace en train de s'effondrer". Car le glacier
qui constitue l'habitat de cette nouvelle espèce recule rapidement. A peine
découvert, Nebria praedicta est déjà considéré comme en danger -
victime probable, lui aussi, du changement climatique-.
ndlr : pourquoi cette association ??
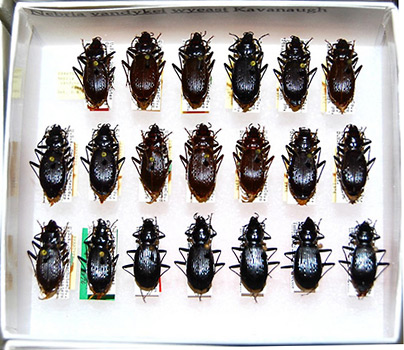 NEBRIA NEBRIA
It wasn’t difficult for David
Kavanaugh to focus on the genus Nebria as his specialty since "they live where I
like to be—up in the mountains." Dr. Kavanaugh has hiked up into mountain ranges
all over the world - the preferred habitat of these insects – in the hopes of
finding these elusive beetles. They have special enzymes in their bodies which
allow them to remain active in the cool climate that would normally be perilous
for other creatures. Nebria also have a natural antifreeze-like chemical that
lowers the freezing point of water within their bodies and prevents them from
freezing solid in the subzero temperatures. The beetles are nocturnal and forage
for food only at night. Dr. Kavanaugh discovered this Nebria beetle, Nebria
vandykei wyeast, in the Cascades Mountains in 1979.
Threatened by
Climate Change
Even
a small insect can tell the story of global climate change. Academy curator Dave
Kavanaugh and graduate student Sean Schoville discovered the ice beetle Nebria
praedicta on a single peak in California's Trinity Alps. The beetle lives only
in the presence of glaciers and snowfields, which are melting under current
warming trends. In the paper, the authors write: "The disappearance of these
temperature moderating bodies, which is virtually certain to occur with the
current climatic warming trend, would be catastrophic for this species...and
likely lead to their quick extinction."
Libellule africaine cherche coin sympa :
Nature. Les scientifiques l'appellent Trithemis annulata. Elle a
été surprise en juillet dans la région de Gaillac puis à Lavaur.
Après les frelons asiatiques, grands amateurs de ruchers du terroir et
de guêpes, voici trithemis annulata pour les scientifiques ou
trithemis purpura pour le commun des mortels. Mais ces deux espèces
d'insectes, qui ont atterri dans le Tarn, n'ont rien en commun. La
trithemis annulata est une inoffensive libellule africaine,
découverte dans la région de Gaillac au mois de juillet par un
entomologiste. Elle n'est cependant pas si inoffensive que ça
puisqu'elle est un vorace prédateur de moustiques et autres moucherons
piqueurs qui nous empoisonnent la vie.
C'est un peu par hasard, au cours d'un échange de courriels entre
naturalistes-donatologues (entomologistes spécialistes des libellules)
qu'un cliché pris le 3 juillet 2009 a révélé l'existence d'une libellule
africaine dans le Tarn. Au fil des infos qui ont circulé, on a appris
que cette espèce d'origine africaine a choisi de s'installer dans le
bassin méditerranéen. Il s'agit du premier signalement de sa présence
dans le nord-ouest du Tarn.
Une bestiole pas comme les autres :
« C'est vrai que ce cliché me posait un vrai problème d'identification,
confie Pascal Polisset, instit à Gaillac, naturaliste membre de la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPO) et de l'Office pour les insectes et
leur environnement de Midi-Pyrénées (OPIE-MP). J'avais beau le comparer
à d'autres références connues (couleur des nervations des ailes, de la
tête, des pattes) mais tout m'interdisait de ranger cette bestiole dans
le catalogue que j'établis pour dresser un inventaire des libellules de
la base de loisirs de Vère-Grésigne. »Le naturaliste a donc utilisé la photo de sa libellule « incognitas »
comme carte de visite jointe à la fin de ses courriels.
Jusqu'à ce qu'un collègue, plus aguerri, Sébastien Albinet, de
Roquemaure, lui annone qu'il s'agit d'une libellule d'Afrique. Le 25
juillet, une autre libellule a été observée à Lavaur.
On peut, bien sûr, se poser la question de savoir si c'est une véritable
invasion ou juste quelques libellules égarées dans le Tarn ?
« Ce phénomène est assez complexe, poursuit le naturaliste.
Il existe de tout temps des migrations de peuplements. Il s'agit d'un
éternel mouvement d'expansion d'espèces que nous nommons pionnières. Il
faut aussi rappeler que l'effet de serre, tant décrié par certains,
reste la condition sine qua non pour que la terre conserve une
température moyenne si utile à notre vie quotidienne. »
Pour la petite histoire, Pascal Polisset avait déjà découvert, au
printemps dernier, une espèce inscrite sur la liste rouge européenne des
espèces en danger : l'oxygastra curtisii, une libellule aux
teintes moirées, présente à Castelnau-de-Montmiral, dans les marais et
étangs entourés de végétation.
Pauvre bête !!
 Les
douaniers états-uniens qui surveillent le passage sur le Gateway
International Bridge qui relie Matamoros (Tamaulipas, Mexique) à
Brownsville (Texas) on réalisé un belle prise. Jeudi dernier, ils
interceptent une dame arborant une broche constituée d’un Coléoptère
vivant orné de pierreries. La dame n’a pas été jetée en prison :
elle avait déclaré le bijou. Mais le coléo s’est retrouvé expédié à
la Protection des végétaux (à Los Indios International Bridge) pour
vérification d’identité, car il ne possédait aucun permis
d’importation de ravageur agricole. Les
douaniers états-uniens qui surveillent le passage sur le Gateway
International Bridge qui relie Matamoros (Tamaulipas, Mexique) à
Brownsville (Texas) on réalisé un belle prise. Jeudi dernier, ils
interceptent une dame arborant une broche constituée d’un Coléoptère
vivant orné de pierreries. La dame n’a pas été jetée en prison :
elle avait déclaré le bijou. Mais le coléo s’est retrouvé expédié à
la Protection des végétaux (à Los Indios International Bridge) pour
vérification d’identité, car il ne possédait aucun permis
d’importation de ravageur agricole.
PS : Jaime Zalac, porte-parole de l’association People for the
Ethical Treatment of Animals est indigné : cette femme est une
fashion victim ; elle fait souffrir un animal et a payé quelqu’un
pour mutiler cet insecte alors que nous passons notre temps à
expliquer aux gens comment replacer dans la nature les fourmis, les
abeilles et les blattes égarés chez eux.
 New species featured in
entomological journal : New species featured in
entomological journal :
A new species of moth (Stichobasis
postmeridianus) endemic to the Maltese islands is featured in the
journal of the Entomological Society of Malta.
The second volume of the annual peer-reviewed publication also lists
more than 50 organisms from local countryside.
In addition, the bulletin contains a number of new records of
insects from the islands and information on their biology, control
strategies for the Red Palm weevil, sandflies and their role in
canine and human leishmaniasis, aphids on native trees, bark beetles
and others.
This year's issue includes a new section dedicated to the young
entomologist in order for him to discover and appreciate more the
world of insects.
The volume is illustrated with colour plates and line drawings.
The journal will not only find its way into Maltese libraries, but
is also distributed in more than 80 research centres in Europe and
elsewhere.
It is edited by David Mifsud, senior lecturer in Biology at Junior
College and the University of Malta.
The ESM is a non-profit, scientific society which is involved in the
study of Maltese and Mediterranean entomology and other arthropods.
Le mot « abeille » en éléphant :
Les éléphants d’Afrique n’aiment pas les
abeilles. Des ruches, voire des zonzonnements enregistrés, peuvent servir à
protéger les cultures qu’ils dévastent volontiers.
Lucy King et son équipe (université d’Oxford, Grande Bretagne)
poursuivent l’étude des réactions de Loxodonta africana vis-à-vis d’Apis
mellifera scutellata. L’observation du comportement de familles d’éléphants
soumis - en comparaison avec des bruits blancs - au bourdonnement d’abeilles
en colère leur a permis de repérer l’émission d’un grondement particulier
associé à des hochements de tête.
C’est un signal pour les congénères, qui se joignent au mouvement de
fuite. À l’intention des éléphanteaux, ce grondement spécifique est
pédagogique : il leur apprend à se méfier d’un danger réel. Les piqûres sont
particulièrement douloureuses pour ces pachydermes quand elles sont
infligées près de l’œil ou à l’intérieur de la trompe, ce que les abeilles
n’hésitent pas à pratiquer.
Il reste à déterminer la spécificité entomologique de ce signal :
est-il général ou modulé selon l’espèce d’insecte agresseur ?
L'abeille à longues antennes est l'animal 2010 : 
Pro Natura a choisi
l'abeille à longues antennes comme "Animal de l'année 2010". Ces véritables
"taxis à pollen" font partie des quelques 580 espèces d'abeilles sauvages de
Suisse. Ils symbolisent l'incroyable diversité de ces indispensables
animaux, selon l'organisation écologiste.L'abeille à longues antennes
succède à l'ours brun. Le choix de l'abeille à longues antennes comme
"Animal de l'année 2010" souligne l'importance des millions d'insectes
invisibles pour la biodiversité. Pourtant, 45% de toutes les abeilles
sauvages figurent déjà sur la Liste rouge des espèces menacées de Suisse.
"En pollinisant les plantes, les abeilles sauvages nous rendent un service
inestimable", relève Pro Natura. Elles constituent un maillon essentiel de
la biodiversité et de la chaîne alimentaire. Leur disparition entraînerait
une dégradation de la diversité végétale et, par conséquent,
l'appauvrissement de notre régime alimentaire et de celui des animaux.
Dos poilu et longues antennes
Avec son dos recouvert de poils et ses longues antennes, "l'Animal de
l'année 2010" ne passe pas inaperçu parmi les abeilles sauvages. Les
abeilles à longues antennes ont un goût prononcé pour l'ophrys bourdon, une
espèce d'orchidée, dont elles assurent la pollinisation.
Cette plante imite l'odeur et la forme de la femelle. Dès qu'un mâle se pose
sur elle pour ce qu'il suppose être une rencontre amoureuse, l'orchidée fait
tomber du pollen sur sa tête. Chargée de ce précieux chargement, l'abeille
mâle se posera ensuite sur un autre ophrys bourdon tel un véritable "taxi à
pollen".
Course de bêtes :
 L’épreuve se déroule sur un terrain marqué de deux cercles concentriques : au
centre se tiennent les entraîneurs ; les concurrents maintenus sous un verre
renversé sont lâchés au signal de l’arbitre sur le cercle intérieur ; le premier
(concurrent) qui a franchi le cercle extérieur a gagné. L’épreuve se déroule sur un terrain marqué de deux cercles concentriques : au
centre se tiennent les entraîneurs ; les concurrents maintenus sous un verre
renversé sont lâchés au signal de l’arbitre sur le cercle intérieur ; le premier
(concurrent) qui a franchi le cercle extérieur a gagné.
Le règlement, mis au point par le Science Club, stipule entre autres que :
• ne sont pas admis à concourir les individus non vivants, d’espèces menacées
ou exotiques ;
• la ligne d’arrivée sera franchie à la marche (vol, saut
ou propulsion par l’entraîneur interdits) ;
• les concurrents devront être
assez gros pour être visibles (les puces et les acariens sont notamment exclus)
;
• sera disqualifié tout concurrent qui en a dévoré un autre ;
• il
est interdit d’apporter des modifications substantielles aux concurrents comme
l’ajout de pattes ou d’ailes, l’éjointage de ces dernières ou leur collage ;
• l’usage (par les concurrents) d’anabolisants ou de dopants est strictement
prohibé et les comportements suspects déclencheront des contrôles antidrogues et
alcoolimétriques.
La Great American Bug Race se tient depuis 27 ans le campus
de l’université à West Palm Beach, en Floride (États-Unis), au lieu-dit
Orthoptera Downs. L’inscription coûte 1 $ ; si l’on n’a pas amené sa blatte, des
vendeurs en proposent sur place à partir de 50 cents.
NB. L’OPIE propose des lots de Blatte géante du Mexique, à 9 € les 6
adultes, très bien élevées et parfaitement propres du point de vue dopage mais
pas spécialement sélectionnées ni entraînées pour ce genre de compétition !
Saint-John-Perse et les insectes :
... Saint-John-Perse a été un observateur
extrêmement méticuleux des régions qu'il traversait, intégrant certaines
particularité géologiques, mémorisant les plantes et animaux qui l'avaient
frappé, retenant coutumes et pratiques de leurs habitants si bien qu'il
compensait par la richesse et la somme de ces informations l'imagination dont il
usait avec prudence dans la vie comme dans l'écriture. Dans son œuvre, il n'est
guère d'images ou de métaphores qui n'ont été vécues ou qu'on ne lui a
rapportées et dont il a vérifié scrupuleusement l'exactitude.
Dans ces
conditions, il est naturel que les insectes n'aient point échappé à son
attention : ils sont présents au sein de tous ses grands récits poétiques. Ayant
un goût marqué pour les Sciences Naturelles - particulièrement la botanique et
l'ornithologie - il n'est guère disert dans ses correspondances avec la matière
qui nous intéresse ici; il écrit, en 1942, depuis une île de la côte est des
Etats-Unis où il aimait séjourné : "je mène ici une large vie physique, de
défricheur de pistes, de bûcheron, de pilleur d'épaves, de nageur en eau froide,
de lanscape gardener en imagination, et de naturaliste d'occasion, à
demi-braconnier, passionnément entomologiste,
botaniste et géologue."
Par ailleurs un de ses grands amis
écrit : "On doit aussi signaler la déférence qu'il
porte aux travaux des entomologistes, non moins respectables pour lui que ceux
des anthropologues, son regret que les livres du "père Fabre" ne soient plus
offerts aux enfants comme autrefois."
Il serait fastidieux et
inutile de donner une liste des nombreux insectes évoqués dans l'œuvre du
poète; aussi me contenterai-je de vous proposer, en guise de mise en
appétit de lecture, quelques citations qui élargissent singulièrement le champ
de notre binoculaire et nous ouvrent l'espace prodigieusement vaste de la
poésie. Les insectes peuvent être un enfermement ou une ouverture; je retiens
cette deuxième proposition dans mes activités et amitiés entomologiques. ...
" ... Ô mémoire, prends souci de ses roses de sel. La grande
rose du soir héberge l'étoile sur son sein comme une cétoine dorée ..."
(D'après Eric de Laclos dans
L'Entomologiste ...)
Portraits d'insectes :


http://www.philippeblanchot.com/
Enfin un article fort
intéressant et utile sur la démographie galopante !
Et de deux !
Chaque seconde, la Terre reçoit 4 nouveaux-nés tandis que que 2 habitants
décèdent; bilan : 2 personnes supplémentaires. Le temps que vous relisiez cette
phrase, la Terre compte déjà 6 habitants de plus; 8, 10, 12 ... Demain, ils
seront 200 000 nouveaux venus !! Dans une semaine, la Terre aura enflé de 1,5
millions d'habitants. dans les 40 années à venir, la Terre devra abriter,
nourrir, donner de l'air, de l'eau, de la place à au moins 3 milliards de
nouveaux habitants (si on fait des efforts de dénatalité !!). Alors qu'il nous a
fallu 7 millions d'années pour être 1 milliard, nous allons, en l'espace de 150
années être 9 fois plus nombreux. "La population mondiale
aura décuplé en 3 siècles; nous vivons une période unique de l'histoire de
l'humanité" résume un spécialiste. La démographie s'emballe. En 2050, 9
milliards d'humains se partageront un espace exigu, exsangue, pollué ...
Estimation moyenne (si on fait des efforts de dénatalité ...); 12 milliards si
on continue comme ça ! De plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. Ceux
qui doubleront ou tripleront, dominant demain numériquement le monde, seront les
5,2 milliards d'habitants des pays en voie de développement. Ils augmentent à
vive allure, 6 fois plus vite que le milliard de ceux qui mangent et prospèrent
dans les pays industrialisés. L'explosion numérique du continent noir a démarré.
En 2009, l'Afrique a dépassé le cap du milliard de ressortissants ! Dingue !
Alors que ce continent a été saigné par la traite négrière, meurtri par le
paludisme, puis, plus récemment, décimé par l'épidémie de sida. Malgré ces
lourdes ponctions, l'Afrique aura doublé en 2050; 2 milliards la peupleront
alors. Deux chiffres pour s'en convaincre : le Nigeria met au monde chaque année
plus d'enfants que tous les pays de L'UE réunis ! Le Niger possède un indice de
fécondité de 7,1 enfants par femme en état de procréer; le plus élevé de la
planète (évidemment encouragé par les marabouts !).........
"Les
populations du Libéria, du Congo, du Niger, de l'Afghanistan vont tripler,
celles de l'Ethiopie, du Nigeria, du Yémen vont doubler. Et, si dans ces pays,
les libertés et autres besoins fondamentaux ne sont pas au rendez-vous, ils
pourrait être entrainés vers la violence" signale un autre spécialiste. La
bombe démographique n'offre pas seulement d'impossibles équations à résoudre en
termes de nourriture, d'eau, de déchets, elle diffuse également les germes
ravageurs du terrorisme et le l'émigration massive.........
(Lire l'article complet dans Le Point)
Quel est le rôle des religions dans cette
catastrophe ? Catastrophique justement !
Le rôle de la Gauche, des Verts, des
Francs-maçons ? 0 ! Un silence assourdissant ! Encore un sujet tabou ! C'est trop
facho, voir même néonazi ! Décidemment cons, si cons ....!!
"Toute naissance évitée permet au monde de mieux respirer !"
Mais il est déjà trop tard !
Ce sont les naissances d'hier qui font les
enfants d'aujourd'hui ! Les centaines de millions de femme mises au monde dans
les années 60 sont devenues mères dans les années 2000; elles ont eu moins
d'enfants que leurs propres mères, et ces enfants en feront eux-mêmes moins
(dans les pays intelligents; en Chine notamment !); seulement, en la matière, la
décrue est naturellement lente; elle s'observe sur 3, 4 générations. Les
démographes appellent cela l'inertie démographique ... Donc finalement, 9
milliards au mieux, 12 milliards au pire !
Entomologie à la Réunion : un très intéressant
site sur des expés. entomologiques à La Réunion !
http://christian.guillermet.perso.neuf.fr/expediti.htm
Entomologie en PNG :
 In October
2008 two surveys were held by members of the Papua Insects Foundation (R. de
Vos, P.J. Zumkehr, V. Kalkman, J. de Vos and J. Schaffers) and students of UNCEN
at the north coast of Supiori Island and again in Walmak. Two members visited
also Lelambo, a small mountain village at an altitude of 900 meters, somewhat
north of Walmak. The insect material which has been collected is stored in the
Zoological Museum of Amsterdam (ZMAN). During this survey many macro-photographs
of insects were made by J. Schaffers which will be used for this website. In October
2008 two surveys were held by members of the Papua Insects Foundation (R. de
Vos, P.J. Zumkehr, V. Kalkman, J. de Vos and J. Schaffers) and students of UNCEN
at the north coast of Supiori Island and again in Walmak. Two members visited
also Lelambo, a small mountain village at an altitude of 900 meters, somewhat
north of Walmak. The insect material which has been collected is stored in the
Zoological Museum of Amsterdam (ZMAN). During this survey many macro-photographs
of insects were made by J. Schaffers which will be used for this website.
In
November-December 2005 the
Foja Mountains Expedition was held by LIPI and Conservation
International. It was undertaken for four weeks and its results were amazing.
Lots of new animals an plants were discovered in an area where probably almost
no people have been before. About 25 specialists joined this expedition
(supervised by Bruce Beehler), among which our contributor Henk van Mastrigt and
Evie L. Warikar (UNCEN), who collected all kind of insects, of which many
appeared to be new to science.
At the end of October till November 2008
another Foja Mountain Expedition by the same organisors was held and again our
contributor and butterfly specialist Henk van Mastrigt was participating. There
was again a lot of rain this time but Henk managed to collect more butterflies
than before and also the moths were quite abundant. Results of this expedition
will follow later in this website.
In March 2009 a survey was
held on Misool Island by the Entomological Society of Latvia (Lettland) with
D.Telnov, M.Kalnins, K.Greke and Z.Pipkaleja. They studied insects and
non-marine Mollusca.
Fondation “Insectes de Papua”
La
Fondation a pour but de réaliser, en coopération avec des étudiants en biologie
de Papua Indonesia et avec des entomologistes de divers pays, une recherche
scientifique sur la faune d’insectes du pays, permettant de reconnaître les
zones importantes et vulnérables de biodiversité élevée (“hot spots”). Ces zones
ont grand besoin d’être protégées. C’est par une telle recherche que nous
espérons participer à la protection de la forêt tropicale humide. Des
organisations bien connues, comme World Wildlife Fund ou bien Conservation
International sont déjà impliquées dans la protection des forêts tropicales de
diverses zones du monde, mais leur activité est surtout concentrée sur les
grands animaux. La Fondation “Insectes de Papua” a l’intention de fournir à ces
organizations, et à d’autres similaires, des informations sur les aires
d’endémisme, les “hot spots” de biodiversité, ainsi que sur la faunistique et la
taxonomie des insectes de Papua, ce qui leur permettra d’affermir leur lutte
pour la protection de la forêt humide du pays.
Nous
stimulons et nous aidons les universités locales et les étudiants en biologie
pour leur participation à du travail d’inventoriage et pour d’autres projets de
recherche sur les insectes.
http://www.papua-insects.nl/about%20us/about%20us%20fr.htm
Expéditions : La Planète Mozambique Revisitée
 carte
des expéditions Mozambique ©J. Leborgne / MNHN carte
des expéditions Mozambique ©J. Leborgne / MNHN
« Planète Revisitée » est un programme d’explorations qui axe ses
recherches sur la biodiversité « négligée ». En cours, l’expédition
Mozambique, destinée à inventorier la biodiversité des forêts sèches
de la côte Est de l’Afrique. Richesse, rareté et haut niveau de
dégradation sont la marque de cet oasis de biodiversité planétaire,
appelé aussi « hotspot ».
Lundi 16 novembre 2009, 14h24. Le Blog de « La Planète Revisitée »
fait le récit du jour. « La traque aux insectes » commence ainsi.
« Dans la religion jaïniste, il est interdit de tuer le moindre
animal. Certains fidèles portent un masque pour éviter d’avaler des
moucherons. Ils balayent le sol devant leurs pas pour ne pas écraser
d’insectes. S’ils étaient jaïns, les entomologistes brûleraient en
enfer. Une partie de leur métier consiste en effet à zigouiller des
insectes à qui mieux mieux. Oui, mais c’est pour la bonne cause. Il
s’agit d’inventorier et classifier pour mieux préserver les
espèces. » L’équipe d’entomologistes est partie pour un « fly camp »
de deux jours au bord de la rivière Rovuma, qui marque la frontière
avec la Tanzanie. Objectif : explorer un nouveau territoire au nord
du Mozambique, plus humide que celui des alentours de Nhica.
L’expédition Mozambique qui s’achèvera le 15 décembre constitue avec
celle de Madagascar prévue en janvier 2010, le premier volet de la
« La Planète revisitée ». Ce programme orchestré par le Muséum
national d’Histoire naturelle et l’ONG Pro Natura International,
vise à inventorier les espèces afin de mieux connaître la
biodiversité des régions les plus riches en espèces et les plus
menacées du monde pour mieux les protéger.
Le « hotspot » des forêts sèches d’Afrique de l’Est
Depuis le 1er novembre, les chercheurs arpentent les forêts côtières
de l’Afrique de l’Est, pour l’heure, celles du Mozambique, un des 34
« hotspots » mondiaux pointés par l’ONG Conservation International.
Ces forêts figurent parmi les 25 sites forestiers mondiaux
prioritaires pour la conservation et sont considérés comme l’un des
10 écosystèmes les plus menacés d’Afrique. Dévastées en Tanzanie et
au Kenya, leur plus grande partie serait abritée par le Mozambique.
Plus de la moitié de leur biodiversité est endémique. Leurs
formations végétales sont encore mal comprises et difficiles à
caractériser. Régions inexplorées, inconnues qu’il faut pénétrer.
La mission itinérante Mozambique mélange équipes logistique et
scientifique. Chauffeurs et cuisiniers ainsi qu’une multitude de
techniciens de « haut vol » épaulent les scientifiques dans leur
tâche : pilotes d’aérostat, grimpeurs d’arbres. Côté chercheurs,
elle compte pour moitié de floristes et de botanistes anglo-saxons
et pour moitié de zoologistes français, essentiellement du Muséum
National d’Histoire Naturelle.
Nouvelle expédition type
Cette expédition s’inspire de l’expérience acquise lors de « Santo
2006 » initiée par les mêmes organisateurs sur Espiritu Santo, la
plus grande île du Vanuatu. 150 scientifiques étaient accompagnés
sur le terrain de spécialistes de la plongée, de l’escalade, de la
spéléologie, logisticiens, collecteurs, guides, naturalistes
amateurs, photographes, journalistes... Au total plus de 212
personnes de 25 nationalités différentes. Ce grand travail d’équipe
pluri et transdisciplinaire accompagné d’importants moyens est à
l’image de ce que sont les nouvelles expéditions. Nouvelles
méthodes, nouvelles techniques au service de nouveaux programmes et
réseaux internationaux pour collecter et partager les données
rassemblées. « L’objectif final est de remettre dans l’agenda
international des forêts qui n’existent pas, pour lesquelles nous
n’avons aucune information. Elles n’existent pas pour les grandes
agences internationales et pour les organismes de conservation, et
sont totalement ignorées des grands circuits d’argent pour ce genre
d’activités. On a encore besoin d’acquérir des connaissances sur
cette planète avant de décider ce qu’on laisse et ce qu’on garde »
conclut Olivier Pascal de l’ONG Pro Natura International.
4 décembre 2009, Gilles Daniel
Pique et pique :
Du nouveau chez les moustiques ! Découvert
dans le N.E. de l'Inde, Armigeres mahantai, vient de rejoindre la
cohorte des insectes volants connus pour être des vecteurs potentiels de
maladies. C'est une équipe constituée d'entomologistes et d'un épidémiologiste
qui l'ont découvert. "Je travaille sur les maladies transmises par les
moustiques, explique ce dernier. Mais la biodiversité est telle dans
notre région que nous devons aussi faire de la taxonomie. L'étude de ces espèces
et de leur environnement est primordiale pour comprendre leur éventuelle
importance médicale". Pour le moment mahantai n'a pas livré tous
ses secrets. Est-il, comme d'autres moustiques du genre, vecteur de filiarioses
humaines ? Autre mystére : l'adaptation de ses larves à un milieu a priori
hostile. Car ce curieux diptère pond ses œufs au cœur des vasques formées par
les feuilles de Nepenthes (plantes carnivores) - dans le liquide même
où d'autres insectes gisent sans vie, victimes de l'appétit du végétal. Les
larves de mahantai, elles, y frétillent vaillamment et en nombre, sans
se soucier outre mesure de l'antre dangereuse dans laquelle elles se développent
!!
D'après National Geographic
Voilà pourquoi elles sont si salopes !!
L'étude a seulement été menée sur la mouche
(pour l'instant !), mais elle pourrait expliquer pourquoi l'infidélité féminine
est une absolue nécessité pour la survie de la plupart des espèces. Nina
(Université d'Exeter) a élevé en captivité 12 populations de Drosophila
pseudoobscura : 5 où les femelles n'ont qu'un seul partenaire, 7 où elles
ont, comme à l'habitude, voleté de mâle en mâle. Après 15 générations; les 5
premières populations avaient disparu car leurs femelles finissaient par ne plus
produire que des femelles. L'explication tient au chromosome Y défectueux de
certains mâles qui les conduit à ne faire que des filles. En multipliant les
partenaires, les femelles évitent le piège. Reste à savoir si l'explication
tient pour l'espèce humaine ...!
Une méduse serait le seul animal immortel :
D’après plusieurs recherches
scientifiques, la méduse Turritopsis nutricula serait le seul animal
pouvant être immortel. En effet, cette méduse serait capable de
remonter le temps, passant d’une phase de vie avancée à une phase de
vie plus jeune.
Les Turritopsis nutricula sont une espèce de méduses bien
spécifique. En effet, ils pourraient être les seuls animaux dans le
monde à avoir découvert le secret d’une jeunesse et d’une vie
éternelle, une véritable avancée dans le monde scientifique. Cette
méduse serait ainsi capable de se rajeunir, une fois une certaine
phase de vie dépassée, ne donnant ainsi aucune limite à leur durée
de vie. Les scientifiques expliquent ainsi que la méduse hydrozoaire
est le seul et unique animal dans le monde à pouvoir inverser son
vieillissement pour revenir dans le temps et régénérer sa structure
entière afin de revenir à l’état de polype, c'est-à-dire lors de sa
première phase de vie.
Ce processus s’expliquerait notamment par le phénomène de trans-différentiation,
ce qui signifie qu’un type de cellule se transforme en un autre type
de cellule. Seuls quelques animaux dans le monde peuvent provoquer
une trans-différentiation, mais celle-ci est toujours limitée, comme
la salamandre par exemple, qui peut refaire "pousser" sa queue
lorsqu’elle la perd. La méduse Turritopsis nutricula a la
particularité de régénérer l’ensemble de son corps, et cela de façon
infinie. Plusieurs chercheurs et équipes scientifiques étudient
attentivement cette espèce afin de déterminer de quelle façon il est
possible de reproduire ce processus de
vieillissement/rajeunissement.
Évoluant souvent en eaux profondes, et puisqu’elles ne peuvent peu
ou pas mourir, ces méduses sont en train de développer leur présence
dans les eaux du monde entier, et non plus seulement dans les eaux
des Caraïbes où elles étaient à l’origine. Et le Docteur Maria
Miglietta de l’institut marin tropical de la Smithsonian d’expliquer
: "Nous assistons à une invasion silencieuse mondiale".
Vision d'abeille :
Les abeilles possèdent une vision en couleur 5
fois plus rapide que celles des hommes. Ainsi peuvent-elles voler rapidement,
repérer toutes les fleurs à butiner et échapper à tout ennemi. Lars Chittka
(Univertsité de Londres) a démontré que cette vision très coûteuse en énergie
s'est imposée pour permettre la survie de l'espèce.
("Neuroscience")
Superlibido :
Pour lutter contre les insectes ravageurs,
tels la mouche à fruit, Boaz Yuval (Université de Jérusalem) propose de stimuler
la libido de mâles stérilisés en labo avant de les relâcher. En fait, le lâcher
de mâles stériles pour neutraliser les femelles sauvages est déjà pratiquer -
sans grande éfficacité - car ces mâles de labo n'ont guère de libido. Aussi
Yuval a-t-il songé à les doper avec un repas de champion enrichi en protéines et
en bactéries stimulatrices. Ainsi, les mâles stérilisés deviendraient-ils des
bêtes de sexe accaparant les femelles. On attend évidemment la recette !!
Plusieurs espèces de papillons,
coléoptères et libellules sont menacés d'extinction en Europe en raison de la
destruction de leur habitat naturel, prévient la dernière Liste rouge des
espèces en danger en Europe publiée mardi.
Cette liste qui comprend 6 000 espèces fait partie de
la plus vaste Liste rouge établie par l'Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) dont l'inventaire couvre plus de 47.000 espèces
de la planète. Concernant les papillons d'Europe, les scientifiques de l'UICN
ont établi qu'une espèce sur trois était en déclin et que 9% des 435 espèces
étudiées étaient déjà menacés d'extinction.
La modification des pratiques agricoles pointées
du doigt
Pour eux, "la menace principale est la destruction de
leurs habitats, liée le plus souvent à des modifications des pratiques
agricoles, que ce soit l'intensification ou l'abandon, au changement climatique,
à des incendies de forêt et au développement du tourisme", a expliqué la
coordinatrice de la Liste rouge européenne à l'UICN, Annabelle Cuttelod, citée
dans un communiqué.
La disparition des vieux arbres prive les
coléoptères d'habitat
La situation est à peu près similaire pour le
coléoptère saproxylique qui dépend du bois en décomposition et joue un rôle
essentiel dans le recyclage des nutriments. Quelque 11% des espèces de
coléoptères saproxyliques étudiées (431 dont un tiers habitent en Europe) risque
de disparaître du continent, tandis que 7% sont menacés d'extinction dans le
monde, relève encore la Liste de l'UICN. Comme les papillons, ces coléoptères
voient leurs habitats en déclin, en raison de l'exploitation forestière et de la
disparition des vieux arbres.
La ressource en eau essentielle pour les
libellules
Pour les libelulles, le déclin de trois espèces est
causée par la diminution des sources d'eau où elles prolifèrent. Cette dernière
est dûe, explique l'UICN, à des besoins croissants en eau pour la consommation
et l'irrigation couplés à de nombreux étés chauds et secs. Selon la Liste rouge,
5% des espèces de libellules "courent un risque d'extinction totale" en Europe.
"Un déclin inquiétant"
"Les services écosystémiques que la nature nous
fournit, tels que l'approvisionnement en eau et en nourriture et la régulation
du climat, sont le pivot central de notre prospérité future", explique le
nouveau commissaire européen à l'Environnement, Janez Potocnik cité dans le
communiqué. "Alors quand une Liste Rouge comme celle-ci sonne l'alarme, les
implications pour notre avenir sont claires. C'est un déclin inquiétant",
prévient-il.
On pressentait qu'au moins certaines espèces de
libellules
étaient
migratrices, mais sans savoir sur quelles distances ni quels itinéraires.
Une équipe associant les universités de Princeton et de
Rutgers a récemment montré[1]
que des libellules migrent un peu à la manière des oiseaux, en étant a priori
capable de faire plus de 100 km/par semaine par beau temps sans vent. On ignore
encore leurs itinéraires, mais en suivant (en voiture et/ou avion) durant 6 à 9
jours 14 libellules de l'espèce
Anax junius (Anax de juin) capturées dans le
New Jersey, et équipées
d'émetteurs-radio miniaturisés, on a montré qu'elles migraient un peu à la
manière des oiseaux (vers le sud des États-Unis en automne), certaines faisant
le voyage du Nord-Est du pays jusqu'en
Floride à une vitesse
moyenne de 12 km par jour (jusqu'à 100 milles/jour, en étant alourdies par les
émetteurs). Elles ont des lieux de repos, et comme les oiseaux, elles volent
quelle que soit la direction du vent, en compensant peu leur dérive (dans ce
cas, mais on a observé des papillons ou des libellules tropicale effectuer un
trajet rectiligne au-dessus de la mer ou d'un lac[2],
de jour, mais se posent quand la vitesse du vent dépasse 25 km/h et/ou par temps
pluvieux. Ce serait la température qui les pousse ; elles semblent ne décoller
qu’après deux nuits froides se succédant.
Les libellules étant supposées apparues il y a 285
millions d’années environ (presque de 140 millions d’années avant les oiseaux)
peut-être ont-elles été pionnières en matière de
migration aérienne.
L'impact de l'entomologiste sur
l'environnement :
On reproche souvent aux entomologistes de ramasser et
de tuer de nombreux insectes, ce qui aurait comme conséquence que les insectes
deviennent de plus en plus rares. Les entomologistes destructeurs de la
biodiversité !!
Il est vrai qu'un entomologiste qui rentre avec une récolte de 500 spécimens
peut susciter de telles idées. Mais il ne faut pas oublier que les insecticides
tuent sans distinction des centaines de milliers d'espèces; que l'éclairage
public et toutes les lampes attirent des milliers d'insectes qui y sont
proprement incinérés; que les voitures, trains ou avions détruisent à chaque
kilomètre parcouru de très grandes quantités d'insectes dont on peut voir les
restes sur les pare-brises.
Lors d'une simple promenade en forêt, à chaque pas, nous écrasons un nombre
important d'insectes, araignées et acariens du sol. Face à ces carnages, les
efforts de récolte des entomologistes sont vraiment dérisoires !
Cependant, certaines raretés entomologiques sont la cible de chasseurs
professionnels et peuvent de ce fait être menacées (elles sont maintenant
protégées !). Mais on ne connaît aucune espèce d'insectes qui ait été exterminée
par ce commerce (ce n'est pas le cas de bien d'autres espèces animales !).
Ce sont les activités de l'homme, en particulier la destruction des biotopes (y
compris par l'ONF !) qui sont responsables de la diminution de la biodiversité,
et non pas les entomologistes qui savent exactement ce qu'ils cherchent et font
des prélèvements (en général ...) raisonnables qui ne risquent pas de détruire
les populations d'insectes.
Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.
Tout est lié !
La plante carnivore Sarracenia
leucophylla aurait de bonnes raisons de porter plainte contre les insectes
pour empoisonnement. En effet, Iain Green (Université de Bournemouth) explique
sa disparition par une contamination au cadmium. Ce dernier proviendrait des
larves de mouche dont elle se nourrit, elles-mêmes contaminées par les engrais !
Or noir contre or vert :
640 espèces d'arbres, 185 d'amphibiens, 100 de
chauves-souris sur 1 hectare ! Et pas moins de
35 000
espèces d'insectes recensés dans un rayon de 3 km. Le parc national de
Yasuni, en Amazonie équatorienne, possède la plus riche biodiversité de la
planète, selon l'Institut de recherche pour le développement. Mais pour combien
de temps ? Le sous-sol contient un pétrole très polluant à exploiter. En 2007,
le gouvernement équatorien promettait d'y renoncer si les pays riches
l'indemnisaient (4,8 milliards d'euros !!). En octobre, Berlin promettait de
verser 33 millions par an. L'accueil de Paris a été tout aussi chaleureux, mais
aucun engagement (et pour cause !!!) pour sa quote-part annuelle estimée à 23
millions d'euros ...
(Le Point)
Les papillons se souviennent- ils de leur passé de
chenille ?
C'est l'un des mystères les plus
fascinants de la vie animale : une vilaine chenille qui va
s'entourer d'un cocon de soie et resurgir en magnifique papillon. Et
on ne sait qu'à peine comment cela se passe. La métamorphose que
subissent certains insectes est totalement «folle». Le «bébé»
insecte ne ressemble physiquement en rien à l'insecte adulte, il n'a
pas les mêmes habitudes alimentaires, ne se déplace pas de la même
façon…
Cela peut sembler une mécanique bien compliquée, peu propice à la
reproduction et au développement des espèces qui la pratiquent.
Pourtant, c'est tout le contraire qui se passe. Résultat, près de
60 % des insectes utilisent la métamorphose. La raison de ce succès
tient dans le fait que le bébé ne mange pas la même chose que
l'adulte. Il n'y a donc pas concurrence et chacun peut déguster ses
plats préférés sans piocher dans l'assiette de l'autre.
Quatre grandes catégories d'insectes se métamorphosent. Les
coléoptères (scarabées ou coccinelles), les lépidoptères
(papillons), les hyménoptères (abeilles, guêpes ou fourmis) et les
diptères (les mouches). Le développement de ces insectes se fait en
quatre grandes étapes : l'œuf, la larve, la nymphe et l'adulte.
Même si la durée de vie des papillons est très variable, allant de
quelques semaines à quelques mois, ces quatre étapes sont partout
les mêmes. La femelle va pondre, au printemps ou en été, des
centaines d'œufs dans des endroits bien précis (durant sa vie, la
femelle pondra de 1 000 à 2 000 œufs). Le stade œuf dure de 3 à 8
jours. Il se forme alors une chenille, ou larve. Ce stade est le
plus long du cycle et donne lieu déjà à d'importantes
transformations. On passe, en trois semaines environ, d'un œuf qui
mesure un millimètre à une chenille longue de plusieurs centimètres.
Pour cela, elle dévore avec voracité des quantités énormes
d'aliments. Et doit effectuer plusieurs mues.
Seules les jeunes chenilles transmettent un souvenir
Puis vient le troisième stade, celui de la chrysalide. La chenille
produit des fils de soie dont elle s'entoure pour former un cocon.
Celui-ci peut être de différentes couleurs et nombreux sont les
exemples où elles sont adaptées au camouflage. À l'intérieur de la
chrysalide, une totale transformation va avoir lieu en 7 à 8 jours.
Cendrillon la souillon s'apprête à devenir princesse pour aller au
bal. L'anatomie de l'animal est complètement réorganisée,
transformée. Certains organes disparaissent, d'autres apparaissent.
Des pattes, des ailes, un abdomen, un thorax, une tête se forment.
Comment ? Pourquoi ? Tout juste la science peut-elle avancer que des
hormones doivent intervenir, que des cellules doivent être tapies
quelque part dans la chenille, attendant leur heure.
Puis, en quelques minutes, l'insecte adulte va percer sa chrysalide,
en sortir, expulser les restes de sa précédente vie, déployer ses
ailes pour les sécher et bientôt s'envoler à la recherche de
nourriture et d'une partenaire. Le délicat papillon illuminé de
couleurs au vol «cubiste», la mouche agitée qui vrombit et nous
énerve, l'abeille stakhanoviste qui butine le nectar et le pollen
des fleurs n'ont vraiment plus rien à voir avec la chenille
rampante, l'asticot gigotant ou la larve dépendante qu'elles avaient
été.
Des chercheurs de l'université de Georgetown, à Washington, se sont
demandés si, au moins, l'adulte avait des souvenirs de sa vie
d'enfant. Ils ont trouvé le moyen d'obtenir une réponse. Ainsi, ils
ont pu prouver que les chenilles du sphinx du tabac, entraînées à
reconnaître (et fuir) certaines odeurs (en les associant à de petits
électrochocs), transmettaient ces souvenirs au papillon adulte. À
condition que les chenilles ne soient pas trop jeunes au moment de
cet apprentissage. Ainsi, seules les chenilles «adolescentes»
transmettent un souvenir. Dans ce cas, spontanément, en dépit des
immenses remaniements que subit l'animal, cerveau et système nerveux
compris, le papillon s'éloigne des odeurs associées, chez la
chenille, à une piqûre électrique. Voici peut-être expliqué
pourquoi, le plus souvent, les papillons femelles choisissent les
feuilles de la «bonne» plante pour y déposer leurs œufs, car elles
se souviennent que la «table» y était du meilleur cru.
D'autres animaux ont recours à la métamorphose, pas toujours de
manière aussi spectaculaire et profonde, surtout dans le milieu
marin. Les batraciens, bien sûr, mais aussi de nombreux poissons
tels que anguille, murène, sole, flétan, turbot, et des
échinodermes, des mollusques… D'un autre côté, tous les insectes ne
passent pas par la métamorphose mais produisent des «bébés»
morphologiquement semblables aux adultes, des répliques en
minuscule.
En tout cas, les premiers papillons sont là. En particulier le
«citron», nom dû à sa couleur, qui hiberne l'hiver mais aussi l'été.
Et le paon du jour, dont les ocelles colorés rappellent ceux du
volatile paon, qui est très facile à élever. Avec une seule petite
restriction : les œufs se ramassent sur les orties et il faut en
nourrir les chenilles.
 L'empêcher de pisser ! L'empêcher de pisser !
La punaise (Réduve) Rhodnius prolixus,
qui transmet la grave maladie de Chagas, a l'impudique habitude de se poser sur
les lèvres d'un dormeur (attirée par le CO2 exhalé pour en aspirer le sang.
C'est en pissant sur la blessure, afin de s'alléger avant le décollage, qu'elle
transmet le trypanosome responsable du mal (Trypanosoma cruzi). Paul
Paluzi (Université de Toronto) a identifié les gènes qui pourraient l'empêcher
d'uriner, et donc de transmettre la maladie !
(Science)
En ville, les
abeilles n'ont pas le bourdon !!
Faune. Le Grand
Lyon pilote un projet destiné à faire de l'agglomération un refuge
pour les butineuses
On le sait, sans les abeilles, l'espèce humaine aurait quelque souci
à se faire. Comment donc protéger nos précieuses butineuses ? En
leur offrant notamment une chambre… en ville. Pendant cinq ans,
l'agglomération lyonnaise va servir de terrain d'expérimentation
pour mettre au point un « guide de survie » des abeilles sauvages en
milieu urbain et périurbain, reproductible ensuite dans n'importe
quel territoire similaire en Europe. Aujourd'hui, les abeilles
vivent souvent mieux parmi la diversité des fleurs de nos balcons et
jardins publics que dans les grandes terres agricoles dédiées à la
monoculture et gavées de pesticides.
Hébergées dans des « hôtels »
Sur le millier d'espèces sauvages en France (pour une seule
« domestique », celle à miel), qui accomplissent l'essentiel du
« boulot » de pollinisation, on estime que le Grand Lyon en abrite
au moins deux cents. « On ne va pas sauver les abeilles avec les
villes. Mais dans l'état actuel, la ville peut être un refuge
transitoire, complémentaire des zones naturelles. Cela permettra
ensuite de recoloniser des espaces saccagés », explique Hugues
Mouret, de l'association Arthropologia, cheville ouvrière du projet
Urban Bees porté en partenariat avec l'Institut national de la
recherche agronomique d'Avignon. Le but de cette étude : comprendre
comment les abeilles évoluent en ville et de quelle manière elles
pourraient vivre mieux. Vingt-quatre sites seront suivis dans le
Grand Lyon et la région, dont seize en ville et en périphérie (sur
les pentes de la Croix-Rousse, dans le parc de la Feyssine, de la
Tête d'Or, à Sainte-Foy-les-Lyon, etc.). Au cours du printemps, ils
seront aménagés tout confort : plantes mellifères et aromatiques,
nichoirs au sol et même « hôtels à abeilles », sortes de cabanes
emplies de tiges creuses et de bois mort. Ces sites serviront à
faire un état des lieux des populations, à tester différentes
techniques de gestion, mais aussi à inciter tout un chacun à aller
voir de plus près ces petites bêtes. Qui, contrairement à l'abeille
des ruches, n'ont pas un venin dangereux.
Projet européen :
Le projet Urban Bees s'est vu attribuer un million d'eurosdu
programme européen Life + Biodiversité, soit la moitié du budget
total. Le reste est pris en charge par l'Etat, la région Rhône-Alpes
et le Grand Lyon. Des actions de communication à destination du
grand public seront menées « en vue de favoriser la cohabitation de
l'homme et de la nature en ville ».
Nouvelles mines :
En
2004, un amateur anglais du nom de Bob Heckford remarque des chenilles d’un vert
brillant inhabituel minant des feuilles tendre de chêne dans les bois d’Hembury
(Devon, Royaume-Uni), une réserve du National Trust.
Cette semaine, la bête
est officiellement présentée au Muséum national d’histoire naturelle de Londres.
C’est une espèce nouvelle pour la science, Ectoedemia heckfordi,
Lépidoptère Nepticulidé.
Quelque chose de Neandertal en nous...
Surtout chez certains !!
Finalement, l'affreux jojo Neandertal n'est
pas si éloigné de nous. L'étude génomique menée par Svante Pääbo, le l'Institut
Max Planck montre que seule une poignée de gènes le distingue de nous, notamment
ceux d'entre eux qui contrôlent le développement cognitif et mental. Le génome
de Neandertal révèle encore que des histoires d'amour, ou de viol, ont dû se
dérouler entre cette espèce et la notre lorsque cette dernière est sortie
d'Afrique et avant qu'elle n'envahisse le monde. Bref, nous aurions tous quelque
chose de Neandertal. surtout certains d'entre nous ...!
(Le Point)
 Une
équipe internationale de recherche a séquencé le génome de l'homme de Neandertal
révélant des croisements avec des ancêtres de l'humain moderne, selon des
travaux publiés hier. Une
équipe internationale de recherche a séquencé le génome de l'homme de Neandertal
révélant des croisements avec des ancêtres de l'humain moderne, selon des
travaux publiés hier.
Comme on le soupçonnait déjà,1 à 4 % du génome de
l'homme d'aujourd'hui - 2 % de ses gènes - proviennent des Néandertaliens, notre
plus proche cousin apparu il y a environ 400 000 ans et éteint voilà 30 000 ans,
précisent ces chercheurs dont l'étude est parue dans la revue américaine
Science, datée du 7 mai.
« Nous pouvons désormais dire que selon toute
vraisemblance, il y a eu un transfert de gènes entre les Néandertaliens et les
humains », souligne Richard Green, professeur d'ingénierie bio-moléculaire à
l'Université de Californie à Santa Cruz.
Selon ces chercheurs, ce transfert
génétique a dû se produire entre 50 000 et 80 000 ans, probablement quand les
premiers homo sapiens ont quitté l'Afrique et rencontré les hommes de Neandertal
au Proche-Orient, avant de se répandre en Eurasie.
Le fait que des empreintes
génomiques néandertaliennes apparaissent dans le génome d'individus d'origine
européenne et asiatique mais pas chez les Africains tend à confirmer cette
hypothèse.
(La Dépêche du Midi)
Certains chercheurs n'ont pas attendu les généticiens pour se forger une
conviction. C'est le cas du paléoanthropologue
Erik Trinkaus (Washington University,
Saint Louis, Missouri), pour qui "il existe déjà en abondance des
preuves paléontologiques montrant des flux de gènes entre néandertaliens et
hommes modernes, résultant de l'absorption des populations des premiers par
l'expansion des seconds, il y a environ 40 000 ans".
Sauf, répond
Jean-Jacques Hublin, que la génétique suggère des métissages plus anciens,
puisque tous les Eurasiens, et pas seulement les Européens de l'Ouest, en
portent la marque : "Probablement ont-ils eu lieu du côté de l'actuel
Israël, où la frontière entre populations de néandertaliens et d'hommes modernes
a été fluctuante entre 120 000 et 50 000 ans", soit avant qu' Homo
sapiens n'entame sa marche triomphale à travers le globe.
Ce qui a fait
ce succès évolutif, Jean-Jacques Hublin espère le trouver non seulement du côté
des os – sa spécialité – ou de l'archéologie, mais aussi de celui des gènes.
L'article de Science ouvre en effet d'autres perspectives fascinantes :
disposer du génome de Neandertal offre un aperçu de ce qui fait la spécificité
d'Homo sapiens.
L'équipe internationale a ainsi mis en évidence
quelques gènes uniques à notre espèce, qui ont la particularité de jouer un rôle
dans le développement cognitif et le métabolisme énergétique. Lorsqu'ils sont
endommagés, certains sont impliqués aujourd'hui dans la trisomie 21, l'autisme
ou encore la schizophrénie. Un autre l'est dans la forme du crâne, de la
clavicule et de la cage thoracique.
(extrait d'un article du "Monde")
La fête de la Coupe du monde :
Elle s’est déroulée le 14 mai à Saiden,
dans l’état de Meghalaya (au nord de l’Inde). Petits et grands, munis de lampes,
se sont joyeusement répandus dans la forêt, à la recherche d’individus tout
frais de Coupes du monde - c'est ainsi qu'on les nomme.
Appelés traditionnellement
Niangtaser, Chremistica sp.
de leur nom scientifique, ces Hémiptères Cicadidés sont prestement insérés dans
un tube en bambou. Ainsi emprisonnées, les larves au bord de la mue imaginale ne
muent pas et, une fois lavées et cuisinées, constituent un mets très apprécié.
Ces cigales périodiques sortent
de terre tous les 4 ans, en synchronisme parfait - et avec exactement un mois
d’avance – avec ce grand événement footballistique !!
(OPIE-Insectes)
 Amours torrides
: Amours torrides
:
La demoiselle
Mnais costalis (Odon. Zygoptère Calopterygidae) est endémique des montagnes
japonaises ; elle y vit dans puis le long des torrents. Les imagos mâles,
territoriaux, s’efforcent d’intéresser les femelles par leurs acrobaties
aériennes. Mais les demoiselles demoiselles sont également très sensibles à leur
ardeur, mesurable en degrés centigrades.
Les systèmes d’imagerie infrarouge
en temps réel sont désormais à la portée des entomologistes. Une équipe
anglo-nipponne a ainsi pu évaluer à distance et sans les perturber la
température corporelle de mâles en pleine cour. Et établir que ce sont les plus
chauds qui ont le plus de succès.
Mademoiselle se donnera à un monsieur qui
possède du bien au soleil, autrement dit un territoire ensoleillé, un bout de
berge où elle sera à l’aise pour pondre et, le cas échéant, échapper à un
prédateur ; ses œufs se développeront plus rapidement et avec une mortalité
moindre. Bien échauffé, le monsieur fera plus de rencontres et aura plus de
descendants mais… s’il advient qu’il se pose à l’ombre, il perdra tout
rayonnement et deviendra un laissé pour compte.
(OPIE-Insectes)
Résidence du Collectif
“mmmmm” et de Patrick Bleuzen
 Loisirs Loisirs
Du 22 mai 2010 au 06 juin 2010
La Cité des insectes
Nedde
La Cité des insectes vous propose sa deuxième résidence de 2010 avec des grands
voyageurs pour explorer notre thème de l'année Hommage à la Vie et à la
Biodiversité!
PROGRAMMATION
Patrick Bleuzen, naturaliste passionné d'insectes et grand voyageur va nous
faire découvrir lors de sa résidence la prospection entomologique et ses
expériences en amazonie. Il va aussi nous permettre de nous approcher des
insectes vivants du limousin comme nous ne l'avons jamais fait en nous
permettant de participer à une chasse de nuit. Sortez vos appareils photos pour
pouvoir enregistrer un moment d'exception!
Adrian Fisher & Luna Montenegro membres du Collectif « mmmmmm » vont par leurs
performances et installation créer des liens entre les modes de séductions
utilisés par les insectes et l'homme. Ils vont explorer comment les insectes
utilisent les sons, la lumière et le la danse pour communiquer entre eux et
tenter d'entrer dans cette communication.
De nombreuses études scientifiques des comportements des insectes parlent de
rituels. Dans certains exemples de rituels de séduction, on retrouve des duos
chantants (moustiques), distribution de cadeaux (criquets), des flash de lumière
(verres luisants). Ces comportements ont inspirés Adrian et Luna dans leur
recherches de connections entre l'homme et l'insecte comme point de départ pour
leurs créations artistiques.
Adrian & Luna travaillent avec l'art performance et l'installation en galeries
et festivals depuis 10 ans. Ils explorent les idées de présence et de limitation
du corps, du rituel et localité. Ils ont créé plus de 50 performances en Europe
et Amérique Latine incluant : Institute of Contemporary Art, ICA, Londres, GB;
Bibliothèque Nationale de France, Paris; Palacio das Artes, Bello Horizonte,
Brazil; Musée d'Art Contemporain, Santiago, Chili et Centro de Cultura
Contemporanea, CCCB, Barcelone, Espagne.
Les artistes seront sur le site du 22 mai au 7 juin et vous pourrez échanger
avec eux sur leur travail et leurs expériences en Europe et en Amérique Latine.
Animations organisées par les artistes Luna & Adrian et le naturaliste Patrick
Bleuzen:
Samedi 29 mai - Dimanche 30
Vers la création de bactéries artificielles. Des chercheurs américains de
l'Institut Venter viennent de synthétiser le plus long ruban d'ADN jamais
construit. Une étape préliminaire vers l'obtention de bactéries de synthèse, qui
suscitent bien des interrogations.
L'institut Venter, du nom de son fondateur, le chercheur et homme d'affaires
Craig Venter, est parvenu à fabriquer le premier génome synthétique d'une
bactérie, selon des travaux mis en ligne jeudi par la revue scientifique
Science. Une première étape cruciale, mais encore hypothétique, vers la création
d'une première bactérie artificielle.
«Il s'agit de la plus grande structure d'ADN jamais construite par l'homme, et
c'est une avancée enthousiasmante pour nos chercheurs et pour cette discipline»,
se réjouit Dan Gibson, le principal auteur de ces travaux. «Toutefois, nous
continuons à travailler vers le but ultime, celui d'insérer un chromosome
synthétique dans une cellule.» En clair, l'Institut Venter espère fabriquer,
brique après brique, un génome sur mesure qui, une fois greffé dans une
bactérie, lui permettra de développer des propriétés radicalement nouvelles.
«Cela ouvre la voie à des applications potentielles importantes telles que la
production de biocarburants» , précise Hamilton Smith, microbiologiste de renom,
Prix Nobel de médecine en 1978, embauché par Craig Venter pour superviser ces
recherches. La bactérie cible, Mycoplasma genitalium, est très prisée des
chercheurs. Il s'agit en effet de l'un des organismes vivants les plus
primitifs, son ADN ne contenant guère plus de 580 gènes (quant l'homme en compte
autour de 30 000). Cela n'en constitue pas moins une séquence de 582 970 paires
de bases, les constituants de l'ADN.
Exploit technique
Réussir à synthétiser une telle molécule, dix fois plus longue que ce qui a
jamais été réalisé jusqu'ici, est sans conteste un exploit technique. «Mais
c'est une étape préliminaire, la seconde sera d'insérer cet ADN dans le
cytoplasme de cette bactérie et de vérifier s'il est vraiment opérationnel »,
explique le Pr Jean-Claude Ameisen, président du comité d'éthique de l'Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), qui pointe aussi les
risques liés à ces manipulations du vivant. «Il faut être certain que les règles
de protection mises en place seront aussi rigoureuses que celles adoptées dans
la recherche publique et qu'elles pourront être soumises à des contrôles.»
Il s'interroge également sur la communication orchestrée par Craig Venter. « S'il
y a de la rigueur dans l'annonce de ces résultats dans Science, ce n'est pas le
cas pour la communication en direction du public (annonce de possible production
de biocarburants) qui risque de susciter de faux espoirs. »
Plusieurs groupes de surveillance éthique canadien et britannique ont par
ailleurs critiqué ces travaux. « Nous pensons qu'il est inacceptable que des
entreprises privées bricolent les éléments de base de la vie pour leur propre
gain, sans réglementation démocratique » , a déclaré Jim Thomas, de l'ETC Group
au Canada, renouvelant son appel pour un moratoire. D'autant qu'il n'existe pour
l'instant aucun cadre face à cette possible création de vie artificielle.
Pauvre Balou !
Il est comme moi ! Il est temps qu'on lui trouve des femelles !
A coeur d'ours rien d'impossible ! Balou, un
ours des Pyrénées agé de 7 ans, s'est tout récemment approché des plages de
Narbonne (Aude), après avoir parcouru environ 150km à la recherche d'une
femelle. Des traces de l'animal, introduit en Ariège en 2006, ont été retrouvées
dans la nuit de samedi à dimanche, à une trentaine de kilomètres de la mer.
L'ONF explique cette escapade "exceptionnelle" par la période de rut que connaît
le mammifère. Des traces plus récentes suggèrent que l'animal de 120 kg a fini
par rebrousser chemin sans avoir pu satisfaire ses désirs. Malgré son caractères
très craintif, Balou avait déjà fugué en 2006, 2007 et 2008, mais n'était jamais
allé aussi loin ...
 Il aurait dû passer la frontière !! Vers
Figueras, ça ne manque pas de femelles disponibles !!! Il aurait dû passer la frontière !! Vers
Figueras, ça ne manque pas de femelles disponibles !!!
La saison venue tous les gamins prenaient le chemin de
l'école avec quelques " catinettes " (appellation locale de la cétoine dorée !)
dans une boîte d'allumettes.
À la " récré " le jeu consistait à les faire voler, un
fil attaché à la patte servant en quelque sorte de laisse. Pour avoir connu
cette époque, il me souvient qu'il fallait parfois longuement faire tournoyer la
malheureuse bestiole, pour l'inciter à prendre un essor rendu laborieux par
l'épuisement ou l'absence de soleil.
Autres temps, autres mœurs, de nos jours ces joies
simples ne sont plus de mise et dans les poches il y a sans doute plus de jeux
électroniques, voire de téléphones portables, que de "catinettes".
Reste que ces deux époques ont néanmoins un point
commun, à savoir qu'en classe mieux valait laisser la catinette dans sa boîte,
tout comme le portable se doit aujourd'hui de rester dans son étui !
André Lequet.
Le cafard vieux comme le monde :
Il est très aplati mais on reconnaît une sorte de
blatte. Avec des mandibules, des ailes, des pattes munies d’euplantulae (organes
adhésifs du tarse, différents de l’arolium) et terminées par des griffes. Et de
l’espèce Archimylacris eggintoni.
On n’est pas dans une enquête
policière, penchés sur un indice, en train d’examiner la victime d’une semelle.
L’insecte vivait au Carbonifère, il y a 300 à 350 millions d’années. À cette
époque, les animaux venaient de conquérir la terre ferme et, déjà, parmi eux,
les insectes étaient une composante importante de la faune, sous forme notamment
d’ancêtres de nos Dictyoptères (mantes, blattes dont termites) actuels.
A.
eggintoni est un fossile très répandu, cosmopolite. Mais, pour la première
fois, on a pu l’examiner sous toutes ses faces et découvrir ses appendices, sur
un modèle en 3 dimensions. Ceci au moyen du scanner à rayons X et des
ordinateurs de l’Imperial College à Londres.
Grâce aux détails morphologiques
révélés, on peut imaginer les traits de vie principaux de ce protocafard. Il se
nourrissait essentiellement au sol, de matière végétale en décomposition et de
cadavres (comme nos blattes forestières) ; ses pattes en faisaient une bête très
agile, se jouant des obstacles et capable de grimper et de se fi xer sur des
végétaux, sans doute pour pondre à l’abri de ses prédateurs.
Avec leurs
outils, nos archéo-entomologues britanniques s’attaquent maintenant à des
opilions et à l’inclassable Camptophyllia, Arthropodes de la même
ancienneté.
OPIE !
La Boudeuse" au large de la Guyane française, en février
2010.
 L'expédition tombe à l'eau ! La mission est avortée. L'expédition scientifique Terre-Océan, un des projets
phares du Grenelle de la mer, et confiée à Patrice Franceschi, le capitaine de
La Boudeuse, s'est arrêtée, mardi 1er juin 2010, à minuit. L'expédition tombe à l'eau ! La mission est avortée. L'expédition scientifique Terre-Océan, un des projets
phares du Grenelle de la mer, et confiée à Patrice Franceschi, le capitaine de
La Boudeuse, s'est arrêtée, mardi 1er juin 2010, à minuit.
Plus un sou en poche, rien que des dettes. Le trois-mâts parti de Brest début
novembre 2009 aura parcouru à peine la moitié de sa route : traversée de
l'Atlantique, étude du littoral de la Guyane française et arrivée au Venezuela,
où il devait explorer le bassin de l'Orénoque. Il n'ira pas plus loin que
Caracas.
Mercredi, il devait quitter le port vénézuélien pour rejoindre la
base navale française de Fort-de-France, en Martinique. Et y être probablement
vendu pour rembourser les créanciers. Un véritable désastre.
Tout avait
pourtant commencé dans un bel enthousiasme. Le 7 janvier 2009, Patrice
Franceschi recevait une lettre de mission du ministre de l'écologie,
Jean-Louis Borloo, comme en son temps, le navigateur-explorateur
Louis-Antoine de Bougainville obtint la sienne de Louis XV pour guider sa
frégate La Boudeuse autour du globe, de 1766 à 1769. Un parallèle
historique largement mis en avant par les pouvoirs publics.
Bougainville fut
le premier navigateur français à emmener avec lui des "savants" et à s'aventurer
sur les mers pour des raisons plus scientifiques que militaires ou commerciales.
Terre-Océan s'inscrivait dans cette tradition de l'exploration maritime
française "désintéressée".
LES DONS PROMIS NE SONT PAS ARRIVÉS
Grâce aux scientifiques embarqués à son bord, la mission de
deux ans, soutenue officiellement par une douzaine de sponsors et huit
partenaires techniques, devait aider à mieux évaluer l'impact du réchauffement
climatique sur la planète et à sensibiliser les publics rencontrés lors du
périple à une écologie plus humaniste.
La première année, la navigation
visait les bassins des grands fleuves d'Amérique du Sud. Au cours de la seconde,
il s'agissait de visiter les îles du Pacifique menacées par les eaux. Le tout
pour un budget d'environ 2,5 millions d'euros.
BNP Paribas, partenaire depuis
plus de quinze ans de La Boudeuse – de 2004 à 2007, le trois-mâts
réalisa un tour du monde consacré aux peuples de l'eau – est aussi son sponsor
principal (500 000 euros) dans la mission Terre-Océan, acceptant d'être le
banquier de l'opération, avec l'ouverture d'une ligne de crédit équivalente
"aux engagements de l'ensemble des partenaires".
Mais tous les dons
promis ne sont pas arrivés. Et si la banque fut un relais de trésorerie pendant
plusieurs mois, elle a décidé aujourd'hui d'arrêter cette fuite en avant : au
total, à peine un million d'euros a été réuni.
UN COÛT DE 50 000 EUROS PAR MOIS
Du côté de l'entourage de Patrice Franceschi, on pointe
surtout du doigt le ministère de l'écologie, qui serait revenu sur une promesse
verbale d'aide financière de l'ordre de 500 000 euros, crise et restrictions
budgétaires obligent. Aucun commentaire officiel, pour le moment, auprès du
cabinet de Jean-Louis Borloo.
In fine, les dépenses engagées – La
Boudeuse coûte, en expédition, 50 000 euros par mois en moyenne – et les
dettes antérieures conduisent à un trou estimé de 400 000 euros.
Sur le site dédié à
l'expédition, Patrice Franceschi a écrit, mercredi 2 juin, "Le dernier
mot du capitaine" afin d'expliquer à ses amis l'échec de la mission :
"Sans doute, l'époque n'est-elle plus à ce type d'engagement et au rêve
désintéressé (…). Vous l'aurez compris, les mathématiques comptables,
inexorables et implacables dans leur roide froideur, ont fini par nous rattraper
et nous imposer leur joug."
Désormais, le navigateur n'a plus qu'une idée en tête: tenter
d'éviter de vendre La Boudeuse pour rembourser les créanciers. Mais,
sans une aide ultime, il ne voit pas comment éviter que le trois-mâts, un des
derniers navires traditionnels au monde à effectuer de grandes missions
d'exploration, ne se retrouve sur le marché. L'élan épique de l'aventure sera
alors épuisé.
http://la-boudeuse.org/photos-terre-ocean
Une excellente initiative :
Le Jardin des papillons de Digne-les-Bains fait des petits !
L’association Proserpine est heureuse
d’avoir activement participé ces deux dernières années à l’aménagement d’un
nouveau Jardin des papillons à Flassans, dans le Var (83). Un espace de 7000 m²
dans le Parc de l’Aoubré où déjà une soixantaine d’espèces de papillons de jour
méditerranéens ont été inventoriés. Dans les Hautes-Alpes, c’est une prairie
naturelle dans le versant nord de la Montagne de Chabre qui a été aménagée en
clairière à papillons accessible aux personnes handicapées.
On ne peut que se féliciter de ce « mitage
positif » au moment où 6000 hectares d’espaces naturels disparaissent chaque
année en France sous la pression foncière. Attention toutefois à ne pas
sanctuariser la nature, en préservant quelques parcelles comme des oasis dans un
monde sans vie, aseptisé, sans diversité. Chacun peut agir dans son jardin en
abandonnant par exemple l’utilisation des pesticides dont les effets nocifs et
durables sur l’ensemble de notre environnement sont démontrés. Il est démontré
aussi depuis longtemps que ces produits chimiques ne sont pas indispensables
dans les jardins.
http://web.me.com/papillons.aoubre
L'Homme est un cousin des singes actuels :
L’Homme n’est pas un singe évolué. Dans la
grande famille des primates supérieurs, notre branche (les hominidés) s’est
séparée de celle des gorilles, bonobos et chimpanzés, nos plus proches parents.
A quel moment la lignée des grands singes et la lignée des hominidés se
sont-elles séparées ? Officiellement, cette séparation remonterait à environ 7
millions d’années.
Mais, une récente découverte remet en cause cette date et
fait remonter la séparation à 13 millions d’années
 Un lémurien Un lémurien
Un ancêtre commun
:
Les premiers primates, groupe auquel nous appartenons, sont
apparus il y a plus de 65 millions d’années.
Les scientifiques ont toujours pensé que les singes et les hominidés ont un
ancêtre commun, un primate inconnu.
L'ancêtre des primates serait un minuscule mammifère appelé purgatorius, qui
vivait il y a 70 millions d'années.
Les primates se caractérisent par leurs mains et leurs pieds préhensiles, leur
cerveau volumineux et leur large champ de vision.
Le groupe des primates comprend des formes primitives comme les lémuriens et des
formes plus évoluées comme les grands singes et les hommes.
 Crâne de Proconsul africanus Crâne de Proconsul africanus
Les grands singes apparurent
entre 30 et 25 millions d’années. La lignée évolutive qui mène à l’Homme dérive
des grands singes.
Cependant, les singes sont nos cousins et non nos ancêtres. Le dernier ancêtre
commun entre les grands singes africains et l’Homme remonte à 6-7 millions
d’années.
Les premiers grands singes africains connus appartenaient à la famille des
Proconsulidae, qui tire son nom de Proconsul africanus.
Crâne d'Adapis parisiensis, un primate adapidé de la fin
de l'Eocène
L’Homme est considéré comme un
primate anthropoïde et fait partie, comme l’orang-outan, le chimpanzé ou le
gorille, de la famille des hominidés.
Cependant, les relations précises entre les différents groupes sont difficiles à
établir. D’autant plus que chaque nouvelle découverte bouleverse les hypothèses
sur nos origines.
Celle qui vient d’être faite
par des chercheurs français au Kenya suggère que la séparation entre l'Homme et
les grands singes est intervenue plus tôt qu'on ne le pensait, il y a 13
millions d'années.
Une séparation beaucoup plus ancienne
 Les chercheurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle
ont étudié quatre dents provenant de la formation géologique de Ngorora, vieille
de 12,5 millions d'années, et trois dents retrouvées dans la formation de
Lukeino, vieille de 5,9 millions d'années. Les chercheurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle
ont étudié quatre dents provenant de la formation géologique de Ngorora, vieille
de 12,5 millions d'années, et trois dents retrouvées dans la formation de
Lukeino, vieille de 5,9 millions d'années.
Une molaire inférieure droite trouvée à Ngorora ressemble aux molaires du
chimpanzé. Pour les paléontologues, l'âge du fossile suggère que la séparation
entre les grands singes et les hominidés est ainsi intervenue plusieurs millions
d'années plus tôt que ce que l’on pensait.
Si les dents de Ngorora présentent des similitudes avec celles des chimpanzés
actuels, celles de Lukeino s’apparentent davantage à celles des gorilles.
Les dents de Lukeino sont également distinctes de celles d’Orrorin tugenensis,
un hominidé de 6 millions d’années découvert par les mêmes chercheurs au Kenya.
Les molaires d’Orrorin, capable de bipédie, rappellent celles des hominidés plus
tardifs, comme les australopithèques ou les Homo, précisent les auteurs dans la
revue Anthropological Science.
Donc, pour la première fois,
les grands singes quadrupèdes et les hominidés bipèdes sont signalés dans les
mêmes couches géologiques en étroite association.
Cette découverte dément également la théorie selon laquelle l'Homme est né de la
savane.
Les indications obtenues sur le paléo-environnement révèlent que, tout comme les
grands singes, ces humains archaïques ont vécu, du moins à cette période, dans
une forêt assez humide.
Chasser au Guatemala :

http://josemonzongt.com/expeditions.html
Le moustique-tigre est à Marseille !
Il vient d'être observé récemment (début juin
2010) dans certains quartiers de Marseille. Il est également présent depuis
quelques années dans les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. Le Ministère de la
santé précise "qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'épidémie", mais juge la
situation suffisament sérieuse pour décider de lancer des actions pour limiter
une propagation des virus (chikungunya, dengue) .....
Il est particulièrement
recommandé aux populations locales de supprimer les eaux stagnantes qui
contiennent les larves (gouttières, pneus usagés ...).
Un vrai GPS miniature :
Jamais une fourmi du désert n'a perdu le
chemin de son nid, même lorsqu'elle s'aventure très loin de lui. Pourtant
celle-ci, au contraire de ses congégères, ne peut compter sur un marquage aux
phéronomes, car l'évaporation et le vent les disperseraient. Mais la fourmi est
pleine de ressources; elle a inventé un système de repérage mental
ultrasophistiqué qui vaut bien nos GPS ultramodernes : tout au long de sa
vadrouille, elle s'arrête à maintes reprises pour photographier mentalement le
paysage. Matthew Collett (Université d'Exeter) a même constaté qu'elle parvient
a mémoriser des itinéraires courbes. Ainsi, pour revenir à son nid, n'a t-elle
qu'à se repasser en sens inverse les images de son parcours aller. Cette méthode
qui consiste donc à fractionner un itinéraire en une succession de panoramas
enregistrés mentalement est si astucieuse que Matthew la verrait bien utilisée
par des robots pour se déplacer d'une manière autonome !
(Le Point)
Miel miracle :
C'est confirmé : le miel possède bien des
vertus antibiotiques. Des chercheurs hollandais sont parvenus à isoler dans
celui-ci la protéine défensine-1 tueuse de microbes qui fait partie du système
immunitaire de l'abeille. Ces scientifiques s'ingénient, dorénavant, à renforcer
son efficacité pour produire un nouvel antibiotique.
 Des scarabées au secours
des agriculteurs : Des scarabées au secours
des agriculteurs :
Aline
BOURSAULT est jeune chercheuse en agroécologie au laboratoire « Biologie et
Gestion des Adventices » de l’INRA* de Dijon et de l’Université de Bourgogne. La
mission des chercheurs de cette unité de recherche est d’étudier les effets des
pratiques agricoles sur les mauvaises herbes (les adventices) et d’essayer de
concevoir des moyens de lutte respectueux de l’environnement. Les travaux
d’Aline portent plus précisément sur des animaux a priori sans rapport avec les
mauvaises herbes : les scarabées. Pourtant, certaines espèces de scarabées
présentes dans les champs se nourrissent de graines de mauvaises herbes. Aline
tente d’évaluer les conséquences de cette consommation sur le développement des
adventices dans les champs. Elle pourra ainsi estimer la portée du service rendu
aux agriculteurs par les scarabées.
Papillonnite
:
La commune de Sinnamary (à l'est de la Guyane) est envahie par des nuées de
papillons urticants qui forcent les habitants à s'enfermer chez eux le soir. En
effet, les femelles du Papillon cendre (Hylesia metabus, Lépidoptère
Saturniidé) se rassemblent autour des lumières, projetant en vol des
"fléchettes" (écailles) urticantes. Alors qu'en 1994, l'invasion de Kourou avait
été combattue par l'armée à coup de traitements insecticides et de déboisements,
la lutte est ici du type "psychique" : des pièges lumineux sont tendus et
éclairés (c'est un procédé de chasse très connu des entomologistes) et imprégnés
d'insecticide (les entomologistes "cueillent" les spécimens intéressants à la
pince).
Vue d'une femelle posée sur un élément de menuiserie. Elle
adopte une posture caractéristique de "défense" en exposant les zones de son
abdomen recouvertes de fléchettes urticantes (photo J.-F. Silvain).
Des scarabées nuisibles et peu
mélomanes :
Une étude menée par Richard Hofstetter,
professeur en entomologie à la Northern Arizona University, pourrait déboucher
sur une solution non chimique pour le contrôle de certaines populations de
scarabées nuisibles. Ces scarabées s'attaquent à plusieurs espèces d'arbres et
la dérégulation de leur population, causée par le réchauffement climatique et
les activités humaines, les rend aujourd'hui dangereux pour l'écosystème. Afin
de combattre ces infestations, les chercheurs arizoniens ont étudié l'effet que
pouvaient avoir divers sons sur le comportement des scarabées. Ils ont pour cela
observé l'évolution des colonies de scarabées infestant plusieurs arbres
transportés dans leur laboratoire. Ils ont découvert que les sons violents
avaient une influence sur la reproduction des scarabées ainsi que sur leur
capacité à creuser des galeries dans le tronc des arbres.
Les premiers
échantillons sonores utilisés par les chercheurs ont été des enregistrements de
groupes de heavy-metal et de rock. Ces styles musicaux sont en effet très
dynamiques et contiennent des impulsions sonores fortes et rythmiques mais
également des périodes de silence. Cette caractéristique a, d'après Hofstetter,
plus de chances d'avoir un effet sur les scarabées. L'expérience a montré que
c'était effectivement le cas mais également que les scarabées s'habituaient
rapidement à cette ambiance sonore et finissaient par ne plus y prêter attention
après quelques temps. Les chercheurs ont ensuite concentré leurs efforts sur les
sons émis par les scarabées eux-mêmes. Ils ont enregistré un "cri" agressif
produit par une espèce de scarabée et en ont modifié la longueur et l'intensité.
Ils ont ensuite soumis des coupes de tronc infesté à ces sons et observé les
effets sur le comportement des insectes. Les résultats sont prometteurs : ce
type de son affecte la reproduction des scarabées et l'endommagement causé à
l'arbre. Dans certains cas, les chercheurs ont même observé qu'il pouvait
pousser les scarabées à s'entretuer.
Bien qu'une poursuite de la
recherche fondamentale soit nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de
l'audition chez les scarabées, l'équipe de l'Université d'Arizona cherche
actuellement à mettre au point un système, possiblement basé sur les ultrasons,
afin de combattre de façon "verte" ces infestations jugées catastrophiques dans
certaines régions. C'est en particulier le cas des Rocheuses et de l'Ouest du
Canada, où certaines espèces de scarabées ont provoqué la destruction de
plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés de forêt. Les conséquences
de cette dévastation sur l'écosystème proche sont importantes : la destruction
des arbres modifie l'ensoleillement du sol et la rétention d'eau par les plantes
qui y poussent. Ces modifications sont couplées à la libération de grandes
quantités de dioxyde de carbone "stockées" dans les arbres ainsi que de
molécules organiques volatiles pouvant former des polluants hautement toxiques
par contact avec certaines molécules atmosphériques telles que l'ozone. Les
conséquences sur le réchauffement climatique sont importantes puisqu'il est
estimé que 270 mégatonnes de dioxyde de carbone seront libérées entre 2000 et
2020 par les déprédations des scarabées dans la région de Colombie Britanique.
Ce chiffre représente la réduction d'émission de gaz à effet de serre à laquelle
le Canada doit parvenir d'ici 2012 dans le cadre de l'accord de Kyoto.
Hommage à Pierre Jauffret et honte au Brésil :
 Pierre
Jauffret n'est plus. Nous ne lirons plus ses notes régulières sur les Riodinidae
du Brésil. Il avait encore beaucoup à faire, passionné par la faune de sa
région, à l'embouchure de l'Amazone, sur les traces de Henri W. Bates, persuadé
qu'il était l'un des derniers à témoigner de la riche biodiversité de cette
région avant la disparition inéluctable de la forêt (par la faute de la
surpopulation et de la bêtise humaines !!!). Pierre
Jauffret n'est plus. Nous ne lirons plus ses notes régulières sur les Riodinidae
du Brésil. Il avait encore beaucoup à faire, passionné par la faune de sa
région, à l'embouchure de l'Amazone, sur les traces de Henri W. Bates, persuadé
qu'il était l'un des derniers à témoigner de la riche biodiversité de cette
région avant la disparition inéluctable de la forêt (par la faute de la
surpopulation et de la bêtise humaines !!!).
Il étudiait les Riodinidae
autour de sa demeure, une traditionnelle bâtisse en pur bois wacapou entourée
d'une végétation primaire de 30 hectares avec un petit "igarape" au milieu. Il
avait lutté pour la sauvegarde de ce petit paradis, ayant réussi, après de
longues et complexes difficultés administratives, à en faire une réserve
nationale, alors qu'autour, depuis 50 ans qu'il avait acheté cette propriété à
50km de Belém, il avait vu petit à petit la forêt disparaître. Tout récemment
encore (début 2009), les fameux "sem terra" venaient d'envahir les propriétés
voisines et abattre les quelques bosquets qui restaient pour y imposer leurs
cabanes de bois et de torchis et y survivre (arrêter de vous multiplier, bandes
de râts ...!). Des groupes organisés qui n'ont pas eu peur d'attaquer et de
mettre à sac la garnison de police du village proche de Santo Antonio de Tauá
!
Il se sentait menacé, mais il ne pouvait quitter ce lieu, vivant enfin son
rêve réalisé après une vie de travail et d'exploration dans les forêts de Java
et surtout d'Amazonie qu'il sillonnait après son arrivée en Guyane en 1962.
Depuis 6 ou 7 ans, nous le rencontrions dans son bureau, auprès de sa
collection, travaillant inlassablement à ses découvertes entomologiques, le
filet à portée de la main, ayant un œil à sa fenêtre pour surveiller les
insectes sur ses Cordia en fleurs ! Il avait ses chiens pour le prévenir
d'éventuelles visites.
Ses enfants et son épouse vivaient dans leur maison de
Bélem. Ils venaient souvent le voir le week-end. Il accueillait aussi ses amis
entomologiques de toutes provenances.
Il était conscient de l'insécurité de
son environnement. Il craignait pour sa vie et son corps était usé par le
travail. Malgré cela (ou à cause de cela ...?), il a énormément publié en peu de
temps (15 notes en 3 ans) mais il y avait donc urgence ...
Dimanche 29 novembre
2009, "ils" sont venus, à plusieurs paraît-il, "ils" l'ont agressé violemment,
comme cela se passe parfois dans le nord du Brésil. Il était seul, personne n'a
rien vu. Découvert dans le coma, il est décédé des suites de ses blessures, sans
avoir repris connaissance ...
Ce pays est pourtant si beau, si
exceptionnellement riche de sa nature forte; mais il est trop vaste pour que,
malgré la bonne volonté du gouvernement, les lois soient respectées.
Pierre
nous laissera le souvenir d'un homme simple, humain, avec du caractère certes,
mais passionné et très sympathique. Avec ses publications entomologiques
récentes, il laisse une importante collection de Rhopalocères amazoniens, dont
celle des Riodinidae, enrichie par les legs de l'Université de Curitiba avec qui
il était en étroite collaboration (Dr. Olaf Mielke). Souhaitons qu'elle arrive
en bon état dans un musée brésilien et que son fils Laxques Corécha-Jauffret y
prenne appui pour poursuivre son œuvre.
Sur les traces des premiers insectes :
expédition événement au Spitzberg
Avec Romain Garrouste, entomologiste et écologue
Une équipe de cinq chercheurs français s’envole dès le 8 juillet 2010 pour un
mois au Spitzberg, à la recherche des premiers insectes fossilisés. Ils vont
braver les conditions climatiques et les ours blancs, pour tenter de découvrir
les premières lignées d’insectes ailés et tenter de valider l’hypothèse selon
laquelle les insectes trouveraient leurs ancêtres dans la faune marine.
Rencontre avec Romain Garrouste, paléo-entomologiste, 48 heures avant le grand
départ.
L’expédition est une première : jamais personne n’avait pour l’heure mener des
fouilles au Spitzberg sur les insectes. « Il faut dire que la paléoentomologie
est une discipline ancienne mais on ne s’est que tardivement intéressé à
l’apport de la paléoentomologie dans la compréhension de la biodiversité »
explique Romain Garrouste.
 Les recherches de fossiles ne sont possibles que l’été, avant que les glaciers
ne recouvrent les potentiels espaces de recherche Les recherches de fossiles ne sont possibles que l’été, avant que les glaciers
ne recouvrent les potentiels espaces de recherche
Le Spiztberg s’est révélé une évidence pour mener des fouilles sur ce qui
pourrait être l’apparition des premiers insectes, à l’ère du Dévonien (de 417 à
350 millions d’années). « Les strates de sédiments au Spitzberg sont
l’équivalent d’une mangrove, idéal pour nous qui cherchons à faire la passerelle
entre la vie marine et la vie terrestre. L’hypothèse serait que les ailes des
insectes se sont développées à partir de branchies trouvant sur les pattes des
ancêtres des plécoptères, (parent officiel des insectes actuels). Ces branchies
auraient permis initialement à ces insectes de respirer sous l’eau ».
L’enjeu de cette expédition est de taille car à ce jour, très peu de gisements
de fossiles d’arthropodes terrestres ont été découverts dans le monde.
« On connait bien les insectes géants à l’ère du Carbonifère, avec des
libellules primitives qui possédaient des ailes de 60 cm, des scorpions de 75 cm
ou des mille-pattes gigantesques". Notre objectif consiste à remonter encore
plus loin dans le temps, là où les indices sont encore plus minces et où les
interactions entre les disciplines sont importantes. c’est la raison pour
laquelle nous partons avec un géologue, un malacologue (étude des escargots), et
bien-sûr, des paléoentomologistes ».

Pendant 5 semaines, les chercheurs vont mener des fouilles dans de grands
espaces isolés. L’équipe pourrait bien croiser sur son chemin des ours blancs,
alléchés par l’odeur des provisions.
Romain Garrouste est paléoentomologiste, écologue, chercheur au Muséum national
d’histoire naturelle et à l’ Université du Sud - Toulon - Var.
L’équipe réunit 6 spécialistes reconnus :
André Nel reste en France. Paléoentomologiste, responsable des collections
d’arthropodes terrestres du Muséum national d’Histoire naturelle (UGC Zoologie
arthropodes terrestres), c’est le responsable de la mission
Jean-Claude Roy, géologue, Institut de France, adjoint du chef de mission,
responsable sur le terrain, bénévole au Muséum
Jean-Michel Bichain, malacologue, attaché au Muséum, responsable logistique de
la mission
Dany Azar, paléoentomologiste, Université Libanaise, Beyrouth, Liban, associé au
Muséum ;
Cyrille d’Haese, entomologiste, Muséum
Romain Garrouste, entomologiste et paléoentomologiste au Muséum.
En savoir plus :
Vous pouvez suivre les aventures de cette équipe en consultant le blog :
http://caracolexpedition.wordpress.com/
Une nouvelle "palette" pour reproduire les couleurs des papillons
:
Les billets de banque seront-ils un jour aussi beau que les
ailes des papillons? Des chercheurs s’inspirent des reflets de ces insectes pour
créer de nouveaux procédés d’impressions sécurisés.
Les couleurs de Papilio blumei combinent deux teintes,
qui varient selon l'angle de vue, grâce à une incidence différente
de la lumière. (Photos: M teintes, qui varient selon l'angle de vue,
grâce à une incidence différente de la lumière. (Photos: Mathias
Kolle, University of Cambridge)
 Pour imiter les magnifiques couleurs des ailes de papillons, et surtout
les reflets irisés de certains, créer de nouveaux pigments ne suffit pas.
Les papillons ou d’autres insectes comme les scarabées doivent leurs reflets
aux structures nanoscopiques de leurs ailes ou de leur cuticule qui
renvoient la lumière d’une façon particulière. Pour imiter les magnifiques couleurs des ailes de papillons, et surtout
les reflets irisés de certains, créer de nouveaux pigments ne suffit pas.
Les papillons ou d’autres insectes comme les scarabées doivent leurs reflets
aux structures nanoscopiques de leurs ailes ou de leur cuticule qui
renvoient la lumière d’une façon particulière.
Une équipe de
l’Université de Cambridge (GB) s’est inspirée de l’aile bleue-verte d’un
papillon indonésien (Papilio blumei) pour recréer des structures
produisant ces intenses couleurs. Vue au microscope, l’aile du papillon
dévoile une surface composée de creux réguliers.
Effets optiques :
Pour
reproduire les propriétés optiques de cette surface, Mathias Kolle et ses
collègues ont utilisé plusieurs procédés d’élaboration nanoscopiques, comme
le dépôt de couches atomiques ou l’auto-assemblage.
Ils ont obtenu une
structure similaire, qui ressemble un peu à une boîte à œufs, qui imite la
capacité des ailes du papillon à mélanger deux couleurs. En fonction de
l’incidence de la lumière, la structure apparait plutôt bleue ou plutôt
verte.
L'aile du papillon vue au microscope (en haut). La
structure fabriquée par les chercheurs (en bas), composée de 11 couches
successives de dioxyde de titane et d’oxyde d’aluminium. (Mathias Kolle)
Dans la nature, cette propriété optique pourrait permettre aux papillons
de se dissimuler aux yeux des prédateurs tout en gardant ses belles couleurs
bleues pour être identifié par ses congénères.
Les chercheurs, qui
publient un article cette semaine dans la revue Nature
Nanotechnology, envisagent d’appliquer ces résultats à la mise au point
de nouveaux procédés d’impression sécurisée, comme pour l’encre des billets
de banque.
Sciences et Avenir.fr
Un sacré coup de filet chez les auchenorrhynques...
 Près
de 70 entomologistes ont parcouru le Ventoux hier à la recherche de
ce cousin de la cigale Près
de 70 entomologistes ont parcouru le Ventoux hier à la recherche de
ce cousin de la cigale
Les entomologistes ont fauché hier à grands coups de filet les
pentes du Géant de Provence pour capturer des auchenorrhynques,
insecte cousin de la cigale...
Armés jusqu'au bout des ongles, motivés comme jamais, 70chasseurs
entomologistes venus du monde entier ont parcouru le Ventoux hier à
la recherche d'une proie un peu particulière, appelée
auchenorrhynque... Derrière ce nom aussi barbare se cache une petite
bébête, cousine de la cigale, phytophage (qui se nourrit de la sève
des arbres) et sujet principal d'étude du 13e congrès international
organisé à Vaison-la-Romaine toute la semaine par le Museum national
d'histoires naturelles de Paris.
Hier donc, Américains, Japonais, Allemands et autres Tchèques ont,
pour une fois, tous parlé le même langage, celui de la chasse aux
auchenorrhynques. Qui dit même langage dit même technique: un coup
de filet dans les herbes et les fleurs et un rapide coup d'oeil pour
voir ce qui a été récolté. "Le but de cette sortie de terrain est de
capturer certaines espèces rares pour les étudier, explique Thierry
Bourgoin, organisateur du congrès et directeur adjoint des
collections du Museum d'histoires naturelles. C'est une source de
travail incroyable pour nous mais également pour les producteurs
locaux, qui seront les principaux bénéficiaires de nos travaux"
(voir encadré).
Lâchés sur les pentes du Mont Chauve, les entomologistes ont
cherché, taillé, fauché toute la journée, avant de redescendre sur
Malaucène, fiers d'avoir fait un sacré coup de filet chez les
auchenorrhynques...
Bien armés! Les entomologues disposent de trois "armes" pour
capturer les auchenorrhynques. Ils utilisent un filet faucheur,
comme les chasseurs de papillons, qu’ils passent à travers les
plantes et les fleurs pour piéger les insectes. Ils mettent ensuite
la tête à l’intérieur, pour ne pas que les bêtes s’enfuient et
vérifient si leurs prises sont bonnes. Ils peuvent également se
servir d’un aspirateur à bouche, pour aspirer les bestioles dans un
petit tube, sans toutefois prendre le risque de les avaler. Enfin,
les spécialistes du genre apprécieront le "parapluie japonais", qui
sert aux spécialistes pour taper sur les feuilles et faire tomber
directement les insectes dans un emplacement prévu à cet effet.
L'analyse de David Ouvrard, organisateur du congrès : "Il y a deux
types d’études autour des auchenorrhynques, explique David Ouvrard,
l’un des organisateurs du congrès. Il y a les entomologistes qui
étudient les bêtes pour en savoir plus sur elles, leur histoire,
leur composition, leur évolution, leur façon de vivre, etc. Et il y
a ceux qui font de l’entémologie appliquée et qui travaillent plus
sur les maladies que peuvent transmettre les auchenorrhynques aux
plantes, notamment aux vignes et aux lavandes."
"Et c’est cet aspect-là qui peut être très utile pour les acteurs du
Mont Ventoux, poursuit David Ouvrard, car les recherches permettront
peut-êtres de trouver des remèdes aux maladies transmises par les
bêtes, et par la même occasion empêcher la contamination des vignes
dans une région qui vit beaucoup de sa culture maraîchère. C’est une
étude qui est bien plus utile qu’il n’y paraît." Ce n’est pas les
producteurs du Ventoux qui vont les contredire...
Une galerie d'art parisienne prise d'assaut
par des abeilles : (AFP) –
3 juin 2010
PARIS — Une galerie d'art contemporain parisienne située dans
la prestigieuse rue Saint-Honoré (8e arr.) a été prise d'assaut jeudi par une
colonie de plusieurs milliers d'abeilles, qui, à l'étroit dans leur ruche,
étaient en quête d'un nouveau logis.
"De mon bureau, j'ai vu des éléments tomber du ciel. Je me
suis rapproché et j'ai vu un gigantesque nuage d'abeilles qui s'agglutinaient
sur mes vitrines", a raconté à l'AFP Pascal Dubois, propriétaire de la galerie
Colette Dubois.
"C'était très impressionnant, j'ai pensé tout de suite aux
oiseaux d'Hitchcock", ajoute-t-il, plutôt amusé a posteriori.
Selon Simon-Pierre Delorme, apiculteur qui est intervenu pour
les recueillir cet essaim de taille moyenne (2kg, soit environ 20.000 abeilles),
le phénomène est assez classique en mai et juin.
Lorsque une colonie grandit et se sent un peu à l'étroit dans
une ruche, la moitié part avec la vieille reine en quête d'un nouvel habitat.
Les abeilles se collent alors quelque part à la hâte et envoient des
exploratrices trouver un logement à leur goût, qui reviendront les chercher une
fois leurs visites terminées.
Pourquoi une vitrine de galerie de peintres figuratifs ? "Les
essaims se mettent un peu n'importe où. Il suffit que les premières s'installent
quelque part et les autres suivent", explique le "cueilleur d'essaim", suivant
la terminologie en vigueur.
"Dans cette situation, elles n'ont ni maison, ni enfants, ni
larves à défendre, elles ne sont donc pas agressives", précise-t-il.
Ces abeilles ont probablement grandi dans Paris intra muros,
qui compte actuellement quelque 300 ruches, car elles se déplacent en général
dans un rayon d'environ 5 km.
"Je vais les installer dans une ruche bien confortable",
explique Simon-Pierre, qui était toujours sur les lieux, mercredi en fin
d'après-midi, attendant patiemment que toutes soient revenues.
"Elles continuent à rentrer gentiment dans la boite. Cela
peut durer jusqu'à ce soir. Je dois attendre le retour des exploratrices".
Après cette après-midi ensoleillée rive droite, les abeilles
devraient poursuivre leur vie parisienne rive gauche, leur apiculteur d'adoption
possédant des ruches dans le 14e arrondissement.
 Ventoux
: interpellé en train de capturer des insectes protégés !! Ventoux
: interpellé en train de capturer des insectes protégés !!
Publié le jeudi 17 juin 2010
à 17H27
Le Carabe doré (Carabus auratus) est un insecte rare
(Soula : NON ! la forme chromatique chassée au Ventoux, honnoratii,
est rare !), qui bénéficie d’une protection intégrale par Arrêté
Ministériel en date du 23 avril 2007 et dont l’habitat est également
protégé par Arrêté Préfectoral de Biotope du 13 novembre 1990.
Un homme, originaire des Alpes-Maritimes, a été interpellé par les
agents du Service Départemental de l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage, le 5 juin dernier dans le massif du Mont
Ventoux, révèle l'ONCFS. L'individu procédait à la capture illicite
de Carabes dorés, un insecte rare et protégé, grâce à plusieurs
pièges qui ont été saisis. Il risque six mois d’emprisonnement et 9
000 euros d’amende, les faits constituant un délit pénal.
Une découverte qui peut révolutionner
l'histoire de la vie sur Terre :
Des chercheurs du
CNRS ont découvert au Gabon des fossiles qui apporteraient la preuve
de l'existence d'organismes multicellulaires il y a 2,1 milliards
d'années. Jusqu'à aujourd'hui, les premières formes de vie complexe
attestées remontaient à 600 millions d'années environ.
Macrofossiles multicellulaires complexes et organisés trouvés au
Gabon.
Des fossiles de deux milliards d'années
C'est au creux d'un site fossilifère situé à Franceville, au Gabon,
que l'équipe du CNRS et de l'Université de Poitiers a trouvé ces
échantillons en 2008. Il ne s'agissait au départ que d'étudier le
"paléo-environnement" très particulier de cette région mais les
chercheurs tombent sur de nombreux fossiles. Le coordinateur de
l'équipe, le géologue Abderrazak El Albani les envoie dans un
laboratoire pour un examen plus précis.
Quelques temps plus tard, en se fondant sur la composition et de la
forme des fossiles, le labo lui donne une datation approximative de
600 millions d'années. 600 millions d'années, c'est le moment où les
experts considèrent que les organismes multicellulaires sont apparus
sur Terre, les unicellulaires, comme les bactéries, remontant à 3,5
milliards d'années. Mais cette fois quelque chose ne colle pas...
En effet, le site gabonais est très connu des géologues qui y ont
procédé à de très nombreux carottages. La datation de
l'environnement minéral des fossiles ne fait aucun doute : à savoir
2,1 milliards d'années. Comment une forme de vie âgée de 600
millions d'années peut-elle être emprisonnée dans un caillou de 2
milliards d'années ?
L'équipe d'Abderrazak El Albani retourne alors sur le site gabonais
et collecte plus de 250 fossiles de 7 millimètres à 12 cm de
longueur pour les examiner plus en détails. Un passage au
microtomographe X (un scanner tridimensionnel à haute définition)
permet d'apprécier la complexité du fossile. Il s'agit bien d'une
forme de vie multicellulaire qui se trouve là, un milliard et demi
d'années plus tôt que ne le présente le calendrier historique !
Plusieurs pistes s'offrent désormais aux chercheurs : approfondir
l'histoire de ce bassin gabonais pour comprendre comment la vie a pu
y apparaître, explorer ce site, mais surtout, le plus urgent sans
doute, demander au gouvernement du Gabon de protéger cet endroit qui
constitue visiblement une pépinière de l'humanité. Même si plusieurs
experts reconnaissent que cette découverte "pose plus de questions
qu'elle n'apporte de réponses", son ampleur lui vaut la couverture
de la revue scientifique britannique Nature.
Des collègues dubitatifs...
"Interpréter réellement des anciens fossiles est une affaire
particulièrement difficile", nuancent Philip Donoghue de
l'Université de Bristol en Grande-Bretagne et Jonathan Antcliffe
dans un commentaire publié dans Nature, promettant des "futures
discussions entre paléontologues". "Ces fossiles de quelques
centimètres, que les auteurs interprètent comme représentant des
organismes multicellulaires", seraient apparus alors que
"l'atmosphère restait un mélange toxique (...) avec une teneur en
oxygène correspondant à quelques centièmes des niveaux actuels",
relèvent les deux experts. Sans mettre en doute la datation de ces
spécimens, ils notent que la définition d'une vie pluricellulaire
"peut tout inclure, des colonies de bactéries (unicellulaires, donc)
aux blaireaux
Arrêtons de nous multiplier !! Bordel !!
2010 : Tous les jours, 236 ha d'espaces naturels
disparaissent en France sous une coulée de béton. C'est le constat accablant
pointé hier par une étude du ministère de l'Agriculture qui souligne que
les champs et les forêts perdent l'équivalent d'un
département tous les 7 ans du fait de la construction de routes, d'équipements
sportifs, de bâtiments, etc.
Baisons, baisons, mais sans procréer !!!
Invasion d'insectes à Saint-Jean-d'Angély (17) :
Des insectes partout dans
les maisons des habitants de Fossemagne, un quartier de Saint-Jean-d'Angély,
et jusque dans les poils de leurs animaux domestiques. Ces triboliums
prolifèrent dans un entrepôt voisin où sont stockés des granulés.
Les
granulés débordent à l'extérieur des bardages, fait constater Jacky
Morin, un habitant de Fossemagne. PHOTO BERNARD MAINGOT
A Fossemagne, quartier légèrement excentré au sud de
Saint-Jean-d'Angély, les riverains de l'ancien bâtiment Fransfruits
sont excédés. Ils n'en peuvent plus et le disent avec vigueur : «
Depuis deux mois, nous sommes une vingtaine dont les habitations
sont infestées par des insectes provenant de ce bâtiment, des
triboliums. Il y en a partout dans nos maisons. Le sol en est
recouvert, nous en retrouvons dans le linge, la vaisselle, la
baignoire, le lit, le papier-toilette, etc. Et ceci malgré les
divers aérosols que nous pulvérisons partout. Car il y en a partout
! »
De fait, c'est à à Fossemagne, dans les locaux de l'ancienne société
Fransfruits, que sont entreposés des granulés pour animaux,
fabriqués au camp de Fontenet à partir des résidus de silos à grain,
par l'entreprise Liot, de Châtellerault. La construction en bardage
laisse échapper des granulés par les interstices, ce qui fait dire
aux voisins que la construction n'est pas adaptée à l'entreposage de
tels produits.
Le tribolium brun de la farine (Tribolium castaneum) est un petit
coléoptère Ténébrionidae brun rougeâtre de 3,5 mm de long. Son corps
est lisse et allongé. Les femelles pondent 300 à 400 œufs dans les
aliments qu'elles infestent au rythme de 2 à 3 œufs par jour. Ces
œufs sont collants et s'agglutinent autour des particules
alimentaires, ce qui les rend difficiles à distinguer. Les larves
éclosent environ 10 jours plus tard et se nourrissent dans ce
milieu.
Le plus proche voisin, Jean-Claude Gidon, précise : « Le bail avec
M. Rousseau, le propriétaire des bâtiments, finissait au 15 juillet,
mais la société Liot est toujours là et ce n'est pas en période de
moisson qu'on peut trouver 200 camions pour déblayer tout ça ! »
Joint par téléphone, Pierre Liot, dirigeant de la société en
question, rétorque : « Nous avons été avisés de la situation et nous
avons pris des dispositions, car nous travaillons dans un cadre
réglementaire. C'est vrai que nous n'avons pas connu ça depuis
vingt-cinq ans et que la chaleur a permis le développement des
insectes dans les 2 500 tonnes stockées à Fossemagne, qui partiront
d'ici quelque temps par bateau… C'est gênant, je ne discute pas,
mais nous sommes allés deux ou trois fois sur place et avons tout
mis en œuvre. Nous avons traité les granulés contre les insectes et
avons donné des bombes aux habitants pour faire de même. Pour moi,
c'est maintenant éradiqué. »
Le 27 juin, les victimes du tribolium ont écrit à l'Agence régionale
de santé à La Rochelle. « Nous avons aussi demandé une réunion avec
le propriétaire, actuellement hospitalisé, et la société Liot, dont
le PDG est pour nous injoignable », explique Annie Morin, qui habite
deux maisons plus loin.
Le chat et les serins
« Et mon chat est infesté », complète Nicole Gidon. « J'ai idée que
mes deux serins sont morts de ça, dans le fond de leur cage, car ils
avaient des colliers de ces petites bêtes autour du cou. Les autres
serins ont également une drôle d'allure », renchérit Jean-Claude
Gidon.
Le maire Paul-Henri Denieuil, accompagné d'un adjoint et du
directeur général des services, s'est déplacé sur les lieux, samedi
dernier. Il a constaté la présence des insectes dans le garage, sur
les voitures, caravanes, tables, dans la vaisselle… Bref, dans tous
les endroits. Il a conclu : « Nous allons faire accélérer le
règlement de cette situation. J'ai demandé à ce qu'une réunion ait
lieu avec les responsables le plus tôt possible », précisant « qu'il
disposait des moyens adéquats pour ça. »
La production de soie d’araignée par des tabacs transgéniques
:
La soie d'araignée est une microfibre naturelle
biodégradable, plus mince qu'un cheveu (diamètre inférieur à 1/10 de celui d'un
cheveu humain), mais qui serait trois à cinq fois plus résistante que l'acier et
plus élastique que le Kevlar, un matériau breveté utilisé dans la fabrication
des gilets pare-balles et des canots.
Les propriétés étonnantes de la soie
d'araignée sont connues de longue date. Pendant plusieurs siècles, diverses
civilisations ont tenté de reproduire ces propriétés. Les Grecs anciens
utilisaient la soie d'araignée pour la fermeture de plaies alors que les
aborigènes de l'Australie en faisaient des lignes de pêche. Plus récemment, la
soie d'araignée a servi à la fabrication de réticules pour nombre d'instruments
optiques, notamment des microscopes, des télescopes et des systèmes de visée
optique, du fait qu'un seul brin de soie d'araignée est plus fin que tous les
autres matériaux utilisables.
Un grand nombre de chercheurs pensent que la finesse de la
soie d'araignée permettra aux fabricants de textile de concevoir des matériaux
d'une extrême légèreté mais suffisamment résistants pour résister à des
contraintes de force précises, comme, par exemple, des fils de suture, des
câbles, des vêtements pare-balles souples et très minces.
Malheureusement,
en raison de leur caractère territorial et carnivore, il n'est pas possible
d'élever les araignées comme on le fait avec les vers à soie.
Une méthode
perfectionnée par l'entreprise Nexia Biotechnologie Inc est le recours à des
chèvres transgéniques dotées d'un gène responsable de la production de la
protéine de soie de l'araignée. Ces chèvres produisent du lait renfermant la
protéine de soie, qui, une fois isolée et purifiée, est filée en fibre
BiosteelIMC brevetée. Le problème reste que le lait a un niveau de production
insuffisante.
Une autre option est consiste à utiliser les biotechnologies
pour transformer des plantes en usines de fabrication de protéines de soie
d'araignée.
Des chercheurs canadiens ont réussi à introduire des gènes
d'araignée dans des plants de tabac mâles-stériles en vue de produire de grandes
quantités de protéines de soie. Le tabac est une plante qui a été étudiée
pendant de nombreuses années et qui est à la base d'un système de culture en
plein champ utilisé en "agriculture moléculaire". C'est une production bon
marché lorsqu'on la compare aux systèmes traditionnels de production de
bactéries et de cellules de mammifères axés sur la fermentation. Les chercheurs
ont validé ce concept en produisant de petites quantités de protéines de soie
d'araignée dans les feuilles de tabac.
Les matières non traditionnelles, comme la soie d'araignée,
sont précieuses et devrait être produites à grande échelle par le secteur
agricole pour répondre aux besoins des applications industrielles. Cette
recherche offre donc une occasion au secteur agricole de jouer un rôle clé dans
la création d'une nouvelle industrie de biofibres de pointe.
Les insectes : bestioles répugnantes ou mets de choix ?
 Avec plus de 1 400 espèces consommées par l’homme dans le monde entier,
les insectes représentent un créneau prometteur tant sur le plan commercial que
nutritionnel, a déclaré l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) hier. L’atelier organisé cette semaine par l’Organisation
des Nations Unies examinera le potentiel de développement du secteur dans la
région Asie-Pacifique. Avec plus de 1 400 espèces consommées par l’homme dans le monde entier,
les insectes représentent un créneau prometteur tant sur le plan commercial que
nutritionnel, a déclaré l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) hier. L’atelier organisé cette semaine par l’Organisation
des Nations Unies examinera le potentiel de développement du secteur dans la
région Asie-Pacifique.
Si l’idée de manger des insectes peut
sembler étrange ou peu ragoûtante, c’est une coutume en réalité très répandue de
par le monde. Au moins 527 insectes différents sont consommés dans 36 pays
d’Afrique ; 29 pays d’Asie et 23 des Amériques en consomment également.
Source de protéines, vitamines et sels minéraux
Sur les centaines d’espèces consommées par l’homme, les
principaux insectes appartiennent à quatre grands groupes: punaises ; fourmis,
abeilles et guêpes ; sauterelles et criquets ; teignes et papillons. Les
insectes possèdent une valeur nutritive élevée. Certains contiennent autant de
protéines que la viande et le poisson. Séchés, ils ont souvent une teneur en
protéines double par rapport à la viande et au poisson frais, mais généralement
pas plus que la viande ou le poisson séché ou grillé. Certains insectes, en
particulier au stade larvaire, sont également riches en graisses et contiennent
d’importants minéraux et vitamines.
La plupart des insectes comestibles sont
récoltés dans les forêts naturelles. Mais si les insectes représentent la plus
grande part de biodiversité dans les forêts, ils sont les moins étudiés de toute
la faune. “Il est surprenant de constater que l’on sait si peu de choses sur les
cycles de vie, la dynamique des populations, le potentiel commercial et de
gestion de la plupart des insectes comestibles des forêts”, a indiqué Patrick
Durst, forestier principal à la FAO.
“Les responsables des forêts ont des
connaissances très limitées sur le potentiel de gestion et de récolte durables
des insectes”, fait remarquer M. Durst. “En revanche, les habitants des forêts
et les populations qui en sont tributaires possèdent souvent des connaissances
étonnantes sur les insectes et leur gestion”.
Dans certaines régions, les
insectes ne sont consommés que sporadiquement pour conjurer la famine. Mais dans
la plupart des régions où les insectes font partie de l’alimentation, ils sont
souvent considérés comme un mets de choix. En Thaïlande, où se tient la
consultation, près de 200 espèces d’insectes sont consommées, dont beaucoup sont
très prisées. Les vendeurs d’insectes sont monnaie courante dans tout le pays, y
compris la capitale, Bangkok.
Traditionnellement, les hommes utilisent
surtout les insectes pour la production de miel, de cire et de soie, comme
source de teinture, voire comme aliments et médicaments.
Lorsque les insectes
font partie de l’alimentation, ils sont généralement recueillis dans la nature,
essentiellement sous forme de larves et de nymphes, les plus consommées. Ils
sont ensuite soumis à une préparation et à une cuisson simples et l’exploitation
de la ressource requiert une gestion minimale.
Certains insectes tels que les
vers à soie et les abeilles ont été domestiqués il y a des siècles, mais ce
n’est que récemment que l’élevage d’autres espèces a suscité un intérêt pour
l’alimentation. Par exemple, il est désormais courant de trouver au nord de la
Thaïlande des agriculteurs qui élèvent des vers de bambou ou des criquets pour
les vendre aux acheteurs locaux.
Potentiel commercial
En dehors de leur valeur nutritionnelle, de nombreux experts
estiment que les insectes comestibles détiennent un potentiel considérable de
création de revenus et d’emplois pour les populations rurales qui s’occupent de
leur capture, de leur élevage, de leur transformation, de leur transport et de
leur commercialisation.
Ce potentiel pourrait bénéficier de la promotion et
de l’adoption de normes alimentaires modernes pour les insectes qui sont vendus
vivants, séchés, fumés, grillés ou sous toute autre forme. Il faut cependant
s’assurer que les insectes présentent des garanties d’hygiène pour la
consommation et ne contiennent pas de quantités excessives de résidus chimiques
tels que les insecticides.
“Il existe en outre des possibilités d’améliorer
le conditionnement et la commercialisation pour rendre les insectes comestibles
plus attrayants aux acheteurs traditionnels et pour ouvrir le marché à de
nouveaux consommateurs, en particulier en milieu urbain”, selon M. Durst.
Durant l’atelier de trois jours organisé par la FAO et l’Université de Chiang
Mai, les spécialistes se pencheront sur la gestion, la collecte, l’exploitation,
la transformation, la commercialisation et la consommation des insectes
comestibles des forêts.
La réunion vise à renforcer la prise de conscience du
potentiel des insectes comestibles des forêts en tant que source nutritive,
documenter la contribution des insectes aux moyens d’existence ruraux et évaluer
les liens avec l’aménagement durable et la conservation des forêts.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Les abeilles se serrent les unes contre les autres pour se tenir chaud
:
 Observant le comportement des abeilles en milieu extrême,
une équipe de chercheurs de l'Université agraire d'Etat russe et de
l'Université d'Etat tchouvache s'est rendu compte qu'elles étaient capables
de réguler leur température et de s'adapter à de fortes variations
climatiques allant de +35°C à -20°C... Observant le comportement des abeilles en milieu extrême,
une équipe de chercheurs de l'Université agraire d'Etat russe et de
l'Université d'Etat tchouvache s'est rendu compte qu'elles étaient capables
de réguler leur température et de s'adapter à de fortes variations
climatiques allant de +35°C à -20°C...
Les
aires d'extension des abeilles vont de l'Equateur au Cercle polaire. Pour
parvenir à des conditions climatiques aussi différenciées, ces populations
d'insectes adoptent la stratégie du regroupement et s'agrègent les unes aux
autres de manière compacte dès lors qu'elles affrontent les grands froids.
Il s'avère, d'après l'observation des chercheurs, que plus les amas sont
denses plus les abeilles survivent à des températures extérieures très
basses -pouvant atteindre jusqu'à moins 21,8 degrés centigrades.
Ce
comportement constitue un modèle de thermostat tout à fait original : chaque
abeille à l'intérieur de l'amas se trouve dans des conditions de température
indépendantes. Il n'existe pas de mécanisme central unique pour contrôler ou
réguler la température du groupe: ces températures varient en fonction de la
place occupée par l'abeille au sein de la sphère formée par l'essaim.
Ce
sont les abeilles situées en périphérie de l'essaim -dont la température est
d'ailleurs la plus basse- qui, grâce aux microvibrations de leurs ailes,
produisent de la chaleur dont bénéficient celles qui sont situées au cœur
de l'amas.
La température interne est constante. Et, lorsque les
abeilles exposées en périphérie de la boule s'épuisent de froid et de faim,
d'autres congénères prennent la relève afin de permettre aux premières de se
restaurer et de se réchauffer. Grâce à ces rotations de la périphérie vers
l'intérieur de l'essaim, les écarts de température au sein de la boule ne
sont jamais trop élevés et l'ensemble du groupe semble mieux survivre.
Invasion de chenilles au Libéria :
L'agence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) craint une « une crise alimentaire et environnementale
» : des millions de chenilles légionnaires dévorent tout sur
leur passage, cultures et végétation, et infestent les puits. Il
s'agit d'une « véritable urgence nationale », selon Winfred
Hammond, entomologiste et représentant de la FAO, qui met en garde «
contre une probable extension à des pays voisins comme la
Guinée, la Sierra Leone et en Côte d'Ivoire ».
 Les chenilles processionnaires dévastatrices mesurent deux à
trois centimètres. Elles « progressent par dizaines de millions, dévorant
tout ce qui pousse sur leur passage et, dans certains cas, dévastant des maisons
et des immeubles », explique Winfred Hammond. Les chenilles processionnaires dévastatrices mesurent deux à
trois centimètres. Elles « progressent par dizaines de millions, dévorant
tout ce qui pousse sur leur passage et, dans certains cas, dévastant des maisons
et des immeubles », explique Winfred Hammond.
La FAO estime qu'une quarantaine de villages dans les
provinces de Bong, Lofa et Gbarpolu, ont été touchés, « tout comme les
deux-tiers des 200 000 habitants de la province de Bong qui a le plus souffert
de l'invasion ». Plusieurs puits et cours d'eau sont également devenus
impropres à la consommation.
« Quand le feu s'éteint, les insectes reviennent,
plus nombreux »
Encerclés par ces bêtes rampantes, les paysans dans certaines
communautés rurales n'arrivent plus à rejoindre leurs fermes. De couleur noire
et jaune, longs d'environ 5 centimètres, ces insectes « mangent chaque type
de végétation qu'ils rencontrent. Parce qu'ils se déplacent en groupes, les
scientifiques se réfèrent à eux comme des légionnaires », explique Gregory
Tarplah, un entomologiste du ministère libérien de l'Agriculture.
Ces chenilles « s'accrochent dans les arbres et quand vous
passez, elles tombent sur vous et vous mordent », affirme le fermier John
Wenopolu. Pour les chasser de leur localité, des habitants ont essayé de mettre
le feu aux arbres où les chenilles se cachaient: en vain. « Quand le feu
s'éteint, les insectes reviennent, même plus nombreux qu'auparavant »,
assure un villageois, Patrick Flomo.
« La pire catastrophe du genre que le
Liberia ait connu depuis 30 ans »
L'infestation se répand rapidement du fait de deux facteurs :
d'abord les bêtes se multiplient à un rythme soutenu et ensuite parce que les
phalènes peuvent parcourir de longues distances la nuit sous le couvert de
l'obscurité.
Trois comités d'urgence ont été mis en place par le Liberia
pour faire face à cette crise mais « le pays a besoin d'une assistance
extérieure, car il ne possède pas assez de ressources financières et d'expertise
technique pour se tirer d'affaire tout seul », estime Winfred Hammond. Qui
ajoute que « ce fléau est la pire catastrophe du genre que le Liberia ait
connu depuis 30 ans ». La dernière invasion de chenilles dans la région
s'était produite au Ghana en 2006, selon la FAO.
Des exemplaires de chenilles ont été transportés par des
services vétérinaires à Accra afin de les identifier et de « déterminer le
pesticide le plus approprié pour décimer la vermine », selon l'agence
Les
moustiques d'Estonie en ont encore le bourdon :
des habitants du petit pays balte ont mis la tête de ces insectes à prix en
organisant un championnat de capture de moustiques.
TARTU, Estonie (Reuters) - Les moustiques d'Estonie en ont encore le
bourdon: des habitants du petit pays balte ont mis la tête de ces insectes à
prix en organisant un championnat de capture de moustiques.
Trente-sept
participants se sont rassemblés dans un champ à Tartu, dans l'est du pays,
pour attraper autant de moustiques que possible en moins de dix minutes dans
une zone délimitée.
Les règles de la compétition ne précisaient pas si ce
curieux gibier devait être capturé mort ou vif. Les chasseurs de diptères
pouvaient concourir seuls ou par équipe de trois.
"On a beaucoup de
moustiques et il faut bien les combattre d'une manière ou d'une autre, alors
nous avons décidé d'organiser un championnat de capture de moustiques", a
expliqué l'organisateur, Triinu Akkermann.
Un des concurrents avait
peaufiné sa stratégie avant la compétition: "Nous allons nous échauffer de
manière à commencer à transpirer un peu, puis je me tiendrai pieds et poings
nus pendant que ma femme et ma fille prélèveront les moustiques sur moi", a
indiqué Jevgeny Serov.
Rauno Luksepp, lauréat du premier prix -- un tour
de voilier sur le lac Peipus, à la frontière russe --, a enchaîné 38
captures, et autant de piqûres pour y parvenir.
Des compétitions
similaires avaient déjà été organisées en Finlande par le passé.
Millau. Insectes.
Ces scorpions qui se cachent sous nos tuiles
Lucas Baliteau, entomologiste à la Maison
Jean-Henri Fabre à Saint-Léons, vous dit tout sur les scorpions cachés dans
vos maisons
 Un
bruissement, une apparition fugace à la nuit tombée, deux pinces qui se
referment brusquement sur une mouche... Vous venez de vous trouver nez à nez
avec le scorpion de Montpellier. Un
bruissement, une apparition fugace à la nuit tombée, deux pinces qui se
referment brusquement sur une mouche... Vous venez de vous trouver nez à nez
avec le scorpion de Montpellier.
En été, son développement est au maximum
: il trouve facilement de quoi se nourrir, se reproduit et donne naissance à
de petits, mais redoutés, bébés scorpions.
Entre le mâle et la femelle,
c'est toute une parade qui se met en place avant l'accouplement. Monsieur
enlace Madame avec ses pinces, ils valsent, s'embrassent. « Une fois
soudés ensemble, le scorpion entraîne la femelle vers un terrain qui lui
convient, raconte Lucas Baliteau . Il y dépose son spermatophore et
fait passer la femelle dessus pour qu'il y ait fécondation. » Mais pas
de panique, les scorpions ne pondent
qu'entre 2 et 110 oeufs dans toute leur vie. Alors que les papillons, par
exemple, en produisent 500 en une seule fois !Une fois adulte, le scorpion
de Montpellier, espèce la plus fréquente en Aveyron, mesure de 4 à 5 cm,
pour les plus gros individus. Signe distinctif ? Sa couleur. Avec ses pattes
jaunes orangées et sa glande à venin jaune, vous ne pouvez pas le rater.
Son habitat favori ? Les tuiles des vieilles habitations.Mais la bête
redoute le soleil. Elle ne sort de son antre qu'en fin de journée, pour y
retourner au milieu de la nuit.
«
Vous pouvez aussi rencontrer le scorpion languedocien, tout jaune, dans la
garrigue, précise l'entomologiste. Mais à part si vous faites des
travaux de terrain et que vous le dérangez sous sa pierre, c'est plus rare.
Il ne rentre pas dans les maisons. » Tant mieux, quand on sait que sa
piqûre peut conduire à une paralysie temporaire.
La piqûre du scorpion
des maisons n'est pas si terrible. Plus vous êtes jeune, plus vous serez
sensible au venin. « Vous ressentirez comme une piqûre de guêpe. Vous
serez bon pour une journée au lit, avec de la fièvre, pas plus »,
explique Lucas Baliteau, une mue de scorpion entre les doigts. Apprécié pour
ses qualités nutritives en Afrique ou en Asie, le scorpion est mangé en
brochette ou en sucette, au choix : « Ce sont les crevettes locales,
plaisante l'entomologiste. Ils ont un bon apport en protéines. »
Avant de le tester en brochette, peut-être pourriez-vous embaucher le
scorpion comme auxiliaire de maison : « Il mange les punaises, les
mouches, les criquets... C'est une bonne aide ménagère ! », conclut
Lucas Baliteau.
Un coléoptère nouveau au Mercantour ? :
Usually announcements of new
species come from biodiverse rainforests or unexplored marine depths, but
researchers have announced the discovery of nearly a dozen new species in one of
Earth's most well-trodden place: France. Eleven new species have been discovered
in Mercantour National Park in southern France. All the new species are insects,
including one beetle, seven new aquatic invertebrate living under creek beds,
and three springtails, which are soil-dwelling arthropods.
These new
discoveries are the partial results of the All Taxa Inventory Project to
identify all living life found in two protected areas: Mercantour National Park
and Maritime Alps National Park in Italy. It is an ambitious project with an
initial investment of 150,000 Euros since its inception in 2007. To accelerate
the colossal work of the All Taxa Inventory Project, an annual budget of 850,000
Euros has been recently approved until 2012 through the support of the European
Commission, the European Distributed Institute of Taxonomy, Albert II de Monaco
Foundation, Principauté de Monaco, Region Provence-Alpes-Côte d'Azur, and
European Regional Development Fund.
Other new species are expected to be
discovered, especially new lichens and parasites as these inventories will be
explored soon. More than 250 scientists are part of the scientific team.
Located in the department of the Alps-Maritimes, at the north east of the
Riviera, the Mercantour National Park covers 65,000 hectares with an elevation
ranging from 300 meters to 3,300 meter. It is believed that this protected park
alone could harbor 15,000 to 20,000 species. To date almost 8,000 species have
been inventoried.
Chasse électrique des insectes :
Là-bas sous les vieux pommiers, voici la vieille mare aux grenouilles coassantes
tout entourée de roseaux et de mousses chevelues. Que de bruit, quelle foule,
quelle turbulence dans ce monde aquatique ! Les insectes pullulent, les têtards
s’agitent, les habitants sont en liesse. C’est le printemps aussi dans la
vieille mare. Aussi voit-on les amateurs se pencher sur les bords et s’efforcer
de saisir quelques spécimens d’insectes. La chasse n’est pas toujours
fructueuse, car ils sont défiants, les habitants de la mare. Et pourtant il
serait aisé de faire une chasse abondante. Comment ?
Ne sait-on pas bien
jusqu’à quel point les insectes et les poissons sont attirés invinciblement par
l’éclat de la lumière ? Des braconniers n’ont-ils pas pêché ainsi en eau
illuminée ? On a défendu, et l’on a bien fait, chez nous la pêche à la lumière,
qui mettrait vite à sec nos minces réserves de poissons. Mais dans les mares,
même dans certains étangs, avec la permission du propriétaire, on peut bien
allumer sa lanterne et entreprendre des chasses fructueuses d’insectes, de
larves de Coléoptères, d’Hémiptères, de Monoptères, de Diptères. Et quelles
récoltes ! M. Paul Noël, directeur du Laboratoire d’entomologie régionale
agricole, vantait encore dernièrement la méthode et la recommandait. On prend
une lampe à incandescence de 3 ou 4 bougies. On installe sur le bord de la mare
un petit accumulateurs comme ceux dont servent les bicyclistes pour leur
lanterne. On le relie à la lampe par des fils assez longs. La lampe, trop légère
pour descendre dans l’eau, est fixée à un demi-cercle en fer et au-dessous du
demi-cercle et de la lampe on place un grand piège de 0m,80 d’ouverture copié
sur le modèle des petits pièges à oiseaux. Le piège est garni d’une toile
d’emballage recouverte d’un filet de ficelle. On descend le piège lentement dans
la mare avec la lampe. On allume, la lumière brille. Aussitôt, insectes,
poissons, salamandres, grenouilles, têtards, larves de toute sorte accourent en
grande affluence. On tire la ficelle. Le piège se détend ; on éteint. Et d’un
seul coup de filet, on retire plusieurs kilogrammes d’animaux, surtout si la
mare renferme des poissons.
On peut encore employer simplement un petit tube
de Geissler alimenté par une bobine de Ruhmkorff.
Flamel, La Nature,
1er sem. 1897, p. 400.
18 225 nouvelles espèces en 2008 :
Unidentified planthopper
insect from Madagascar. Scientists estimate that at best 20 percent of the
world's species have been described.
In the 2010 State of Observed
Species researchers have announced that 18,225 living species were discovered in
2008. In addition, 2,140 new extinct species were discovered byway of fossils.
For researchers the easiest new species to discover were insects: over
48 percent of the new species described in 2008 were insects. Over a third of
the new insects were beetles. Mammals were among the most difficult: researchers
discovered only 41 new species of mammal in 2008, nearly a third of which were
rodents. Five times as many extinct mammals were found as living species.
To date insects represents a majority of the world's species with just over
a million insects described. Plants come in second with just over a
quarter-million. As of 2008, researchers have described 9,997 birds, 8,863
reptiles, 6,644 amphibians, and 5,528 mammals. In all, scientists have described
almost 2 million species (1,922,710) since taxonomic work began in the 18th
Century.
However, most of the world's species remain unknown to
researchers. According to the report, scientists believe that there are at least
10 million species in the world, as well as tens of millions of microbes. If the
current rate of discovery (i.e. approximately 18,000 new species a year)
continues, it will take taxonomists 444 more years to describe the world's
estimated remaining 8 million (non-microbial) species.
However, if
higher total species estimations prove correct, for example 50 million species,
then it would take two and half millennia before the world's species are
described at the present rate.
Whether 8 million or 48 million species
remain undiscovered by researchers, many of these species may vanish before
scientists find them. Extinction rates are currently estimated at 100 to 1000
times higher than the background extinction rate (i.e. the average extinction
rate as determined by studying fossils), leading scientists to warn of a mass
extinction that could rival the comet that destroyed the dinosaurs.
Des insectes amphibiens !??
(03/22/2010)
Scientists have never before discovered a truly amphibious insect until now:
writing in the Proceedings of the National Academy of Sciences
researchers have announced the discovery of 12 species of Hyposmocoma moths in
the Hawaiian islands which they consider truly amphibious—that is a species able
to survive both on land and underwater indefinitely.
Pourquoi les
insectes volent-ils en zigzag ?
 Apparus
il y a 350 millions d'années, les insectes sont les plus anciens
«aviateurs» du monde (ici : un syrphe). Apparus
il y a 350 millions d'années, les insectes sont les plus anciens
«aviateurs» du monde (ici : un syrphe).
C'est du moins l'impression que nous donnent les mouches ou les
moustiques à virevolter en tous sens, à droite, à gauche, vers le
haut, vers le bas, rebroussant chemin brusquement pour mieux
repartir dans une autre direction. Les oiseaux semblent eux, en
comparaison, avoir des vols beaucoup plus droits et directs.
Pourtant, les mécanismes du vol des insectes et celui du vol des
oiseaux sont très semblables. Alors d'où vient cette différence ? On
commence à avoir des éléments de réponse, qui peuvent d'ailleurs
avoir des applications pratiques pour l'homme, mais il reste,
étonnamment, de nombreux mystères dans la façon dont les insectes se
déplacent.
Les insectes sont les plus anciens «aviateurs» du monde. Ils sont
apparus il y a quelque 350 millions d'années sous une forme
rappelant celles de grandes libellules (70 cm de long). Ils
représentent aujourd'hui les 4/5 de toutes les espèces animales.
Leur aptitude et leur habileté au vol sont des facteurs clés de leur
réussite. Les insectes ailés ont soit une paire soit deux paires
d'ailes. Qu'ils agitent différemment.
Chez les libellules, les éphémères et les demoiselles, les muscles
chargés de bouger les ailes sont insérés directement à la base des
ailes. Ils agissent comme un rameur dans une barque. Lorsqu'il
abaisse l'extrémité de la rame qu'il tient, l'autre extrémité se
lève. Un système efficace. Ainsi, avec leurs deux paires d'ailes
indépendantes, les libellules peuvent changer très brusquement de
vitesse et de direction. Et les demoiselles peuvent même pratiquer
le vol stationnaire.
Guidés par les odeurs :
Chez les autres insectes, les muscles servant à agiter les ailes
ne sont pas directement rattachés aux ailes. Ils sont fixés sur le
thorax et c'est en le déformant que les ailes, qui sont des
prolongements du thorax, vont pouvoir battre. La fréquence de
battement varie de 5 à 200 par seconde et peut monter à plus de
1 000 battements par seconde. Pour cela, certains insectes possèdent
des systèmes où une seule impulsion nerveuse va se traduire par la
contraction répétée d'une fibre musculaire.
Tout cela pour donner des performances de vol dignes des meilleurs
pilotes de voltige. Les scientifiques se cassent depuis longtemps
les dents sur une modélisation correcte de ces battements d'aile.
Mais les progrès continuent. Des chercheurs ont ainsi comparé un
virage sur l'aile, d'au moins 60°, chez une mouche, un pigeon, un
colibri et une chauve-souris. Conclusion de l'étude : quel que soit
leur poids, ils font exactement la même chose avec leurs ailes. Et
la mouche et le colibri ont besoin du même nombre de battements
d'ailes pour leur virage.
Si les principes aérodynamiques sont bien respectés chez les êtres
volants, la différence entre leurs déplacements tient à d'autres
facteurs. Les insectes, plus légers que les oiseaux, sont plus
soumis aux «courants d'air». Mais ils sont tout de même capables de
voler en ligne droite, comme on le voit bien chez les libellules ou
les abeilles par exemple. Il y a bien sûr aussi le fait qu'un vol
apparemment erratique les rend plus difficile à attraper par leurs
prédateurs.
Mais la grande différence entre les insectes et les oiseaux est leur
vue. Que l'on sait bonne, voire très bonne chez les oiseaux. Un vol
trop heurté nuirait d'ailleurs aux informations visuelles
collectées. Tandis que les yeux à facettes des insectes sont
beaucoup moins efficaces pour distinguer le lointain. Le vol saccadé
ne les affecte pas.
D'autant que, contrairement là aussi aux oiseaux, de très nombreux
insectes se guident beaucoup par les odeurs grâce aux deux antennes
qu'ils portent sur leur tête. Ils volent donc dans des «courants
odoriférants» et se dirigent en égalisant l'intensité de leurs
perceptions sur chacune de leurs antennes. Ce qui dans l'air oblige
à des «contorsions» donnant ces ballets aériens où la chorégraphie
semble absente et où la danse semble être de «Saint-Guy». Mais il y
a là, peut-être, les principes de futurs engins volants conçus par
l'homme. La nature ne réclamera pas de copyright.
Photos: Google Earth utilisé pour découvrir de nouvelles espèce !
 (04/14/2009) Les scientifiques ont utilisé
Google Earth pour trouver une espèce encore inconnue de la biodiversité au
Mozambique, rapporte le Jardin Botanique Royal de Kew. En passant en revue les
images via google earth à la recherche de potentiels sites naturels à conserver
à 1600 m d'altitude ou plus, Julian Bayliss, un défenseur de la nature basé sur
place, a repéré en 2005, une région de 7000 hectares de forêt sur le mont Mabu.
La forêt scientifiquement inconnue et inexplorée à ce jour, n'était précédemment
connue que des villageois. Les expiditions qui ont suivi, en octobre et novembre
cette année, ont mis à jour des centaines d'espèces végétales et animales, y
compris un bon nombre qui sont des nouveautés pour la science. (04/14/2009) Les scientifiques ont utilisé
Google Earth pour trouver une espèce encore inconnue de la biodiversité au
Mozambique, rapporte le Jardin Botanique Royal de Kew. En passant en revue les
images via google earth à la recherche de potentiels sites naturels à conserver
à 1600 m d'altitude ou plus, Julian Bayliss, un défenseur de la nature basé sur
place, a repéré en 2005, une région de 7000 hectares de forêt sur le mont Mabu.
La forêt scientifiquement inconnue et inexplorée à ce jour, n'était précédemment
connue que des villageois. Les expiditions qui ont suivi, en octobre et novembre
cette année, ont mis à jour des centaines d'espèces végétales et animales, y
compris un bon nombre qui sont des nouveautés pour la science.
Un squat pour la Rosalie :
Au dernier niveau du jardin respectueux, le plus humide, une dizaine de
frênes étonnent. Depuis quelques jours, leurs troncs sont devenus bleus et
cerclés de noir. Cette étrangeté n'est pas due à un miracle de la nature,
mais aux coups de pinceaux de Rémy Marcotte et de ses trois stagiaires.
Cet architecte paysagiste a conçu dans le respect de la biodiversité ce
jardin en terrasses, caché derrière le Château de L'Yeuse.
Chaque année,
le Château subventionne une nouvelle installation. Après un observatoire de
martin-pêcheur ou des œuvres en bois de vignes réalisées pour les
salamandres, c'est au tour d'un insecte rare de se voir offrir un lieu
privilégié.
Une espèce protégée :
Son corps est étroit et aplati. Il possède deux grandes antennes. Mais
c'est surtout sa couleur qui donne à ce coléoptère toute sa beauté. Un bleu
cendré tacheté de noir. Cet insecte porte le doux nom de Rosalie des Alpes.
Mais la demoiselle se plaît aussi en dehors de ses montagnes. Notamment dans
les frênes charentais.
La Rosalie alpine se reproduit dans des bois morts
où les larves resteront deux longues années. Ce coléoptère protégé en Europe
est menacé de disparition.
Il est donc exceptionnel de pouvoir le
rencontrer. « On participe à sa disparition en utilisant le frêne pour se
chauffer », explique Rémy Marcotte.
C'est Marie, l'une des stagiaires,
qui a eu l'idée de cette installation consacrée à la Rosalie des Alpes. «
L'été dernier alors que je travaillais dans le jardin j'ai eu la chance de
pouvoir observer les adultes s'envoler », raconte cette étudiante.
Après
avoir exposé le projet à l'écologue Vincent Albouy et à une soixantaine
d'autres spécialistes en mai, l'idée a pris forme.
« Il fallait
absolument capter le génie du lieu. C'est-à-dire connaître la biologie et
l'écologie de l'insecte pour ne pas le déranger », précise Rémy Marcotte.
« Le squat de Rosalie » est presque terminé. L'insecte peut
tranquillement déposer ses larves dans un cercle constitué de frênes morts.
Au centre, les arbres maintenant colorés de peinture biologique faite de
chaux et de pigments, seront coupés en têtard au mois de décembre.
« La
Rosalie aime la chaleur, il faut couper le haut des arbres pour laisser
passer les rayons du soleil. Les visiteurs auront peut-être alors la belle
surprise de l'apercevoir », espère Rémy Marcotte.
Le Jardin respectueux. Se présenter à l'accueil du Château de l'Yeuse, 65
rue de Belle vue à Châteaubernard. Entrée 3 €.
Les fourmies se cachent pour mourrir !
Chez certaines
espèces, il a été observé que des individus
s’isolaient pour mourir. C’est le cas notamment chez les fourmis, les éléphants,
les chats, les chiens et même, parfois, les hommes. L’une des raisons de ce
comportement pourrait être une forme d’altruisme.
En effet, les sociétés animales créent les conditions parfaites pour les
épidémies. Ce
comportement altruiste
réduit ce risque et pourrait donc avoir été favorisé par l’évolution.
Le
caractère occasionnel de ce phénomène le rend cependant difficile à étudier de
manière quantitative. Les chercheurs allemands de l’Université
de Regensburg ont donc transporté une
fourmilière en laboratoire pour tester statistiquement ce comportement.
Jurgen Heinze et Bartosz Walter ont tout d’abord exposé une colonie de fourmis
Temnothorax unifasciatus à des spores d’un champignon
parasite mortel (Metarhizium anisopliae).
Ils ont alors observé que les fourmis les plus infectées, quelques heures ou
jours avant leur mort, quittaient la colonie. Ce départ est
volontaire, et non forcé
par la colonie. Ces fourmis rompent alors toutes relations sociales avec leurs
congénères et s’en vont
mourir loin de la
colonie, dans une zone peu exploitée.
 En s’isolant
de la colonie et en mourant en un lieu peu fréquenté par ses congénères, la
fourmi augmente ses chances de ne pas contaminer la colonie et que celle-ci, en
continuant à se développer, transmette ses
gènes à travers sa parenté. En s’isolant
de la colonie et en mourant en un lieu peu fréquenté par ses congénères, la
fourmi augmente ses chances de ne pas contaminer la colonie et que celle-ci, en
continuant à se développer, transmette ses
gènes à travers sa parenté.
Un départ vers la mort volontaire et indépendant
Pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une altération
du comportement dictée par le champignon parasite, comme c’est observé avec le
genre Cordyceps, les scientifiques ont ensuite exposé les fourmis à une
atmosphère constituée de 95% de CO2,
ce qui réduit singulièrement leur
espérance de vie. Une fois encore, ils ont
observé le même comportement.
Ces expériences corroborent donc les
observations réalisées dans la nature. Cet isolement social, observé aussi chez
d’autres
insectes sociaux comme les Bourdons (Bombus
sp.), est très vraisemblablement un moyen de réduire le risque d’infecter
d’autres individus dans la colonie.
Les chercheurs avancent donc dans la
revue
Current Biology que
« l’isolement social pourrait être un
comportement altruiste souvent sous-estimé qui sert la
valeur sélective globale
[NDLR : taux de reproduction de l’individu et de sa parenté] des individus
mourants dans les sociétés animales ».
Encore le Pique-prune :
Le pique-prune est un insecte
aussi puissant que discret. Il s'est rendu célèbre, en 1999, en bloquant pendant
six années la construction de l'autoroute A28, entre Le Mans et Tours.
Aujourd'hui, il se met sur la route du conseil général de l'Yonne qui, pour des
raisons de sécurité, souhaite faire abattre les quelque cinq cents tilleuls
centenaires formant l'allée monumentale d'un kilomètre de long qui conduit au
château de Tanlay. L'affaire est moins spectaculaire que celle de l'A28, mais
localement, elle déchaîne tout autant les passions.
Le 20 avril, elle est
remontée jusqu'à Paris, lorsque le député de l'Yonne
Jean-Marie Rolland (UMP), a interpellé le ministre de l'écologie pour
demander une dérogation à la "sacro-sainte" loi sur la protection des
pique-prunes. "La présence non vérifiée, à un kilomètre du site, de
pique-prunes passe-t-elle avant la sécurité des enfants pratiquant une activité
sportive sur le stade proche, avant celle des promeneurs, voire des
automobilistes fréquentant l'allée ?", a-t-il questionné. Sans succès :
Valérie Létard, au nom du ministère, a rappelé au député que toute
dérogation devrait s'appuyer sur "un dossier établissant la nécessité de
procéder à cet abattage en indiquant les mesures compensatoires prévues au titre
de la qualité de conservation de la population des coléoptères concernés".
On en est resté là.
Car les vieux tilleuls de Tanlay abritent ce scarabée
strictement protégé par la législation européenne - en l'occurrence la
"directive habitat" - et par la loi française depuis 1979. "Le pique-prune a
le même statut que l'ours ou le loup", confirme
Pascal Dupont, de l'Office pour les insectes et leur environnement (OPIE).
Rares, pourtant, sont ceux qui peuvent se targuer d'avoir vu ce gros coléoptère
brun d'aspect massif, dont la taille à l'âge adulte varie entre 20 et 35 mm.
L'animal ne se promène pas, comme nombre de ses cousins, le long des chemins. Il
sort le plus souvent à la nuit tombée, vole mal, et passerait, selon les
entomologistes, l'essentiel de son existence dans ces cavités caractéristiques
des arbres en état de décomposition avancée. Souvent, ce sont ses larves,
accrochées à une branche de bois mort tombée au sol, qui mettent l'observateur
aguerri sur la piste de l'insecte. Ou encore une odeur prégnante de "cuir de
Russie" ou de "pot-pourri" qui se dégage de l'arbre.
Osmoderma
eremita est le témoin d'une histoire révolue. Celle d'une agriculture de
bocage malmenée par les remembrements ou encore des derniers massifs forestiers
à conserver de très vieux spécimens, comme les forêts de Fontainebleau ou de
Sare, dans les Pyrénées. Le pique-prune affecte les arbres âgés de 40 ans au
minimum, mais, le plus souvent, vieux de 150 à 200 ans pour les chênes. C'est à
ce titre qu'il est protégé, car ces paysages si particuliers sont en voie de
disparition. "La présence du pique-prune est le signe d'un milieu écologique
extrêmement exigeant qui abrite quantité d'autres espèces dont l'enjeu de
conservation est également fort pour le fonctionnement des écosystèmes",
explique l'entomologiste
Bruno Meriguet. Sur le site de Tanlay, ce chercheur de l'OPIE a recensé 53
autres espèces d'insectes qui participent à la décomposition du bois et au
recyclage de la matière organique.
A côté de ces insectes, des
chauves-souris, rapaces, écureuils trouvent aussi refuge. Le pique-prune est
ainsi une "espèce parapluie" ou une "espèce porte-drapeau", comme
aiment à le désigner les spécialistes de la biodiversité. Les batailles menées
au nom du coléoptère vont donc bien au-delà de l'existence de celui-ci.
Que
faire pour sauver ce pan de la biodiversité que la marche de l'Histoire semble
condamner ? Jusqu'où faut-il aller ? "Nous sommes face à un vrai problème de
conservation. Les arbres multicentenaires qui hébergent le pique-prune ont tous
le même âge, ils vont disparaître en même temps, et nous n'aurons plus
d'habitats pour les pique-prunes si nous ne prenons pas de mesures pour
organiser une relève", reconnaît Pascal Dupont.
Dans les régions où
subsiste du bocage, l'une des idées est d'inciter les agriculteurs à renouer
avec les pratiques d'émondage qui se pratiquaient au XIXe siècle sur
les feuillus délimitant les parcelles. Ces coupes, en créant des replats au
sommet des arbres, favorisent la formation de cavités.
La nécessité de
déployer de tels efforts est cependant loin de faire consensus, y compris au
sein même de la communauté des naturalistes.
Patrick Blandin, professeur émérite au Collège de France et chargé de donner
un avis scientifique dans l'affaire de l'A28, conclut ainsi le prologue de son
dernier livre, Biodiversité, l'avenir du vivant (Albin Michel, 2010) :
"Comment notre société en est-elle arrivée là ? Une espèce animale aurait-elle
une si grande importance que sa découverte dans une région puisse remettre en
cause d'importants projets de développement ? Bien des fois, on m'a posé la
question : "A quoi sert le pique-prune ?" Honnêtement, je ne sais toujours pas
répondre."
Laurence Caramel
Les cafards pourraient être les antibiotiques de demain:
 Les cafards vivent dans de très mauvaises conditions sanitaires
et d'hygiène et ont donc développé des moyens de se protéger contre les
micro-organismes. Les cafards vivent dans de très mauvaises conditions sanitaires
et d'hygiène et ont donc développé des moyens de se protéger contre les
micro-organismes.
Les
cafards, insectes à jamais associés aux immondices, pourraient contribuer à de
nouveaux traitements contre les bactéries résistantes, selon une étude publiée
lundi 6 septembre par des chercheurs britanniques qui ont découvert des
substances aux propriétés antibiotiques inattendues chez ces insectes.
Une
équipe de l'Université de Nottingham
a identifié jusqu'à neuf molécules différentes dans les cerveaux et les tissus
nerveux de cafards et de sauterelles. Des substances toxiques pour les bactéries
et qui pourraient déboucher sur des traitements pour certaines infections
fréquemment résistantes aux antibiotiques communs.
Selon ces
chercheurs, ces tissus sont ainsi capables de tuer plus de 90 % de
staphylocoques dorés résistants à la méticilline (SARM) et d'Eschirichia coli
(E. coli), sans endommager les cellules humaines. Ils sont actuellement en train
d'étudier les propriétés spécifiques des substances découvertes dans leur
laboratoire.
ALTERNATIVE AUX TRAITEMENTS DÉJÀ DISPONIBLES
Pour
Simon Lee, de l'école de médecine et de science vétérinaire de l'université
britannique, cette découverte était prévisible. "Les insectes vivent souvent
dans de très mauvaises conditions sanitaires et d'hygiène, dans des
environnements où ils sont exposés à un grand nombre de bactéries différentes.
Il est donc logique qu'ils aient développé des moyens de se protéger contre les
micro-organismes", estime-t-il.
"Nous espérons que ces molécules
pourront aboutir à des traitements contre les infections par l'E. Coli et le
SARM qui deviennent de plus en plus résistants aux médicaments actuels",
explique M. Lee. "En outre, ces nouveaux antibiotiques pourraient constituer
une alternative aux traitements déjà disponibles, qui peuvent être efficaces
mais ont des effets secondaires indésirables importants", ajoute le
chercheur.
A Saint-Etienne, le tigre des platanes fait rugir les riverains
:
 Des
signes d'attaque sur les platanes de la ville; la bête, Corythucha ciliata (Tingidae,
Hemiptera) Des
signes d'attaque sur les platanes de la ville; la bête, Corythucha ciliata (Tingidae,
Hemiptera)
Un minuscule insecte s'invite sur les balcons et terrasses des citadins résidant
à proximité de groupes de platanes, les forçant à vivre fenêtres fermées, à
partir du milieu de l'après-midi
« Si ça continue, je vais créer une association ». Francis Urban est très
remonté. Ce Stéphanois est propriétaire d'un magnifique appartement situé au
neuvième étage près de Centre II. Il dispose d'une terrasse plein Sud et d'une
autre orientée Sud-Est.
Tout irait bien si, cet été encore, son appartement n'avait été envahi par des «
petites bestioles » appelées familièrement tigres du platane. Il faut dire que
cette variété d'arbres est partout dans le quartier. Du balcon, on aperçoit la
cour de l'école Jules-Ferry, elle aussi plantée de platanes.
Ce sont ces mêmes arbres qui ont été maintenus entre les voies du tramway et la
faculté de lettres, à quelques pas de là.
Sur chacun, des plaques d'écorce sont tombées, preuve selon Francis Urban de
l'état de dégradation de cette espèce végétale. À l'heure où on aime ouvrir ses
fenêtres en été pour faire entrer un peu de fraîcheur, on voit arriver ces
armadas volantes. Dès 17 heures, les insectes sont plaqués aux vitres et forment
aussi une nappe grisâtre sur la table de jardin.
Ce riverain nous montre les courriers envoyés à la mairie en 2003, en 2004 puis
cette année encore. Par exemple, il écrit : « C'est par milliers qu'ils (les
insectes) nous incommodent, sans oublier que pour pallier les grosses chaleurs,
la solution écologique des échanges d'air en soirée nous est impossible ».
Il a bien rencontré un employé municipal après le deuxième courrier, mais
l'action s'est arrêtée à un échange courtois de paroles. « Je pense que c'est un
problème d'argent », estime Francis Urban. Toutefois, il n'en démord pas : «
Soit la mairie les traite, soit elle les coupe ».
Son épouse montre l'étendage vide : « C'est impossible d'étendre le linge dehors
en été sinon on retrouve plein de petites bêtes accrochées aux vêtements ».
Elle aussi apprécierait des petits dîners en terrasse pour profiter des heures
fraîches des soirées estivales.
Le problème s'arrêtera aux premiers frimas mais Francis et son épouse n'auront
plus alors envie de passer leur soirée de l'autre côté de la baie vitrée.
Non loin de là, sur la Place Jean-Jaurès, bordée aussi de platanes, quelques
consommateurs disent avoir été un peu incommodés par ces invités surprise
tombant dans le verre ou l'assiette.
Serge Michel, patron du Gambrinus, ne trouve pas qu'il y en a davantage que
les autres années. En revanche, il observe que les arbres ont de plus en plus
l'air malades. « Mais on le dit depuis la fin des travaux du parking, en 1998 ».
Entre 3 et 4 mm, mais un grand appétit.
Tout petit, très joli !
Le tigre du platane porte aussi un nom savant : Corythucha ciliata. Il s'agit
d'un insecte de 3 à 4 mm de long, au corps foncé et aux ailes transparentes. Les
antennes, d'un blanc sale, sont poilues.
Il se reproduit à grande vitesse : entre deux et quatre générations par an.
L'hiver sous l'écorce :
Les adultes passent l'hiver sous l'écorce. Au début du printemps, ils quittent
cet abri pour se positionner sur la face inférieure des feuilles, à proximité de
la nervure centrale. Pendant dix jours, ils se goinfrent, puis ils s'accouplent.
Les œufs éclosent au bout de 18 à 20 jours. Quatre mues sont nécessaires aux
larves pour devenir adultes.
Des points blancs :
Les feuilles se décolorent par petits points blancs.
Les plus fortement attaquées tombent prématurément et l'arbre peut se retrouver
tout nu à la fin de l'été.
Les platanes, affaiblis, peuvent ensuite devenir plus sensibles aux attaques de
champignons.
Les traitements :
Si le traitement est effectué en été, il convient de choisir un produit à
vaporiser sur les feuilles.
En hiver, il faudra viser le tronc et les grosses branches charpentières.
Des produits chimiques existent, des méthodes naturelles aussi, comme le
nettoyeur à haute pression.
Benjamin Franklin à Mary Stevenson (1760) :
[...] Votre réflexion sur ce que vous avez lu dernièrement au
sujet des insectes est très-juste et très-solide. Des esprits superficiels sont
disposés à mépriser et à traiter d'hommes frivoles ceux qui prennent cette partie
de la création pour en faire leur étude ; mais certainement le monde leur a de
grandes obligations. Grâce aux soins et au ménage de l'homme, le chétif ver à
soie donne de l'emploi et de la subsistance à des milliers de familles, il est
devenu un immense article de commerce. L'abeille nous cède son miel délicieux et
sa cire qui sert à une multitude d'emplois. Un autre insecte, dit-on, produit la
cochenille, d'où se tire notre riche teinture d'écarlate. Tout le monde connaît
l'utilité des cantharides (ou mouches d'Espagne) en médecine : des milliers de
personnes doivent la vie à ce remède. L'industrie et l'observation humaine
découvriront peut-être quelque jour chez d'autres insectes d'autres propriétés
non moins utiles. Une parfaite connaissance de ces petites créatures peut aussi
mettre les hommes en état de prévenir l'accroissement, de celles qui sont
nuisibles, ou de nous garantir des dommages qu'elles occasionnent. Vos livres
sans doute parlent de tout cela ; je ne puis y ajouter qu'un exemple récent que
je tiens d'un gentilhomme suédois, très-digne de crédit.
Dans les
chantiers du roi de Suède, les pièces de charpente fraîches, destinées à
construire des vaisseaux, étaient attaquées par une espèce de vers, qui
devenaient plus nombreux et plus pernicieux d'année en année, de sorte que les
vaisseaux étaient fort endommagés, avant même que d'être mis à l'eau ; Le roi
envoya de Stockholm M. Linnée, le grand naturaliste, pour examiner la chose, et
voir si le mal comportait quelque remède. Après examen, Linnée découvrit que le
ver sortait d'un petit œuf, déposé sur les aspérités du bois par une sorte de
mouche ou de scarabée dont la nymphe aussitôt qu'elle était éclose commençait à
ronger la substance du bois ; au bout de quelque temps, elle se métamorphosait
en mouche, pareille à celle qui l'avait pondue; c'est ainsi que l'espèce se
multipliait. Linnée reconnut en outre que la saison de la ponte se réduisait à
une quinzaine de jours, dans le mois de mai, à ce que je crois, et n'avait
jamais lieu dans un autre temps. Il conseilla donc de jeter dans l'eau, peu de
temps avant cette date, toutes les pièces de bois frais coupées et de les tenir
immergées jusqu'à ce que la saison fût passée. La chose faite par l'ordre du
roi, les mouches, privées de leur nid habituel, ne purent se multiplier;
l'espèce en fut détruite, ou alla ailleurs, et le bois fut sauvé, car, passé la
première année il était trop sec et trop dur pour convenir à ces insectes.
Il est toutefois à propos d'apporter une certaine modération
dans les études de cette sorte. La connaissance de la nature peut être un objet
d'agrément ou d'utilité, mais on serait répréhensible si, pour s'y distinguer,
on négligeait la connaissance et la pratique des devoirs essentiels. Car, dans
les études naturelles, il n'y a rien qui soit aussi important que d'être bon
père, bon fils, bon mari ou bonne femme, bon voisin ou bon ami, fidèle sujet ou
bon citoyen, et en un mot bon chrétien. Nicolas Gimcrack, qui négligeait le soin
de sa famille pour courir après les papillons, était donc un personnage
ridicule, et donnait beau jeu aux satiriques, à qui il faut l'abandonner.
Adieu, my
dear
Friend
Fil de ver :
Des biologistes de l'Université du Wyoming ont
réussi à modifier génétiquement des vers à soie pour leur faire fabriquer du fil
d'araignée. Ce tour de force scientifique est d'une extrême importance, car
le fil d'araignée possède des qualités de
résistance et d'élasticité que la chimie moderne reste incapable de reproduire.
Bientôt, ce fil, produit à volonté par des millions d'insectes-esclaves, pourra
servir à fabriquer des tendons, des ligaments artificiels, des airbags
améliorés, des vêtements pour sportifs, des matériaux pare-balles et bien
d'autres merveilles ...!
Pauvre Terre !
L'humanité utilise désormais l'équivalent
d'une planète et demie pour subvenir à ses besoins, estime WWF. " Si chaque
habitant de la planète vivait comme un habitant moyen des USA, il faudrait 4,5
planètes pour répondre à la consommation de l'humanité et absorber les émissions
de CO2", ajoute le WWF.
Et 3 planètes si chacun vivait comme un Français !
Dénatalité, décroissance, condamnation des Eglises
...!
Candidats à l’entrée en Europe :
Ils sont 10. 10 espèces d’insectes en faveur desquels une demande
d’autorisation devrait être déposée dans les prochaines 10 années.
Ce sont des IGM, insectes génétiquement manipulés.
Parmi eux, principalement, les moustiques vecteurs Aedes aegypti, A.
albopictus (Moustique tigré), Anopheles gambiae et A. arabiensis,
les Diptères nuisibles à l’élevage Lucilia cuprina (Lucile cuivrée
australienne) et Stomoxys calcitrans (Mouche charbonneuse), les ravageurs
agricoles Bactrocera (Dacus) oleae (Mouche de l’olive),
Ceratitis capitata (Mouche méditerranéenne des fruits), Cydia pomonella
(Carpocapse) et Pectinophora gossypiella (Ver de la capsule du
cotonnier).
Certaines espèces inscrites ne sont présentes et dommageables que
dans un territoire d’outre-mer, ainsi la
lucilie en Nouvelle
Calédonie.
Il y a actuellement dans le monde une trentaine d’insectes OGM ;
presque tous ne sont jamais sortis du labo. Beaucoup servent d’outil, de modèle,
pour la recherche. D’autres sont développés par les artisans de la lutte
autocide contre les mouches du bétail et des ravageurs du cotonnier et des
fruits. Leur mise au point est très active en entomologie médicale, contre les
moustiques vecteurs. Le ver à soie GM est attendu comme « usine à protéines ».
D’autres applications sont encore loin de la mise en pratique – heureusement ou
malheureusement selon les opinions – comme les hématophages vaccinateurs, les
dispensateurs de phéromones de confusion sexuelle, les auxiliaires ou l’Abeille
domestique résistants aux insecticides…
Land art
Une équipe d’entomologistes de
l’université de Loughborough (Royaume-Uni) propose de
peindre les éoliennes – toutes blanches ou gris pâle – en violet. En
effet, d’après les captures de panneaux colorés englués disposés à l’altitude du
rotor de ces engins, violet est la couleur qui attire le moins les insectes
volants.
Ceux-ci sont effectivement attirés par les éoliennes – et même la
nuit. Ce qui est grave, c’est que les oiseaux insectivores et les chauves-souris
s’y précipitent à leur poursuite.
Des travaux supplémentaires devront
établir le rôle de la chaleur dégagée par les aérogénérateurs.
 Lâché d'araignées en Grande-Bretagne : Lâché d'araignées en Grande-Bretagne :
Une
chercheuse les a élevées dans sa cuisine...
Elle les a élevées dans sa cuisine et même nourries à la
main. Les petites protégées d’Helen Smith, chercheuse en écologie, vont être
relâchées dans la nature cette semaine. Quelque 3.000 bébés araignées, de
l’espèce Dolomedes plantarius, iront peupler la réserve naturelle de
Castle Marshes dans le Suffolk pour revigorer une espèce menacée, selon
Natural England, un
organisme qui conseille le gouvernement sur la biodiversité.
Des araignées en éprouvette
L'espèce
est rarissime: deux habitats seulement en Angleterre et un
au Pays de Galles. Il s'agit
d'une araignée de belle taille
(18 à 23 mm pour le corps d'une femelle) qui se distingue de ses congénères par
une bande colorée crème, jaune ou blanche sur l'abdomen.
Les bébés
araignées ont été élevés dans des éprouvettes de laboratoires, séparés les uns
des autres pour éviter qu'ils ne se battent, et nourris à la main avec des
insectes. Selon Helen Smith, élever les bébés araignées s'est révélé «épuisant».
«Je me retrouvais dans ma cuisine jusqu'à 2 heures du matin, 7 jours sur 7, en
train de nourrir des bébés araignées affamés», témoigne-t-elle.
L'espèce est
classée «en danger» au Royaume Uni, et Natural England espère que l'opération de
réintroduction va lui donner une deuxième chance.
Le réchauffement pourrait favoriser les insectes « ravageurs» :
 A
en croire des chercheurs de Rennes 1 et du CNRS, le réchauffement
climatique pourrait favoriser dans les années à venir la prolifération
des insectes ravageurs notamment en France. A
en croire des chercheurs de Rennes 1 et du CNRS, le réchauffement
climatique pourrait favoriser dans les années à venir la prolifération
des insectes ravageurs notamment en France.
Si le phénomèhe n'est pas nouveau, il
inquiète. Les "ravageurs" menacent. A l'exemple des chenilles
processionnaires du pin, au poil urticant, qui se nourrissent de
feuilles, et qu'on trouve désormais en Bretagne, les insectes
"nuisibles" remontent désormais vers le Nord. Et selon Joan van Baaren,
responsable scientifique du projet de recherche "Impact des changements
climatiques", "les indices laissent à penser que les
changements climatiques seront plus favorables aux ravageurs qui sont
plus prolifiques".
La Maître de conférences à
l'université de Rennes 1 travaille à une solution
écologique : les parasitoïdes qui ont "un rôle
de régulateur des ravageurs". Ces petites guêpes pondent leurs
œufs dans les insectes nuisibles pour l'homme. La larve se développe à
l'intérieur de l'insecte et le grignote progressivement pour finalement
le tuer. A terme, l'objectif serait d'utiliser ces parasitoïdes pour
protéger les cultures de manière biologique.
 Des insectes dans nos assiettes ? Des insectes dans nos assiettes ?
Pourrons-nous
bientôt acheter des insectes grillés au supermarché ?
C’est en tout cas ce que souhaite la FAO (Food and Agriculture Organization), un
organe de l’ONU en charge de l’alimentation. Un atelier était organisé la
semaine dernière avec l’Université de Chiang Mai pour explorer « les
possibilités d’améliorer le conditionnement et la commercialisation » des
insectes comestibles.
Pour Patrick Durst, forestier principal à la FAO, l’objectif est de rendre les
insectes comestibles plus attrayants aux acheteurs traditionnels et d’ouvrir le
marché à de nouveaux consommateurs, en particulier en milieu urbain ».
On consomme 14 000 espèces à travers le monde, et cela représente pour
l’organisation un « créneau prometteur tant sur le plan commercial que
nutritionnel ». Les punaises, fourmis, sauterelles, criquets et autres possèdent
en effet une valeur nutritive élevée, certains contenant autant de protéines que
la viande ou le poisson.
En Thaïlande, on en consomme 200 espèces différentes, y compris à Bangkok.
Pour ma part, je n’ai encore jamais franchi le pas, je préfère un bon Burger
King ou un MK Restaurant.
De magnifiques dessins de Tremois,
difficiles à reproduire sur Internet (protégés) !

Des insectes géants !
Ces insectes géants s'appellent des wetas. Ils peuvent atteindre
10 centimètres de long (sans les pattes et antennes) et peser jusqu'à 70 grammes
(plus lourd qu'un moineau !).
Des insectes géants !
Ces insectes géants s'appellent des wetas. Ils peuvent atteindre 10 centimètres
de long (sans les pattes et antennes) et peser jusqu'à 70 grammes (plus lourd
qu'un moineau !).
 
Ils rivalisent avec les goliaths pour le record de poids chez les insectes !
Cette espèce de weta sur ces photos, provenant de Nouvelle-Zélande, a failli
subir l’extinction il y a 100 ans alors qu’elle était décimée par les rats et
autres petits mammifères. Elle a récemment été réintroduite sur le territoire
principal de la Nouvelle-Zélande.
Des sushis d'insectes ! Régalez-vous !!




La vie aventureuse d'un bon grand entomologiste-chasseur américain
:
By day Charles DeRoller is
the Director of International Sales and Marketing at Redcom in Fishers,
NY. But during his off hours he leaves his brief case and lap top behind
and heads for the four corners of the earth in search of bugs. Yes—
bugs.
Technically, DeRoller is an entomologist. He studies insects.
"But you can say bugs,” he smiles. “That's what we call them.”
About
8000 specimens catalogued and stored neatly and securely in a climate
controlled space at home bear witness to the fact that this is
more than just a casual hobby for DeRoller. And with this kind of
attention, his extensive collection could potentially last for hundreds
of years.
He was bitten by the “bug” bug about 40 years ago.
“My
dad had a small collection of bugs when I was three years old,”
remembers DeRoller. “Then in kindergarten I met a kid who was into it
too and we won the first grade science fair with our displays of bugs.”
“In ‘76 we moved to Webster and I met another kid who was into bugs and
he turned out to be my best friend,” DeRoller recalls. “That's what we
did all through school— go catch bugs. When everybody else was doing
whatever kids do after school, that's what we’d be doing.
And when
other kids were setting up lemonade stands, mowing lawns and babysitting
for extra cash, DeRoller was earning his money in a different way.
“I
started selling insects that we caught locally when I was 14,” he
smiles. “I did allright. I sold monarchs for 25 cents and dragon flies
for a buck. I sold to collectors, and some to artists for framing.”
Now as an adult, DeRoller goes to literally the ends of the earth in
search of exceptional specimens.
“I used to buy some,” he says, “but
now I go to exotic locations and spend a couple of weeks out in the
jungle and catch bugs, bring them back and identify them.”
Over the
last 15 years this modern day explorer has taken roughly 20 overseas
excursions lasting from a day to a couple of weeks.
“I’ve had malaria
three times,” he recalls. “I’ve had salmonella, giardia (intestinal
parasite), I've been shot at by militants, and have encountered
crocodiles.”
DeRoller’s meal plan while traveling is quite unique,
and for him, the buffet is always open.
“I eat what I find,” he says
with a note of pride. “I go into the jungle and I take nothing with me
except one canteen of water. I just live off the jungle— no food, no
tent, no sleeping bag, no mosquito net.”
And while he’s in search of
bugs, does he eat them too?
“Yes, I eat insects while in the jungle:
grasshoppers, mantises, and grubs,” says DeRoller. “I usually eat fruits
and tubers which are abundant. Land crabs are great, and grasshoppers
are fine. A short trip to the shoreline always turns up fish. I'll eat
just about anything raw, but some things like crabs and some veggies are
just much easier to eat cooked. And all I have to do is find some
native village and they're always happy to share.”
“I like being out
in the jungle,” DeRoller confesses. “I don't care to hike, I don't care
to camp, I'm looking for the new stuff, the undiscovered. Things I
can't identify, and specimens that I think either museums or serious
collectors would appreciate. I'm very selective.”
“I discovered
two new species of butterfly,” smiles DeRoller. “One of them a colleague
of mine named, the other one, I named.”
But good luck pronouncing
those discoveries. Entomologists of this caliber don’t seem to choose
short, catchy, easy-to-remember names.
No larger than the size of a
thumbnail, ‘Psychonitis Waihuru’ is brilliant blue on its top and
striking black and white on its bottom. There is only one known specimen
in the world: DeRoller’s. Originating in the Solomon Islands, it has
been donated to the British Museum of Natural History in London.
‘Argyronympha Rubianensis Masolo,’ another catchy tongue twister, was
found on Tetepari Island in the Solomon Islands. It’s a small brown and
yellow butterfly that’s the size of a half dollar.
“I was on an
island that had never been surveyed,” remembers DeRoller. “As soon as I
saw it I knew it was different. Of six existing specimens, four are in
British Museum of Natural History and two I have.”
Some of his other
specimens have been donated to the Carnage Museum in Pittsburgh,
Pennsylvania, The Arthropod Museum in Florida, and the Strong Museum in
Rochester.
So with 40 years invested and thousands of frequent flyer
miles racked up, the question has to be asked: Why does he do it? Why
collect bugs? DeRoller’s answer reflects his lifelong passion.
“It's
important to study and collect insects for several reasons,” he says.
“First, with ongoing deforestation and housing development worldwide, we
need to find these new species before they are extinct. If we don't know
they exist, we cannot protect them.”
“Second,” he continues, “you
never know where the next big break-through in medicine or science might
come from. If the source is gone, then the solution is gone forever.”
“Third, while photos are wonderful, they are limited in the data they
can provide. And fourth,” he concludes, “to enlighten people
(particularly children) about the beautiful, often unseen, world around
them.”
DeRoller’s motivation is also personal.
“My daughter is
three and she has her own bug collection that we started this year. She
loves bugs, snakes, and fishing. She's just like daddy— no fear.”
200 new species discovered in 60-day expedition in New
Guinea :
"There’s no question that the discoveries we made in
both surveys are incredibly significant both for the large numbers of new
species recorded, and the new genera identified," said Leeanne Alonso, head of
CI's Rapid Assessment Program (RAP) which sends scientists on brief expeditions
into biodiverse areas that have been largely unsearched by researchers. Since
its first expedition in 1990, RAP has uncovered over 700 new species.
On this expedition in the Nakanai Mountains experts found a
unique high-altitude mouse with a half white, half black tail. With no close
relatives to date identified, researchers are creating a new genus for the tiny
rodent.
Entomologists also
uncovered a variety of new ant species, including an ant sporting remarkable
spins on its back. Researchers believe the new ant, of which they only found two
individuals, actually lives high in the forest canopy. Like the mouse, the new
ant is so different that researchers think it belongs to its own genus: DNA
studies on species are underway.
Another notable discovery
was a two centimeter long frog from the ceratobatrachid family. The new tiny
amphibian was surprising because until now these type of frogs were only known
from the Solomon Islands.
Researchers were
especially attracted to the Nakanai Mountains and Muller range given that both
have been nominated for UNESCO World Heritage status by the federal government's
Department of Environment and Conservation.
"We hope that news of these
amazing new species will bolster the nomination of these spectacular
environments for World Heritage status," said expedition team leader Stephen
Richards.
Once protected by its remoteness and wild geography, Papua New
Guinea's people and species are facing new threats, as well as new
opportunities. Logging and palm oil industries are putting pressure on tribes
and the governments to clear forests for income, while big development projects,
such as mines, imperil ecosystems. For now, however, Papua New Guinea remains
one of the most untouched nations in the eastern hemisphere.
"[These new
species] should serve as a cautionary message about how much we still don’t know
about Earth’s still hidden secrets and important natural resources, which we can
only preserve with coordinated, long-term management," said Alonso.
Collaborating with CI was A Rocha International (ARI), a Christian-oriented NGO
devoted to conservation.
"As Christians, we believe we are called to
care for creation and ensure that life on Earth is protected and respected, no
matter how seemingly insignificant a particular species might appear to be,”
said Sir Ghillean Prance, chair of the A Rocha International Board. "We also
believe that we have a responsibility to help the poorest members of society,
whose needs very often go hand in hand with natural resources, as it is usually
the poorest people who live most closely to nature and depend on it for their
daily needs."
Enorme gisement d'ambre découvert en Inde ! :
 L’examen des insectes retrouvés incrustés dans des morceaux
d'ambre trouvés dans le Nord-Ouest de l'Inde, un des plus importants gisements
d'ambre au monde, permettent de considérer sous un jour nouveau
l'histoire du sous-continent indien. L’examen des insectes retrouvés incrustés dans des morceaux
d'ambre trouvés dans le Nord-Ouest de l'Inde, un des plus importants gisements
d'ambre au monde, permettent de considérer sous un jour nouveau
l'histoire du sous-continent indien.
Plus de 700 arthropodes issus de 55 familles animales
différentes ! Des insectes bien sûr mais aussi des araignées, des acariens et
des restes de plantes. C’est le petit trésor qui attendait emprisonné depuis
plus de cinquante millions d’années dans sa gangue d’ambre. Encore mieux : les
cadavres sont dans une certaine mesure extrêmement bien conservés et il est très
facile d'amener la résine fossilisée à délivrer son contenu. Les
chercheurs de l'Université de Bonn présentent dans la revue PNAS ce
trésor vieux de plus de 50 millions d'années, qui commence seulement à être
exhumé.
Les morceaux d’ambre proviennent des régions côtières de la
province du Gujarat située dans le Nord-Ouest de l'Inde. Leur contenu permet de
considérer d'un regard neuf l'histoire du sous-continent: en effet, ce dernier
se serait détaché il y a de cela 160 millions d'années de la plaque de l'Afrique
orientale pour ensuite dériver et traverser seul les océans – à un rythme assez
rapide d'environ 20 centimètres par an. L'Inde a ensuite heurté l'Asie il y a
environ 50 millions d'années. C'est lors de cette collision que l'Himalaya s'est
formé.
Si ces informations sont exactes, l'Inde aurait été
complètement isolée pendant cent millions d'années. Cette période aurait été
suffisante pour permettre le développement d'une faune et d'une flore uniques en
leur genre. L'ambre indien est apparue il y a 53 millions d'années de cela. Un
peu à la manière d'une photo ancienne elle permet de voir à quoi ressemblait la
vie en Inde peu avant la collision avec le continent asiatique. Ce cliché
instantané devrait donc également permettre de découvrir des espèces animales
qui n'existent nulle part ailleurs.
Les insectes retrouvés sont particulièrement bien
préservés.
Mais
c'est précisément ce que ce cliché ne permet pas: on a aussi trouvé en Europe et
même en Amérique centrale des insectes fossilisés identiques à ceux mis au jour
dans la province de Gujarat. D'après le Professeur Jes Rust : « cela va
dans le sens de la thèse selon laquelle il existait déjà de nombreux échanges
entre espèces bien avant la découverte de l'ambre ». Il y avait alors
vraisemblablement à la frontière entre les différentes plaques continentales de
longues chaînes d'îles volcaniques comparables à ce que l'on trouve aujourd'hui
au Japon ou en Indonésie. En sautant d'île en île, les espèces d'insectes
trouvées en Inde et en Asie se seraient donc mélangées – et ce, des millions
d'années avant la grande
A la recherche de nouvelles espèces en
République centrafricaine :
 Une
expédition scientifique se rendra début novembre en République
centrafricaine pour étudier la biodiversité dans une région de lacs mal
connue, à la découverte de nouvelles espèces, ont annoncé jeudi les
organisateurs, de l'association Insectes du Monde basée à Toulouse. Une
expédition scientifique se rendra début novembre en République
centrafricaine pour étudier la biodiversité dans une région de lacs mal
connue, à la découverte de nouvelles espèces, ont annoncé jeudi les
organisateurs, de l'association Insectes du Monde basée à Toulouse.
Cette
mission d'une dizaine de personnes dans le parc national de
Dzanga-Ndokicette, baptisée "Sangha", devrait notamment permettre
d'identifier de nouvelles espèces d'insectes de la zone dont "nous n'avons
aucune donnée entomologique", a estimé le coordinateur, Philippe Annoyer,
entomologue au Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse.
Lors
d'une expédition en 2008 près de la rivière Sangha, dans la même région
d'Afrique, il avait découvert 13 nouvelles espèces, dont 10 de fourmis, une
de papillon de jour, une de bousier et une de mante.
L'entomologue, qui
sera notamment accompagné d'un botaniste et d'un ornithologue, prospectera
en particulier toute la ramure d'arbres situés au bord des lacs, pour
déterminer quels insectes vivent sur les mousses, lichens, orchidées ou
fougères croissant sur les branches.
"Les insectes sont de très bons
indicateurs de la biodiversité et de ses changements", car la présence de
telle ou telle espèce révèle celle des plantes, des mammifères ou des
oiseaux auxquels ils sont associés, explique Philippe Annoyer.
Les
chercheurs travailleront dans des arbres de 40 à 60 m de haut, juchés sur
une plateforme spéciale en toile de l'association "Tout là-haut", qui permet
de pénétrer à l'intérieur de l'entrelacs de branches.
Des
scientifiques français partent mercredi (3 novembre) pour le
parc national de Dzanga-Ndoki en Centrafrique pour y
découvrir de nouveaux
insectes et étudier
notamment le mythique
papillon géant "Papilio
antimachus".
"Nous n'avons aucune donnée
entomologique" sur cette zone de lacs, explique Philippe
Annoyer, le coordinateur général de la mission "Sangha"
montée par l'association
Insectes du Monde qui
espère recueillir une moisson de nouveaux spécimens.
Philippe Annoyer ne rentre jamais
bredouille
En 2008 une expédition, effectuée près
de la rivière Sangha dans la même région d'Afrique centrale,
avait permis à Philippe Annoyer de rapporter 120.000
insectes. Parmi eux, 13
nouvelles
espèces, dont 10 de
fourmis, une de
papillon de jour, une de
bousier et une de mante avaient été identifiées.
Cette
expédition, qui comprend également un botaniste et un
ornithologue, sera accompagnée de chercheurs de l'université
de Bangui, de pygmées connaissant bien la région et sa
faune, ainsi que d'une soixantaine de personnes, chargées de
convoyer sur place une tonne et demie de matériel. Ils
navigueront en pirogue, sur la Sangha à partir du bourg de
Bayanga, avant de frayer son chemin pendant six jours au
cœur de la forêt du bassin du Congo.
Comment
vont-ils procéder une fois sur place ?
Les
scientifiques, qui travailleront dans des arbres de 40 à 60
mètres de haut, seront juchés sur une plateforme spéciale en
toile qui permet de pénétrer à l'intérieur de l'entrelacs de
branches pour observer les
insectes dans leur milieu
naturel.
L'entomologiste Philippe Annoyer prospectera la
ramure de la base au sommet, pour déterminer quels
insectes vivent sur les
mousses, lichens, orchidées ou fougères croissant sur les
branches.
"Les
insectes sont de très bons
indicateurs de la biodiversité et de ses changements" car la
présence de telle ou telle
espèce révèle celle des
plantes, des
mammifères ou des oiseaux
auxquels ils sont associés, explique Philippe Annoyer.
Les gros
mammifère sont très
difficilement visibles car la forêt est très dense et ils
fuient à l'approche du danger. "Mais il existe une
espèce de bousier qui ne
mange que les excréments de l'éléphant. Si nous en observons
une grande quantité, cela signifiera que ces
mammifères sont nombreux
dans la zone" note-t-il. En revanche, l'absence de tel autre
insecte prouve celle de
l'animal auquel il est lié.
 Pour
en savoir plus sur le "Papilio antimachus" Pour
en savoir plus sur le "Papilio antimachus"
Ce lépidoptère, de couleur orange à rouge, toxique, figure
parmi les plus grands
papillons, pouvant
atteindre une envergure de 20 à 25 centimètres.
Or "la
femelle est rarissime et ne vit que dans la cime des arbres
: on ne connaît pas sa biologie. Ses œufs, la chenille, la
chrysalide, sont inconnus" raconte-t-il. "Je souhaiterais
vraiment trouver sur quelle
plante vit la chenille,
découvrir si la toxicité de la
plante hôte et de l'insecte
est la même" dit-il.
Suite : SANGHA 2012 est constitué de 2 missions distinctes
La mission 2010
Le but de cette mission est de préparer la mission de 2012 en
permettant un repérage des lieux et une évaluation des techniques de
prospection.
Description approfondie des biotopes de 3 lacs sélectionnés parmi
les 7 lacs prospectés
Inventaire de la faune et de la flore d’un ou deux arbres
Méthodologie de collectes botaniques
Inventaire et étude des communautés lichéniques, bryophytes et
ptéridophytes
Evaluation de l'efficacité des pièges à arthropodes
Taxonomie
Autres collaborations scientifiques
La mission 2012
Evaluation la plus exhaustive possible de la biodiversité des zones
sélectionnées durant la mission 2010 intégrant des nouveaux domaines
de recherche (mammalogie, mycologie…).
 Et pour un insecte de plus ... Et pour un insecte de plus ...
Forêt de San Lorenzo, en 2004 : la mission au
Panama du projet Ibiaca (Inventaire de la biodiversité des insectes du sol et de
la canopée) est lancée. Cet inventaire , étalé sur quatre saisons, a l'ambition
d'être l'un des plus exhaustifs sur les insectes de cette zone. Un enjeu de
taille. Car San Lorenzo est une forêt tropicale humide, de celles qui hébergent
plus de la moitié des insectes vivant sur la Terre, alors qu'elles ne
représentent que 8% du territoire émergé. Un rêve pour naturalistes. Un
rêve qui, ils le savent, va les maintenir occupés plusieurs années. Au terme de
la mission, 422 000 arthropodes auront été collectés. De nombreuses espèces,
encore inconnues pour la Science, sont peu à peu isolées, décrites et nommées.
Parmi celles-ci, une nouvelle espèce d'hémiptère,
Oronoqua ibisca est
décrite en 2010. "Nous avons comparé les spécimens du
Panama avec l'unique exemplaire d'Oronoqua alors connu en collection,
précise Henri-Pierre Aberlenc, entomologiste au
Cirad. Nous avons alors compris que
les 3 femelles découvertes en 2004 appartenaient à une espèce proche, mais
inédite". Avec si peu d'exemplaires collectés, on pouvait craindre que
l'espèce ne soit rare et menacée. "Pas nécessairement, rassurent les
auteurs de la description. Cela souligne surtout que nous ne savons rien de
ces insectes herbivores tropicaux. Nous ne connaissons ni leur biologie ni leur
plante-hôte, ce qui rend les captures aléatoires". Paradoxalement,
chaque découverte d'espèce nouvelle souligne l'immensité
de ce que la Science ignore encore.


1) Jérôme Orivel de Toulouse aspire des fourmis
arboricoles (en équipement spéléo ...)
2)
Jürgen Schmidl d’Erlangen (RFA) en pleine
opération de “fogging” (fumigation).
L'éclairage nocturne favorise certaines épidémies :
Des chercheurs estiment que le phénomène devrait être
étudié de près.
«En modifiant le
comportement des gens et des insectes, l'éclairage nocturne favorise les
contacts entre les humains et les vecteurs potentiels d'épidémies et même
ceux qui ne sont pas traditionnellement impliqués dans la transmission de
maladies à l'homme», expliquent Alessandro Baghini et Bruno de Medeiros, de
l'université de São Paulo (Brésil) dans le numéro de novembre de la revue
Environmental Health Perspectives. Ils donnent trois exemples.
La
maladie de Chagas, qui avait presque entièrement été éradiquée du Brésil
depuis les années 1970, est en train de réapparaître sporadiquement selon
des modes de contamination tout à fait différents dans des régions où
l'éclairage a été nouvellement installé (électricité ou pétrole). Véhiculé
jusqu'alors par des insectes piqueurs aux mœurs nocturnes, le parasite est
désormais transmis par des espèces apparentées mais fortement attirées par
la lumière.
Des insectes vecteurs
Les personnes se contaminent en absorbant des jus des
fruits ou de la nourriture souillés par des insectes vecteurs. La maladie de
Chagas qui se manifeste par des nodules provoque de fortes fièvres pouvant
conduire à la mort.
Même chose pour la leishmaniose, une maladie cutanée
qui peut prendre une forme viscérale, plus grave. Les petits moucherons (les
phlébotomes) transmettant cette maladie étant eux aussi attirés par la
lumière, l'épidémie se transmet désormais dans les zones périurbaines où des
lampadaires sont installés dans les rues. «Le risque augmente dans les
maisons ayant un éclairage extérieur, des murs clairs, des buissons alentour
et du bétail à proximité», ont noté des chercheurs brésiliens.
Pour le
paludisme, la situation est un peu différente. Aucune étude sur l'impact de
l'éclairage nocturne sur cette épidémie n'a encore été spécifiquement menée.
«En Amazonie, la lumière artificielle a incité la population à passer plus
de temps à l'extérieur durant la nuit. Cela a pu attirer les moustiques et
favoriser la transmission», notent les deux chercheurs brésiliens. Ils
estiment que des études épidémiologiques devraient être menées dans ce sens.
L'exemple des îles Salomon où l'électrification, dans les années 1980, a
coïncidé avec une recrudescence du paludisme montre en effet qu'il y a
matière à s'interroger.
Une très belle vidéo sur une Pelidnota
quadrimaculata, en Guyane :
http://www.youtube.com/v/Am4A5iW665s?hl=fr&fs=1"></param><param
Les punaises à
l’attaque de Paris :
Après avoir
infesté New-York à la fin de l’été dernier, les punaises de lit
sont-elles en train d’envahir Paris ? Aux États-Unis, les "bedbugs"
avaient créé une véritable psychose, entrainant des fermetures de
magasins ou de bâtiments administratifs. En France, rien de tel pour
l’instant mais les services d’hygiène et les sociétés spécialisées
dans la désinsectisation constatent que les cas sont de plus en plus
nombreux. Ces petites bestioles d’à peine 5 millimètres prolifèrent
en ce moment dans la capitale. Elles se cachent dans les draps,
matelas et sommiers. Et il est très difficile de s’en débarrasser...
Monsieur Marcel est désinsectiseur de profession. Et depuis
plusieurs semaines, son téléphone n’arrête pas de sonner pour des
interventions dans tous les quartiers de la ville, "dans de tous
petits appartements insalubres, dit Monsieur Marcel, mais aussi dans
de superbes lofts des beaux quartiers. Les punaises touchent tout le
monde. Je dirais que Paris, et même la France, sont envahis en ce
moment ! "
 Ces
punaises de lit (nom scientifique : Cimex lectularius) avaient plus
ou moins disparu au milieu des années cinquante, mais elles ont
profité de l’interdiction de certains insecticides, comme le DDT, et
du boom des voyages internationaux pour réapparaitre. Elles se
transmettent par les voyageurs qui ramènent dans leurs valises ces
drôles de souvenirs. Ensuite, la punaise se cache partout : dans les
matelas, les sommiers, les vêtements, les plinthes. L’insecte vit en
moyenne dix mois, se déplace vite et se reproduit rapidement (la
femelle peut pondre jusqu’à 500 œufs). Il faut parfois plusieurs
pulvérisations pour s’en débarrasser. Ces
punaises de lit (nom scientifique : Cimex lectularius) avaient plus
ou moins disparu au milieu des années cinquante, mais elles ont
profité de l’interdiction de certains insecticides, comme le DDT, et
du boom des voyages internationaux pour réapparaitre. Elles se
transmettent par les voyageurs qui ramènent dans leurs valises ces
drôles de souvenirs. Ensuite, la punaise se cache partout : dans les
matelas, les sommiers, les vêtements, les plinthes. L’insecte vit en
moyenne dix mois, se déplace vite et se reproduit rapidement (la
femelle peut pondre jusqu’à 500 œufs). Il faut parfois plusieurs
pulvérisations pour s’en débarrasser.
La folie des "bed bugs" à New-York
L’été dernier à Manhattan, des boutiques de vêtements ont été
contraintes de fermer par crainte des "bed bugs". On a retrouvé des
punaises également au siège des Nations Unies ou à l’Empire State
building. Un new-yorkais sur quinze se dit envahi par ces insectes
et 30.000 plaintes ont déjà été enregistrées par les autorités
municipales. Aurélien Colly, notre correspondant à New-York,
raconte : "on voit encore sur les trottoirs de Manhattan des
dizaines de matelas et des sacs de vêtements abandonnés. Certains
syndics d’immeubles font même appel à des chiens renifleurs, censés
dénicher ces petites bêtes !"
A Paris pour l’instant, pas de telle psychose. Le SMASH (service
municipal d’actions de salubrité et d’hygiène) aurait déjà réalisé
plus de 600 interventions depuis le début de l’année. A l’Hôtel de
Ville, le discours est rassurant, mais différent si vous appelez une
mairie d’arrondissement : "on ne fait que ça en ce moment", confie
un technicien qui semble bien occupé en ce moment par ces petites
punaises.
Insecte de l'année 2011 : la
Formica Exsecta
Lundi 8 novembre, Le conseil d'administration du Musée
d'histoire naturelle berlinois présentait, lors d'une conférence de presse,
différents "insectes sociaux" [1] en vue d'élire l'insecte de l'année 2011.
L'Allemagne, ainsi que l'Autriche et la Suisse, ont ainsi porté leur choix sur
la fourmi de type "Formica Exsecta".
En choisissant cette fourmi, le
conseil met l'accent cette année sur une espèce particulièrement protégée
puisqu'en voie d'extinction. Les fourmis "Formica Exsecta" ne sont pas des
insectes solitaires, elles ne peuvent survivre individuellement. Comme toutes
les fourmis, elles ont formé des colonies de très grande taille, qui contiennent
plusieurs centaines de milliers d'individus. La fourmi Formica Exsecta
appartient à la famille des fourmis forestières : comme ces dernières, elle ne
pique pas, puisque démunie de dard. Pour se défendre, la fourmi forestière
recroqueville son abdomen sous son thorax de façon à ce que son extrémité soit
orientée devant elle et en l'air, et projette un jet d'acide formique avec une
force redoutable. Elle se sert aussi de ses mandibules pour déchiqueter ses
proies, et injecte pour finir de l'acide dans les blessures ainsi infligées.
 Sauterelle méga-burnée : Sauterelle méga-burnée :
Ça va faire des jaloux, mais celui qui a les
plus grosses couilles du monde n'est ni un acteur porno, ni votre facteur, ni
Nicolas Sarkozy, mais une banale sauterelle du nom de Platycleis affinis.
Ils pèsent 70mg chacun, soit 14% du poids de la bête (ce qui fait des
pastèques de 15 kg ramené à l'homme).
Contrairement
à ce que l'on pourrait penser, ces testicules ne permettent pas d'éjaculer
davantage, et ils ne représentent pas non plus un argument esthétique, vu qu'ils
sont à l'intérieur du corps. Par contre, ils permettent de féconder davantage de
femelles (Ah ! Quand même !!), ce qui multiplie les chances de reproduction pour
ces mâles, dont les femelles sont particulièrement volages. Dans le monde
animal, il semble en effet que la taille des couilles soit proportionnelle à
l'infidélité des femelles. Selon cette étude, c'est parce que la femme serait
plutôt monogame (quoique pas complètement !!) que l'homme n'est pas obligé de
porter ses couilles dans une brouette !!
(Charlie Hebdo)
Beetle beauty captured in silicon :
 The
shells of scarab beetles take on a metallic appearance The
shells of scarab beetles take on a metallic appearance
Researchers in Canada have created a new material that mimics the
brilliant iridescent colours seen in beetle shells. As the eye-catching
effect can be switched off with the simple addition of water, the
researchers believe their new material could lead to applications
including "smart windows".
Structural colours, such as those on beetle shells and butterfly
wings, differ from traditional pigments because the colour results
from the interaction of light with periodic structures on the
surface of the material. In certain biological materials, including
the shells of scarab beetles, these exoskeletons take on a twisted
or "chiral" structure, which causes reflected light to emerge
circularly polarized.
Kevin Shopsowitz, working with colleagues at the University of
British Columbia and FPInnovations, has now succeeded in mimicking
this effect in a silica film. The breakthrough occurred with a
certain degree of serendipity as the researchers were working with
their industrial partner to develop forms of porous silica that
could be used to store gases such as hydrogen. They were using
nanocrystalline cellulose (NCC) as a template in silicon, which was
then burned away to leave gaps within the silica.
Twist and shout
But when Shopsowitz had forged the material, he discovered that is
appeared to be iridescent. Analyzing the material with polarized
optical microscopy (POM) revealed that the surface of the silica
film had taken on a fingerprint-like texture during evaporation,
with its associated spiralling pattern. Further analysis using
transmission electron microscopy (TEM) confirmed that the individual
nanocrystalline cellulose rods had organised into a "chiral nematic"
structure.
"The eureka moment occurred when Kevin [Shopsowitz] discovered that
the materials were iridescent," Mark MacLachlan, one of the
researchers at the University of Columbia, told physicsworld.com. "Although
NCC by itself forms iridescent films, we never thought it could be
retained in the silica material."
Coloured silica films
Silica is usually a colourless material but modifying the
surface in this way caused these films to reflect light at specific
wavelengths. The researchers demonstrated that by changing the
conditions of the synthesis, they could control how tightly wound
the helix is (the pitch) and hence the wavelength of light that is
reflected. In this way, they produced films that were a range of
different colours.
Une très bonne idée !!
Un site pour acheter et sauver
les forêts tropicales :
D'un simple clic de
souris, devenir propriétaire d'une parcelle de forêt tropicale et lutter du même
coup contre le réchauffement de la planète ?
L'idée, loin d'être
saugrenue, a germé dans l'esprit de Johan Eliasch, le propriétaire de la marque
d'accessoires de sport Head. Ce milliardaire anglo-suédois aux multiples
casquettes, producteur de films notamment, s'est toujours montré très préoccupé
par le sujet : "Le niveau des mers
monte, les glaciers fondent, de grands espaces sont en train de disparaître. Le
seul moyen d'éviter tout ça, c'est de réduire les émissions de CO2 et donc de
lutter contre la déforestation, l'une des premières causes de ces émissions",
prêche-t-il.
Pour mettre ses idées
en application, il a racheté en 2005 à une exploitation forestière 160 000
hectares de forêt amazonienne afin de la protéger.
"Le député anglais Frank Field est venu me voir et m'a demandé : "comment
puis-je faire la même chose ?"", raconte-t-il. C'est ainsi que le concept a vu
le jour : et si chacun pouvait ainsi - selon ses moyens bien sûr - acheter un
lopin de forêt en Amazonie, en Afrique centrale ou en Indonésie pour la protéger
?
Deux ans plus tard, en 2007, les
deux hommes créent l'association caritative Cool Earth. Le site Internet a été
mis en ligne le 5 juin.
http://www.coolearth.org
À partir de 35 livres sterling, tout le monde peut s'offrir
une demi-acre de forêt amazonienne, soit 0,2 hectare pour un peu plus de 50
euros. Avec en prime la possibilité de voir son terrain grâce aux images de
Google Map.
"Agir concrètement"
L'objectif de Cool Earth est double : "Protéger les forêts et ceux qui y
vivent et devenir une voix importante dans la lutte contre le réchauffement,
explique Johan Eliasch. Les gouvernements ont du mal à se mettre d'accord. Nous
voulons agir concrètement."
Une fois
le terrain virtuellement acquis sur coolearth. org, l'association s'engage à le
protéger avec l'aide des populations locales.
À la clé : réduction de la déforestation et travail pour les habitants qui
surveillent la forêt et peuvent utiliser gratuitement ses ressources naturelles.
"Nous avons passé un accord", explique Johan Eliasch. Un pacte qui a permis,
selon lui, de créer 1 500 emplois en Amazonie grâce à sa première initiative de
2005. Mais, revers de la médaille, son action a aussi provoqué le licenciement
du millier d'employés qui travaillaient dans l'exploitation forestière
volontairement fermée.
Reste que
l'initiative connaît un joli succès. L'organisation bénéficie de nombreux
soutiens : 10 000 membres en tout, particuliers, écologistes, businessmen ou
politiques. Plus important encore : depuis le lancement de coolearth. org, plus
de 10 000 hectares ont déjà été achetés.
Une guêpe venue de Chine s'apprête à
dévaster les chataîgniers corses,
la Castagniccia est déjà
touchée.
Dryocosmus
kuriphilus, soit le cynips du chataîgnier, un petit hyménoptère responsable de
la galle du chataîgniers. Venue de chine, plusieurs foyers de cette petite guêpe
ont été localisés en Haute-Corse ces derniers jours.
Alors qu'elle menace les plantations, les castanéiculteurs s'organisaient hier à
Corté afin d'élaborer un plan de combat.
De la famille des cynipidés, cette guêpe provoque des galles. Sous l’effet des
toxines que la larve secrète, il se forme une galle à la place de la pousse
normale. Plusieurs bourgeons sont attaqués et le rameau meurt. Comme il s’agit
généralement d’une pousse fructifère, c’est d’abord la production qui est
condamnée mais l’infestation peut être suffisamment intense pour tuer l’arbre.
Il n'existe aucun moyen curatif pour lutter contre cet insecte. Néanmoins, un
autre insecte, le Torymus, de la famille des chalcidiens, pond ses œufs dans les
larves de cynips. Un espoir pour lutter contre ce fléau qui s'abat sur les
châtaigneraies corses.
d'environ 3mm, cette petite guêpe se reproduit par parthénogénèse
et pond environ 100 œufs
La mouche "hirsute" africaine retrouvée :
 Un
groupe de scientifiques a retrouvé pour la première fois au Kenya depuis 1948
des spécimens de la "mouche poilue", selon un communiqué diffusé mercredi par
l'équipe de chercheurs qui décrit cette mouche comme "la plus rare et la plus
étrange au monde". Les entomologistes Robert Copeland et Ashley Kirk-Spriggs ont
redécouvert la "Mormotomyia hirsuta" dans une crevasse située dans les
Ukazi Hill, à environ deux cents kilomètres à l'est de Nairobi, le seul habitat
jamais enregistré pour cette espèce. Un
groupe de scientifiques a retrouvé pour la première fois au Kenya depuis 1948
des spécimens de la "mouche poilue", selon un communiqué diffusé mercredi par
l'équipe de chercheurs qui décrit cette mouche comme "la plus rare et la plus
étrange au monde". Les entomologistes Robert Copeland et Ashley Kirk-Spriggs ont
redécouvert la "Mormotomyia hirsuta" dans une crevasse située dans les
Ukazi Hill, à environ deux cents kilomètres à l'est de Nairobi, le seul habitat
jamais enregistré pour cette espèce.
"La redécouverte de ces insectes, qui
n'avaient été rencontrés auparavant qu'en deux occasions, en 1933 et en 1948, a
suscité l'engouement dans les muséums d'histoire naturelle à travers le monde",
commente le communiqué publié par le Centre international sur l'écologie et la
physiologie des insectes (Icipe), installé au Kenya.
La mouche est décrite
comme "étrange, en raison de sa taille relativement grande, de ses yeux
atrophiés, de ses ailes qui ne fonctionnent pas et par le fait que les mâles
peuvent étirer leurs pattes couvertes de poils jaunes sur plus d'un centimètre",
selon le communiqué qui estime que l'insecte ressemble plus à une araignée qu'à
une mouche.
"La Mormotomyia ne pouvant voler, la probabilité est
forte que l'espèce soit réduite à cet habitat très limité", a ajouté M. Copeland
dans le communiqué. "Si c'est le cas, ce serait merveilleux que les Ukazi Hill
soient déclarées héritage national et fassent l'objet de mesures de
conservation", a-t-il souhaité.
AFP 08/12/2010
L'homosexualité est-elle une maladie ??
La recherche sur le glutamate finit en enculage de mouches
(au sens propre !!!)
A l'occasion d'expériences en vue de guérir
certaines scléroses, des chercheurs ont modifié le taux de glutamate de mouches
drosophiles, et ont observé avec stupeur l'apparition de parades homosexuelles
parmi les insectes. Une avancée sur la relation entre comportement sexuel et
communication entre neurones.
http://www.rue89.com/2007/12/22/la-recherche-sur-le-glutamate-finit-en-enculage-de-mouches
Vous pouvez observer cette hyperactivité sexuelle dans la vidéo ci-dessus,
véritable séquence pornographique. Mais tout public. Là où le résultat est
devenu stupéfiant aux yeux des chercheurs, c'est que ce comportement homosexuel
a cessé dès que le taux de glutamate des insectes est revenu à la normale.
Ce qui n'était pas le résultat attendu. Jean-François Ferveur est directeur de
l'unité de recherche de Communication chimique chez les insectes à l'Université
de Bourgogne, un département spécialisé dans les parades sexuelles des insectes.
Il a travaillé aux côtés de Yael Grosjean, de l'université de Lausanne, ainsi
sensibilisé à ces comportements :
Le même glutamate que dans la nourriture chinoise
Mais que cherchaient-ils à la base ? A bloquer la circulation du glutamate.
Le glutamate est présent dans le corps humain, émis depuis les cellules gliales
et transporté autour des neurones grâce à un gène, celui-là même que les
chercheurs ont bloqué sur leurs mouches drosophiles. Or quand ce glutamate est
présent en trop grande quantité, il détruit les neurones, provoque de graves
maladies neuro-dégénératives, voire la mort du patient.
C'est ce qui se passe, par exemple, dans le cas des scléroses latérales
amyotrophiques (SLA).
Pour les amateurs de cuisine chinoise, il s'agit bien du même glutamate que
l'exhausteur de goût du même nom, également nocif à haute dose.
Les mouches drosophiles sont connues pour leur génome simplifié et
largement utilisées pour l'étude des maladies neuro-dégénératives.
Yael Grosjean a donc, grâce à des produits pharmacologiques, bloqué le gène qui
permet la transmission du glutamate. Et ainsi observé le changement de
comportement.
« Quand nous stoppons la transmission du glutamate, les neurones-cibles
multiplient leurs récepteurs pour tenter de capter le mieux possible la
substance absente. Ils deviennent ainsi hyperactifs et vont alors détecter des
phéromones mâles qui, normalement, les laissent indifférents. Mais là, ils sont
hyperexcités et les drosophiles réagissent très vigoureusement à cette odeur. »
Bientôt sur des souris
Yael Grosjean et Jean-François Ferveur s'accordent à dire que c'est le caractère
temporaire, d'une durée de quelques heures, qui ouvre de nouvelles perspectives,
comme l'explique ce dernier.
Selon Yael Grosjean, les conclusions sont nombreuses et loin d'être anodines :
« D'abord, cette expérience montre qu'un comportement, sexuel ou non, n'est pas
figé et peut varier selon les transmissions chimiques entre neurones. Ensuite,
le comportement vis-à-vis des femelles n'a jamais varié, alors que l'excitation
envers les mâles subissait de brusques changements. Il y aurait donc deux
circuits parallèles et indépendants d'excitation. »
La découverte paraîtra sous peu dans la revue Nature Neuroscience, mais certains
éléments
figurent déjà sur le site internet de Nature.
La relation entre le glutamate et la sexualité devrait bientôt être examinée sur
des mammifères, par d'autres équipes de scientifiques. Les résultats attendus
sont similaires, puisque le glutamate a les mêmes fonctions sur les insectes que
sur les animaux plus évolués.
Toutefois, peu de risques de voir l'expérience transposée à échelle humaine dans
les prochaines années. D'abord parce que notre génôme est bien plus compliqué
que celui de notre amie la drosophile. Ensuite, comme l'explique Yael Grosjean :
« L'homosexualité n'est pas une maladie. Pas
question, donc, de tenter de “guérir l'homosexualité” en triturant le taux de
glutamate. »
(M. Soula : conclusion en totale contradiction avec
l'étude; toujours la langue de bois ??!!)
Les habits ont 180 000 ans !
(L'entomologie mène à tout !)
Les êtres humains auraient commencé à enfiler
des habits voilà 180 000 ans, lors de l'avant-dernière glaciation. Des
chercheurs de l'Université de Floride ont abouti à cette conclusion après une
étude génétique du ..... pou du corps (Pediculus humanus corporis),
vivant dans le repli des habits. En effet, celui-ci aurait divergé génétiquement
de son cousin, le pou de tête (Pediculus humanus capitis), voilà 150
000 ans. ce qui fait penser aux chercheurs que les hommes auraient commencé à se
vêtir à cette époque. Auparavant, ils se baladaient donc tout nus. Même s'ils
avaient perdu leur fourrure naturelle depuis 1 million d'années. Brrrrrrr !
 Cette dame avait le cafard ! Cette dame avait le cafard !
Une
dame de 52 ans, précédemment sujette à un cafard persistant, se voit prescrire
par son médecin un examen de dépistage du cancer colorectal. On lui nettoye
l’intestin avec 4l d’éthylène glycol la veille, selon le protocole habituel. La
caméra explore : aucune pathologie n’est décelée mais, au niveau du colon
transverse, apparaît un insecte.
Celui-ci, proprement aspiré, est dirigé vers
le labo. C’est une larve âgée de Blatte germanique, Blatella germanica
(Dyct. Blatellidé). Le signalement est aussitôt publié dans le n°42 d’Endoscopy
(septembre 2010).
Le dame avait des cafards à la maison et avait dû en avaler
un par inadvertance en mangeant.
Le secret des ailes irisées des insectes enfin
percé !
 Les jolies
couleurs irisées parfois visibles sur les ailes
transparentes des
Insectes ne seraient pas aléatoires, mais
définies par l’espèce
et le sexe de l’animal. Cette découverte devrait permettre de revoir la
classification des Insectes par les entomologistes. Les jolies
couleurs irisées parfois visibles sur les ailes
transparentes des
Insectes ne seraient pas aléatoires, mais
définies par l’espèce
et le sexe de l’animal. Cette découverte devrait permettre de revoir la
classification des Insectes par les entomologistes.
Lorsque l’on regarde les ailes
transparentes des Insectes selon un angle particulier, de jolis reflets irisés
sont perceptibles. Roses, verts, jaunes,
bleus… Ce joli patchwork
coloré nous est donné par un effet d’optique lié à la
lumière blanche qui arrive sur les ailes dans
des conditions favorables.
Il est le résultat d’interférences
de lumière dus à la superposition de deux très fines couches de
chitine, une
protéine qui constitue les ailes et la
cuticule. Lorsque des rayons lumineux arrivent
sur cette surface, 80 % traversent l'aile alors que les 20 autres pourcents sont
reflétés par la chitine, nous offrant ce beau spectacle.
En
fonction de l'espèce d'Insecte, les couleurs observées sur les ailes
transparentes diffèrent.
Bien que les
couleurs des Insectes
aient été dans l'ensemble largement étudiées (notamment chez les papillons), il
semble que les couleurs des ailes transparentes, pourtant connues depuis
longtemps, n’aient intéressé personne jusqu’à présent. Une équipe de recherche
menée par des entomologistes de l’université de Lund en Suède ont comblé ce
manque en étudiant en détail ces étonnantes couleurs.
Observation sur fond noir...
Afin de comparer de façon précise les différents motifs, les
ailes d’Insectes (de diptères et d’hyménoptères) provenant principalement de
collections de musées ont été placées horizontalement sur un fond noir et
photographiées à des angles proches de la perpendiculaire. Ce genre
d’observation n’avait jamais été réalisé puisque les entomologistes préfèrent
généralement observer les insectes sur fond blanc où il est alors plus facile de
déterminer l'appartenance de l'animal à une espèce particulière.
Les ailes d'Insectes observées sur fond noir montrent de jolies couleurs
irisées, invisibles sur fond blanc :
Grâce à la génération par
ordinateur d’une série de couleurs de
Newton par interférence à l’aide de l'indice
de réfraction de la chitine (1,57), les
chercheurs ont obtenu une échelle de couleurs qui correspondent à la lumière
réfléchie par les deux couches de chitine superposées en fonction de l’épaisseur
globale de l’aile. L'échelle est composée de l’ensemble des couleurs du
spectre visible (l'arc-en-ciel), excepté le
rouge. Ce motif se répète trois fois (jusqu'à une épaisseur d'aile de 550
nanomètres), puis la lumière réfléchie donne
ensuite des couleurs magenta et vertes non-spectrales (couleurs visibles par
l'œil humain, mais en réalité composées d'un mélange de plusieurs
longueurs d'ondes), pour finir progressivement
sur un gris pâle au niveau des couches les plus épaisses.
Ces reflets sont
bien connus puisque l’on observe les mêmes lorsqu’une fine couche d’huile
recouvre une flaque d’eau
ou sur une bulle de savon. Mais à l'inverse de ces reflets qui sont aléatoires,
les chercheurs se sont vite rendu compte que les motifs d’interférence des ailes
ou WIP (pour wing interference patterns en anglais) étaient constants
quel que soit l’angle d’observation. En fait, les motifs ne dépendaient que de
la
morphologie et de l'épaisseur de l'aile, des
critères constants en fonction de l’espèce de l’insecte et de son sexe, d'après
les travaux publiés dans la revue
Proceedings of the National Academy of Sciences.
Dans la nature aussi les couleurs sont visibles et servent certainement de
repères aux congénères.
Des couleurs utiles aux Insectes... et aux
entomologistes !
Si ces propriétés des ailes
permettront probablement aux entomologistes de mieux distinguer deux espèces de
mouches morphologiquement
très similaires et ainsi de revoir les classifications phylogénétiques, ces
couleurs seraient également importantes pour les Insectes. En effet, alors que
les ailes ont une utilité incontestable pour la mobilité de l’Insecte et donc
pour qu’il puisse trouver de la nourriture ou échapper à un prédateur, elles
seraient aussi probablement importantes pour la communication intra ou
inter-espèce, à l’image des ailes colorées des papillons.
Leurs couleurs
pourraient notamment leur permettre d’être reconnues par un individu de sexe
opposé pour favoriser l’accouplement.
Comme les
abeilles qui sont attirées par les fleurs aux couleurs
ultraviolettes, les autres insectes pourraient
également utiliser ces couleurs irisées pour mieux interagir avec leurs
congénères.
Chaco
biodiversity expedition suspended
A joint expedition by the Natural
History Museum (NHM), London and the Natural History Museum, Asuncion to the
dwindling dry forest of the Gran Chaco in Paraguay to record biodiversity, and
hopefully uncover 'hundreds' of new species, has been suspended by the
Paraguayan government. The suspension comes after a local organization voiced
concern that the expedition would threaten uncontacted members of the Ayoreo
tribe in the forest.
"If this expedition goes ahead we will not be able to
understand why you prefer to lose human lives just because the English
scientists want to study plants and animals," the an open letter from Iniciativa
Amotocodie (IA) reads in part. "There is too much risk: the people die in the
forest frequently from catching white people’s diseases—they get infected by
being close."
However, the NHM countered by arguing that the expedition had
taken necessary precautions to avoid any unintentional contact with the tribe,
including having a local Ayoreo elder scout ahead of the group.
"We know
that when we visit remote areas there may be indigenous people that we need to
carefully consider and with the expedition to Paraguay, this has been extremely
important to us," the NHM Press Office told mongabay.com last week. "We've
considered the whole expedition from the very beginning—not only the impact on
the environment but also on the people that live there. We have real concern for
uncontacted peoples. They have a right to remain uncontacted."
The
government of Paraguay says it will meet with Ayoreo representatives to discuss
concerns regarding the expedition. No one has put a timeline on when or if the
expedition will occur.
The Gran Chaco is being rapidly deforested for cattle
ranching, agriculture, and logging, threatening not only the biodiversity in the
region, but the uncontacted group as well.
Doubler la
biodiversité :
L’exploit est à mettre au comte de la recherche. La
recherche de fourmis dans tous les endroits possibles, par tous les moyens
possibles, en mobilisant tout le monde. Chargé d’actualiser l’inventaire des
fourmis dans les dunes de l’Alberta (Canada) près d’Edmonton – qui datait des
années 1960 -, James Glasier, mémorisant de 25 ans, a commencé par refaire la
clé de détermination. Ceci à partir des 20 000 individus récoltés le premier
été.
Résultat : l’Alberta comptait 40 espèces de fourmis, il en possède
désormais 89.
Alerte rouge
 On
est en manque d’E120. Ce colorant rouge, en français le carmin, est le produit
de l’élevage de la cochenille Dactylopius coccus (Hém. Dactylopiidé) sur
cactus nopal. Le Pérou est le principal fournisseur et le secteur de la
pâtisserie-confiserie un utilisateur important. On
est en manque d’E120. Ce colorant rouge, en français le carmin, est le produit
de l’élevage de la cochenille Dactylopius coccus (Hém. Dactylopiidé) sur
cactus nopal. Le Pérou est le principal fournisseur et le secteur de la
pâtisserie-confiserie un utilisateur important.
La pénurie a été déclenchée
par l’abandon partiel d’un rouge concurrent (E124, de la famille des colorants
azoïques) suspecté de provoquer l’hyperactivité chez les enfants. Elle a été
aggravée par l’abandon de l’élevage de la cochenille par certains producteurs,
l’augmentation du prix des cochenilles mères en début de saison, le mauvais
temps, la mauvaise gestion des stocks. Les prix ont flambé et on s’est remis à
planter et à infester des cactus – qui seront pleinement productifs dans 3 ans.
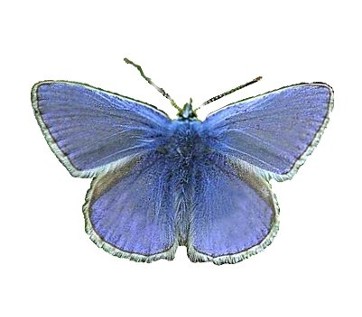 Nabokov’s Blue
Butterflies : Nabokov’s Blue
Butterflies :
Vladimir
Nabokov once said, “A writer should have the
precision of a poet and the imagination of a
scientist.” The famed author exhibited both equally
in his writing and in his non-literary pursuits,
which included lepidopterology, the study of
butterflies and moths. Although he is of course best
known for his intricate novels and essays, the past
decade has seen a rediscovery of Nabokov’s
entomological ventures. On Tuesday, the Times
revealed that a team a
scientists had vindicated a nearly seventy-year-old
theory of his about the development of the
Polyommatus blue butterflies:
|I]n a speculative moment in
1945, [Nabokov] came up with a sweeping
hypothesis for the evolution of the butterflies
he studied, a group known as the Polyommatus
blues. He envisioned them coming to the New
World from Asia over millions of years in a
series of waves. Few professional lepidopterists
took these ideas seriously during Nabokov’s
lifetime. But in the years since his death in
1977, his scientific reputation has grown. And
over the past 10 years, a team of scientists has
been applying gene-sequencing technology to his
hypothesis about how Polyommatus blues evolved.
On Tuesday in the Proceedings of the Royal
Society of London, they reported that Nabokov
was absolutely right.
Dr. Naomi
Pierce, a co-author of the report, organized four
separate trips to the Andes to collect the blues,
and then she and her colleagues at Harvard sequenced
the genes of the butterflies, as well as comparing
the number of mutations each species had acquired.
Their research resulted in the revelation that five
waves of butterflies came from Asia to America, as
Nabokov had originally hypothized.
Butterfly hunting was a
popular sport among Russian intellectuals in the
early- to mid-twentieth century, and enthusiasts
were often referred to as “fly doctors.” Nabokov
became fascinated with butterfly collecting and
study as a child, and, when he emigrated to
America in 1941, he brought his love of
lepidoptology with him, taking a job as a
curator at the Museum of Comparative Zoology at
Harvard University. In an interview he gave to
the Paris Review in 1967, Nabokov noted
that
The pleasures and
rewards of literary inspiration are nothing
beside the rapture of discovering a new
organ under the microscope or an undescribed
species on a mountainside in Iran or Peru.
It is not improbable that had there been no
revolution in Russia, I would have devoted
myself entirely to lepidopterology and never
written any novels at all.
The novelist also went on
extensive butterfly-hunting expeditions across
America while he was working on his masterpiece,
“Lolita.” In “Nabokov’s Blues: The Scientific
Odyssey of a Literary Genius,” Kurt Johnson and
Steven L. Coates
observe,
The sublime joy
associated with this [entomological] work
was due to the butterfly-hunting trips to
the West that Nabokov took every summer.
Nabokov, who never learned to drive a car,
estimated that in the glory years between
1949 and 59, Véra drove him more than
150,000 miles all over North America, mostly
on butterfly trips. Those expeditions have
taken on the aura of legend among
lepidopterists as well as Nabokov’s literary
admirers, and it was a habit he maintained,
with only the geographical scenes shifting,
for the rest of his life.
Blue butterflies can have
some of the shortest life spans of any species,
and Nabokov seemed particularly fascinated by
this quality of ephemeral metamorphosis. In
“Speak, Memory,” part of which ran as an essay
titled “Butterflies” in the June 12, 1948, issue
of The New Yorker, he
contemplated the
connection between art and the changing subtlety
of these fragile insects:
The mysteries of mimicry
had a special attraction for me. Its
phenomena showed an artistic perfection
usually associated with man-wrought things.
Such was the imitation of oozing poison by
bubble-like macules on a wing (complete with
pseudo-refraction) or by glossy yellow knobs
on a chrysalis (“Don’t eat me—I have already
been squashed, sampled, and rejected”). When
a certain moth resembled a certain wasp in
shape and color, it also walked and moved
its antennae in a waspish, unmothlike
manner. When a butterfly had to look like a
leaf, not only were all the details of a
leaf beautifully rendered but markings
mimicking grub-bored holes were generously
thrown in. “Natural selection,” in the
Darwinian sense, could not explain the
miraculous coincidence of imitative aspect
and imitative behavior, nor could one appeal
to the theory of “the struggle for life”
when a protective device was carried to a
point of mimetic subtlety, exuberance, and
luxury far in excess of a predator’s power
of appreciation. I discovered in nature the
nonutilitarian delights that I sought in
art. Both were a form of magic, both were a
game of intricate enchantment and deception.
Nabokov’s love of and
appreciation for entomology would continue until
his last days. Shortly before he passed, in
1977, his son Dimitri
recorded the following
anecdote in his diary:
A few days before he
died there was a moment I remember with
special clarity. During the penultimate
farewell, after I had kissed his still-warm
forehead—as I had for years when saying
goodbye—tears suddenly welled in Father’s
eyes. I asked him why. He replied that
certain butterfly was already on the wing;
and his eyes told me he no longer hoped that
he would live to pursue it again.
La quiche aux vers, une alternative à la viande :
 Qu'est-ce qui a un "goût de noisette", est riche
en protéine, pauvre en graisses, rejette peu de gaz à effet de serre et de
lisier, et ne transmet pas de maladies à l'humain qui le consomme ?
L'insecte. Qu'est-ce qui a un "goût de noisette", est riche
en protéine, pauvre en graisses, rejette peu de gaz à effet de serre et de
lisier, et ne transmet pas de maladies à l'humain qui le consomme ?
L'insecte.
Selon une équipe de chercheurs néerlandais, les
insectes finiront par remplacer la viande dans nos assiettes, en tant que
source de protéine meilleure pour la santé et l'environnement.
"Le jour
viendra où un
Big Mac coûtera 120 euros et un
Bug Mac 12 euros
[bug signifie insecte en anglais], où
les gens qui mangent des insectes seront plus nombreux que ceux qui mangent
de la viande", a prédit l'entomologiste Arnold van Huis, au cours d'une
conférence à l'université de Wageningen (Pays-Bas) où il présentait les
derniers résultats de leurs recherches.
CHANGER LA MENTALITÉ OCCIDENTALE
"Un goût... de noisettes" : Walinka van Tol, étudiante néerlandaise,
mord dans un chocolat d'où dépasse un ver. Avec deux cents autres curieux,
elle a joué aux cobayes pour l'équipe de scientifiques. Rouleaux de
printemps aux sauterelles, ganache au chocolat et aux larves et quiche aux
vers de farine ont été rapidement engloutis.
 Mais
Marcel Dicke, le chef du département d'entomologie de l'université de
Wageningen, sait qu'il faudra davantage qu'un ver enfoui dans un chocolat
pour changer la mentalité occidentale. "Le problème est là. Les
gens croient que c'est sale", explique-t-il devant une exposition de
moucherons, guêpes, termites et coccinelles, quelques-unes des 1 400 espèces
d'insectes comestibles. "Nous devons manger moins de viande ou trouver
une alternative", assure le chercheur qui affirme manger régulièrement
des insectes en famille. Mais
Marcel Dicke, le chef du département d'entomologie de l'université de
Wageningen, sait qu'il faudra davantage qu'un ver enfoui dans un chocolat
pour changer la mentalité occidentale. "Le problème est là. Les
gens croient que c'est sale", explique-t-il devant une exposition de
moucherons, guêpes, termites et coccinelles, quelques-unes des 1 400 espèces
d'insectes comestibles. "Nous devons manger moins de viande ou trouver
une alternative", assure le chercheur qui affirme manger régulièrement
des insectes en famille.
METS DÉLICATS
Selon l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la
planète comptera 9 milliards d'habitants en 2050 alors que la superficie des
terres agricoles a déjà commencé à diminuer. Avec dix kilos de végétaux, on
produit six à huit kilos d'insectes, contre un kilo de viande seulement.
"La question à se poser devrait vraiment être : pourquoi ne pas
manger d'insectes ?", estime Marcel Dicke en citant une étude selon
laquelle chacun mange, à son insu, en moyenne 500 grammes d'insectes par an,
dissimulés dans de la confiture de framboises ou du pain par exemple.
Environ 500 variétés d'insectes sont consommées au Mexique, 250 en Afrique
et 180 en Chine, où ils sont souvent considérés comme des mets très
délicats.
Une nouvelle blatte sauteuse :
Chez nous, les blattes ont mauvaise
réputation. Elles fascinent pourtant les scientifiques. Car elles peuplent
presque tous les habitats terrestres. .
Certaines creusent leur terrier sous le sable, en plein désert, pour y trouver
de l'humidité. D'autres nagent ou même plongent sous l'eau. D'autres, enfin,
sont associées à des organismes symbiotiques qui digèrent la cellulose du bois
qu'elles percent. Dernier exemple en date de cette étonnante faculté
d'acclimatation, Saltoblattela montistabularis. Chez cette espèce
sud-africaine, nouvellement décrite, les fémurs et tibias postérieurs sont
spécialement longs, voire élargis pour les tibias. Ces adaptations rappellent
celles des sauterelles. Et sont idéales pour sauter à la verticale, quand les
congénères se contentent de courir sans pouvoir bondir. L'espèce a été
découverte dans un mini-paradis de la biodiversité : la réserve naturelle de
Silvermine, au sein du parc national de Table Mountain, en Afrique du Sud. "Le
plateau et les pentes de Table Mountain sont particulièrement protégés de
l'intrusion de végétation étrangère, explique Mike Picker, l'un des
découvreur de l'espèce. La péninsule du Cap a été très souvent isolée des
autres montagnes par la mer lors des interglaciaires récentes; ce qui explique
le haut degré d'endémisme de cette zone. Ainsi, on retrouve ici beaucoup de
"fossiles vivants" et de nouvelles espèces y sont régulièrement découvertes. il
reste d'ailleurs peut-être de nouvelles espèces de blattes sauteuses dans la
végétation de Table Mountain ..."
(National Geographic)
Chère biodiversité
Les
zoologistes s’accordent pour estimer à 1,4 millions le nombre d’espèces animales
recensées dans les catalogues. Et à 5,4 celui des espèces qui nous restent à
découvrir, décrire, nommer…
L’obstacle : la pénurie de taxinomistes,
spécialistes chacun pour son groupe, de l’identification et du classement des
êtres vivants. La moitié du petit nombre en activité s’occupe des vertébrés –
plutôt du genre grands félins ou oiseaux colorés – bien plus intéressants en
terme de reconnaissance par le public (et les financeurs). On en connaît 62 000
espèces ; la part de ceux qui peuvent encore être découverts est infime : 4% de
la faune ignorée. Celle-ci est composée, comme la faune répertoriée,
majoritairement d’insectes (dont on connaît déjà près d’1 million d’espèces). Il
faudrait une armée d’entomologistes.
Et cela coûterait combien ? Fernando
Carbayo et Antonio Marques (université de Sao Paulo, Brésil) proposent une
estimation. Étant donné ce que coûte globalement un spécialiste (dans leur pays,
d’un bon niveau en taxinomie et où le salaire est dans la moyenne mondiale) par
espèce nouvelle, le programme reviendrait à 200 milliards d’euros.
Heureusement qu'il y a beaucoup de
bénévoles, passionnés comme moi, de part le monde !
Les
entomologistes confirment : les insectes
adorent la vie en Principauté !
 Dans
le cadre de la Convention de partenariat « Monacobiodiv »* une campagne
d’inventaire des insectes a été menée en Principauté entre le printemps 2008 et
la fin de l’année 2010. Dans
le cadre de la Convention de partenariat « Monacobiodiv »* une campagne
d’inventaire des insectes a été menée en Principauté entre le printemps 2008 et
la fin de l’année 2010.
L’inventaire des coléoptères (scarabées, coccinelles, charançons…) et des
hétéroptères (punaises) a révélé toute la diversité de cette faune comptant plus
de 330 espèces de coléoptères et 101 d’hétéroptères. Parmi ces derniers, on a
découvert 5 espèces nouvelles. Parmi les coléoptères, 2 espèces se sont avérées
nouvelles pour la science. L’inventaire entomofaune a été réalisé par un groupe
d’entomologistes dont Philippe Ponel (Imep-CNRS, Université Paul Cézanne),
Jean-Michel Lemaire (Muséum d’Histoire naturelle de Nice) et Armand Matocq
(Muséum national d’Histoire naturelle de Paris).
Selon les scientifiques, les glacis autour du Palais ont la faveur du plus grand
nombre d’espèces - l’isolement du Rocher favorisant la préservation de cette
microfaune - et abrite des populations d’insectes peu mobiles vivant quasiment
« sur une île ». Afin de protéger cette précieuse microfaune « diverses
préconisations de gestion sont aujourd’hui à l’étude » souligne Cyril Gomez,
Directeur de l’Environnement. V.L.R.
* La convention « Monacobiodiv » a été passée entre la Fondation Albert II, le
gouvernement princier, le conservatoire botanique national méditerranéen de
Porquerolles, l’Institut méditerranéen d’écologie et de paléoécologie, et
l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III.
Photo : En pleine action sur le rocher : Philippe Ponel (Imep-CNRS, Université
Paul Cézanne Aix-Marseille); avec un piège Brustel !
Plus de 430 espèces d’insectes en principauté
Les insectes ont, eux aussi, eu droit à leur recensement en principauté. Une
entomofaune a ainsi été menée, entre 2008 et 2010, par Philippe Ponel et Sylvain
Fadda, entomologistes de l’Institut méditerranéen d’écologie et de paléoécologie
(IMEP) et de l’Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille. Il s’inscrivait dans le
cadre de la convention de partenariat MonacoBiodiv’. 330 espèces de coléoptères
(scarabées, coccinelles,…) et 101 d’hétéroptères (punaises) ont ainsi élu
domicile sur le sol monégasque. En prime, deux nouvelles espèces d’hétéroptères
ont été découvertes. Le plus grand nombre d’espèces a été retrouvé dans les
glacis qui entourent le palais princier.
Le Rocher, par son isolement, tend à préserver cette microfaune. Les populations
d’insectes peu mobiles y vivent presque comme sur une île. Les abords de la
Porte Neuve ou encore le vallon de Sainte-Dévote figuraient également parmi les
endroits visés par l’étude.
L'œil du papillon :
On savait déjà que le battement d'ailes d'un
papillon pouvait déclencher un cataclysme à distance ! Mais pas encore que son
seul regard pouvait augmenter le rendement des panneaux photovoltaïques de 5 à
6%. Des chercheurs de l'Université de Nagoaka (Japon) se sont inspirés de la
morphologie de l'œil du papillon pour créer un film antireflet aux performances
inégalées !
Fil de ver :
Des biologistes de l'Université du Wyoming ont
réussi à modifier génétiquement des vers à soie pour leur faire fabriquer du fil
d'araignée ! Ce tour de force scientifique est d'une extrême importance, car le
fil d'araignée possède des qualités de résistance et d'élasticité que la chimise
moderne reste incapable de reproduire. Bientôt, ce fil, produit à volonté par
des millions d'"esclaves", pourra servir à fabriquer des tendons, des ligaments
artificiels, des airbags améliorés, des vêtements pour sportifs, des matériaux
pare-balles et bien d'autres merveilles !
Des vers à soie pour produire du fil de toile d'araignée :
On
n'arrête plus le progrès ! Des chercheurs américains ont réussi à
modifier génétiquement des vers à soie dans un seul but : leur faire
produire du fil de toile d'araignée qui est réputé pour sa
résistance et son élasticité exceptionnelle.
La voie à la production industrielle de ces fibres est ouverte
"Cette recherche représente une percée importante dans le
développement de fibres de soie (de qualité) supérieure pour des
applications médicales et non-médicales" explique Malcolm Fraser,
professeur de biologie à l'Université Notre-Dame.
Ce chercheur a déclaré : "Pouvoir produire des fibres de soie ayant
les propriétés des fils de toile d'araignées est l'un des objectifs
clés de la science des matériaux". Le fil naturel formant la toile
d'araignée a des propriétés physiques exceptionnelles dont une plus
grande élasticité et force de traction que la fibre de soie
naturelle. Le fil "artificiel" produit par les vers à soie
transgéniques a les mêmes propriétés que celui engendré par les
araignées, a assuré le chercheur.
Quelles sont les applications biomédicales possibles ?
Les auteurs ont cité des fils de suture plus fins, de meilleurs
pansements ou des fibres pour réparer ou remplacer des tendons ou
des ligaments endommagés.
Ces fibres pourraient aussi être utilisées dans la fabrication de
gilets pare-balles, de tissus plus résistants et plus légers ou
encore d'une nouvelle génération de vêtements de sport.
Dans la mesure où les vers à soie sont déjà viables pour la
production industrielle de fil de soie, ces vers transgéniques
résolvent le problème de la production à grande échelle de ces
fibres d'une manière efficace et économique, soulignent les auteurs
de cette avancée biogénétique.
"Nous pourrions même avoir des vers à soie transgéniques capables de
produire du fil de toile d'araignée doté de caractéristiques encore
supérieures" assure Malcolm Fraser. L'impossibilité de produire de
la soie d'araignée en grande quantité avec les techniques d'élevage
traditionnelles avait incité au développement de divers procédés
biotechnologiques ces dernières années.
Auparavant, des chercheurs avaient tenté en vain d'insérer des gènes
d'araignées dans des chèvres pour qu'elles produisent cette soie
d'araignée dans leurs glandes mammaires. Seul le bombyx du mûrier,
ver exploité depuis des millénaires pour la production de soie, est
apparu comme une alternative plausible pour l'élaboration de
protéines fibreuses transgéniques. La glande séricigène qui produit
la soie est munie de pompes et de valves permettant d'organiser, à
partir des molécules de fibroïne, la structure caractéristique
conférant la résistance mécanique et l'élasticité au fil produit.
Biodiversité : les héritiers de Buffon :
REPORTAGE - Imaginé par le Muséum national d'histoire naturelle et l'ONG
Pro-Natura, le projet «La planète revisitée» remet au goût du jour les grandes
expéditions naturalistes. Partis à la découverte des forêts côtières du
Mozambique et des fonds sous-marins du Grand Sud de Madagascar, des dizaines de
scientifiques travaillent à un vaste inventaire de la biodiversité de notre
planète. Une aventure que nous avons suivie.
 Astrid Cruaud, thésarde, collecte des papillons de nuit. Le
piège consiste en une toile tendue devant une ampoule, au cœur
de la forêt.
En partenariat avec Le
Figaro Magazine, les photographies de Xavier Desmier, tirées
de ce reportage, seront exposées en plein air à partir du 4 juin
prochain au
Festival "Peuples et Nature " de La Gacilly (Morbihan), dont
le thème est consacré cette année à la biodiversité. Astrid Cruaud, thésarde, collecte des papillons de nuit. Le
piège consiste en une toile tendue devant une ampoule, au cœur
de la forêt.
En partenariat avec Le
Figaro Magazine, les photographies de Xavier Desmier, tirées
de ce reportage, seront exposées en plein air à partir du 4 juin
prochain au
Festival "Peuples et Nature " de La Gacilly (Morbihan), dont
le thème est consacré cette année à la biodiversité.
Patrice Petit de Voize se hisse sur le Zodiac. Essoufflé par une course à
contre-courant, il ôte promptement ses palmes et ses bouteilles. Le moteur
est en panne et la houle, impétueuse ce matin, achemine l'embarcation vers
les rochers blanchis d'écume. Pagayant à l'avant, le pilote résiste à
l'appel de l'écueil. À quelques centaines de mètres, deux plongeurs
dérivent, emportés par le courant. Leurs têtes ne sont plus qu'un point que
les lames cachent par moments. Patrice s'affaire autour du moteur
capricieux, tente, échoue, retente; il démarre enfin. En quelques instants,
on récupère Laurent Albenga et Pascal Bigot, les deux plongeurs malmenés par
les vagues depuis plus de trente minutes. Fin de la séquence tragique, une
tortue à la nage tranquille escorte le bateau, puis disparaît. Il reste à
récupérer le butin: les échantillons de faune et de flore collectés à 22
mètres de profondeur et qui seront recensés par l'équipe de scientifiques
qui attend à terre. Des hommes et des femmes venus du monde entier pour
participer à cette expédition naturaliste, Atimo Vatae.
Organisée dans l'extrême sud de Madagascar, à Fort-Dauphin, l'expédition
conduira à la découverte de nouvelles espèces, endémiques pour la plupart
crustacés, mollusques, étoiles de mer, algues tirées des fonds fertiles. Des
fonds difficiles d'accès parce qu'ils sont éloignés de tout, qu'il faut
acheminer les bateaux et le matériel, et que la mer, agitée ici, complique
considérablement la tâche des plongeurs. Embarqués au large, sillonnant la
côte à pied ou plongeant jusqu'à 50 mètres, plus de 60 chercheurs se
relaieront pourtant à Madagascar jusqu'à la fin juin. Un projet d'envergure
qui s'inscrit dans un programme plus vaste encore, celui de
«La planète revisitée».
Des fonds privés pour explorer la biodiversité
Nouveau souffle des grandes expéditions naturalistes, «La planète
revisitée», qui inclut également un volet terrestre au Mozambique, a été
pensée en collaboration par le Muséum d'histoire naturelle et l'ONG
Pro-Natura International. Budget: 1 550 000 euros essentiellement financés
par la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation Total et la
Fondation Stavros Niarchos. Une somme remarquable lorsque les budgets
universitaires pour les missions sur le terrain - 2 ou 3 scientifiques
déployés durant deux à quatre semaines - dépassent rarement les 3 000 euros.
Des fonds privés donc, pour explorer la biodiversité,
10 à 30 millions d'espèces
restant encore, selon les estimations, à découvrir.
Retour à quai. Le Zodiac est amarré dans le nouveau port d'Ehoala,
construit par le minéralier anglo-australien Rio Tinto, qui extrait ici la
richesse locale: l'ilménite, un oxyde naturel de fer et de titane. Quelques
minutes plus tard, les prélèvements sont livrés à l'hôtel Village Petit
Bonheur, à quelques mètres de la plage. On y a installé un laboratoire,
alignement de tables blanches. Les spécimens, parfois grands de quelques
millimètres seulement, sont triés à l'aide de loupes binoculaires:
mollusques d'un côté, crustacés de l'autre. Puis, tous sont photographiés.
Tin-Yam Chan, professeur à l'université océanographique de Taïwan et
spécialiste des crevettes et langoustes, a installé un studio
macrophotographique. Sous son objectif, de minuscules crabes révèlent des
carapaces psychédéliques aux motifs fluorescents. À quelques pas, Robert
Abela, un Américain, photographie des mollusques vivants, qu'il fait évoluer
dans un aquarium. Devant lui sont installés Ellen Strong, chercheuse à la
Smithsonian Institution (Washington) et Yuri I.Kantor, chercheur à
l'académie des sciences russe. Ils constituent l'équipe «Barcode» dont la
mission ici est de prélever des échantillons de tissus sur des spécimens
vivants. Ceux-ci, conservés dans de l'alcool à 80° afin d'en préserver
l'ADN, seront envoyés en France. Récupérés par Barbara Buge, chargée de
collection barcode au Muséum, ils seront ensuite dirigés vers le Génoscope,
où l'ADN du spécimen sera séquencé.
Il s'agit, à terme, de créer une banque de données répertoriant l'ADN de
toutes les espèces grâce à un réseau mondial: le CBOL (Consortium for the
Barcode of Life), un consortium international pour le développement d'un
code-barres du vivant comme outil standard de la taxonomie. Dirigé par le
Muséum d'histoire naturelle de Washington, le CBOL a, depuis sa création en
2004, regroupé plus de 130 organisations issues de 43 pays, dont le Muséum
d'histoire naturelle français.
«La révolution moléculaire a démarré il y a une vingtaine d'années,
explique Philippe Bouchet, professeur au Muséum, qui dirige l'expédition. Ce
qui a changé, c'est l'effondrement des coûts, la facilité de séquençage
ainsi que la découverte en 2003 d'un gène, le CO1, très bon marqueur des
limites entre les espèces. Cela permettra de trancher dans les cas où les
systématiciens ne sont pas d'accord.» Egalement chargé par le Muséum
d'organiser les grandes expéditions, Philippe Bouchet fut à l'origine, avec
Olivier Pascal, botaniste et directeur des programmes chez Pro-Natura, de
«La planète revisitée». Ce dernier dirigeait en novembre dernier
l'expédition au Mozambique, volet terrestre du programme.
Arrivée au camp Nhica, base arrière de la mission au Mozambique
Ce sont les forêts côtières, au nord-est du pays, qui ont été choisies
pour accueillir les chercheurs. Des forêts sèches d'Afrique de l'Est, dont
90% de la surface originelle a déjà disparu, ravagée par le feu destiné à
dégager des aires de culture. Ravagée parce que le charbon de bois
représente l'unique énergie pour cuisiner et faire bouillir l'eau. Parce que
le bois constitue les fondations des maisons de terre. Indispensable. Ainsi
la conservation, confrontée à la survie des populations, ne peut-elle
concerner qu'une petite partie de ces forêts qu'il est urgent de recenser.
Le camp principal de l'expédition a été installé à Nhica, à 8 heures de
route en piste de la première ville électrifiée. Chaque matin, de nombreux
véhicules en partent, transportant à leur bord des spécialistes. Chasse aux
fourmis, termites, papillons, guêpes, fleurs, lianes, oiseaux,
chauvessouris, la collecte révélera ce qu'abritent les forêts menacées.
Détaché à quelques dizaines de kilomètres au sud, Thomas Müller, torse
nu, progresse dans la touffeur végétale. 38 °C. Des ronces lui lacèrent les
bras et les jambes mais il poursuit l'ascension de la colline, s'arrête
soudain parce qu'un arbre retient son attention: «Un comifora», lance-t-il.
Du tronc vert et lisse se détachent, comme une mue, des copeaux de peau pâle
à l'odeur sucrée. Il tourne autour, lève le regard: «J'ai vu des centaines
de comiforas, mais aucun comme celui-ci», commente- t-il. Pourtant pas un
conscrit, à 77 ans, Thomas Müller, botaniste suisse allemand devenu
consultant après sa retraite, vit au Zimbabwe depuis plus de quarante ans et
fut, dès 1962, à l'origine de la création des jardins de Harare, puis
responsable du département botanique national. Une figure de l'expédition
qui compte près de 30 chercheurs en botanique, entomologie, zoologie, venus
du Royaume-Uni, de Belgique, de Tanzanie, de France...
Roger Swaintson, zoologiste et dessinateur , explique son
travail.
Ici, à Lupenga - péninsule inhabitée où l'on parvient en
bateau de pêche à travers la mangrove -, il a fallu, pour planter le camp au
pied de la colline, le camp au pied de la colline, traverser un désert de
boue imprimé de traces d'ongulés, d'oiseaux, de singes et de petits fauves.
Les bagages ont été réduits au minimum: de l'eau potable, quelques conserves
de sardines, une trousse à pharmacie et des tentes. Pas d'électricité.
L'activité est rythmée par le soleil, les repas du soir partagés autour d'un
feu. Leur journée, les gardes mozambicains du camp la passent dans un arbre
parce qu'ils ont peur des lions dont ils sentent, disent-ils, la présence.
Thomas souhaite à présent prélever les feuilles de ce
Comifora nouveau. Il hèle Frédéric Mathias, grimpeur d'arbres. Comme les
plongeurs des expéditions sous-marines, les grimpeurs sont indispensables à
la mission. Courant les cimes, ils en rapportent les échantillons qui seront
conservés. Frédéric - également maire de Boult-aux-Bois, une petite commune
des Ardennes - enfile son baudrier, lance une corde lestée d'un poids dans
les branches hautes, se hisse rondement à la tête du géant. Les premières
branches tombent. Thomas les attrape et entreprend aussitôt de les mettre
sous presse, aplaties entre des pages de journaux. Tentaculaire, il repère,
coupe, collecte, rassemble, presse.
L'un des échantillons sera envoyé en Angleterre, au
jardin botanique royal de Kew, l'un des plus importants herbariums au monde;
un autre, à l'herbarium d'Harare; le troisième, à l'université de Maputo; le
quatrième, enfin, à l'herbarium national du Mozambique.
«Les espèces présentes ici, tant les espèces dominantes
que le sous-bois, ne sont pas du tout les mêmes que celles que l'on a
récoltées aux alentours de Nhica, explique Olivier Pascal. C'est la
diversité des forêts qui fait, dans cette région, leur intérêt.»
Maurice Leponce, enthomologiste, décrit les particularités du
termite kamikaze.
En direction des berges de la Rovuma, la rivière séparant le Mozambique
de la Tanzanie, une équipe d'entomologistes s'est également mise en marche
pour deux jours. À l'arrière du long 4 x 4 sans toit ni fenêtres, protégé
par deux arceaux et hérissé de filets à papillons, sont installés Jean-Yves
Rasplus, directeur de recherche à l'Institut national de recherche
agronomique (Inra), Astrid Cruaud, son élève, thésarde, Olivier Montreuil,
maître de conférences au Muséum d'histoire naturelle, spécialiste des
scarabéidés. Au volant, Mark McAdam, Zimbabwéen, expert dans la traque
d'animaux sauvages et logisticien.
À quelques pas du camp monté par Mark en quelques minutes, les
hippopotames ont imprimé leurs empreintes dans la terre rouge. Il faudra
rester vigilant. Astrid et Jean Yves se mettent en marche, profitant des
dernières heures de soleil pour démarrer une chasse avec des filets. Olivier
part poser des pièges à scarabées, bouteilles de plastique découpées dans
lesquelles il a écrasé des bananes. Les méthodes de capture sont variées.
Les journées commencent à la fraîcheur de l'aube, et se terminent au
crépuscule. 4h00-16h30. Passé 19h00, sous les étoiles, les paupières
s'alourdissent. À 20 h 00, c'est l'extinction du feu.
Astrid Cruaud, thésarde et Jean Yves Rasplus, directeur de
recherche à l'Inra, chassent les papillons dans la région de de Nhica de
Rovuma.
C'est différent, ce soir. Astrid et Jean Yves ont disposé un piège
lumineux pour capturer des papillons nocturnes. Ronronnant bruyamment, un
générateur alimente une ampoule derrière laquelle on a tendu un drap blanc.
Peu à peu, les insectes envahissent la toile, tapisserie vivante où
s'amassent des papillons de toutes tailles, aux couleurs beiges, rosées,
jaune vif, aux yeux de hibou dessinés sur les ailes, qu'ils font ondoyer
pour effrayer leurs prédateurs. Jean Yves leur injecte une piqûre
d'ammoniaque, et les ailes cessent de frémir. Malgré les conditions
difficiles, le manque de pluie surtout, qui réduit considérablement la
sortie des insectes, la chasse sera bonne et les spécimens acheminés à Paris
où ils seront étudiés. Ainsi, grâce à la persévérance de quelques femmes et
hommes, la carte de la biodiversité s'étoffe-t-elle.
Au total, l'aventure mozambicaine a duré un mois, et celle de Madagascar
se poursuivra jusqu'en juin. D'autres expéditions pourraient voir le jour,
qui permettraient de découvrir, ailleurs, d'autres trésors de notre planète.
De les recenser et d'en planifier la protection.
Un éphémère de
300 millions d’années :
 Des
chercheurs de l'Université Tufts ont découvert ce qu'ils croient être le plus
ancien fossile d'un insecte volant dans un affleurement rocheux près de North
Attleboro, dans le Massachusetts. Des
chercheurs de l'Université Tufts ont découvert ce qu'ils croient être le plus
ancien fossile d'un insecte volant dans un affleurement rocheux près de North
Attleboro, dans le Massachusetts.
L'empreinte retrouvée à North Attleboro
(Crédit : Tufts University / Richard J. Knecht et Jacob Brenner)
L’empreinte, d’environ sept centimètres de long retrouvée sur un éperon rocheux
à proximité d’un centre commercial, représente le thorax, l’abdomen ainsi que
six pattes d’un insecte dont l’aspect extérieur rappelle une libellule. Selon
son découvreur, géologue à l’Université de Tufts, il serait en réalité un très
lointain cousin des éphémères.
Le fossile a été retrouvé dans une couche de
boue solidifiée d’aspect rouge bordeaux, vieille de 312 millions d’années. Il
constitue la plus ancienne trace de passage d’un insecte vivant enregistrée dans
la roche, elle est sans doute due au bref atterrissage de l’animal sur une nappe
de boue. Sur la roche, il n’y a aucune trace d’ailes mais les chercheurs ont
découvert les restes fossilisés d’une aile, appartenant probablement à la même
espèce, à proximité du site.
Il y a 312 millions d’années les insectes
constituaient déjà une classe largement répandue sur la Terre tandis que les
premiers reptiles, ancêtres des dinosaures, commençaient à peine leur essort. A
cette époque, le sud de la Nouvelle-Angleterre (région qui correspond au
nord-est des Etats-Unis) était beaucoup plus proche de l’équateur ce qui suggère
que cette région pourrait être une source importante de découvertes dans
l’avenir.
La mère
des éphémères :
Il y a 312 millions d’années, soit à la fin du
Carbonifère, un insecte s’est posé sur de la boue et y a été prestement englouti
non sans s’être un peu débattu. Une boue piégeuse parfaite pour le moulage de
l’insecte : on vient en effet de le retrouver sous forme d’un fossile
extraordinaire. La découverte, due à Richard Knecht et son équipe (Harvard
University) est publiée dans les PNAS. Elle repousse de quelque 30
millions d’années l’âge du plus ancien insecte volant (Ptérygote) connu.
Le
spécimen a été trouvé par l’auteur en 2008, alors étudiant, qui pataugeait dans
un marécage du Massachussetts autrefois désigné comme gisement de fossiles : en
émergeait un rocher de grès fragmenté ; un bloc s’est ouvert en deux, livrant le
moule et l’objet. Avec tous les détails du corps et des pattes mais pas des
ailes que ce très probable ancêtre direct des Éphéméroptères tenait déjà
verticalement au repos.
Retour de mission, une MST transmise par le moustique !
Brian Foy, de l’université du Colorado à Fort Collins (États-Unis), est un
entomologiste très consciencieux et marié. Ce qui lui vaut d’être, un peu par
accident, le découvreur de la première MST transmise par moustique.
La
maladie, mal caractérisée par des douleurs articulaires et une grosse fatigue,
peu connue, est causée par le virus du Zika (du nom d’une forêt ougandaise) ;
elle s’attrape usuellement par la piqûre d’un Aedes (Dip. Culicidé).
De retour d’une mission de courte durée au Sénégal, notre entomologiste tout
comme son collègue de terrain Kevin Kobylinski tombent malades : douleurs
articulaires et grosse fatigue, entre autres – pendant une semaine. La dengue
est suspectée. Un peu plus tard, son épouse, qui ne l’accompagnait pas, souffre
de la même maladie. Ceci alors qu’aucun moustique vecteur ne vit au Colorado.
En fait, la maladie ne sera identifiée qu’ultérieurement, à la suite de la
rencontre fortuite (dans un bar) au Sénégal de K. Kobylinski avec un collègue
texan, Andrew Haddow. Ce dernier s’intéresse au virus Zika, en partie à la
mémoire de son grand-père. Andrew Haddow l’avait en effet isolé en 1948 d’un
singe rhésus capturé près d’Entebbe.
Sur les échantillons de sérum des trois
personnages de l’histoire, soigneusement conservés au frigo par B. Foy, le virus
Zika est identifié.
Tout indique, même si la preuve formelle manque, que M.
Foy l’a transmis sexuellement à Mme Foy.
Cet agent pathogène est surveillé
par les sentinelles des maladies émergentes. La littérature rend compte de 14
cas isolés. Mais il a provoqué une épidémie surprise – avec les trois quarts des
gens touchés – à Yap, une île du Pacifique, en 2007.
Les poux ont côtoyé les dinosaures :
Les poux, connus pour être des insectes parasites
extrêmement résistants, existaient probablement déjà du temps des dinosaures,
selon une étude publiée mercredi dans les "Biology letters" de la Royal Society,
l'académie des sciences britannique. Une équipe américaine avance que "à la fois
les poux d'oiseaux et de mammifères ont commencé à se diversifier avant
l'extinction des dinosaures" il y a 65 millions d'années, selon un des auteurs
de l'étude, Kevin Johnson de l'Université de l'Illinois. Un fossile décrit par
les scientifiques en 2004 montrait déjà que des poux assez semblables à ceux que
nous connaissons vivaient il y a quelque 44 millions d'années.
En examinant les séquences de gènes de 69 espèces de poux,
les chercheurs ont pu reconstituer une sorte de ligne généalogique du pou, qui
remonte beaucoup plus loin, à la fin du crétacé. Les oiseaux, des hôtes de choix
pour les poux, seraient les descendants d'un groupe de dinosaures carnivores
bipèdes, les Thérapodes, qui comprenait aussi bien le Tyrannosaure que des
sortes d'autruches (Ornithommidés). Nos oiseaux actuels auraient hérité des poux
de ces ancêtres.
L'étude
conforte la théorie selon laquelle de grands groupes d'oiseaux et de mammifères
étaient déjà apparus avant l'extinction au crétacé des dinosaures et de
nombreuses autres espèces, probablement des suites d'une chute de météorite
géante.
Comprendre l'évolution
des poux peut donner des indices sur l'évolution de leurs hôtes. Chaque espèce a
en effet son pou spécifique, qu'elle soit à poil ou à plume. "Compte tenu des
chronologies de diversification présentées ici, et de l'origine précoce des
plumes, les poux ont probablement infesté les dinosaures thérapodes à plumes",
conclut l'étude.
CRÈVECŒUR-LE-GRAND :
Il revend des insectes aux animaleries
 Antoine Garault est le gérant de France Insectes. Cette nouvelle
entreprise revend des insectes dans de grandes chaînes d'animaleries. Les
propriétaires des nouveaux animaux de compagnie en redemandent. Antoine Garault est le gérant de France Insectes. Cette nouvelle
entreprise revend des insectes dans de grandes chaînes d'animaleries. Les
propriétaires des nouveaux animaux de compagnie en redemandent.
Antoine Garault cherche la petite bête pour la donner aux grosses. Depuis
novembre 2009, ce jeune entrepreneur de 31 ans s'est lancé dans la revente
d'insectes. Dans l'ancienne verminière de son grand-père, à
Crèvecoeur-le-Grand, il reçoit des blattes, des criquets, des larves
vivantes et même des souris congelées de toute l'Europe de Nord.
Ces
insectes servent à l'alimentation des nouveaux animaux de compagnie (NAC)
comme les lézards, serpents et autres araignées. Il vend ces petites
bestioles dans les grandes chaînes d'animalerie.
« Les banquiers
m'ont regardé avec de grands yeux quand je leur ai présenté mon projet. Ils
préfèrent ne pas prendre de risque avec des projets dits hors normes ».
Antoine Garault ne baisse pas les bras pour autant.
Ce diplômé en école
de commerce frappe à la porte d'Oseo qui garantit des prêts bancaires pour
les entreprises. « Avec 14 000 euros de capital, mon dossier était bien
ficelé. J'avais deux autres associés, mon père et mon ancien employeur,
commissaire aux comptes, qui étaient derrière moi. »
Sur les
recommandations de son père, revendeur d'asticots pour la pêche, Antoine
Garault s'engouffre dans une brèche : la revente d'insectes pour les NAC en
créant sa société France Insectes. Ils ne sont qu'une poignée
d'entrepreneurs (quatre ou cinq) à exercer cette activité à l'adresse des
professionnels. « En 2006, deux millions de Français possédaient un
nouvel animal de compagnie. Quatre ans plus tard, c'est toujours autant le
rush. ».
Des chaufferettes pour les petites bêtes
En face, les propriétaires de NAC sont très exigeants. Antoine Garault
transporte ses bestioles dans les meilleures conditions possibles. « Je
mets des chaufferettes à l'intérieur des boîtes d'élevage. L'hiver, cela
évite une trop forte mortalité. » À leur arrivée dans l'entrepôt de
Crèvecoeur-le-Grand, le jeune chef d'entreprise leur redonne à manger.
En magasin, la boîte de 30 à 40 grillons est vendue aux environs de 3 euros
et la boîte de 10 sauterelles est vendue aux environs de 8 euros : «
Elles sont plus grosses et se nourrissent d'herbe. L'élevage demande plus de
coûts matériels, cela se répercute sur le prix de vente », précise
Antoine Garault.
Une animalerie, comme Magasin vert, à Beauvais, reçoit
300 boîtes de grillons par semaine. « Le budget moyen d'alimentation d'un
propriétaire de lézard est de 5 euros par semaine. Cela revient moins cher
que de nourrir un chien ou un chat », explique Hélène, responsable des
NAC. Antoine Garault a encore de beaux jours devant lui.
 Un "scarabée" collecteur d'eau : Un "scarabée" collecteur d'eau :
Stenocara gracilis, petit ténébrion du désert de Namibie, possède un
système de collecte d'eau très particulier. Lorsque l'insecte se tient face au
vent, dans le brouillard matinal, des gouttes se forment sur ses élytres, puis
roulent vers son organe buccal. Pourtant, les conditions météorologiques - vents
forts et chaleur extrême - ne favorisent pas du tout l'accumulation de liquide.
Faut-il y voir un mécanisme analogue à celui observé sur les feuilles de lotus,
enduites d'une cire qui « repousse » l'eau ? Pas exactement. A l'œil nu, on
distingue sur les élytres de Stenocara, de petites bosses qui, au microscope,
présentent deux types de surface. A leur sommet, une zone hydrophile, où les
micro-gouttelettes s'accumulent jusqu'à former une goutte ; sur leurs flans et
dans les creux, un enduit de cire hydrophobe, qui sert de toboggan à la goutte,
une fois qu'elle a atteint une certaine masse critique.
Une structure facile à
imiter, et qui pourrait servir à construire des pièges à eau dans les contrées
arides.
Des insectes à 3 paires d'ailes
Au cours des 250 millions d'années d'évolution des insectes,
jamais on n'avait vu apparaître de nouvelles ailes. Des transformations, oui.
Des pertes, oui. Mais pas d'ajout. Une équipe de l'Institut de biologie du
développement de Marseille-Luminy (CNRS/Université Aix-Marseille 2) vient de
briser ce dogme en apportant les preuves que le casque exubérant des
membracides, un groupe d'insectes cousin des cigales, est en fait une troisième
paire d'ailes profondément modifiée. Cette découverte est publiée dans la revue
Nature du 5 mai 2011 dont elle fait la couverture.
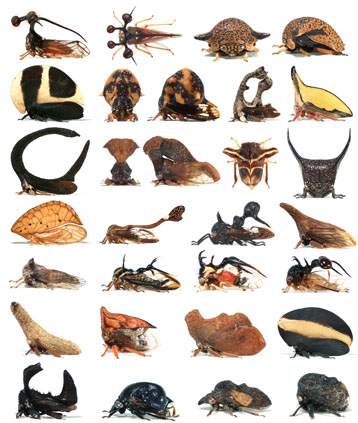 Les
membracides (1) sont un groupe d'insectes cousin des cigales, dont les
espèces rivalisent d'originalité dans leurs formes, leurs textures et leurs
couleurs. Cette diversité est largement conférée par une structure
surprenante, recouvrant en grande partie leurs corps : un casque. Celui-ci
ressemble parfois à une fourmi en posture d'attaque, d'autres fois à une
déjection d'oiseau, à une feuille morte, à une épine... Avant que l'équipe
de Nicolas Gompel et Benjamin Prud'homme, tous deux chercheurs CNRS, ne les
observe au microscope électronique, l'origine évolutive de cette structure
était encore controversée. Les
membracides (1) sont un groupe d'insectes cousin des cigales, dont les
espèces rivalisent d'originalité dans leurs formes, leurs textures et leurs
couleurs. Cette diversité est largement conférée par une structure
surprenante, recouvrant en grande partie leurs corps : un casque. Celui-ci
ressemble parfois à une fourmi en posture d'attaque, d'autres fois à une
déjection d'oiseau, à une feuille morte, à une épine... Avant que l'équipe
de Nicolas Gompel et Benjamin Prud'homme, tous deux chercheurs CNRS, ne les
observe au microscope électronique, l'origine évolutive de cette structure
était encore controversée.
Contrairement à la corne du scarabée
rhinocéros, le casque des membracides n'est pas une simple excroissance de
la cuticule (2), mais un appendice dorsal attaché de chaque côté du thorax
par une articulation, avec des muscles et de la membrane flexible qui lui
permettent d'être mobile. Ces observations anatomiques ont été confirmées
par les chercheurs au niveau génétique : les mêmes gènes interviennent pour
le développement du casque et des ailes. Les membracides seraient donc des
insectes à trois paires d'ailes, dont l'une est profondément modifiée,
méconnaissable.
Cette découverte est le premier exemple d'un changement
du plan d'organisation des insectes par l'ajout d'une nouveauté évolutive.
Ce plan se définit par un corps divisé en trois parties (tête, thorax et
abdomen), une paire d'antennes, trois paires de pattes et, le plus souvent,
deux paires d'ailes, toujours présentes sur le deuxième et le troisième
segment du thorax. Mais, il existe des variations autour de ce plan général.
Chez les mouches et les moustiques, par exemple, les ailes postérieures sont
réduites à de petits ballons appelés balanciers. Chez les coléoptères
(coccinelles, scarabées, hannetons...), la première paire est transformée en
élytres, ces ''ailes'' dures et souvent colorées qui protègent les ailes
postérieures. Chez certains insectes, les ailes ont même totalement disparu.
C'est le cas pour les puces ou les poux au mode de vie parasite, ou pour les
punaises rouges, communément appelées Gendarmes.
Comment une nouvelle
paire d'ailes a-t-elle pu apparaître chez les membracides ? « Chez les
insectes, la formation des ailes est normalement réprimée sur tous les
segments par les gènes Hox, sauf sur le deuxième et le troisième segment
thoracique. » explique Nicolas Gompel. Le gène Hox qui intervient
dans le premier segment du thorax, ne serait-il pas exprimé chez les
membracides ? Non, la protéine Hox, le produit du gène, est bien détectée
dans le casque en formation. Ce gène serait-il inactif ? Là encore la
réponse est non : son injection chez la drosophile inhibe bien la formation
des ailes. « Nous sommes confrontés à un paradoxe : un gène Hox qui
est capable de réprimer la formation des ailes mais qui ne la réprime pas.
Nous pensons que les changements évolutifs touchent plutôt le programme
génétique de formation des ailes ; ces gènes seraient devenus insensibles à
la répression par le gène Hox », précise Nicolas Gompel. Ces
résultats vont également à l'encontre de l'idée selon laquelle le plan du
corps est uniquement régi par les gènes Hox. En effet, le gène Hox n'a pas
changé alors que le plan du corps, lui, a évolué.
Depuis son apparition,
il y a environ 40 millions d'années, le casque des membracides s'est
totalement dédouané des contraintes structurelles liées au vol. «
C'est une aile qui n'en n'est plus une, en somme. Libéré de sa fonction pour
le vol, cette aile a pu diversifier sa forme et sa texture sans modération
dans ce groupe d'insectes.», conclut Benjamin Prud'homme.
Les fourmis-zombies
:
La nature regorge de phénomènes aussi
étonnants que mystérieux. Parmi ceux-ci, les fourmis-zombis méritent sans aucun
doute l’une des meilleures places au classement. Ces insectes sociaux, à
l’organisation très hiérarchisée et dont le comportement est habituellement
entièrement dévoué au bien-être de la colonie, perdent soudainement la tête à
cause de champignons un peu trop envahissants.
Parmi les interactions fourmi-champignon, certaines s’en
sortent plutôt bien en entretenant des relations pacifiques (symbiotiques). Ce
sont les
fourmis coupeuses de
feuilles, qui utilisent ces morceaux de végétaux comme zone de culture pour une
espèce particulière de champignon, qui ne vit qu’au sein des
colonies de fourmis. Les
champignons y trouvent la nourriture idéale et nécessaire à leur développement,
et les fourmis peuvent à leur tour s’en nourrir.
Les fourmis-zombis grimpent aux arbustes…
À l’inverse, certaines fourmis vivent
un peu trop étroitement avec des champignons, au point que ceux-ci trouvent le
moyen de s’emparer de leur
cerveau et de modifier leur comportement. Ces
fourmis-zombis sont connues depuis longtemps, mais ne cessent d’intriguer les
scientifiques, qui tentent d’en apprendre un peu plus sur ce champignon pas
comme les autres. Dans une nouvelle publication parue dans la revue
Plos One, trois
biologistes issus d’universités brésilienne, américaine et anglaise, ont
identifié quatre nouvelles espèces du microorganisme.
C’est dans la forêt amazonienne, dans
la région Minas Gerais au Brésil, que les chercheurs ont prélevé des
échantillons, après avoir observé l’étrange comportement des fourmis-zombis. Une
fois infectés par les spores du champignon et par un procédé encore mystérieux,
les insectes deviennent comme possédés et se mettent à la recherche d’un arbuste
particulier. Ils y grimpent et ne s’intéressent qu’à certaines feuilles aux
caractéristiques très précises : situées à 25 centimètres du sol et exposées au
nord ou au nord-ouest.
et deviennent des usines de production de spores
Avant de mourir, la
fourmi s’accroche à la
face inférieure de la feuille et plante ses
mandibules dans la nervure principale. Alors
que les
molécules chimiques produites par cette plante
sont nocives pour la fourmi et la tuent, le champignon, lui, est ravi. Il se
multiplie, faisant du pauvre insecte une usine de fabrication et de
dissémination des spores, qui sera opérationnelle pendant près d’un an. Les
spores du champignon sont alors éjectées et tombent au sol, idéalement
directement sur une nouvelle proie qui passait par là. La spore qui n’a pas
cette chance peut prendre sa revanche en germant sous forme de tige et en
colonisant une nouvelle
fourmi qui viendrait s’y
frotter, recommençant ainsi le cycle de la vie.
Des nouvelles espèces
Si les quatre champignons découverts possèdent le point
commun d’appartenir au genre Ophiocordyceps, caractérisé par la
formation d’une tige sur la « nuque » de la fourmi, ils sont néanmoins
reconnaissables selon des différences micromorphologiques évidentes (des spores
mais aussi des formes anamorphes et télomorphes, c'est à dire asexuées et
sexuées). Chacun d’entre eux attaque une espèce particulière de fourmis (Camponotus
rufipes, C. balzani, C. melanoticus ou C.
novogranadensis), et ont naturellement été baptisés en hommage à leur hôte
(Ophiocordyceps suivi du nom de la fourmi légèrement revisité).
Les noms d’espèces ont déjà été déposés
à l’Index
Fungorum, une référence internationale en
ce qui concerne la
taxonomie des champignons. Des prélèvements d’ADN
ont été réalisés, et les
génomes respectifs de chaque champignon seront
prochainement analysés afin de vérifier leur classement et leurs relations
phylogénétiques.
 Carabes bufonivores : Carabes bufonivores :
D’ordinaire,
c’est le crapaud, insectivore patenté, qui croque le carabe, insecte chasseur
mais petit. Le Dytique dans la mare fournit un exemple bien connu d’attaque de
vertébré vivant par un insecte prédateur : il mord en effet les têtards, même
plus gros que lui et les déboyaute. On savait les larves d’Epomys (Col.
Carabidé) consommatrices d’amphibiens. Les observations de Gil Wizen et d’Avital
Gasith (université de Tel-Aviv, Israël) dévoilent que les imagos aussi, en guise
de complément à leur régime de base entomophage et charognard sur vertébré,
croquent le crapaud vivant et gigotant. Le jour, ils se reposent dans les mêmes
abris que leur proie. La nuit venue…
Deux espèces d’Epomys cohabitent
en Israël, E. circumscriptus et E. dejeani, qui occupent des
niches quelque peu distinctes. Elles n’attaquent pas tout à fait les mêmes
espèces d’amphibiens. Au laboratoire, les deux Epomys (au stade adulte)
s’en sont pris au Crapaud vert, à la Rainette de Turquie, à la Grenouille verte
et brune, à la salamandre Salamandra infraimmaculata ; seul E. dejeani
a mangé du Triton à bande.
Cigale qui rigole :
Une équipe de biologistes philippins et de l’Académie des sciences de
Californie a découvert un bon nombre d’espèces nouvelles sur l’archipel, sur
terre et dans la mer. Parmi elles, une cigale probablement inconnue des
entomologistes (le MNHN est alerté), repérée par Ireno Lit et ses collaborateurs
sur le mont Banahaw. Terreur des habitants, elle émet, en guise de
cymbalisation, un rire aigu !!
Cigale qui régale :
Sparky, glacier qui fabrique des glaces maison à Columbia (Missouri,
États-Unis) a trouvé la recette du succès éclair : une glace à la cigale - avec
des morceaux d’aile pour le croquant. Les cigales ramassées dans la cour, sont
cuites puis enrobées de sucre et de chocolat au lait avant d’être plongées dans
la crème.
Les clients se sont précipités et lui ont vidé son bac en un
tournemain. Puis l’autorité sanitaire locale lui a interdit d’en préparer un
second. Motif ? La réglementation porte sur la température à respecter pour le
porc bouilli, le bœuf bouilli, le poulet bouilli, le poisson bouilli. Elle est
muette sur la cigale bouillie.
L'année 2011 s'annonce
comme une année particulière pour l'Observatoire de la
Biodiversité des Jardins (OBJ) piloté par le Muséum
national d'Histoire naturelle et l'association Noé Conservation :
 Les
spécialistes des papillons parlent de 2011 comme d'une année vraiment
exceptionnelle tant la sécheresse a été intense et longue, sauf peut-être dans
le Midi. Ils témoignent d'une situation contrastée : on observe, pour la
période, une grande diversité d'espèces mais une faible abondance dans les
milieux secs, alors que les papillons semblent plus abondants en milieu
forestier. Il est possible que la sécheresse ait un impact négatif, en
particulier parce que les plantes nourricières des chenilles seraient moins
abondantes. Par ailleurs, plusieurs espèces du début d'été ont déjà éclos alors
que subsistent encore de nombreuses espèces printanières expliquant ainsi la
diversité des papillons observés. D'autres espèces présumées disparues de
certaines régions ont même été découvertes comme le demi-argus en Ile-de-France,
et des espèces peu communes sont observées plus fréquemment que les autres
années à l'instar de l'azuré des cytises... ! Les
spécialistes des papillons parlent de 2011 comme d'une année vraiment
exceptionnelle tant la sécheresse a été intense et longue, sauf peut-être dans
le Midi. Ils témoignent d'une situation contrastée : on observe, pour la
période, une grande diversité d'espèces mais une faible abondance dans les
milieux secs, alors que les papillons semblent plus abondants en milieu
forestier. Il est possible que la sécheresse ait un impact négatif, en
particulier parce que les plantes nourricières des chenilles seraient moins
abondantes. Par ailleurs, plusieurs espèces du début d'été ont déjà éclos alors
que subsistent encore de nombreuses espèces printanières expliquant ainsi la
diversité des papillons observés. D'autres espèces présumées disparues de
certaines régions ont même été découvertes comme le demi-argus en Ile-de-France,
et des espèces peu communes sont observées plus fréquemment que les autres
années à l'instar de l'azuré des cytises... !
Toutefois, les données
transmises au Muséum national d'Histoire naturelle sur les papillons observés
dans les jardins ne mettent pas en évidence une diminution des espèces communes
par rapport aux périodes précédentes. Les nombres de papillons comptés dans les
jardins au début de l'année 2011 sont comparables à ceux du début des années
2006 à 2010.
En revanche, on observe, depuis le lancement de la saison 2011,
une participation des observateurs moins importante que les autres années. Cela
pourrait traduire le fait qu'effectivement, les papillons sont moins abondants
cette année : lorsqu'il y a peu de papillons dans le jardin, il est moins
motivant d'observer, ce qui se traduit par une baisse de la participation. Les
données qui nous parviennent proviendraient alors des jardins les mieux lotis,
où le suivi est motivant, et donneraient une représentation biaisée de la
réalité.
Pour en avoir le cœur net, une seule solution : effectuer des
observations, y compris dans les jardins pauvres en papillons et transmettre ces
données au Muséum national d'Histoire naturelle. Aussi l'OBJ compte fortement
sur une mobilisation accrue des observateurs, même si le nombre de papillons
rencontrés peut sembler faible. Les données montrant une absence de papillons
sont aussi importantes pour comprendre l'évolution des populations que celles
montrant une forte abondance !
Quoi qu'il en soit, les conditions actuelles
sont remarquables, et méritent des observations continues. En effet, avec le
réchauffement climatique, de tels épisodes météorologiques exceptionnels
pourraient être plus fréquents, et avoir un impact sur la
biodiversité. Les suivis comme l'OBJ sont alors des outils irremplaçables
pour comprendre ces effets.
Pour observer les espèces
de votre jardin et participer à l'Observatoire de la Biodiversité des Jardins,
inscrivez votre jardin et découvrez la démarche à suivre pour le relevé et le
comptage via le site
www.noeconservation.org
ou sur le site
vigienature.mnhn.fr.
Pas besoin d'être spécialiste, de nombreux outils sont en ligne pour vous aider
à déterminer l'espèce que vous avez sous les yeux ! À la fin du mois, saisissez
vos données en remplissant un formulaire en ligne, elles seront transmises aux
scientifiques du Muséum !
L’insecte qui chante avec son sexe
 C’est un insecte curieux et minuscule, qui va servir de modèle aux
derniers des crooners lascifs. Il s’appelle Micronecta scholtzi et
appartient à la famille des corises, punaises aquatiques que l’on surnomme
aussi “cigales d’eau” en raison de leur chant. En réalité, parler de chant
avec les insectes est incorrect puisqu’à
de très rares exceptions, aucun son ne sort
de leur bouche. Qu’il s’agisse de grillons, de sauterelles, de
capricornes, de certaines fourmis ou de corises, ces petits animaux
stridulent (mais pas la cigale, qui cymbalise). Comme l’explique
le site de l’Office pour les insectes et leur
environnement (OPIE), la stridulation est
le résultat du frottement d’une râpe ou d’un archet sur un grattoir, comme
si on faisait passer une lime ou les dents d’un peigne sur le bord d’une
table : “Le son ainsi produit pourrait se
comparer à celui d’un instrument à cordes, comme le violon, ou au
washboard.” C’est un insecte curieux et minuscule, qui va servir de modèle aux
derniers des crooners lascifs. Il s’appelle Micronecta scholtzi et
appartient à la famille des corises, punaises aquatiques que l’on surnomme
aussi “cigales d’eau” en raison de leur chant. En réalité, parler de chant
avec les insectes est incorrect puisqu’à
de très rares exceptions, aucun son ne sort
de leur bouche. Qu’il s’agisse de grillons, de sauterelles, de
capricornes, de certaines fourmis ou de corises, ces petits animaux
stridulent (mais pas la cigale, qui cymbalise). Comme l’explique
le site de l’Office pour les insectes et leur
environnement (OPIE), la stridulation est
le résultat du frottement d’une râpe ou d’un archet sur un grattoir, comme
si on faisait passer une lime ou les dents d’un peigne sur le bord d’une
table : “Le son ainsi produit pourrait se
comparer à celui d’un instrument à cordes, comme le violon, ou au
washboard.”
La plupart du temps, ce
sont les mâles qui stridulent, afin d’être choisis par une femelle. Pour ce
faire,
ils utilisent comme archet
soit leurs élytres, leurs pattes, mais aussi leurs ailes, leurs antennes,
leurs mandibules, etc. Le cas de Micronecta scholtzi est un peu
particulier. En effet, même si l’affaire n’est pas bien claire car la
bestiole ne mesure que 2,3 millimètres, il semblerait bien qu’elle réussisse
l’exploit de striduler avec… son appareil génital, comme une réincarnation
d’Elvis Presley, dont le succès auprès de ses groupies féminines tenait tant
à sa voix qu’à ses déhanchements suggestifs, au point qu’on l’avait surnommé
“Pelvis”. Cette corise se sert d’un paramère (sorte d’appendice situé près
du pénis) qu’il frotte contre une arête de son abdomen. On peut
écouter ici ce que
cela donne.
Le plus incroyable, dans l’histoire, n’est
pas tant que cet insecte joue du violon avec son sexe (après tout, il fait
ce qu’il veut) mais que cet archet de seulement 50 microns produise autant
de bruit. En effet, comme vient de le montrer une équipe franco-britannique
dans une étude publiée le 15 juin par la revue en
ligne PLoS ONE,
Micronecta scholtzi fait beaucoup de boucan pour une bête de moins
de 3 millimètres, vivant dans l’eau et dénuée d’appareil amplificateur qui
plus est. On peut l’entendre à plusieurs mètres. Evidemment, si l’on s’en
tient à la valeur absolue du chant émis, cette corise n’entre pas dans le
Livre des record, malgré des pointes stridentes à 105 décibels. D’autres
animaux, beaucoup plus gros, comme le cachalot ou l’éléphant, sont aussi
plus bruyants, mais si l’on rapporte le son émis à la taille de l’animal,
M. scholtzi apparaît comme un champion du monde (une “donnée
aberrante” disent les chercheurs qui n’ont pas le sens de la compétition).
Pourquoi cet insecte au sexe stridulant fait-il autant de
bruit ? Madame est-elle dure d’oreille ? L’idée du mâle est sûrement de
brailler plus fort que les autres pour se faire détecter et choisir par la
femelle. C’est une variante acoustique de la livrée chatoyante du
faisan doré mâle qui
est aussi voyant qu’une Ferrari dans un parking de supermarché. La stratégie
a son revers de la médaille : plus on tente de se faire remarquer, plus on
risque de l’être… par un prédateur. Apparemment, cela n’a pas l’air de gêner
notre punaise aquatique. Peut-être les animaux qui la chassent sont-ils
sourds ?
Charançon à 6
boulons :
Avant
de publier leur trouvaille (dans Science), Alexandre Riedel (muséum de
Karlsruhe, Allemagne) et ses collègues ont attendu (7 ans) de pouvoir examiner
leur charançon Trigonopterus oblongus(Col. Curculiondié aptère de
Nouvelle Guinée) en tomographie à rayons X produits par le synchrotron ANKA. Les
1 800 clichés pris ont permis la reconstitution en 3 dimensions de
l’articulation coxa (hanche)-trochanter.
Et confirmé la découverte du premier
cas de boulonnage naturel : chez cet insecte – et pourquoi pas chez d’autres de
la même famille – un système vis/écrou assure l’articulation à la base de la
patte, en permettant un débattement de 130°.
Il est difficile d’expliquer en
termes d’avantage évolutif ce parti pris mécanique. Peut-être assure-t-il au
charançon une stabilité hors pair ?
 Mort ou vif ! Mort ou vif !
Le
Dermeste des grains Trogoderma granarium(Col. Dermestidé) est, parmi les
ravageurs des denrées, un des rares à n’être pas cosmopolite. Il sévit – en
provoquant des dégâts très importants – de l’Est de l’Asie (son aire d’origine)
au Maroc. Il est établi en Suisse et au Vénézuéla. Sinon, il subsiste uniquement
dans des entrepôts en Allemagne, Belgique… Il a été signalé mais a été éradiqué
dans de nombreux pays, de l’Australie aux États-Unis. Il n’aurait jamais posé la
patte en France.
C’est un spécialiste des environnements chauds secs, qui
affectionne les stocks de céréales (dont il ne peut attaquer que les grains
cassés) , d’arachide, de légumineuses et d’aliments du bétail. La larve est
capable d’une longue diapause – plusieurs années. C’est un voyageur discret et
endurant.
Mais les douaniers l’ont à l’œil. Le 21 juin, traversant la
frontière à Port-Huron (Michigan, États-Unis), une famille revenait d’un tour en
Inde, via Toronto, avec 10 valises. Inspection et découverte dans l'une d'elles,
en train de boulotter la colle d’un éventail en plumes, de 2 larves et d’un
adulte de dermeste. Les bagages sont mis en quarantaine. Le lendemain, un
entomologiste communique aux douaniers qu’il s’agit du khapra beetle (nom local
et aussi mondial de D. granarium). 9 valises sont rendues, celle qui
transportait notre migrant part à la stérilisation puis est restituée défaunée.
Les propriétaires ne l’ont pas reconnue : une boule compacte et informe.
Et
le Dermeste des grains, seul insecte déclenchant le rejet de la marchandise
importée s’il est trouvé même mort, retentera le passage…
Bon à savoir :
boire rend attirant
L’expérience a été menée au Burkina-Faso,
sur 25 volontaires adultes à qui les entomologistes de l’IRD ont fait ingurgiter
un litre de bière Dolo, et sur 2 500 individus adultes d’Anopheles gambiae
(Dip. Culicidé), moustique vecteur du paludisme.
Ces derniers ont été soumis
par lots de 25 au test de l’olfactomètre - schématiquement un tube en Y parcouru
par un courant d’air descendant, parfumé à l’odeur humaine dans une des
branches. Dans le cas où cette odeur est prélevée avant la consommation de
bière, 35 % des moustiques ont tendance à voler vers l’une ou l’autre branche et
un sur deux finit dans le piège au bout du tube parfumé. Si ce parfum est celui
de buveurs, 47 % des moustiques se déplacent et 65 % finissent au bout de ce
tube.
L’expérience, répétée avec 1l d’eau, ne montre aucune différence.
L’odeur de bière transpirant par la peau attire les moustiques et augmente leur
activité de vol.
Les gens sont plus ou moins susceptibles de se faire piquer
et donc d’attraper le paludisme. Ce travail contribue à améliorer les politiques
publiques qui doivent, pour être plus efficaces, tenir compte des différences
individuelles.
 Il pleut des coccinelles sur La Baule ! Il pleut des coccinelles sur La Baule !
dimanche 03 juillet 2011
Tant de «bêtes à bon Dieu» sur le parasol, c'est
étrange!
Sabine Hervy.
Elles sont arrivées ce matin sur la côte d’Amour et toute la
presqu'île : les coccinelles volettent actuellement par millions
dans le ciel de la baie de La Baule. Elles s'accrochent sur les
vêtements ou dans les cheveux des touristes... Ou finissent écrasées
sous les pieds des passants. Désagréables mais inoffensives, les
coccinelles...
Le même phénomène avait été observé l'an dernier, à la fin du mois
de juillet, à Lorient. L'entomologiste et spécialiste des
coccinelles, Olivier Durand, avait alors expliqué ce phénomène dans
nos colonnes : une fois la saison des pucerons finie, les petites
«bêtes à bon Dieu» partent, ensemble, à la recherche d'un endroit
pour se repaître de leur autre nourriture : le pollen. Or, les vents
de mer rabattent au sol les coccinelles qui s'approchent du
littoral... D'où ce débarquement massif aujourd'hui !
Une punaise bat un record du monde de chant :
 On savait la puce capable de bonds qui, rapportés à sa
taille, battent tous les records de hauteur. Mais, pour la puissance du chant,
c’est une minuscule punaise d’eau qui remporte la médaille. En termes d’énergie
acoustique, le micronecte pygmée bat à plate couture les éléphants, les
baleines, les explosions de bulles de la crevette pistolet et… n’importe quel
chanteur de heavy-metal. Nul besoin de partir en lointaine exploration pour
l’entendre : les spécimens de Micronecta pygmea ayant conduit à cette
conclusion ont été récoltés à Paris et à Morsang-sur-Orge. On savait la puce capable de bonds qui, rapportés à sa
taille, battent tous les records de hauteur. Mais, pour la puissance du chant,
c’est une minuscule punaise d’eau qui remporte la médaille. En termes d’énergie
acoustique, le micronecte pygmée bat à plate couture les éléphants, les
baleines, les explosions de bulles de la crevette pistolet et… n’importe quel
chanteur de heavy-metal. Nul besoin de partir en lointaine exploration pour
l’entendre : les spécimens de Micronecta pygmea ayant conduit à cette
conclusion ont été récoltés à Paris et à Morsang-sur-Orge.
Cette découverte, publiée dans la revue
scientifique
Plos One, est due à
Jérôme Sueur (Muséeum
national d’histoire naturelle/CNRS)
et à
David Mackie et
James F.C. Windmill
(université de Strathclyde, à Glasgow). Ils ont capturé des dizaines de ces
punaises d’eau, puis ont enregistré la puissance du chant de douze mâles.
Résultats : 79 db à 1 m de distance (à peu près le bruit d’une voiture), avec
des pics à 99 dB ! Ce chant est si puissant qu’il peut traverser la couche d’eau
et se faire entendre à l’air libre à plusieurs mètres du point d’émission.
(a) : Le micronecte pygmée est long de 2 mm.
(b) : Cet insecte
aquatique produit un chant modulé en amplitude
(c) : Rapportée à la taille de
son émetteur, la puissance de ce chant dépasse celle de tous les autres animaux
chanteurs ou crieur, laissant par exemple l’éléphant loin derrière.
Ainsi, constatent les chercheurs, “Si l’on compare le rapport
puissance acoustique/taille du corps, le micronecte pygmée apparaît comme
l’animal le plus efficace en terme d’énergie acoustique, dépassant notamment les
grands mammifères.”
L’explication de cette particularité reste assez mystérieuse.
Le mâle produit son chant en frottant ses pièces génitales pour attirer les
femelles. Mais pourquoi si fort? “L’intensité de ce chant pourrait être le
résultat d’une sélection sexuelle non contrôlée par des contraintes externes
comme celles exercées par des prédateurs, estiment les chercheurs. Cette faculté
pourrait ainsi être considérée comme un caractère sexuel secondaire extrême au
même titre que les bois des cervidés, les chants complexes de certains oiseaux
ou les couleurs variées et éclatantes observées dans de nombreux groupes
animaux.”
« A la recherche de l'origine des insectes » - Retour
au Spitzberg :
- Paris, 12 Juillet 2011
Retour au Spitzberg pour l'expédition scientifique polaire du
Muséum national d'histoire naturelle et du CNRS avec le soutien de l'Ipev du 15
Juillet au 1er août 2011.
Après la mise au jour en 2010 de gisements
fossilifères exceptionnels (l'une des plus anciennes forêts du monde, le
gisement d'ambre le plus septentrional jamais découvert), l'équipe du Muséum
national d'Histoire naturelle et du CNRS mettra cet été à nouveau le cap vers le
Spitzberg, l'île principale de l'archipel du Svalbard, territoire de l'Arctique
situé à l'est du Groenland.
 L'objectif est cette fois-ci de rechercher des traces des plus anciens
insectes connus dans des sédiments où se sont imprimés les troncs, feuilles
et racines des premières forêts de notre planète (au Dévonien, environ – 400
millions d'années) et de comprendre l'absence de fossiles d'insectes dans
les périodes géologiques qui ont suivi (début du Carbonifère). L'objectif est cette fois-ci de rechercher des traces des plus anciens
insectes connus dans des sédiments où se sont imprimés les troncs, feuilles
et racines des premières forêts de notre planète (au Dévonien, environ – 400
millions d'années) et de comprendre l'absence de fossiles d'insectes dans
les périodes géologiques qui ont suivi (début du Carbonifère).

Les recherches auront lieu principalement dans la vallée
de Mimerdalen (péninsule de Dicksonland) et dans les anciennes mines de
charbon à proximité de la ville fantôme de la concession russe de Pyramiden.
Celle-ci est située dans le fjord Billefjorden, où se jette l'un des plus
grands glaciers d'Europe, le Nordenskioldbreen. Si la région connaît
aujourd'hui un climat semi-désertique polaire, elle était pendant l'ère
tertiaire tempérée chaude et recouverte d'une végétation luxuriante.
Le
paysage spectaculaire de cette région est très favorable à la découverte de
fossiles : les versants des montagnes, avec leurs différentes strates qui se
superposent comme les pages d'un livre, présentent une continuité
stratigraphique du Dévonien (de -416 à -359 millions d'années) au
Mississippien (de -345 à -320 millions d'années), avec un passage progressif
et alterné marin-continental. Ce type de paléo-environnement correspond
précisément à celui des premiers « insectes », puisque ceux-ci sont
apparentés aux crustacés marins.
Toutes les étapes de la sortie des eaux
ont pu se fossiliser et s'enregistrer dans les sédiments fins
caractéristiques de cette zone, aussi bien pour la paléoentomologie, la
paléobotanique, les paléo-traces de broutages sur les végétaux, de
paléoichnologie (déplacements d'êtres vivants), que pour les
paléo-vertébrés.
L'équipe, internationale, est composée cette année de 7
spécialistes de la paléoentomologie et de la paléobotanique et d'un
ingénieur de l'IPEV, Sébastien Barrault, de la station AWIPEV de Ny Alesund.
- Dr André NEL, paléoentomologiste, responsable des collections
zoologiques d'arthropodes du Muséum national d'Histoire naturelle, UMR
MNHN/CNRS 7205 « Origine, structure et évolution de la biodiversité » du
Département Systématique et Evolution*, organisateur ;
- Dr Romain
GARROUSTE, entomologiste et paléoentomologiste, UMR MNHN/CNRS 7205 «
Origine, structure et évolution de la biodiversité » du Département
Systématique et Evolution*, organisateur ;
- Mr Patrick ROQUES,
bénévole, Muséum national d'Histoire naturelle ;
- Pr Dany AZAR,
paléoentomologiste, Université Libanaise, Beyrouth, Liban, associé au Muséum
;
- Dr Torsten WAPPLER, paléoentomologiste Université de Bonn, Allemagne
;
- Pr Michael ENGEL, paléoentomologiste, Kansas University, USA ;
-
Dr Christopher BERRY, paléobotaniste, Cardiff University, UK.
L'expédition scientifique polaire « A la recherche de
l'origine des insectes » est financée par l'Institut Polaire français
Paul-Emile Victor (IPEV), co-organisée par le CNRS et le Muséum national
d'Histoire naturelle (UMR 7205, « Origine, structure et évolution de la
biodiversité » du Département Systématique et Evolution*), et reçoit le
soutien de la Société des Amis du Muséum.
Depuis plus de 300 ans, le Muséum national d'Histoire
naturelle (MNHN) est une référence mondiale pour l'étude et de la protection
de la biodiversité. S'appuyant sur ses 5 missions - recherche, collections,
enseignement, expertise, diffusion - il appréhende les problématiques
naturalistes et environnementales de manière à la fois transdisciplinaire et
très spécialisée.
http://www.mnhn.fr
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
est un organisme public de recherche français. Il produit du savoir et met
ce savoir au service de la société. Avec plus de 32 000 personnes, le CNRS
exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, en s'appuyant
sur plus de 1 200 unités de recherche et de service.
http://www.cnrs.fr/
L'Institut polaire français Paul Émile Victor (IPEV) est
un Groupement d'Intérêt Public (GIP) constitué par neuf organismes publics
ou parapublics (Ministère de la recherche, Ministère des affaires
étrangères, CNRS, Ifremer, CEA, TAAF, Météo-France, CNES, Expéditions
Polaires Françaises). L'IPEV est une agence de moyens et de compétences au
service de la recherche scientifique dans les régions polaires. Son rôle est
d'offrir les moyens humains, logistiques, techniques et financiers ainsi que
le cadre juridique nécessaires au développement de la recherche scientifique
française dans les régions polaires et subpolaires.
http://www.institut-polaire.fr
Notes :
*UMR MNHN / CNRS 7205 OSEB « Origine, structure et
évolution de la biodiversité ». Cette Unité Mixte de Recherche a pour
objectif de répondre aux questions concernant l'origine de la
biodiversité, les modalités de diversification des espèces et la mise en
place des communautés animales en lien avec l'évolution
spatio-temporelle des taxons. L'approche privilégiée par l'équipe est la
systématique phylogénétique et ses outils moléculaires, génétiques,
morphologiques et morphométriques.
Tropical Insects : The Bugs Are Bigger!
http://greenanswers.com/blog/249056/tropical-insects-bugs-are-bigger#ixzz1SkYTLVs1
A la recherche du papillon
perdu :
Leurs
amateurs sont si nombreux que l'on pensait déjà connaître un grand nombre de
papillons diurnes. Un nouveau représentant vient pourtant d'être redécouvert au
fin fond ... d'un tiroir du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres ! Orobrassolis latusoris a été décrit à partir de 2 spécimens mâles collectés
en 1919 à Castro, au Brésil, puis rapportés en Europe. Mais mal identifiés
jusqu'alors. Carla Penz étudie le genre Orobrassolis depuis plus de 10
ans : "J'avais eu l'occasion d'observer une espèce rare O. ornamentalis,
capturée sur les hauts plateaux brésiliens de Campos do Jordao (à plus de 1600m
d'altitude) et conservée au Brésil. En examinant les spécimens de Londres, j'ai
remarqué des divergences entre ces derniers et ceux du muséum brésilien.". Les
spécimens de Londres "ont une ligne sur le bord de l'aile plus large et plus
foncée que leur cousin" - ce que traduit latusoris en latin. L'histoire
géologique et climatique des hauts plateaux brésiliens a sans doute façonné
l'évolution d'Orobrassolis. "Les fluctuations climatiques ont amené une
progression des forêts en altitude, et donc une fragmentation des prairies
d'altitude, habitat de ces papillons. Les populations séparées ont évolué en 2
espèces distinctes". Mais O. latusoris n'a plus été observé dans la
Nature depuis sa capture.
Un fossile d'insecte bien mystérieux
:
Des ailes d’éphémère, un corps de libellule et des pattes de mante
religieuse, ce fossile d’insecte découvert au Brésil permet d’en savoir plus sur
l’évolution de ce groupe.
Coxoplectoptera
Larva Insect Systematics & Evolution
Des caractéristiques mêlées
Ce
sont les scientifiques du Musée d'histoire naturelle de Stuttgart qui ont
découvert cet insecte qu’ils ont baptisé Coxoplectoptera. Il provient du
gisement de Crato, au Brésil, où deux spécimens adultes ailés (photo
ci-dessous) et une trentaine de larves (photo d’ouverture) ont été
identifiés depuis. Leur âge est estimé à 120 millions d’années.
Si
les paléontologues estiment que Coxoplectoptera est lié aux éphémères
modernes, il diffère de manière significative à la fois des éphémères et de
tous les autres insectes connus tant d’un point de vue anatomique qu’au
niveau du mode de vie. Avec son corps qui semble composé d’un patchwork
d’organes provenant de différents insectes, Coxoplectoptera a une place à
part au sein de ce sous-embranchement. A tel point que les spécialistes ont
créé un nouvel ordre (qui porte le même nom) pour le classer. La revue
anatomique de l'insecte est publiée dans le journal Insect Systematics &
Evolution.
Coxoplectoptera Adulte. Insect Systematics & Evolution
Pour mieux comprendre l’apparition des ailes
Les larves de Coxoplectoptera (qui ressemblent à de petites crevettes)
étaient probablement aquatiques et devaient flotter sur l’eau. Après sa
métamorphose, l’insecte avait un mode de vie mixte, l’exosquelette renforcé
et certaines pièces buccales indiquent qu’il était sans doute capable de
creuser de petites galeries sur les rives afin de piéger ses proies.
Bien qu'il partage des caractéristiques avec un certain nombre d'autres
insectes, Coxoplectoptera est plus proche des éphémères. Ces insectes ont
une vie d’adulte très courte, de deux à trois heures parfois et deux à trois
jours au plus, uniquement centrée sur la reproduction sans même se nourrir.
Ce qui n’est pas le cas de Coxoplectoptera qui avait peut-être une vie
adulte plus longue.
Cette découverte permet enfin de construire une
nouvelle théorie sur l’apparition des ailes chez les insectes. Le débat qui
anime les spécialistes étant de savoir si elles proviennent d’excroissances
de plaques dorsales ou d’appendices similaires aux pattes qui ont changé de
forme. Pour les auteurs, la réponse est : un peu des deux. Ils pensent avoir
trouvé des indices établissant que les ailes se forment à partir de plaques
dorsales thoraciques sous le contrôle de gènes liés aux pattes qui sont
recrutés pour guider leur développement.
Des carabes contre les mauvaises herbes :
Une étude conjointe entre l’INRA et le BBSRC (Biotechnology and
Biological Sciences Research Council) au Royaume-Uni, conclut que la
présence de carabes dans les champs cultivés serait un moyen de lutte
biologique efficace contre les mauvaises herbes. Une meilleure gestion
des populations de ces coléoptères permettrait de diminuer l’usage
d’intrants et préserverait ainsi la biodiversité. Ces résultats sont
publiés dans le Journal of Applied Ecology* du mois d’août 2011.
 Les carabes sont des insectes appartenant à l’ordre
des coléoptères, tout comme les scarabées et les coccinelles. De
nombreux carabes consomment des graines et notamment les graines de
mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ou adventices, représentent un
problème récurrent en agriculture car elles réduisent la productivité en
consommant les ressources du sol au détriment des cultures, et donc
diminuent les rendements. Les carabes sont des insectes appartenant à l’ordre
des coléoptères, tout comme les scarabées et les coccinelles. De
nombreux carabes consomment des graines et notamment les graines de
mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ou adventices, représentent un
problème récurrent en agriculture car elles réduisent la productivité en
consommant les ressources du sol au détriment des cultures, et donc
diminuent les rendements.
Au Royaume-Uni, sur la seule année 2008, 5
700 tonnes d’herbicides ont été utilisés pour traiter les cultures
céréalières qui occupent la moitié de la surface des terres cultivées du
pays. A cause de l’utilisation intempestive d’herbicides, certaines
espèces d’adventices deviennent de plus en plus résistantes, rendant la
tâche encore plus difficile pour s’en débarrasser.
Une équipe de
chercheurs de l’INRA et du BBSRC ont étudié des données portant sur 257
champs comprenant 4 cultures différentes (maïs, betterave, colza d’hiver
et de printemps), répartis sur l’ensemble du territoire britannique.
L’objectif était de comprendre le lien entre la quantité de graines
d’adventices disponible dans le sol d’année en année et l’abondance des
populations de carabes dans les champs cultivés. L’analyse des données a
permis de conclure que plus il y a de graines disponibles en surface,
c’est-à-dire juste après qu’elles soient tombées de la plante, plus le
nombre de carabes est élevé. Ces résultats suggèrent aussi que les
carabes prélèvent une part non négligeable de graines avant que
celles-ci ne viennent réalimenter le stock de graines du sol,
responsable des futures germinations.
Cette régulation est un
service des écosystèmes qui se produit naturellement, et qui
représenterait un moyen complémentaire de lutter contre les adventices.
Ce service serait amplifié si la quantité de pesticides utilisés était
réduite et si la pratique du labour qui perturbe le sol dans lequel
certains carabes passent l’hiver sous forme de larve ou d’adulte était
limitée. Par ailleurs, les habitats semi-naturels permettant à ces
insectes de se maintenir dans les paysages agricoles doivent être
préservés. La recrudescence de carabes prédateurs de graines pourrait
augmenter le contrôle des mauvaises herbes et donc limiter le recours
aux herbicides ce qui constituerait un réel impact positif sur la
biodiversité et l’environnement
Bande
de décodeurs :
Ils sont 10, 9 États-Uniens et 1 Britannique,
qui viennent de lancer le «projet Manhattan en entomologie ». Il ne s’agit pas
de réunir des milliers d’entomologistes au fin fond d’un désert pour mettre au
point la bombe insecticide atomique. Leur but : décrypter le génome et étudier
le transcriptome des 5 000 insectes (et quelques autres arthropodes terrestres)
les plus importants sur Terre. Pour l’heure, il s’agit de choisir, parmi un bon
million de candidats, les espèces à décoder. Le programme s’appelle ik5.
Le
critère est que la connaissance de leur patrimoine génétique puisse servir à
mieux les tuer, gérer, multiplier, favoriser, exploiter… Ceci dans les domaines
de l’agriculture (au sens large), de la santé des gens et des bêtes, du
fonctionnement des écosystèmes, de la recherche… Sont donc éligibles à ce club
des 5 000 décodables les plus notables des insectes ravageurs, pollinisateurs,
entomophages, vecteurs, appâts de pêche, hématophages, décomposeurs, modèles,
domiciliaires, médicaments, clés, architectes du paysage, parapluies,
comestibles, communautaires…
Un formulaire est à disposition des
entomologistes de la Planète pour signaler, promouvoir, dénoncer tout insecte
devant figurer sur la liste à
//arthropodgenomes.org/wiki/i5K La liste des 100 premiers retenus est
consultable à partir de cette page.
A Tokyo, les cigales sont revenues :
Leur silence inquiétait : on les
croyait touchées elles aussi par la catastrophe nucléaire. En
fait, elles étaient simplement en retard pour des raisons
climatiques. Comme chaque année après la saison des pluies, les
cigales sont là, vrillant du matin au soir de leur chant
l'étouffant été japonais. A la campagne, bien sûr, mais aussi en
ville, à commencer par Tokyo, gigantesque flaque urbaine (30
millions d'habitants), que l'on pense trop souvent à l'étranger
être une monstrueuse nappe de béton.
La densité du bâti ne
fait pas de doute. Et, parmi les grandes métropoles du monde, la
capitale nippone n'est pas la plus dotée en espaces verts : en
superficie du moins - quoique la situation se soit améliorée par
des campagnes de plantations d'arbres -, car Tokyo a aussi un
côté bucolique par ses myriades de jardinets ou d'arbustes et de
plantes en pot disposés devant les innombrables maisonnettes
individuelles des petites rues, des ruelles voire des venelles
qui innervent cette mégalopole de la démesure. Personne ne pense
à les voler, à les vandaliser ou à les prendre pour urinoir et,
sans être l'équivalent de jardins publics ou de parcs (qui
existent aussi), ces " jardins de rue " - titre d'une plaquette
illustrée de Michel Butor et Olivier Delhourme (éditions Notori)
sur cette verdure inattendue des villes japonaises - sont autant
de fragments improvisés de nature auxquels s'accrochent les
cigales, dont les mâles s'adonnent à leur chorale pour attirer
les femelles.
Les cigales n'intéressent plus guère les petits
Japonais des villes qui, autrefois, observaient la métamorphose
de la larve puis attrapaient les insectes dans des filets et les
plaçaient dans des cages. Mais leur chant, qui fait partie de
ces " événements de saison apportés par le vent ", dit-on, est "
indispensable " aux Japonais pour qu'ils se sentent vraiment en
été. Un peu comme la floraison des cerisiers symbolise l'arrivée
du printemps. L'été est aussi associé aux lucioles : à la
campagne, des restaurants à jardin éteignent les lumières
pendant quelques minutes afin que les dîneurs puissent les voir
évoluer dans la nuit.
Les Japonais manifestent un attachement
particulier aux insectes. Un grand peintre des animaux et des
végétaux, Jakuchu Ito (1716-1800), excella à rendre leur forme
et leurs couleurs. Et l'entomologiste français Jean-Henri Fabre
(1823-1915), quelque peu oublié en France, est en revanche connu
de la plupart au Japon grâce à la traduction de son ouvrage
Souvenirs entomologiques.
L'attachement des Japonais à la
nature a aussi sa dimension sonore : ce charivari du vivant,
dont la langue japonaise plus que toute autre s'est efforcée de
rendre les nuances par une multitude d'onomatopées (Japon !
Au pays des onomatopées, par Pierre Ferragut, Ilyfunet). "
Voix " de la nature auxquelles les haïkistes (amateurs de poèmes
à l'expression courte, fulgurante, pour épingler le fugitif, les
haïkus) ne sont pas insensibles. Basho (1643- 1694), le maître
du genre, saisit par exemple l'essence de l'été nippon par ces
quelques mots : " Le silence. Vrillant le roc. Le
chant des cigales. "
Sur les quelque 2 000 espèces de
cigales à travers le monde, une trentaine existent au Japon dont
cinq sont les plus communément observées à Tokyo. L'étranger, à
moins qu'il soit connaisseur ou qu'il ait l'oreille musicale, ne
distinguera guère de différence dans le chant des différentes
espèces. Sans aller jusqu'à penser, à la suite du
neurobiologiste Tadanobu Tsunoda, dans les années 1970, que le
cerveau japonais perçoit le chant des cigales comme un langage,
beaucoup de Japonais le différencient néanmoins si bien qu'ils
paraissent surpris que l'on puisse être aussi sourd à ces "
évidences " acoustiques.
Niinii-zemi (Platypleura
kaempferi), explique-t-on à l'ignare, est la première des
espèces de cigales à entonner son " hymne à l'amour ", mais son
chant serait quelque peu monotone ; abura-zemi (Graptopsaltria
nigrofuscata), la cigale la plus commune à Tokyo, fait,
elle, " jin-jin " - un peu comme un bruit de friture (d'où son
nom abura, qui signifie " huile " et semi ou
zemi " cigale ") ; higurashi (Tanna japonensis) ne
chante que dans l'après-midi et préfère le feuillage dense des
cryptomerias, et minmin-zemi (Oncotympana maculaticolis)
a un chant particulier dont le tempo progresse : "
miin-miin-min-min-miiiiin ". Le chant le plus complexe serait
celui de la cigale tsukutsuku-boshi (Meimuna opalifera)
qui intervient en fin de saison peu avant l'automne... Une
sixième espèce, kuma-zemi (Cryptotympana facialis), la "
cigale-ours " en japonais en raison de sa grosseur, rare
autrefois à Tokyo, envahit désormais la capitale de son "
chan-chan-chan "....
Il faudra s'aiguiser l'ouïe et faire
preuve d'une certaine patience avant de distinguer, non sans
moue dubitative, dans ce qui semble une stridente cacophonie le
chant des différentes espèces...
Il y a certes, dans les
villes japonaises, bien d'autres bruits que le chant des
cigales, et quand le citadin se coupe de ce brouhaha, sinon de
cette agression (annonces, musiques...), c'est pour se réfugier
dans son propre paysage sonore avec un pod walk.
Il se
prive ainsi du bruit des " averses de cigales ", qui rappelle
que l'été est là et que des failles du béton sourd encore un peu
de nature.
Combien sont-ils ?? Dernières
estimations !
La semaine dernière, une équipe de
chercheurs japonais annonçait avoir découvert une nouvelle espèce
d'anguille près d'une île de l'archipel de Palau, dans le Pacifique. Un
évènement pas si rare (note de M. Soula : je décris une nouvelle
Pelidnota aujourd'hui même !!) tant notre connaissance des espèces
reste finalement très incomplète. En fait les scientifiques ne savent
pas combien d'espèces d'animaux et de végétaux peuplent notre
bonne vielle Terre. Un recensement qui vient d'être effectué avec des
universitaires américains et canadiens évalue à
8,7 millions le nombre d'espèces vivantes sur la planète, dont
6,5 millions sur la terre ferme et 2,2 dans les océans, les mers, les
fleuves, les lacs. Des chiffres imprécis, basés sur des
extrapolations, mais qui s'approchent sans doute plus de la réalité que
certaines estimations passées, assure Philippe Bouchet, spécialiste de
la question au MNHN. "Jusqu'aux années 1980, on avait décrit environ
1,5 millions d'espèces et on pensait qu'il en restait à peu près autant
à découvrir" explique-t-il.
"Puis on a pris conscience de
l'immense diversité des insectes vivant dans les forêts tropicales. Du
coup, jusqu'aux années 1990, tout le monde s'est laissé un peu allé et
les chiffres ont enflé : de 30 à 100 millions d'espèces ! Par la suite,
on a réévalué à la baisse la quantité de ces insectres tropicaux et donc
le total".
Un autre chiffre est en revanche sûr, c'est celui des
espèces menacées d'extinction : 19625 delon l'UCN (note de M. Soula :
une telle précision paraît ridicule !), mises en danger par la chasse,
la pêche, la cueillette, la pollution, l'exploitation intensive des
ressources et le manque de place.
Madame "Guêpes" tombe sur un monstre :
Dans les montagnes Mekkonga, à Sulawesi, en pleine forêt équatoriale humide,
une expédition de 67 personnes (entomologistes états-uniens et indonésiens et
leurs porteurs) a rebroussé chemin au bout de 3 semaines, à court de vivres mais
riche d’au moins une découverte extraordinaire.
Celle d’un Hyménoptère
Crabronidé (un sphégien) du genre Dalara, caractérisé par des mandibules
recouvrant la tête au repos et qui s’avèrent, une fois ouvertes, plus grandes
que les pattes antérieures, chez le mâle. La taille de la bête est également
impressionnante : 8,4 cm pour le mâle, un peu moins pour la femelle – des
mensurations qui dépassent largement celles des autres Lariinés, des « guêpes »
carnivores, prédatrices d’insectes.
Cette espèce nouvelle pour la science,
dont la biologie n’est pas connue, recevra le nom de garuda, d’après un
féroce et mythique guerrier, symbole de l’Indonésie.
À l’initiative et à la
tête de l’expédition, Lynn Kimsey, directeur du Bohart Museum of Entomology et
professeur d’entomologie à l’université de Californie, à Davis (Etats-Unis).
Madame Guêpes, localement « Wasp Woman », a déjà décrit plus de 300 espèces
nouvelles. Elle estime que les captures réalisées lors des 3 campagnes de
prospections menées à Sulawesi livreront plusieurs centaines, voire milliers
d’espèces nouvelles – dont la description prendra de nombreuses années.
Une bactérie bien utile pour lutter contre la dengue :
Des chercheurs ont réussi à créer une population de moustiques
résistants au virus de la dengue: une nouvelle stratégie pour stopper la
transmission de cette maladie.
Des moustiques Aedes aegypti, vecteurs de la dengue. (AFP)Le virus de la dengue,
une maladie qui toucherait au moins 50 millions de personnes chaque année, est
transmis par un moustique, Aedes aegypti. Comme il pique le jour, les
moustiquaires autour du lit ne sont pas efficaces pour se protéger. Et contre
les insecticides les moustiques développent des résistances. Une autre méthode
permettrait de lutter efficacement contre les moustiques vecteurs de la maladie
: remplacer les populations existantes par des Aedes aegypti résistants au
virus. C’est ce qu’ont réussi à faire des chercheurs australiens, qui publient
leurs résultats aujourd’hui dans la revue Nature.
Scott O’Neill et ses collègues (Monash University, Melbourne, Australie) ont
utilisé une bactérie du genre Wolbachia pour parvenir à leurs fins. Ces
bactéries sont bien connues pour leurs capacités à vivre dans les cellules de
différents insectes –mouches, guêpes, moustiques… Chez certaines espèces de
moustiques, Wolbachia rend les femelles stériles. Chez d'autres invertébrés, la
bactérie manipule la reproduction de son hôte afin d’augmenter ses chances
d’être transmise par les femelles à la génération suivante.
Les chercheurs australiens ont réussi à introduire chez A. aegypti une souche de
Wolbachia qui les rend résistants au virus de la dengue.
De précédents travaux (publiés en 2009) avaient montré qu’une souche de
Wolbachia infestant les mouches drosophiles pouvaient bloquer l’infection par la
dengue chez le moustique. Problème : la durée de vie du moustique était
sérieusement écourtée, réduisant ses chances de s’implanter dans un habitat
naturel. Cette fois-ci, O’Neill et ses collègues ont trouvé une souche de
Wolbachia qui bloque l’infection virale sans entamer la longévité de l’insecte.
Les mécanismes permettant cette résistance demeurent méconnus.
Après la mise au point d’un protocole et d’un accord avec les autorités, les
chercheurs australiens ont mené un essai grandeur nature, relâchant près de
150.000 moustiques résistants à la maladie dans des zones du Queensland touchées
par la dengue. L’infestation par la bactérie s’est rapidement répandue au sein
de la population d’A. aegypti, atteignant 80% et frisant les 100% sur certains
sites.
Reste à tester cette stratégie dans des pays très touchés par la dengue,
notamment des pays d’Asie où sévissent des formes de dengue hémorragique
mortelles. Des méthodes similaires sont testées contre le paludisme avec la mise
au point d'un moustique transgénique bloquant la réplication du parasite.
Polémique sur la stratégie de lutte contre la
chrysomèle du maïs :
 Repérée
pour la première fois en Europe en 1992 près de l'aéroport de Belgrade, la
chrysomèle du maïs n'a depuis cessé de progresser sur le vieux continent,
notamment à la faveur de plusieurs introductions successives depuis les
Etats-Unis. En Europe centrale, les dégâts occasionnés par l'insecte peuvent
aggraver considérablement les pertes de rendement dues au stress météorologique. Repérée
pour la première fois en Europe en 1992 près de l'aéroport de Belgrade, la
chrysomèle du maïs n'a depuis cessé de progresser sur le vieux continent,
notamment à la faveur de plusieurs introductions successives depuis les
Etats-Unis. En Europe centrale, les dégâts occasionnés par l'insecte peuvent
aggraver considérablement les pertes de rendement dues au stress météorologique.
En France, Diabrotica virgifera a été piégée en 2002 seulement, à proximité des
aéroports parisiens. Une politique drastique d'éradication, impliquant des
traitements insecticides et un abandon temporaire de la culture du maïs dans un
rayon proche, assortis d'une surveillance renforcée alentour, a porté ses fruits
dans ces points d'entrée. Mais ailleurs, en Alsace et Rhône-Alpes, ces mesures
n'ont pas suffi à enrayer l'installation durable de l'animal.
C'est pourquoi dans ces zones, à la fin de la saison 2010, les pouvoirs publics
ont défini avec la filière maïsicole une nouvelle stratégie, dite de
confinement. Un décret prévoit une rotation de la culture du maïs une fois tous
les six ans sur les parcelles concernées, et le recours à des traitements
larvicides lors du semis, et non plus l'épandage d'insecticides sur les adultes,
jugé inefficace, polluant et très critiqué par les riverains et les apiculteurs.
VIVRE AVEC L'INDÉSIRABLE
"Cette nouvelle stratégie découle du constat d'échec de certaines tentatives
d'éradication", indique Céline Duroc, directrice adjointe de l'Association
générale des producteurs de maïs (AGPM). L'objectif est de vivre avec
l'indésirable, en maintenant sa population à des seuils n'engendrant pas des
dégâts trop importants. Pour l'heure, les concentrations sont en augmentation
(un millier d'adultes piégés en 2011, dix fois plus qu'en 2010, une "flambée"
dans l'Ain, des détections inédites en Gironde et Dordogne) sans induire des
baisses de rendement.
Cette approche est critiquée par France Nature Environnement (FNE), qui estime
que la rotation une année sur six est très insuffisante pour enrayer l'invasion
et critique le recours aux insecticides. "Il faut conditionner leur utilisation
à une vraie rotation, une année sur deux ou trois, qui fera baisser la pression
de la chrysomèle à une densité supportable", insiste Jean-Claude Bévillard,
vice-président de FNE.
"Le choix d'une année sur six découle d'un compromis socio-économique, entre les
pertes à court terme engendrées par la rotation et à plus long terme par
l'installation de l'insecte", reconnaît Céline Duroc. "Il s'agit d'enclencher
une évolution des pratiques", indique-t-on au ministère de l'agriculture. Dans
le Sundgau alsacien, le maïs représente jusqu'à 70 % des surfaces arables : la
filière n'est pas encore disposée à renoncer à cette quasi monoculture pour un
modèle encore à inventer.
L'été indien a attiré des papillons exotiques au Royaume-Uni :
L'été indien, avec des températures
supérieures à 27 degrés Celsius la semaine dernière, a attiré au
Royaume-Uni des centaines de papillons de nuit méditerranéens et même
tropicaux, a indiqué vendredi l'association Butterfly Conservation.
Certains n'ont plus été vu depuis 130 ans.
Ainsi, la noctuelle
embrasée (Trigonophora flammea), qui réside normalement en Espagne et en
France, a été vue dans le Sussex (sud de Londres). Le nombre de
spécimens, qui n'a pas été observé depuis 130 ans, laisse supposer
qu'une colonie a pu s'installer.
Certains de ces insectes ont été
portés par les vents du sud vers la Grande-Bretagne. Une espèce
tropicale, Spoladea recurvalis, a même été vue pour la première fois
cette année en Irlande et en Ecosse.
Le Sphinx tête de mort, rendu
populaire par le film d'horreur "Le Silence des agneaux", a lui été
repéré dans le Dorset, dans une réserve naturelle ainsi qu'à Plymouth
(sud-ouest de l'Angleterre). Il tient son nom du dessin semblable à une
tête de mort qui apparait distinctement sur son thorax.
Selon
Butterfly Conservation, il s'agit de la plus importante migration
d'espèces depuis cinq ans. La plupart des espèces méditerranéenne ne
passeront toutefois pas l'hiver anglais, prédit l'association.
Butterfly Conservation estime par ailleurs que l'année a été rude pour
les espèces locales de papillons, avec un printemps extrêmement sec. Un
tiers des espèces insulaires ont disparu depuis 35 ans, essentiellement
à cause de la disparition de leur habitat naturel.
 Insectes
artificiels : Insectes
artificiels :
Les OVMI – objets volants mimant les insectes – sont ils
l’avenir de l’entomologie ? Les militaires et les agriculteurs sont intéressés.
D’aucuns pensent que, moyennant quelques progrès technologiques, les insectes
artificiels pourront non seulement exécuter des missions de reconnaissance et
des ennemis mais remplacer les insectes naturels là où ils sont défaillants,
pour polliniser les arbres fruitiers notamment.
Les recherches vont bon train dans les labos et des prototypes volent ou
volettent. C’est le cas notamment du spécimen nommé DASH+Wings(littéralement «
hexapode dynamique autonome étalé + ailes ») construit à l’université de
Californie à Berkeley (États-Unis). L’engin, de quelque 3 pouces de long,
possède 6 pattes et… 3 ailes. Il est incapable de s’envoler mais grâce à sa
voilure vibrante, il est plus agile et peut progresser bien plus vite que son
compère aptère. Notamment sur les substrats rugueux et pentus.
Dans le même labo sont nés Octoroach, un engin grand comme la main, à 8 « pattes
» qui crapahute vaillamment sur le gravier (sur pas plus de 100 m) et BOLT, ailé
et bipède, volant et sautillant.
La Mouche de la navette :
Drosophila melanogaster(Dip. Drosphilidé). Le dispositif
expérimental Commercial CSI-05 (Generic Bioprocessing Apparatus Science
Insert-05) prendra le vol STS-134 de la navette Endeavour le 29 avril pour
rejoindre l’ISS (Station spatiale internationale). Dans ce CSI-05, 2 néphiles et
des drosophiles.
Nephila clavipes (Aran. Néphilidé), d’Amérique centrale, est une grande araignée
(la femelle, le mâle est 5 fois plus petit) qui fabrique une toile d’1 m de
diamètre, dorée aux fils bien collants, dans la forêt ; des colibris s’y font
prendre. Les néphiles ont une mission, tisser ; les spatioarachnologues vont
observer si et comment la quasi-absence de gravité modifie la construction du
piège.
Les drosophiles ont deux missions. Comme leurs compagnes de voyage, elles se
laisseront observer en train de voler – mission entomologique. Mais ce qui leur
vaut leur billet pour ce voyage (aller simple), c’est celle de nourrir
proprement les tisseuses. La précédente expérience (avec Larinioides patagiatus
et Metepeira, vol STS-126), s’est achevée piteusement en 6 jours. Elles ont en
effet petit à petit sali la paroi transparente de la cage si bien qu’on ne
pouvait plus rien observer. Pour ce coup, elles seront élevées à part et
fournies à leurs consommatrices par escouades successives par le personnel de la
station, tous les 4 jours. L’expérience, suivie au sol par des étudiants qui
mènent des élevages parallèles, devrait durer quelque 45 jours.
La petite mort sur bouteille !
Beaucoup de coléos se font piéger par des bouteilles
abandonnées sur les bas-côtés et y meurent faute d’en avoir pu gagner la sortie
: (re)lire La mort en bouteilles, par Bruno Didier, dans Insectes n° 132
(2004-1).
Un bupreste mâle australien Julodimorpha bakervelli prend, lui, une bouteille de
bière (370 ml, verre brun, avec des granulations en léger relief près du fond)
pour partenaire sexuel. Il s’installe dessus, déploie son édéage (fort long) et
après force tentatives (vaines) choit, épuisé.
Deux entomologistes spécialistes de la sélection sexuelle, alertés par une
photo, ont observé le phénomène les 12 et 13 septembre 1981. Ils précisent que
ces coïts déviants sont courants, pour peu que la bouteille présente les
caractéristiques susmentionnées. En fait, pratiquement toutes les bouteilles
conformes sont honorées. Notre bupreste phialophile n’y voit que la texture de
surface, le brillant et la couleur. C’est une pratique à risques : son appareil
copulateur est assez long pour donner prise à de nombreuses fourmis qui peuvent
finir par le boulotter en entier.
Publiés il y a une trentaine d’années, ces observations ont valu à leurs
auteurs, Darryl Gwynne et David Rentz, le prix IgNobel de biologie, remis le 29
septembre à Harvard (États-Unis).
Recolorisation :
Les insectes fossiles nous parviennent décolorés ou tout au
moins avec des couleurs très modifiées – un peu comme les vieilles diapos. Dans
le cas des couleurs physiques, structurelles, dues à des arrangements
microscopiques de détails des couches superficielles de la cuticule et non à des
pigments, il est désormais possible de retrouver l’aspect du vivant. En
associant la microscopie et un traitement informatique ad hoc, Maria McNamara et
son équipe ont pu retrouver l’aspect originel de restes vieux de 15 à 47
millions d’années retrouvés en Idaho (Etats-Unis) et en Allemagne, entre autres.
On a ainsi accès à un caractère qui joue un grand rôle dans l’écologie des
insectes, pour la reconnaissance des proies par les prédateurs et du partenaire
sexuel au sein de l’espèce. Jusqu’où pourra-t-on remonter ? L’œil « d’insecte »
serait apparu il ya quelque 520 millions d’années, durant l’explosion
cambrienne, chez des prédateurs chassant désormais à vue.
Crever de peur :
Les larves de Leucorrhine mouchetée (Leucorrhinia intacta, Odon. Libellulidé)
sont sensibles à la vue et au goût de leur prédateur au point d’en mourir. À
l’université de Toronto, on les a élevées dans le même aquarium que le poisson,
leur ennemi, mais hors d’atteinte de ce dernier. De façon surprenante, leur
mortalité a été 2,5 à 4,3 fois supérieure à celle des témoins, probablement
causée par des infections. Lors d’une seconde manip, on a compté 11% d’échec de
la métamorphose, contre 2% chez les individus non stressés.
Les auteurs de ce travail estiment que tous les animaux peuvent être victimes de
stress et proposent leur expérience comme modèle de futures études sur le rôle
du stress en dynamique des populations.
Faire du sport :
L’été (en janvier) à Brisbane (Australie), sont organisées
des courses de cafards (14 épreuves dans la journée) devant 7 000 spectateurs
qui éliront, une fois les concurrents départagés et remis dans leur élevage,
Miss Cocky qui sera l’ambassadrice de l’épreuve pendant un an. Si l’on ne
dispose pas de ses propres bêtes de course, on peut en acheter sur place au prix
de 5 $. La discipline est pratiquée également aux États-Unis.
Les Japonais sont classiquement friands de combats de kabutomushi, Allomyrina
dichotoma(Col. Scarabaeidé). On y fait aussi se battre à mort – et l’on poste
désormais la video sur Internet – des mille-pattes, des grillons, des mantes…
Suscitant diverses réactions.
En Chine, le combat de grillons, organisé à l’automne, a ses règles, ses
accessoires et ses trucs. Le dernier à la mode : la veille du combat, fournir au
combattant – qui s’en trouvera réjoui et revigoré - une grillonne (ou plusieurs)
et les laisser se connaître.
Sport universitaire, le cracher de grillons (Achaeta domestica, Orth. Gryllidé),
est codifié depuis 1996. Le règlement stipule que les insectes sont
préalablement congelés.
Ressortissant au parascolaire rural, le « tour de France » consistait à faire se
mesurer des sauterelles lors d’une épreuve de marche. Sur 4 pattes, les« cuisses
» ayant été arrachées.
Piqûre de scorpion : Une jeune femme paralysée
Une habitante des
Bouches-du-Rhône est paralysée du côté gauche, après avoir été piquée par un
scorpion.
 Caroline
Emma Gallego, 26 ans, employée du magasin de décoration Casa de
Cabriès, dans les Bouches-du-Rhône, a été victime d’une piqûre
de scorpion le 14 octobre. Ce jour-là, la petite bête s’était
cachée dans les stocks du magasin de décoration, à Cabriès dans
les Bouches-du-Rhône. Comme elle le raconte elle-même, elle
s’est retrouvée nez à nez avec l’animal alors qu’elle
s’apprêtait à étiqueter des tasses en provenance de Chine. Caroline
Emma Gallego, 26 ans, employée du magasin de décoration Casa de
Cabriès, dans les Bouches-du-Rhône, a été victime d’une piqûre
de scorpion le 14 octobre. Ce jour-là, la petite bête s’était
cachée dans les stocks du magasin de décoration, à Cabriès dans
les Bouches-du-Rhône. Comme elle le raconte elle-même, elle
s’est retrouvée nez à nez avec l’animal alors qu’elle
s’apprêtait à étiqueter des tasses en provenance de Chine.
Elle a alors retenu un cri, histoire de ne
pas affoler collègues et clients. Mais elle a bien senti «
un gros coup de chaleur » quand le scorpion est passé sous
son poignet. Elle est rapidement prise de vomissements, son
poignet enfle, elle est transférée à l’hôpital à Marseille.
«
Les gens étaient sidérés par mon accident, d’autres venaient
me voir en rigolant, en disant que ce n’était pas possible.
» Depuis, ses séjours à l’hôpital Nord de Marseille se
multiplient, mais la jeune femme n’est pas guérie pour autant. «
En vingt minutes, j’ai alors perdu la sensibilité et la
mobilité de la main gauche. Un quart d’heure après, c’était
l’avant-bras gauche », confie-t-elle. Un choc allergique a
ensuite paralysé sa cuisse gauche, et elle souffre également de
photosensibilité aiguë. A ce jour, l’animal n’a pas encore été
retrouvé dans le magasin. Une équipe de spécialistes est à sa
recherche, selon la directrice des ressources humaines du groupe
Casa.
Un laboratoire national
d'entomologie à Quillan :
 "C’est le seul laboratoire d’entomologie
qui a été créé cette dernière décennie”, avoue Thierry
Noblecourt, le responsable. Et il se trouve à… Quillan, petite ville de
la haute vallée de l’Aude. Le laboratoire national d’entomologie
forestière de l’ONF (Office national des forêts) remplace la cellule
entomologique qui était implantée depuis 1997. Il comprend trois
permanents, 40 000 échantillons de collections, et assure une double
mission : "Comme un bureau d’études, nous réalisons des
inventaires à la demande, cela peut être pour l’INRA, le CNRS, le Muséum
national d’histoire naturelle… Notre deuxième activité est notre
inventaire des réserves ONF, notamment des coléoptères sacroxyliques,
qui se nourrissent de bois mort. Pour cela, nous identifions les
vieilles forêts. Même si nous œuvrons sur toute la France grâce à notre
réseau de vingt-quatre entomologistes de référence, nous travaillons
toujours sur les Pyrénées, des forêts d’Aspe à celle de la Massane, via
celles de l’Aude", explique Thierry Noblecourt. "C’est le seul laboratoire d’entomologie
qui a été créé cette dernière décennie”, avoue Thierry
Noblecourt, le responsable. Et il se trouve à… Quillan, petite ville de
la haute vallée de l’Aude. Le laboratoire national d’entomologie
forestière de l’ONF (Office national des forêts) remplace la cellule
entomologique qui était implantée depuis 1997. Il comprend trois
permanents, 40 000 échantillons de collections, et assure une double
mission : "Comme un bureau d’études, nous réalisons des
inventaires à la demande, cela peut être pour l’INRA, le CNRS, le Muséum
national d’histoire naturelle… Notre deuxième activité est notre
inventaire des réserves ONF, notamment des coléoptères sacroxyliques,
qui se nourrissent de bois mort. Pour cela, nous identifions les
vieilles forêts. Même si nous œuvrons sur toute la France grâce à notre
réseau de vingt-quatre entomologistes de référence, nous travaillons
toujours sur les Pyrénées, des forêts d’Aspe à celle de la Massane, via
celles de l’Aude", explique Thierry Noblecourt.
De
gauche à droite: Thierry Noblecourt, responsable du laboratoire,
Fabien Soldati et Thomas Barnuin, entomologistes spécialisés. ©
Laboratoire National d'Entomologie
Forestière.
Biodiversité : toutes les espèces
méritent-elles d'être sauvées ?
Un sondage réalisé
auprès de quelque 600 biologistes met en évidence une hétérogénéité
autour de la question de la conservation des espèces. Si les
scientifiques s'accordent pour dire que l'Homme est responsable du
déclin de la biodiversité, leurs avis divergent sur la façon de la
préserver.
Faut-il tenter de sauver toutes les
espèces en danger d'extinction ? Et si oui,
dans quelle mesure ? C'est peu ou prou la teneur du sondage réalisé par
Murray Rudd, auprès d'environ 600 chercheurs ayant récemment publié des
travaux en rapport avec la biologie de la conservation.
Alors que la toute dernière version de la
liste rouge de l'UICN, qui recense le statut
de nombreux être vivants, vient d'être publiée, l'étude de Murray Rudd
s'interroge sur la pertinence des méthodes de conservation de la
biodiversité.
Pour cela, il
a effectué une liste de 1.826 biologistes qui ont publié des travaux en
relation avec la biologie de la conservation. Parmi ceux-ci, 583 ont
répondu entièrement au sondage et c'est sur ces réponses que l'analyse
de Murray Rudd repose. Les résultats sont parus dans
Conservation Biology.
L'ours polaire est une espèce menacée (dans la
catégorie « vulnérable » de la liste rouge de l'UICN). Les efforts de
conservations le concernant doivent-ils être revus ?
L'activité humaine réduit la diversité
génétique
Aux chercheurs, il adressait en
substance les questions suivantes : jusqu'à quel point la communauté
scientifique doit-elle tenter de sauver les
espèces en danger d'une extinction ? Faut-il
faire une sélection parmi les espèces que l'on choisit de protéger ou,
en d'autres termes, certaines ont-elles plus de valeur que d'autres ?
Comment doit-on s'organiser afin de
préserver la biodiversité ?
Autour de ces thèmes, les sondés devaient indiquer
s'ils étaient d'accord ou pas avec des suggestions qui leur étaient
faites. Et le moins que l'on puisse dire est que les réponses sont assez
hétérogènes, reflet d'une claire dissonance au sein de la communauté
scientifique.
Si la
quasi-totalité des sondés s'accorde à dire que la biodiversité en
général a tendance à se dégrader, et ce pour des raisons anthropiques
principalement, ils ont en revanche des avis différents quant aux moyens
à mettre en place et aux espèces à privilégier.
Les scientifiques interrogés considèrent que
l'activité humaine est responsable du déclin de la diversité génétique.
© Futura-Sciences, d'après Murray Rudd, 2011, Conservation Biology
Concentrer les efforts sur certaines espèces
Sélectionner certaines espèces à protéger plutôt que
d'autres, en se fondant sur des critères économiques (services),
écologiques ou plus subjectifs encore, est appelé le triage. Et
concernant la pertinence d'un éventuel triage, les scientifiques ne sont
pas unanimes.
Par exemple, environ 60 % d'entre eux considèrent
qu'il faut mettre l'accent sur quelques espèces, quitte à en laisser
d'autres disparaître et un peu plus de 40 % des scientifiques interrogés
estiment que les espèces doivent être sélectionnées en fonction de
l'argent qu'elles pourraient apporter et qui servirait à financer
d'autres programmes de protection. Ces heureuses élues sont qualifiées
d'espèces icônes.
Sur la question du triage, près
de 60 % des chercheurs sont d'accord (ou profondément d'accord) qu'il
faut mettre en place des critères. © Futura-Sciences, données Murray
Rudd, 2011,
Conservation Biology
Cependant, près de la moitié
des chercheurs sondés pense qu'on ne peut pas se permettre de se
focaliser sur certaines espèces tant que le rôle exact des espèces au
sein des écosystèmes n'est pas clairement connu.
Or, c'est un peu la stratégie actuelle. Certains
animaux comme le
panda ou le
tigre, qui ont un fort impact émotionnel sur
le grand public, font partie des espèces qui permettent de récolter
beaucoup de financements (du public justement) pour les campagnes de
protection. Mais si ces critères finissaient par sauter ou bien s'ils
étaient modifiés (pour des espèces dont la conservation a davantage de
chance d'aboutir), les efforts de conservation les concernant pourraient
s'amoindrir, menant à leur inéluctable disparition.
Le débat reste donc ouvert...
Les scientifiques doivent-ils faire des efforts pour
sauver le panda d'une éventuelle extinction ?
OK, le panda est charmant, mais il passe son
temps à grignoter des bambous. En revanche, l'abeille transporte le pollen de
milliers de fleurs : le choix est vite fait, quand on n'est pas chinois !!!
A bois racourci !
Décembre 2011 : Les sénateurs
brésiliens viennent de voter à une grande majorité un nouveau code
forestier qui restreint le nombre de réserves légales et vide de leur
contenu les zones de protection permanente. Selon le WWF, cela se
traduira par une perte forestière de 75 millions d'hectares. Et ils ont
mis en prison notre collègue belge pour 10 malheureux papillons !
Un insecte très
suspect (c'est le cas de le dire !!) :

Sur un papillon fossile, des couleurs vieilles de 47 millions
d'années :
Des chercheurs
ont retrouvé les
couleurs originelles d'un
papillon datant de 47 millions d'années et dont le
fossile a été découvert en
Allemagne. Une reconstitution qui donne des indications sur le
mode de vie du
lépidoptère et sur l'évolution
des traits en relation avec la communication.
Un peu à l’image d’un vieux film
auquel on tenterait de donner un coup de jeune en y ajoutant de
la couleur, des scientifiques ont rendu ses
teintes vives à un papillon
datant de 47 millions d’années (Éocène), dont le fossile a été
retrouvé en Allemagne. Ce n'est pas un jeu : les couleurs d’un
être vivant, que ce soit un animal ou une
plante,
en disent long sur son
écologie, sa place au
sein d’un
écosystème ou encore sur la
relation qu’il entretient avec les autres individus présents
dans son environnement.
Les couleurs d’une plante peuvent
appâter des
insectes pollinisateurs,
et certains
insectes arborent des teintes
vives pour prévenir d’un
danger ou d’une toxicité,
c'est ce qu’on appelle l’aposématisme (utilisé aussi chez
certaines
grenouilles).
D’autres animaux, et en particulier les
papillons,
empruntent la même apparence que des congénères toxiques,
réalisant ainsi un
mimétisme mullérien. On peut
également citer les phasmes, qui ressemblent à des brindilles ou
à des feuilles et qui peuvent ainsi se
camoufler
dans les végétaux. Les exemples sont nombreux.
 Un des fossiles de papillons retrouvés en
Allemagne et datant de 47 millions d'années. Un des fossiles de papillons retrouvés en
Allemagne et datant de 47 millions d'années.
C’est donc dans le but
de mieux connaître l’écologie d’un lépidoptère fossilisé que des
scientifiques, emmenés par Maria McNamara (université
Yale) ont décidé de lui rendre
ses couleurs. Pour cela, ils ont utilisé différentes techniques
permettant d’analyser les microstructures de l’aile
du papillon. En effet, les
teintes des ailes de lépidoptères sont souvent des couleurs
structurales et non
pigmentaires. C’est-à-dire
qu'elles ne sont pas le fruit de pigments, mais d’un phénomène
optique – une interaction physique entre
lumière et matière. Ici, il
s'agit des microstructures de l’aile, en l'occurrence les
écailles striées qui la composent et qui ne renvoient qu’une
seule longueur d’onde.
Ainsi, grâce à la microscopie
électronique et à des modèles mathématiques fondés sur les
dimensions de l’aile, les scientifiques ont pu déduire les
teintes originelles. Le résultat est assez spectaculaire et
présente des couleurs très vives (bleu, jaune, vert et marron),
ainsi qu’une faible iridescence (changement de couleur en
fonction de l’angle de vue). Ces résultats sont publiés dans
Plos Biology.
Stratégies de communication datant
de 47 millions d'années
Qu’est-il possible
alors de conclure concernant le mode de vie de ce papillon ? On
peut avancer des suppositions. Le vert et la faible iridescence
sont des attraits qu’on retrouve désormais chez des insectes
adeptes du
camouflage.
Toutefois, les teintes vives auraient pu servir de signal pour
des prédateurs potentiels, indiquant une
toxicité (avérée ou prétendue).
Quoi qu’il en soit, ces résultats fournissent des
indications sur l’évolution
des papillons et des stratégies
de communication puisqu’ils suggèrent que soit le camouflage,
soit la capacité à synthétiser des produits chimiques rendant
ces insectes immangeables faisait partie de l’attirail de
défense des papillons il y a 47 millions d’années. Voilà donc un
pas de plus dans la reconstruction évolutive de la
myriade de couleurs qu’arborent
aujourd'hui les papillons.
Besouros invadem cidade, suspendem novenas e causam transtornos no
Piauí :
Moradores de São João do Piauí (a 441 km de Teresina) estão há
uma semana sofrendo com uma praga de besouros que infestou as ruas e
os prédios da cidade. Até as novenas tiveram que ser suspensas na
zona rural do município. Nem Igreja Matriz de São João Batista
escapou.
Segundo o padre Alaércio de Carvalho Souza, a infestação dos
besouros começou depois que caiu uma forte chuva, na madrugada do
dia 12. Desde lá, os insetos vêm causando sérios transtornos a toda
população.
Besouros invadem cidade e causam transtornos no
Piauí
Foto 2 de 3 - Os besouros que infestaram o
município são chamados de besouros cascudos, têm a coloração preto
com verde metálico e medem de 1 cm a 1,5 cm de comprimento Mais
Júnior Lopes/Portal Sanjoaense
“Os besouros mordem e deixam um líquido ácido, que queima como
fogo. A cidade está completamente infestada deles, que, além de
picar as pessoas, deixam um mau cheiro”, contou o pároco, afirmando
que há uma semana vem lutando para diminuir a praga de besouros na
igreja.
Os besouros que infestaram o município são chamados de
besouros cascudos, têm a coloração preto com verde metálico e medem
de 1 cm a 1,5 cm de comprimento.
“Recolhemos uns 10 baldes de
besouros e botamos fogo em todos, mas não sei o que acontece que à
noite eles minam de todos os buracos. De dia, a cidade fica um mar
de besouros. A gente passa o dia varrendo e no dia seguinte mais
besouros aparecem”, disse o padre.
Segundo Souza, a infestação de
besouros vem atrapalhando as celebrações de novenas nas comunidades
rurais, pois “fica impossível rezar com uma nuvem preta de besouros
voando e nos atacando.”
“Eu nunca vi nada igual. Moro há 35 anos
na cidade e nessa época é comum aparecer besouros, mas nesta
quantidade eu nunca vi”, disse a aposentada Maria Fernanda da Silva,
63.
Ela contou que a preocupação maior dos moradores é com as
crianças, principalmente os bebês. “Minha netinha de 4 meses de vida
esta toda picada nas pernas e nos braços, mesmo a gente usando o
mosquiteiro para proteger o berço. Os besouros encostam no
mosquiteiro e quando ela encosta dormindo recebe a picada.”
Prefeitura aumenta limpeza
A Prefeitura de São João do Piauí informou ao
UOL
Notícias que intensificou a limpeza do município para
tentar minimizar a quantidade de besouros. A Secretaria de
Comunicação atribuiu a praga ao desmatamento de áreas rurais e ao
lixo jogado desordenadamente em áreas públicas.
Segundo o
secretário de Comunicação, Osmar Lopes Junior, a Secretaria de
Saúde, Saneamento e Meio Ambiente está realizando ações de
orientação nos postos de saúde para a população se previna das
picadas dos besouros.
“Eles não causam doenças perigosas. Causam
um mal-estar pela queimadura. Nesse período de chuvas, as pessoas
devem evitar jogar lixo nas ruas e esperar a coleta passar para
despejar os restos. Orientamos também que usem mosquiteiros para se
prevenirem das picadas”, informou.
Falta de predadores
Segundo a UESPI (Universidade Estadual do Piauí), a praga de
besouros que infestou São João do Piauí ocorre devido a um
desequilíbrio ambiental, com a deficiência de predadores naturais na
cadeia biológica dos insetos.
O laboratório de biologia da UESPI
explicou uma das possíveis causas é a poluição das águas do rio
Piauí, que acarretou no desaparecimento dos anfíbios, que são
sensíveis aos agentes poluentes.
Segundo o laboratório, a
poluição faz um efeito dominó em toda a cadeia, com a escassez de
girinos (filhotes de sapos) e sapos e o aumento de insetos, que
estão se reproduzindo sem o controle natural.
Le poil
repousse :
Ils
furent 29 à faire don à la science de deux bras. Lesquels, au nom de
la science (entomologique) furent offerts à des
Cimex lectularius
assoiffées, l’un tel quel, l’autre rasé.
Le bras glabre fut
allègrement ponctionné par les hématophages cependant que son
symétrique au naturel fut nettement moins goûté par la Punaise des
lits ; nombre d’entre elles s’empêtrèrent et perdirent du temps à
chercher un passage dans la jungle, bousculant au passage des poils
sensibles. Alertés, les cobayes à sang chaud s’empressèrent
d’écraser les Hémiptères (Cimicidés).
De cette expérience, leurs
auteurs Michael Siva-Jothy de l’university de Sheffield
(Royaume-Uni) et ses collaborateurs tirèrent l’explication de la
préférence des moustiques, des moucherons-qui-piquent, des sangsues
et des tiques pour les poignets et les chevilles de l’Homme, parties
particulièrement mal pourvues en poils durs comme en duvets.
Les insectes souffrent-ils (bis) :
Données comportementales :
Les auteurs de l'article citent une série d'exemples
tirés d'observations qu'ils ont faites personnellement :
- Un criquet continue à manger pendant qu'il se fait
dévorer par une mante religieuse.
- Une mouche tsé-tsé s'envole pour aller se nourrir
alors qu'elle est à moitié disséquée.
- Les mantes religieuses mâles continuent à copuler
alors qu'elles sont dévorées par leur partenaire.
- Des chenilles continuent à s'alimenter pendant que
des larves de tachines les perforent.
- De nombreux insectes poursuivent leurs activités
ordinaires alors qu'ils sont dévorés de l'intérieur par de gros
parasites.
- Des pucerons continuent à manger pendant
qu'eux-mêmes se font manger par des coccinelles.
Les insectes poursuivent leurs activités normales
après avoir été gravement blessés ou après avoir perdu des parties de
leur corps. Ils ne cessent pas de se nourrir ou de copuler suite à des
blessures abdominales générales. Les auteurs rapportent n'avoir jamais
observé chez eux le comportement de protection d'une partie endommagée
du corps.
Un insecte marchant avec un tarse brisé par exemple
l'appuiera sur le sol avec une force inchangée, alors qu'un mammifère
souffrant d'une blessure à une patte se mettra à boiter.
Ces exemples suggèrent que si un sens de la douleur
est présent chez les insectes, il n'a aucune influence adaptative sur
leur comportement puisqu'il n'induit pas la réponse consistant à
protéger la partie blessée jusqu'à ce qu'elle guérisse. Les auteurs
penchent pour la conclusion que la neurobiologie des insectes n'inclut
pas de « programme douleur » (tout en reconnaissant que les
comportements cités n'en sont pas la preuve absolue). En effet, il est
difficile d'envisager qu'il y ait eu sélection naturelle d'une capacité
à souffrir sans qu'existe la capacité correspondante à apporter une
réponse adaptative.
Certains comportements des insectes ressemblent
superficiellement aux réponses d'animaux supérieurs confrontés à des
stimuli douloureux : contorsions d'insectes pris au piège ou empoisonnés
par des insecticides, production de sons ou sécrétions repoussantes chez
des insectes victimes d'une attaque, production de phérormones*
d'alarme... Cependant, il ne semble pas nécessaire d'invoquer une
motivation fondée sur la perception de la douleur pour rendre compte de
tels comportements. La plupart d'entre eux peuvent s'expliquer par des
réflexes suscités par certains types de stimulations : par exemple,
l'activation des circuits neuronaux responsables des comportements de
fuite et de nettoyage comme résultat d'une stimulation mécanique pendant
la manipulation. Ainsi, un très léger toucher à l'extérieur d'une
chrysalide de lépidoptère, qui selon les critères des mammifères ne
serait pas considéré comme nocif, provoque une forte réaction motrice.
D'autres réactions peuvent simplement résulter
d'une activité neuronale anormale. L'hyper-excitabilité, l'ataxie
et les convulsions des insectes empoisonnés par le DDT ou par des
insecticides au pyrèthre par exemple ont été directement attribuées à
des décharges anormales dans certains neurones.
Conclusion :
Les données issues de la prise en compte du rôle
adaptatif de la douleur, de la neurobiologie des insectes et de leur
comportement ne semblent pas plaider en faveur de leur capacité à
ressentir la douleur. Cette conclusion peut probablement s'étendre à
d'autres invertébrés, bien qu'il faille se montrer plus circonspect dans
le cas des céphalopodes et mollusques dont le système nerveux est
beaucoup plus complexe. De façon générale, il convient de rester
prudents, car l'expérience subjective d'un organisme ne peut pas être
directement éprouvée par un autre, et nous ne disposons pas de moyens de
communiquer avec les animaux inférieurs.
On conçoit difficilement un monde où les insectes ne
seraient pas détruits en masse par les humains, à la fois volontairement
et accidentellement. Cependant, la question de la sensibilité a des
implications éthiques, car les expérimentateurs ont à décider de la
façon dont ils traitent les insectes sur lesquels ils opèrent. En la
matière, il est souhaitable que, dans la mesure du possible, les
biologistes inactivent le système nerveux des insectes avant de procéder
sur eux à des expériences traumatisantes. Cette façon de procéder peut
non seulement faciliter la manipulation, mais aussi prémunir les
expérimentateurs contre le risque résiduel d'infliger une souffrance, et
favoriser chez eux une attitude respectueuse envers des organismes
vivants dont la physiologie, bien que différente et peut-être plus
simple que la nôtre, est encore loin d'être entièrement comprise.
Darwin, un collecteur d'insectes passionné :


Darwin was an avid collector of beetles while at Cambridge. Some
of his specimens survive at the Cambridge Zoology Museum.
See some of his original beetle notes
here.
N.B.
Un
excellent site de nouvelles entomologiques diverses (en espagnol) :
http://axxon.com.ar/mus/insectos.htm#noticias
et je rappelle le très sympathique site de notre collègue André Lequet,
bourré d'anecdotes dans le même esprit que cette présente rubrique :
http://perso.orange.fr/insectes.net/index.htm
Et énormément d'articles et de renseignements sur le site de nos
collègues de l'OPIE :
http://www.inra.fr/opie-insectes
J'invite mes amis entomologistes et tous les visiteurs du site à m'envoyer
quelques histoires ou textes intéressants (et si possible savoureux) que je ne manquerai pas de publier
aussitôt dans
cette rubrique.
Marc Soula
|